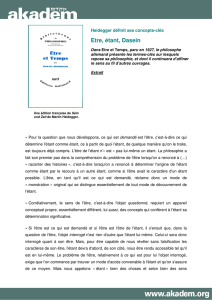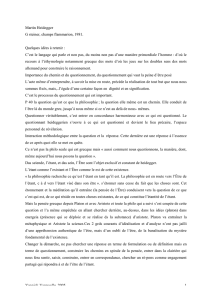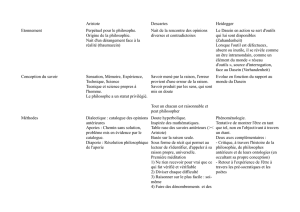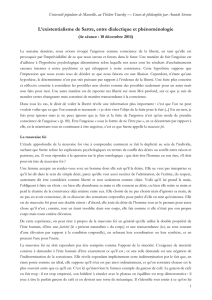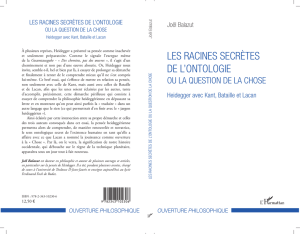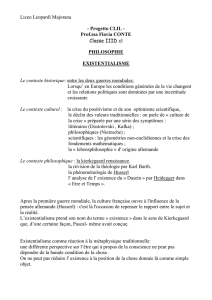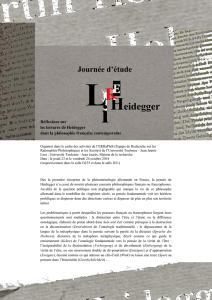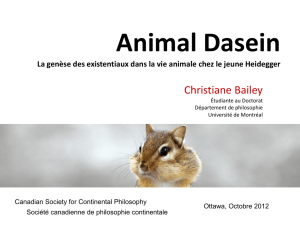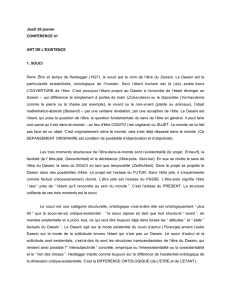Ontologie et anti-humanisme

1
Ontologie et anti-humanisme
« L’être supprime le faire. »
Fichte, Doctrine de la science nova methodo
Nous nous proposons d’établir que la notion d’homme est incompatible avec
l’ontologie, en partant d’une opposition entre Sartre et Heidegger. En effet, d’un côté
nous trouvons une démarche qui se dit ouvertement humaniste, de l’autre une
défiance à l’égard de cette tendance. Mais d’où vient cette méfiance pour la notion
d’homme et l’humanisme qui s’en fait le défenseur ? Faut-il se contenter d’invoquer
une question d’affinités électives ? Ou au contraire, restreindre cette opposition à un
différend lexical, l’un parlant d’homme et l’autre de Dasein ? Nous pensons bien
plutôt que le montage heideggérien exclut fondamentalement les valeurs humanistes.
Voire : tout discours sur l’être, fondé sur des principes touchant exclusivement à
l’être, serait incompossible avec un discours l’anthropologique, au sens large d’un
discours qui tiendrait l’homme comme point d’absolu d’un dispositif théorique.
1. Ontologie et anthropologie
L’ontologie peut-elle prétendre rendre compte de la situation de l’homme ? La
lecture sartrienne de Heidegger semble ajouter à l’être une détermination vécue par
l’homme : celui-ci éprouve l’être comme un trop-plein. Nous entretiendrions une
relation étouffante avec l’être qui sature notre situation. En ce sens, l’en-soi
désignerait la plénitude de l’être dont serait porteuse toute chose, comme
l’emblématise La Nausée : « La chose, qui attendait, s'est alertée, elle a fondu sur
moi, elle se coule en moi, j'en suis plein. » L’être témoigne ici d’une hostilité à l’égard
de l’homme qui se retrouve empli d’être. La conséquence d’une telle saturation de
l’homme par l’être est qu’il faut ménager la place de l’homme, tant au sens spatial de
lui conférer un lieu protégé des attaques de l’être, qu’au sens figuré de le maintenir
comme centre de l’attention philosophique. La Nausée évoque à cet égard
l’indépendance de l’homme par rapport à l’être : « J'existe. C'est doux, si doux, si lent.
Et léger : on dirait que ça tient en l'air tout seul. » Sartre fonde cette idée sur le fait
que de l’être ne peut advenir autre chose que de l’être : « L’être ne saurait engendrer

2
que l’être ».
1
Cette place de l’homme, Sartre la ménagerait par l’introduction d’un
second principe, distinct de celui de l’être. Il s’agit de la liberté humaine comme
négation : « l’homme est l’être par qui le néant vient au monde. »
2
Mais comment concilier ce principe avec celui de l’être ? De cette question
dépend la pertinence du discours ontologique à rendre compte de la situation de
l’homme. Or, dans la mesure où la liberté est négation, la solution de Sartre fait
entrer en opposition le principe de l’être et le principe qui définit l’homme. C’est ainsi
que la conscience est néantisation de l’être : « il faut qu’il soit conscience de cette
coupure d’être ».
3
Or, cette réponse nous semble problématique pour l’ontologie
dans la mesure où la conscience nous fait passer du champ strictement ontologique
– celui de l’être – à un champ anthropologique (au sens large) – celui de l’homme. Et
ce glissement résulte de deux postulats que nous pourrions ainsi résumer : l’être
sature le monde de l’homme ; l’homme doit être revalorisé comme principe de
modification de l’être. En un certain sens, l’être est redouté autant que l’homme est
honoré. Plus précisément, l’homme est redoré parce que l’être ne cesse de le ternir.
C’est pourquoi nous constatons que la considération de la dignité humaine tend à
restreindre les droits de l’ontologie. En l’occurrence, la facticité humaine est
reconduite à une corrélation entre philosophie et sciences humaines (l’homme
sartrien de L’Etre et le néant devenant objet tour à tour de psychanalyse, d’histoire et
de la discipline anthropologique).
Heidegger incarne à l’opposé la possibilité d’un discours qui ne serait
qu’ontologique. A quelle condition l’ontologie n’a-t-elle plus à être supplémentée par
l’anthropologie ? C’est que l’ontologie heideggérienne est marquée par une
connivence entre le sujet et l’être, ce dont atteste le fait que ce sujet est le Dasein,
c'est-à-dire l’homme pris dans son rapport à l’être. Reste à déplier ce rapport.
2. L’enjeu de la différence ontologique
Que ce rapport qui unit le Dasein à l’être puisse être saisi à partir de la
différence ontologique – en tant que différence de l’être et de l’étant –, cela
s’explique doublement. D’une part, c’est par cet « événement fondamental » que
1
Sartre, L’Etre et le néant, 1943 Gallimard « Tel », page 59
2
Sartre, ibid.
3
Ibid., page 63

3
nous sommes constamment rapportés à l’être ; d’autre part – et par conséquent –,
c’est par cet événement que le Dasein est ce qu’il est, c'est-à-dire qu’il peut être
l’étant qui peut viser l’être en tant que tel. Or, notre rapport à l’être est un rapport à la
fois d’obligation et d’éloignement. En quoi cette caractérisation nous éloigne-t-elle de
l’anthropologie sartrienne ?
Par la différence ontologique, nous sommes dans un rapport d’obligation avec
l’être : « Notre tenue-de-rapport est toujours de part en part sous le règne de
l’obligatoire ».
1
En effet, notre considération de l’étant nous ramène toujours à
l’obligation d’être auprès de l’être. Et s’il s’agit d’une obligation, c’est parce que cela
ne relève pas d’une décision de la conscience : « Nous nous réglons sur l’étant et
nous ne pouvons pourtant jamais dire ce qui, à même l’étant, est cela qui lie, ni sur
quoi se fonde, de notre côté, cette possibilité d’être lié. »
2
La différence ontologique
manifeste donc que nous sommes constamment convoqués auprès de l’être. Mais
ne retrouvons-nous pas en cela le caractère aliénant de l’être en soi tel que le
conçoit Sartre ? Pourtant, contrairement à celui-ci, Heidegger ne fait pas appel à un
pour soi qui nous libérerait de l’être. En effet, chez Heidegger l’obligation trouve dans
l’être en tant que tel son envers. En quelque sorte, l’être porte en lui-même sa propre
mise à distance.
L’envers de l’obligation est l’éloignement ; la différence ontologique nous
projette constamment loin de l’être : « ce événement qu’est la projection emporte et
éloigne de lui, d’une certaine manière, celui qui projette. »
3
Nous sommes ainsi
constamment repoussés au loin. De ce fait, l’obligation ne nous accule pas contre
l’être (lequel n’est alors plus vécu comme saturation) mais est constamment
distendue par l’éloignement. En ce sens, au modèle de la dignité de l’homme sartrien
s’oppose la distance respectueuse du Dasein heideggérien.
Mais qu’advient-il de la liberté humaine ? La conséquence de cette relation
tendue (entre obligation et éloignement), de cette relation à la fois nécessaire et
distante, c’est ce que Heidegger nomme l’ouverture : « cet élargissement qui met en
suspens et qui lie, qui a lieu principalement dans la projection, présente en soi la
caractéristique du fait de s’ouvrir. »
4
En quoi cette ouverture est-elle un effet de
l’obligation et de l’éloignement, c'est-à-dire de notre rapport à l’être ? Essayons de
1
Heidegger, Concepts fondamentaux de la métaphysique, 1992 Gallimard, page 518
2
Ibid.
3
Page 521
4
Page 522

4
schématiser ce rapport : quand nous étirons (par l‘éloignement) sur une certaine
distance les lignes (de l’obligation), nous obtenons approximativement un espace
rectangulaire. Or, c’est cet espace qui constitue l’ouverture. De ce point de vue, la
liberté devient une conséquence de l’obligation et de la distance. En tant que résultat,
elle s’oppose à la primauté principielle de la liberté sartrienne, précisément parce que
plus que ma liberté importe ma tenue de rapport à l’être. C’est d’ailleurs ce qui définit
le Dasein.
Cependant, le risque que présente la liberté déterminée comme ouverture est
qu’elle soit aussi formelle que le rectangle qui la schématise. C’est ce dont atteste le
fait que la projection nous suspend dans l’ouverture du possible comme telle : « cet
emportement propre à la projection a comme caractéristique de mettre en suspens
dans le possible ».
1
Or, le possible en question n’est ni rapporté au choix, ni à sa
réalisation. Aussi parlerait-on de possibilisation pour en souligner la singularité : « la
projection lie, non pas au possible ni non plus à l’effectif, mais bien à la
possibilisation ».
2
A ce point de l’analyse, la liberté semble être une liberté
condamnée d’être encadrée par l’être.
3. Motricité et mobilité : les deux lignes d’extériorisation
Si nous voulons comprendre en quoi l’ouverture, comme conséquence du
principe de l’être même (et non d’un principe attribué à l’homme), rend possible la
liberté du Dasein, la tâche qui s’impose est la suivante : spécifier cette ouverture en
précisant ce qui nous relie à l’être. Nous voudrions montrer que le Dasein et l’être
sont liés par l’extériorisation comme mouvement qui leur est commun.
En effet, nous pouvons tracer une ligne motrice d’extériorisations. Tout
d’abord, l’être extériorise à travers la projection comme structure de la différence
ontologique. Qu’extériorise l’être ? D’une part, il extériorise l’étant en ce qu’il fait
advenir de l’étant, c'est-à-dire de l’être différencié : « ce qui demeure fermé à
l’entendement courant est précisément la différence qui, finalement et
fondamentalement, rend possible toute différenciation et tout être-différencié. »
3
D’autre part, l’être extériorise le Dasein. En effet, dès lors qu’il fait advenir l’étant, il
1
Page 521
2
Ibid.
3
Page 511

5
fait aussi advenir (au sens d’instituer) cet étant privilégié qui peut demander ce qu’est
l’être : « nous nous trouvons toujours déjà dans la distinction qui a lieu. Ce n’est pas
nous qui l’effectuons : c’est elle qui a lieu avec nous, en tant qu’événement
fondamental de notre Dasein. »
1
Mais ensuite, le Dasein lui-même extériorise, en tant qu’être-au-monde.
Qu’extériorise-t-il ? Le Dasein extériorise le monde, comme l’atteste Etre et temps et
son mouvement analytique qui remonte du monde (dans sa mondanéité, au
troisième chapitre de la première section) à l’être-au-monde (chapitre 4) puis à l’être-
à qu’est le Dasein (chapitre 5). Comptant l’être-à parmi ses existentiaux, le Dasein
apparaît comme la condition d’institution de tout monde. Or, le monde désignant par
la suite la manifestation de l’étant en entier, il est à ce titre une extériorisation de la
projection (laquelle extériorise l’étant) : « la projection est projection de monde. »
2
Il
apparaît ainsi une homologie motrice, instigatrice de mouvement, en ce que tout
extériorise. Nous pouvons donc tracer une ligne d’extériorisation : l’être extériorise
(différencie) l’étant et le Dasein, lequel extériorise (institue) le monde.
Mais à s’en tenir là, ce modèle s’apparente à une chaîne de production où un
terme ne devient actif que lorsqu’il produit à son tour. Or, cette ligne d’extériorisation
se trouve redoublée par une seconde : il ne s’agit plus de ce qui extériorise mais de
ce qui s’extériorise soi-même.
D’une part, l’être s’extériorise : sa détermination comme Temporalität lui
octroie un pouvoir de schématisme qui repose sur les extases de la temporalité. Or,
les extases de la temporalité de l’être s’extériorisent, comme c’est le cas de la
présentification : « Le présent se projette extatiquement dans soi-même en direction
du praesens. »
3
C’est en ce sens que l’être s’extériorise lui-même comme temps :
« Le temps originaire est l’être hors-de-soi lui-même ».
4
Mais cela ne signifie pas que
l’être s’extériorisant devient autre chose que de l’être : l’être extériorise de l’être.
Nous retrouvons l’affirmation sartrienne selon laquelle l’être ne peut donner lieu qu’à
de l’être, à ceci près que Heidegger intercale un mouvement extatique sans lequel
l’être pourrait être dit saturant pour le Dasein. Que l’être extériorise de l’être se
retrouve par la différence ontologique : l’être extériorise de l’étant et du Dasein ; or,
1
Page 513
2
Page 520
3
Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, 1985 Gallimard, page 368
4
Page 321
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%