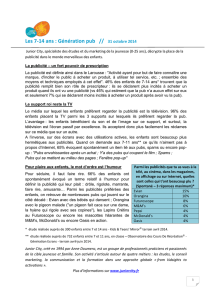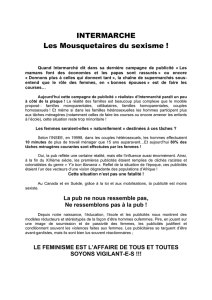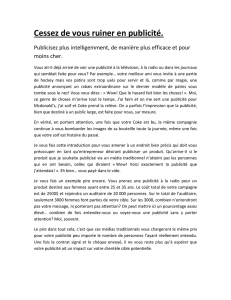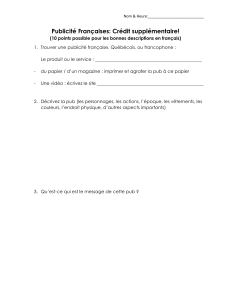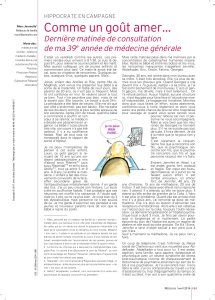La mondialisation est morte, vive la glocalisation

La mondialisation est morte, vive la glocalisation
Emmanuelle Garnaud
collaboration spéciale, La Presse
Mondialisation est le mot le plus à la mode et le plus prisé par les médias des dix
dernières années. Encensé ou dénigré (par les «antimondialisation», justement), le
phénomène n’en finit plus de rebondir, d’être analysé et de générer ses propres contre-
courants.
La publicité et le marketing, qui sont souvent au coeur des tribulations économiques, subissent
évidemment ces tiraillements. Surtout ceux des grandes multinationales, qui doivent gérer des
marques à l’échelle mondiale. Depuis quelques années, un mot réapparaît régulièrement dans les
livres spécialisés: la «glocalisation», contraction de «globalisation» et de «localisation». Être
«glocal» , c’est sans doute la meilleure recette inventée par les Américains pour résoudre les
problèmes de gestion auxquels sont confrontés les Nike, Coke ou McDo de ce monde.
Pendant longtemps, une seule campagne de publicité destinée au monde entier, à quelques
retouches près, permettait d’assurer une présence mondiale. La recette «globalisante» était pleine
d’avantages: quand on amortit le coût du concept publicitaire et de sa production sur une panoplie
de pays, on a plus d’argent à consacrer à l’achat d’espaces publicitaires dans les médias. Économie
d’échelle, contrôle parfait et entier de l’image qu’on veut diffuser, simplicité d’exécution: une pub
pour le monde entier, c’était le paradis des marques! Cette formule a triomphé notamment après la
Seconde Guerre mondiale, période au cours de laquelle les géants américains ont commencé à
transformer leurs marques en fleurons économiques et en outils de conquête. À quoi bon, se disait-
on à l’époque, avoir des publicités locales quand l’Europe tout entière applaudit les GI libérateurs?
Les entreprises comme Coke, McDonald’s ou encore Levi’s n’avaient pas à faire beaucoup d’efforts
pour s’adapter: ce que les gens aimaient alors, c’était justement cette image de l’Amérique que
leurs marques véhiculaient. Une simple traduction suffisait.
Plus tard, les compagnies américaines ont appris à miser sur des valeurs universelles pour ne pas
avoir à créer des pubs différentes pour chaque marché: Nike s’est fait le chantre de la
performance, Coke nous vantait la fraternité entre les peuples réunis autour de sa bouteille (
souvenez-vous des messages à la We are the world!), Benetton faisait la promotion du
multiculturalisme comme une façon de vêtir tous les habitants de la planète de ses chandails
colorés. Aujourd’hui encore, Chanel ne produit qu’une pub pour le No5, tous les deux ou trois ans.
L’Oréal fait des adaptations locales de la même annonce qui sera diffusée partout: «Parce que vous
le valez bien.» En somme, les stratégies publicitaires centralisatrices ne sont pas mortes avec les
manifestations de Seattle, loin de là.
Au Québec, on nage en pleine «glocalisation». À cause du fameux caractère distinct, des plaidoyers
de Jacques Bouchard dans les années 1970, les publicitaires d’ici connaissent bien la bataille du
local contre le global. Sébastien Fauré, vice-président-directeur général de l’agence Cossette à
Montréal vit cette réalité tous les jours. «La glocalisation n’est pas un terme qu’on utilise beaucoup
dans le quotidien d’une agence. Mais c’est quelque chose qu’on utilise tout le temps dans la
pratique: fondamentalement, c’est une question d’équilibre entre une gestion locale et une gestion
centralisée. Ça évolue de la même façon qu’un balancier: ça va d’un côté, puis de l’autre, et je ne
connais pas d’entreprise qui ait trouvé un point d’équilibre et qui s’y tienne depuis très longtemps,
année après année», explique-t-il.
L’agence gère les comptes de trois géants qui se trouvent au coeur du phénomène: Coke, Mc Do et
Nike. L’exemple de Coke est parmi les plus frappants dans l’actualité récente. En effet, la
campagne en dessins animés qui tourne depuis le début de l’été, avec la pub Choix de cours, est
un petit miracle: Cossette était sur le point de perdre le contrat (Coke avait justement décidé de ne
faire affaire qu’avec un seul réseau d’agences, en l’occurence Interpublic), et le département de
création a proposé cette approche, très différente de la l’orientation fixée par le client. «Gérer le
compte de Coke, c’est se trouver dans une partie de Risk, ce jeu où on a des pays à conquérir dans
le contexte d’une bataille mondiale, commente M. Fauré. À un moment donné, Coke peut décider
que la petite zone québécoise, détenue par Pepsi, est un enjeu incontournable: la compagnie
investiera alors massivement et forceront Pepsi à réagir. Il peut même arriver que cet
investissement ne soit qu’une façon de détourner les budgets (des rivaux) d’autres régions qui les
intéressent en réalité davantage.»

En somme, dans cette industrie hyper-concurrentielle, la glocalisation est devenue la règle:
stratégie globale, mais guérilla locale. «Coke est un client très changeant dans son équilibre global-
local. Depuis quelques années, on a senti un grand vent de centralisation et une pression plus forte
pour nous obliger à adapter simplement des pubs conçues pour le monde entier, continue M.
Fauré. Mais, malgré ça, on demeure capable de faire passer des concepts différents, distincts. La
campagne de cet été fait partie de ces exceptions: on a démontré qu’elle avait de meilleurs
résultats que la campagne canadienne ou nord-américaine. Et nous ne sommes pas les seuls. Je
sais que certains pays ont tenté l’approche locale: l’Italie et la France ont par exemple décidé de
plaider des contextes distincts et elles ont pu créer des campagnes locales de publicité.»
De fait, le cas français est étonnant. Depuis des années, l’agence Publicis se contentait de
concevoir, pour le compte de Coke, de vagues adaptations, des annonces sans saveur, à
l’exception de quelques pubs concoctées pour des événements très spéciaux (comme le Mondial de
Foot en 1998). La raison? En France, Coke détient une énorme longueur d’avance sur ses
compétiteurs: rien à voir avec la situation vécue ici. D’où le comportement de leader adopté par
l’entreprise: peu d’investissement en création, beaucoup de promotion et une guerre de
distribution destinée à verrouiller le marché. Mais, en 1999, les ratés se sont succédés: la crise des
cannettes empoisonnées en Belgique, très mal gérée par une direction américaine inconsciente de
la réalité européenne, puis un mariage raté avec la marque favorite des Français, Orangina. La cote
d’amour de Coke s’est effritée, et les ventes avec elle. Au printemps 2001, la compagnie a fait ce
qu’elle n’avait pas fait depuis très longtemps: elle a investi dans une campagne massive, créée en
France et très proche des jeunes du pays, avec des pubs d’une facture très real TV, où
n’apparaissait aucun comédien professionnel.
La campagne a été saluée par les médias spécialisés comme un «bain de Jouvence pour la
marque», loin «des images internationales stéréotypées», pour paraphraser CB News, le magazine
français de la pub, en février 2001. Sébastien Fauré ajoute: «Les stratégies de marque, les
grandes orientations, sont toujours internationales, mais les «opportunités», elles, sont la plupart
du temps d’origine locale. Souvent, la lumière rouge, la sonnette d’alarme, vient du local.» Mais les
positions acquises par l’agence locale demeurent fragiles. «La stratégie de marque, pour des
multinationales comme McDo, Coke ou Nike, est absolument indiscutable. C’est souvent ce qui fait
déborder le vase: le siège social réalise que dans un pays, ses valeurs ne sont pas respectées dans
une pub. En général, la réaction est immédiate, et augure un retour de balancier globalisant!
Après, ces gestionnaires sont généralement mis en pénitence pendant de longs mois», précise M.
Fauré.
Le champion de la glocalisation, c’est McDo. Depuis que l’entreprise a donné le coup d’envoi à sa
conquête de la planète, elle a bien réparti ce qui relève de l’international et du local.
L’international, c’est tout ce qui touche la recette marketing des trois F - pour «food»
(«nourriture»), «folks» («les gens») et «fun» («plaisir») - la promotion, les commandites et les
projets caritatifs. À l’échelle locale, on s’occupe de l’application et de la création culturellement
distincte.
Visionner une vidéocassette des publicités de McDonald’s, c’est faire le tour des régionalismes qui,
parfois, se recoupent grâce à un système généralisé d’échange de publicités. Ainsi, la petite Alice
au téléphone conçue au Québec a été exportée dans une dizaine de pays. «On a exporté certains
spots McValeurs au Portugal, et on est en négociation avec le Danemark pour les mêmes
publicités.»
«Ce qu’on sent chez Mc Do depuis deux ou trois ans, c’est moins un vent de globalisation qu’un
vent de promotion intensive. Du coup, la créativité se remarque moins qu’avec le message Alice ou
celui de la traîne sauvage (les enfants en traîneau qui se croient au paradis), qui ont marqué le
Québec. Mais malgré ces stratégies très contraignantes, on arrive parfois à faire passer de petits
bijoux, comme la couette de la petite fille en forme de M: ce n’était pas une commande, c’est une
idée qui est venue de l’équipe de création, on l’a affichée sur des panneaux et, depuis ce temps-là,
le téléphone n’arrête pas de sonner», explique M. Fauré. Avec McDo, la boucle est donc bouclée: la
pub locale peut devenir universelle et voyager!
Au bout du compte, la seule chose qui peut convaincre une entreprise de décentraliser la création,
c’est le retour sur investissement. Selon Sébastien Fauré, le type d’industrie dans laquelle oeuvre
le client influence également ses stratégies, un détaillant se devant d’être plus à l’écoute des
consommateurs locaux qu’un grand fabricant industriel.

Quant à l’influence des mouvements antimondialisation nés des manifestations ou de la diffusion
de livres comme No Logo, de la canadienne Naomi Klein, elle semble moins importante qu’on ne le
croit, disent les publicitaires. « Les groupes de pression ou les ad busters sont moins importants
que le retour sur investissement. Là où ça peut entrer en considération, à mon avis, c’est quand
une forte opposition, un mini-scandale ou des groupes de consommateurs hostiles émergent dans
un territoire précis: dans ce cas, avec le recul d’une multinationale, la compagnie peut très bien
décider de laisser tomber le marché ou, au contraire, de dépenser plus et d’avoir des stratégies de
communication plus spécifiques pour enrayer le problème», dit M. Fauré.
Ce dernier pense que le «local» ne devrait pas perdre du galon dans les prochaines années.
«Aujourd’hui, être un citoyen corporatif hors pair dans son milieu est plus important qu’être une
grande marque mondiale», dit-il. Devinez comment s’appelle le livre de chevet des militants
antimondialisation, publié par le mouvement ATTAC? «Agir localement, pensez globalement». Très
glocal quoi...
1
/
3
100%