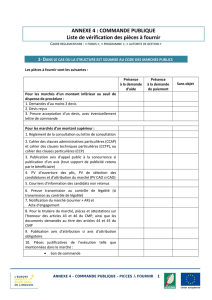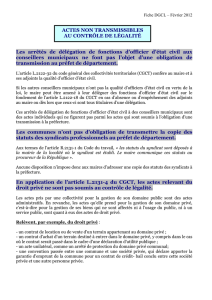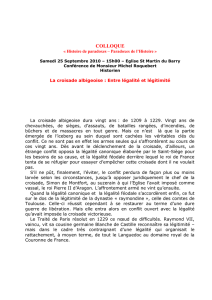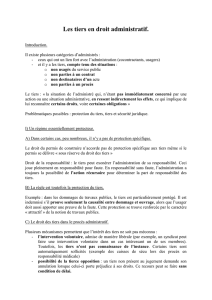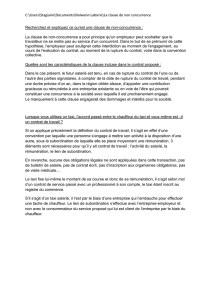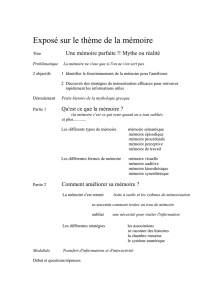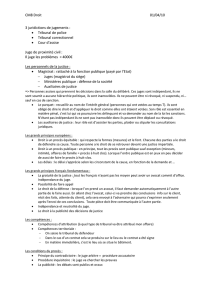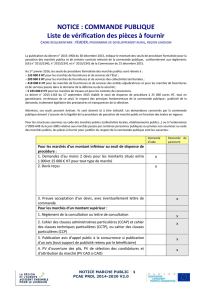9) La loyauté du salarié en arrêt maladie à l`égard de son

1
Institut d'Etudes Judiciaires
PREPARATION E.N.M.
Année 2008 - 2009
EPREUVE D’ENTRAINEMENT : MARS 2009.
NOTE DE SYNTHESE
Rédiger à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages
environ, relative à :
LA LOYAUTE.

2
Note de synthèse : La loyauté
1) Assemblée plén., 27 février 2009
2) Rapport Magendie I, 2004
3) Assemblée plén., 7 juillet 2006
4) La légalité procédurale, L. Cadiet (extrait)
5) Article 1351 C. civ.
6) Article 780 CPC
7) Principes de droit européen des contrats, article 1 :201
8) Principes de droit européen des contrats, article 1 :202
9) La loyauté du salarié en arrêt maladie à l’égard de son employeur par Céline Braz
10) Com., 24 fév. 1998
11) Code de la consommation, L. 212-1
12) Code commerce, L134-4
13) Code civil, 1134
14) Civ. 1ère, 10 mai 1989
15) Manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi sanctionné par un
licenciement abusif, par Agathe Euvrard, Avocate
16) Les clauses de non-concurrence, par Laurent Babin, Avocat.
17) L’arbitrage interne par C. Jarosson
1) Assemblée plén., 27 février 2009
Arrêt n° 573 du 27 février 2009 (07-19.841) - Cour de cassation - Assemblée
plénière
Donne acte à la société Sédéa électronique du désistement de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre
la société Viaccess ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile ;
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas
nécessairement fin de non-recevoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par arrêt irrévocable du 21 avril 2004, la cour
d'appel de Grenoble, statuant en matière de référé, a rejeté la demande formée au printemps 2002 par
la société Sédéa électronique (société Sédéa) et tendant à ce que la société X-Com multimédia, devenue
la société Pace Europe, soit condamnée sous astreinte à lui livrer un certain nombre de récepteurs
numériques de télévision par satellite fabriqués par elle ; qu'aux mois de mai et de juin 2002, la société
Sédéa a acquis de la société Distratel, devenue la société Kaorka, un lot de récepteurs du même type
également fabriqués par la société X-Com multimédia ; que, le 22 août 2002, la société Viaccess a
informé la société Sédéa qu'elle n'avait pas consenti à la société X-Com multimédia la licence nécessaire
à la fabrication et à la commercialisation de l'un des dispositifs de décryptage incorporés aux récepteurs
de ce type ; qu'après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 30 août 2002, qu'il soit ordonné sous
astreinte à la société Distratel de consigner le montant de deux lettres de change émises en règlement
d'une partie du prix, la société Sédéa électronique a, au mois d'octobre 2002, saisi le tribunal de
commerce de demandes tendant à la condamnation des sociétés Distratel, X-Com multimédia et Viaccess
au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à l'institution d'une expertise
technique pour rechercher, compte tenu des contestations élevées à cet égard par les sociétés Distratel
et X-Com multimédia si les matériels litigieux étaient ou non, à la date de leur achat, couverts par une
licence conférée par la société Viaccess ; que, par conclusions du 31 août 2004 déposées devant le
tribunal de commerce, la société Sédéa a demandé la nullité ou la résolution de la vente ainsi que des
dommages-intérêts ;

3
Attendu que, pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen des
procédures successivement menées en référé puis au fond par la société Sédéa que celle-ci n'a pas cessé
de se contredire au détriment de ses adversaires, et retient que ce comportement doit être sanctionné,
«en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de
l'estoppel)» ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'en l'espèce, notamment, les actions engagées par la société
Sédéa n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les
mêmes parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la
cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
2) Rapport Magendie I, 2004 (extrait)
La loyauté est indispensable au déroulement de la procédure22. Il
n’existe pourtant pas de principe directeur de loyauté expressément visé dans le
nouveau Code de procédure civile. Certains auteurs considèrent cependant qu’un réel
principe de loyauté existe et se dégage des dispositions liminaires du nouveau Code
de procédure civile23. Ce principe découle, notamment, de l’obligation de ne pratiquer
que des mesures “légalement admissibles”, de communiquer les pièces en temps
utile24.
Henry Motulsky y voyait, quant à lui, une composante des droits de la
défense25. Un principe de loyauté est par ailleurs prévu en tant que tel dans le projet
de l’American law institut et d’Unidroit concernant des règles transnationales de
procédure applicables en matière de commerce international26.
Qu’elle existe ou non en tant que principe, la loyauté est certainement
une composante essentielle du procès civil.
Le respect de la loyauté processuelle devrait figurer explicitement au
nombre des principes directeurs du procès pour mieux asseoir sa nécessité et servir
de référent pour toutes les procédures et devant tous les juges (Section 1). Il impose
également des réformes plus techniques qui visent toutes les phases de la procédure,
notamment celles de première instance (Section 2).
Section 1 - La loyauté processuelle, principe directeur de procédure civile
Les rôles respectifs des parties et du juge au cours de l’instance sont
présentés en ouverture du nouveau Code de procédure civile, aux articles 2 et 3 27. La
formulation de ces deux articles n’apparaît pas satisfaisante. Elle recèle en effet une
certaine contradiction, ou à tout le moins une grande ambiguïté. En outre, ces textes
rendent mal compte des attributions respectives des parties et du juge en droit positif.
En tout cas, la consécration du renforcement des pouvoirs que l’on voudrait
reconnaître au juge dans le cadre de la présente Mission nécessite une réécriture de
ces dispositions liminaires du nouveau Code de procédure civile.
Selon l’article 2, « Les parties conduisent l’instance », une instance qu’elles
sont seules, en principe, à pouvoir engager. La référence faite à la «conduite» semble
étendre la maîtrise qu’elles ont de l’introduction de l’instance au déroulement de celle-ci.
Mais le texte poursuit qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les
“délais requis”. Et l’on découvre ailleurs que c’est le juge qui impartit ces délais, autrement
dit qui rythme la progression de l’instance. La «conduite» qu’assureraient les parties serait
tout au plus une «conduite guidée» par le juge.
Aux termes de l’article 3, « le juge veille au bon déroulement [...] de
l’instance». Formule feutrée28 qui pourrait évoquer une simple «surveillance» et n’irait pas
sans rappeler l’expérience malheureuse d’un certain juge chargé de «suivre» la procédure.

4
Il est toutefois précisé que le juge a «le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les
mesures nécessaires». Il n’est cependant pas précisé ici s’il le fait de façon systématique ou
s’il intervient seulement à titre subsidiaire, lorsque les choses ne vont pas bien.
L’article 2 donne ainsi l’impression que les parties dirigent l’instance,
qu’elles en ont la maîtrise tout comme elles ont la maîtrise du déclenchement du procès29
et de la matière litigieuse30. Or, cela ne correspond pas à la réalité.
Dans les textes, l’intervention du juge résulte déjà du final de l’article 2 :
“sous les charges qui leur incombent”. Ensuite, la surveillance du juge figure à l’article 3 :
“Le juge veille au bon déroulement [...]”. Toute hésitation est levée lorsque l’on consulte
les dispositions que le nouveau Code consacre, beaucoup plus loin, à la mise en état des
causes devant le tribunal de grande instance. C’est bien d’obligation, et d’obligation
permanente, qu’il s’agit. Par ailleurs, si l’article 763 dispose timidement que le juge a pour
mission de “veiller” au déroulement loyal de la procédure, et spécialement à la ponctualité
de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, ajoutant même qu’il peut,
“si besoin est” adresser des injonctions, c’est sans aucune ambiguïté que l’article 764
dispose que ce juge “fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de
l’affaire” […] après avoir - il est vrai - “provoqué l’avis des avocats”. Présent de l’indicatif
(à connotation impérative), généralité du propos : l’équivoque est levée.
La même tonalité dirigiste ressort de l’article 761, propre à la mise en état
simplifiée : le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau “à la date
qu’il fixe” pour conférer une dernière fois de l’affaire. Il impartit à chacun le délai
nécessaire à la signification des conclusions et à la communication des pièces.
C’est bien ainsi incontestablement le juge qui imprime à la procédure son
rythme et lui confère l’impulsion nécessaire à sa progression, dans un esprit de concertation,
mais avec les moyens de se faire obéir, puisqu’il dispose d’un double pouvoir d’injonction
et de sanction31.
Il n’est donc pas exact de dire que les parties “conduisent” l’instance, sauf
à donner à cette expression un sens très particulier. Il est vrai, en effet, que ce sont elles qui
apportent à l’instance la substance dont elle est faite, en échangeant les conclusions qui
déterminent la matière litigieuse, en procédant aux mises en cause ou aux appels en garantie,
en soulevant les incidents (exceptions, fins de non-recevoir, demande de mesures
d’instruction). La “conduite” qui leur revient concerne donc la substance de l’instance, non
son cheminement procédural32. C’est ainsi que le juge, parce qu’il a mission de veiller au
bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable, peut refuser une demande de
renvoi à une audience ultérieure présentée conjointement par les parties33.
Il apparaît utile de sortir de cette ambiguïté et de renforcer l’idée selon
laquelle les parties font les actes de procédure sous la direction du juge, en substituant au
terme : “conduire”, celui de : “diligenter”. En effet, diligenter, ce peut être conduire, comme
on parle de diligenter une enquête. Mais c’est aussi apporter tous ses soins, tout son zèle,
se hâter de faire ce que l’on doit effectuer34. Cette idée est d’ailleurs présente dans la
formulation retenue par l’American Law Institute et par l’Association Unidroit dans le
dernier état de leur projet commun de “Principes uniformes de procédure civile
transnationale”. Il est en effet indiqué que “Les parties partagent avec le tribunal la charge
de favoriser une solution du litige équitable, efficace et raisonnablement rapide.”35
Dans le souci d’asseoir plus nettement le principe de loyauté en droit
processuel, il importe encore d’indiquer que les diligences des parties dans le déroulement
de l’instance doivent se faire loyalement.
Pour répondre à cet objectif, l’article 2 du nouveau Code de procédure civile
devrait être ainsi nouvellement rédigé :
“Les parties diligentent loyalement la procédure sous les charges qui leur

5
incombent ; il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais
requis”.
Faudrait-il retoucher également l’article 3 et aller jusqu’à poser explicitement
le principe que le juge «assure le bon déroulement de l’instance» ? Ce serait sans doute
excessif et dangereux.
Excessif, car le juge n’«assure» pas seul le bon déroulement de l’instance.
Certes, l’autorité, les pouvoirs de décision et de sanction sont entre ses mains. Mais cette
autorité s’exerce dans un esprit de coopération institutionnalisée, ce qui ne signifie pas que
les juges et les parties doivent avoir des charges et des prérogatives processuelles égales. Le
juge doit constamment «provoquer l’avis des avocats» ; et ces derniers ne sont pas interdits
d’initiative36. Une part importante, celle de l’accomplissement des actes, revient de toute
façon aux parties. Par là, elles «assurent», elles aussi, le bon déroulement de l’instance.
Dangereux aussi, peut-être. La crainte a été exprimée qu’à trop insister sur
le rôle du juge dans la direction de l’instance, l’on ne provoque un transfert du centre de
gravité sur le terrain de l’appréciation du délai raisonnable, les parties n’ayant plus de
diligences à accomplir que sur décision du juge.
Le risque est réel, mais inégalement réparti.
Du point de vue des responsabilités en jeu dans l’inobservation du délai
raisonnable, on peut considérer que, de toute façon, la cause est d’ores et déjà entendue. Il
faut se reporter, sur ce point, à l’arrêt E.R. c/ France rendu par la Cour européenne des
droits de l’homme le 15 juillet 2003 37. Ayant à apprécier si la cause avait été entendue dans
un délai raisonnable et si la lenteur constatée de la procédure était susceptible d’engager la
responsabilité de l’État, la Cour rappelle que, si l’article 2 laisse l’initiative aux parties, cela
ne dispense pas le tribunal de «veiller à ce que le procès se déroule dans un délai
raisonnable», l’article 3 lui prescrivant précisément de «veiller au bon déroulement de
l’instance» et l’investissant du pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures. Elle
stigmatise en l’espèce la longue période d’inertie du conseiller de la mise en état, qui n’avait
fixé aucun délai ni délivré la moindre injonction.
Reste la question de la péremption d’instance38. On pourrait penser que, la
direction de l’instance appartenant au juge, celui-ci ne pourrait plus reprocher aux parties
leur inaction, comme cela se passe déjà, par exemple, en matière prud’homale39. Mais
devant le tribunal de grande instance, durant la phase de mise en état, il est admis que “les
pouvoirs conférés au juge après l'exécution d'une mesure d'instruction n’ont pas pour effet
de priver les parties de la possibilité d’accomplir les diligences”40. Cette jurisprudence a fait
l’objet de critiques, au motif qu’elle ferait supporter aux justiciables les conséquences d’un
dysfonctionnement judiciaire41. Il apparaît pourtant légitime que, dès lors que la péremption
d’instance sanctionne le fait que les parties se désintéressent de la procédure, les actes
accomplis par le juge ne soient pas considérés comme des diligences susceptibles
d’interrompre le délai de péremption42. La Cour de cassation n’hésite cependant pas à
admettre l’interruption de ce délai dès que les juges du fond ont pu caractériser sans
équivoque une manifestation de volonté de poursuivre l’instance, de faire progresser
l’affaire. Nombreuses sont les démarches révélant, à ses yeux, une réelle impulsion
La péremption d’instance reste marquée par ses fondements plus
complémentaires que contradictoires. Elle manifeste la place que conserve le principe
dispositif dans le procès civil tout autant que la nécessité de conserver en toutes
circonstances le souci d'une bonne administration de la justice. Le principe de coopération
entre le juge et les parties trouve dans cette institution une nouvelle illustration.
3) Assemblée plénière, 7 juillet 2006
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%