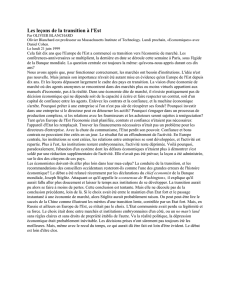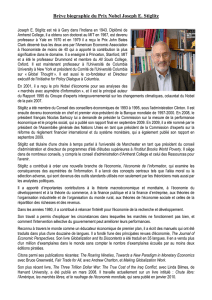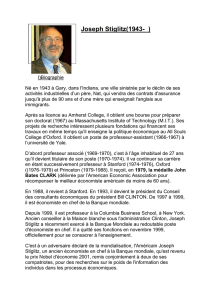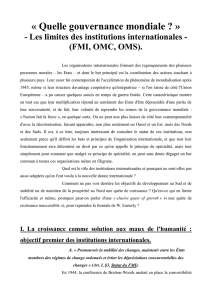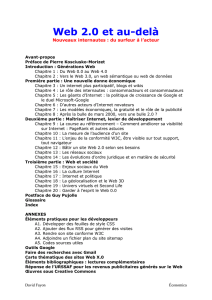Stiglitz J.E.

J.E. Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête, 2003
Présentation générale
Chapitre 1 : Expansion-récession : le ver dans le fruit. Fiche réalisée par
OUMABADY Radja
Chapitre 2 : Coup de génie ou coup de chance ? Fiche réalisée par Nassim
BENCHALEL
Chapitre 3 : La Fed toute puissante. Fiche réalisée par Nikola MILENKOVIC
Chapitre 4 : La Déréglementation tourne au délire. Fiche réalisée par Alyeska
GUILLAUD
Chapitre 5 : « Comptabilité : l’imagination au pouvoir ». Fiche réalisée par Marc
FROGET
Chapitre 6 : Les banques et la bulle. Fiche réalisée par Nina AURIAC
Chapitre 7 : Les réductions d’impôt nourrissent la frénésie. Fiche réalisée par
Clotilde CAVAROC
Chapitre 8 : Vivre dangereusement. Fiche réalisée par Emir BERKANE
Chapitre 9 : Mondialisation : les premières razzias. Fiche réalisée par Julie BEZEJAT
Chapitre 11 : Déboulonnons les mythes. Fiche réalisée par Béryl TROUSSEL
Chapitre 12 : Vers un nouvel idéalisme démocratique : une perspective, des
valeurs. Fiche réalisée par Caroline HUET.
Présentation générale
Joseph Eugène Stiglitz est un économiste américain né le 9 février
1943 qui reçut le « Prix Nobel » d'économie en 2001 pour ses travaux sur
« l’économie de l’information », avec G. Akerlof et A.M. Spence. Il est un des
fondateurs et un des représentants les plus connus du « nouveau
keynésianisme ».De 1995 à 1997, il est le conseiller économique principal du
président Clinton. Cette expérience au sein du pouvoir exécutif américain lui
permet de comprendre quelles ont été les failles du modèle capitaliste. Il a
acquis sa notoriété à la suite de ses violentes critiques envers le FMI, qu’il
attaque dans La Grande Désillusion paru en 2002, et la Banque Mondiale,
critiques émises peu après son départ de la Banque Mondiale en 2000, alors
qu’il en était l’économiste en chef.

En 2003, dans « Quand le capitalisme perd la tête », fait le procès du
libéralisme sans limites : il retrace l’histoire des « folles années 1990 »,
essayant d’analyser les erreurs qui ont conduit l’économie américaine (et par
là le reste du monde) à l’éclatement de la bulle des nouvelles technologies et
à la phase de récession particulièrement violente qui a suivi.
D’un point de vue historique, le capitalisme prend son essor avec la
fin de la Guerre Froide, les Etats-Unis deviennent alors la seule
superpuissance, le capitalisme triomphe du communisme.
Chapitre 1 : Expansion-récession : le ver dans le fruit
Fiche réalisée par OUMABADY Radja
Dans le 1er chapitre, Stiglitz s’intéresse au cycle d’expansion-
récession. Suite à l’ouverture internationale au profit des Etats-Unis, les
États-Unis connaissent dans les années 1990 caractérisées de “folles
années” des taux de croissance très élevés. Cependant cette période de forte
expansion est suivie d’une récession beaucoup plus importante : c’est ce qui
caractérise le capitalisme depuis deux siècles.
L’ampleur du bouleversement de la nouvelle économie, basée sur les
nouvelles technologies de l’information et de la communication, serait
équivalente à celui de la révolution industrielle d’il y a deux siècles, où
l’économie était passée de l’agriculture à l’industrie.
Cependant après une période d’essor les vraies répercussions de la
mondialisation au profit des États unis se font sentir peu à peu par des
crises alarmantes vers la fin des années 1990 qui se situe à la fois à
l’étranger comme les premières en Asie, et à la fois aux États-Unis même
surtout celle à Seattle en décembre 1999.
De plus, du fait que les intérêts spéciaux et immédiats l’aient emporté
sur l’intérêt général et durable, grâce à des lois fiscales et à la législation
limitant les plaintes en matières financières, les inégalités entre les différents
pays du monde face aux États unis se sont aggravées ; d’où, la montée
croissante de l’anti-américanisme.

Les causes de l’échec du capitalisme dans cette période seraient
essentiellement une carence du rôle de l’Etat liée à l’excès de
déréglementation. Cependant un nouveau problème se pose : l’Etat lui-
même fait-il des échecs ?
C’est pourquoi Stiglitz préconise par sa grande connaissance et son
incroyable expérience que l’Etat et le marché bien qu’étant tous deux
défaillants, devraient coopérer, se compléter chacun compensant les
faiblesses de l’autre et prenant appuis sur ses forces.
Pendant ces folles années 1990 au lieu d’investir en masse dans la
bourse, qui fut pour la plupart des investisseurs du gâchis, les agents
économiques auraient mieux fait en investissant plus dans les besoins
publics vitaux de la société tels que l’éducation, la recherche, les
infrastructures…
Mais il ne faut pas oublier que le fanatisme du marché a conduit, les
États-Unis à saboter les processus et les principes même de la démocratie.
Néanmoins ce gâchis et cette incompétence de l’Etat ne demeurent
pas inévitable puisque Stiglitz nous dit que “ce n’est que par des accords
internationaux équitables que nous parviendrons à stabiliser les marchés
mondiaux”.
Chapitre 2 : Coup de génie ou coup de chance ?
Fiche réalisée par Nassim Benchalel
Présentation préliminaire des personnes physiques et morales
évoquées dans le chapitre :
- Bill Clinton (1946 - ) : Président démocrate des Etats-Unis de 1992
à 2000, il fut très populaire, car réussit grâce à une politique de réduction
du déficit budgétaire à rétablir l’économie américaine, alors en récession.
- Ronald Reagan (1911–2004) : Président républicain des Etats-Unis
de 1980 à 1988, a voulu résoudre la crise économique, due aux chocs
pétroliers et à la Guerre du Viêt-Nam, aux Etats-Unis, en préconisant une
politique de restriction des dépenses de l’Etat (système d’austérité).

- La Federal Reserve Board (Réserve Fédérale des Etats-Unis) :
Institution indépendante, introduite par le Federal Reserve Act le 23
décembre 1913, décide de la politique monétaire des Etats-Unis (recherchant
stabilité des prix, croissance économique), supervise le système bancaire
américain, publie des rapports en rapport avec l’économie américaine (le
livre beige) et enfin agit comme « prêteur de dernier ressort ».
- Le Fond Monétaire Internationale (FMI) : Institution
internationale regroupant 185 pays créée en 1944 avec le rôle d’assurer la
stabilité du système monétaire international et de gérer les crises financières
(en fournissant des aides aux pays en difficulté).
Résumé du Chapitre 2 :
L’économie a sa place en politique, ainsi quand la conjoncture est
opportune, les élections sont quasi acquises pour le candidat. (Exemple :
la victoire de Clinton sur Bush en 1992 sur fond de récession.). Quand un
pouvoir politique maîtrise et considère le poids des outils économiques, il en
résulte bien souvent un engouement populaire pour l’économie, et une
légitime reconnaissance pour les économistes contribuant aux bons
résultats conjoncturels (Exemple : les bons résultats de Clinton permirent à
son équipe de conseillers économiques de sortir de l’anonymat, y compris
pour Stiglitz).
Mais parfois la conjoncture est comme un jeu de carte avec une main
dépendant des aléas du hasard (ex : 11 septembre 2001). Il semblerait que
selon Stiglitz la vie économique ne soit qu’un jeu soumis au hasard. Dés lors
tout gouvernement en fonction doit jouer avec la « donne » qu’elle a : c’est à
dire pour l’administration Clinton, une « reprise sans emploi », situation
d’expansion privée de création d’emploi ; un déficit budgétaire important
issu de l’ère Reagan, ayant baissé la pression fiscale, en vertu de la courbe
de Laffer. Stiglitz avance que les choix politiques déterminent la donne
future.
L’administration Clinton dut relever l’économie d’un déficit du PIB
américain de 5 % et d’une situation sociale critique. Mais Stiglitz n’hésite
pas à avancer que Clinton a été bien aidé par la conjoncture économique.

Stiglitz surenchérit même en déclarant que les collaborateurs de Clinton
étaient au bon endroit et au bon moment. L’objectif majeur de Clinton était
de maîtriser le déficit, il fallait réduire les dépenses ou augmenter les impôts.
Mais ces deux solutions menaçaient de ralentir l’économie. Finalement la
stratégie d’équilibre budgétaire fut un succès et le déficit se transforma
rapidement en excédent.
Pour Stiglitz, cette réussite est due au contexte historique.
Il s’explique : le Fédéral Reserve Board mena dans les années 1980
une politique d’austérité, visant à augmenter les taux d’intérêts afin de
juguler l’inflation. (De 13.5% en 1980 à 3.2% en 1983). Mais rapidement, les
conséquences se firent sentir avec une hausse de chômage, et un système
bancaire ravagé, par les taux d’intérêts fort, mettant en situation de faillite
les caisses d’épargne de prêts immobiliers. Pour les sauver, Reagan les
autorisa à évaluer très haut leurs profits futurs. Mais cela ne fut pas
suffisant, et le « pari de la résurrection » fut tenté en consentant des prêts à
hauts risques, mais à haut rendement. Reagan dû en 1988 employer de
lourdes dépenses (1 milliard de dollars) pour sauver les caisses
d’épargne. Finalement, il réussit à sauver son erreur de 1980 mais le
budget général en avait souffert et, la récession de 1990 était amorcée.
Ces taux d’intérêts élevés eurent aussi des conséquences hors des USA,
notamment en Amérique Latine, qui avait beaucoup emprunté aux USA et
dont les pays durent bien vite se déclarer en défaut de paiement et donc
fragilisèrent le système bancaire Américain.
Bush Senior mit en place des réglementations bancaires
restrictives afin d’assainir les bases financières, mais les banques durent
aussi dans cet effort, réduire leurs prêts.
Dès lors, l’économie Américaine s’assèche et la Federal Reserve
reprend les maladresses, en traitant les bons d’Etats à long terme dont le
rendement est sensible aux variations du taux d’intérêt, incitant les banques
à placer leur argent en bons d’état, plutôt que de proposer des prêts pour les
entreprises créatrice d’emploi. En 1991, la Federal Reserve baisse enfin
ses taux d’intérêts.
Bill Clinton, bénéficia de ces erreurs de gestion économique pour être
élu. Mais sa politique de réduction du déficit, fut « un coup de chance »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%
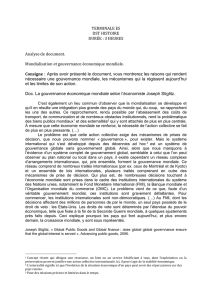

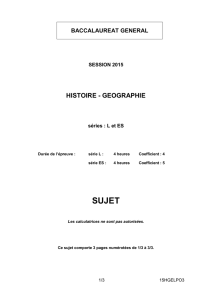
![Quand le prix d`un bien correspond à l`équilibre, [le plus] de](http://s1.studylibfr.com/store/data/001607953_1-b1e8d310d6a3161232aec38b6aae1e5a-300x300.png)