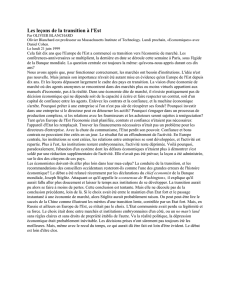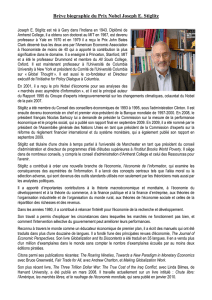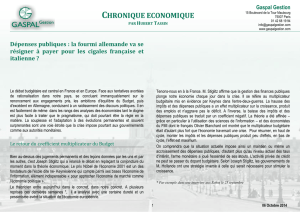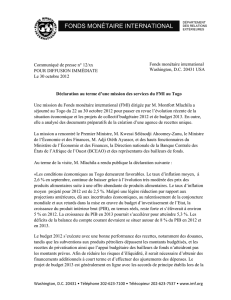Bail Adrien 2PES3 Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d`économie en

1
Bail Adrien 2PES3
Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d’économie en 2001, fut membre du Concil of
Economic Adivisers (1993-1997), dans l’administration Clinton, président des Etats-Unis
d’Amérique de 1992 à 2000. Il fut par la suite Economiste en chef de la Banque mondiale
(1997-1999). Sa position lui a offert une place d’observation de premier ordre. Elle lui a aussi
donné d’être soumis à l’impératif de la décision. Et c’est en cette double qualité qu’il a rédigé
The Roaring nineties, traduit par Quand le Capitalisme perd la tête en France en 2003.
L’auteur s’appuie sur la théorie néo-keynésienne et tente d’analyser la période des années
1990, dans un style accessible et volontairement pédagogique : il s’agit de faire un bilan, pour
pouvoir tirer des leçons et être à même de ne pas refaire les mêmes erreurs à l’avenir. Ce
schéma fait déjà ressortir l’idée de la durabilité, très présente dans les analyses que mène
Stiglitz. Les « Folles années 1990 » l’ont été parce qu’elles ont vu des aberrations théoriques,
l’inversion des priorités dans la décision économique, le renforcement des conflits d’intérêts,
et l’emprisonnement de la politique économique dans le court terme, faisant perdre de vue le
rôle de l’Etat dans l’économie. L’auteur tente ici de mettre en lumière les processus en cause
dans la création de la « Bulle spéculative des hautes technologies » et de son éclatement, aux
effets néfastes pour les Etats-Unis, et ô combien destructeurs pour l’économie mondiale. Le
monde est de plus interdépendant, et les Etats-Unis semblent ne pas avoir mesuré la
prééminence de leur position depuis la chute de l’Union Soviétique en 1991 : constater les
vicissitudes de l’économie des années 1990 doit inciter à cette prise de conscience, afin
d’envisager un renforcement de la « Démocratie mondiale » et une croissance économique qui
profite à tous.
Les années 1990 sont en apparence celles de la croissance. L’économie est caractérisée
par un essor du commerce international et des flux de capitaux, fondés sur une « troisième
révolution industrielle ». La « Nouvelle économie » devait apporter la croissance et la
prospérité de manière durable, et la fin du cycle des affaires, c'est-à-dire la stabilité
économique. Pourtant à l’aube du deuxième millénaire, c’est bien une récession mondiale qui
se produit, après l’effondrement de Wall Street en avril 2000. Le choc de l’an 2000 pose une
question : qu’est-ce qui, dans l’expansion, a pu être à l’origine de cette désillusion, aux
conséquences si graves ? L’auteur affirme que la bulle spéculative était d’un genre nouveau :
« les investisseurs ont versé des milliards de dollars pour des entreprises qui n’avaient jamais
Joseph E. Stiglitz
Quand le Capitalisme perd la Tête
The Roaring Nineties
Fiche de lecture

2
réalisé le moindre profit, et très probablement ne le feront jamais ». Et la récession qui lui a
succédé est parmi les plus longues. A cette « exubérance irrationnelle », il y a plusieurs
coupables : l’Etat américain, qui a poussé trop loin sa politique de réduction des déficits et de
déréglementation, qui a subi les pressions des « prétendus petits génies de Wall Street » et des
groupes d’intérêts conservateurs. Le laxisme comptable a orchestré directement la constitution
de la bulle spéculative, favorisant le profit à court terme des banquiers, analystes et présidents
des grands groupes, aux dépens des investisseurs, victimes des asymétries d’information.
Selon Stiglitz, c’est le « fanatisme du Marché », cautionnant la recherche ultime de l’intérêt
individuel à court terme, qui a fait perdre la tête au capitalisme.
___
L’arrivée de Clinton à la Maison Blanche devait marquer un tournant : son
programme était orienté vers le long terme : la croissance, l’emploi et la prospérité. Stiglitz
déplore l’urgence de la situation laissée par Reagan et Bush père (déficit budgétaire, faible
croissance, réforme fiscale néfaste) qui a fait perdre de vue à la nouvelle Administration ses
idéaux et ses valeurs. Les Nouveaux Démocrates ont embrassé les revendications néolibérales
dans la lutte contre le déficit budgétaire, notamment sous les pressions de la Federal Reserve.
Il était supposé responsable de la fixation de taux d’intérêts trop forts, à leur tour défavorables
à l’investissement. Pour Stiglitz, cette politique était dangereuse, car son succès dépendait
d’une grande élasticité des investissements à la baisse des taux d’intérêt, afin de compenser la
réduction des dépenses de l’Etat et la hausse des impôts. Mais la recherche de l’équilibre
budgétaire a été un succès, et la reprise a eu lieu, accréditant les revendications de la FED.
L’auteur constate aujourd’hui les limites de cette politique : la reprise a plus été provoquée
par les effets d’investissements anciens que par la réduction du déficit. Seule la croissance
peut inspirer la confiance, et un déficit temporaire aurait pu favoriser l’investissement dans
une perspective de long terme.
L’économie des années 1990 a souffert de la prédominance du court terme sur le long
terme. Et c’est ce qui caractérise les acteurs principaux de la période. Greenspan et la FED
privilégiaient la lutte contre l’inflation, oubliant les objectifs de croissance de l’emploi.
Craignant que la réduction du chômage ne provoque la flambée des prix, elle prônait une
politique de hausse des taux d’intérêt, risquant de fragiliser l’économie au moment de la
reprise.
La déréglementation a joué un rôle dans l’explosion de l’activité à court terme. Il est évident
que la mutation des structures économiques nécessitait une réforme des réglementations en
vigueur depuis les années 1930, mais déréglementer les secteurs des nouvelles technologies
revenait à ne pas prendre en compte l’existence d’échecs du marché : le résultat en a été une
course folle aux marchés, créant des situations de monopole, de surinvestissement et de
gaspillage des capitaux. Le poids du secteur des télécommunications a ainsi doublé en dix ans,
a concentré plus du tiers des investissements, et le marché s’est excessivement concentré : des
surcapacités sont rapidement apparues, ce qui ne constituait pas des bases stables pour le long
terme.

3
Sur le marché financier, les dirigeants des grandes sociétés se sont joués de l’ignorance des
investisseurs. Les stock-options ont été des instruments d’entretien de l’illusion : elles
permettaient d’attirer les investisseurs, dans une optique de maximisation de la valeur des
profits à court terme. La mauvaise information fait prendre des risques aux investisseurs mais
aussi à toute l’économie : il en a résulté une mauvaise orientation des capitaux et une
survalorisation des actions. La distorsion de l’information fut un facteur central de la
spéculation et de la formation de la bulle.
L’illusion de bonne santé des firmes a été favorisée par des pratiques d’arrangement fiscal :
les cabinets d’audits qui étaient très liées aux firmes clientes, ont aidé leurs clients à donner
une image saine et attrayante. La fraude et le contournement de la loi se sont développés
comme jamais, comme la capitalisation boursière, qui atteint 17 000 milliards de dollars en
2000, soit plus de 1,7 fois le PIB américain. De la même façon, les banques et les analystes
financiers ont été mêlées à un certain nombre de scandales financiers (Arthur Andersen et
Enron) : l’inadaptation de la réglementation aux changements de l’économie a incité les
banques d’affaires à introduire en bourse des sociétés peu sûres, tirer profit de multiples
opérations de fusion-acquisition, et fournir au marché une information erronée. La fin de la
séparation entre banque de dépôt et banque d’affaire a mis en péril la fonction de garde-fou de
la banque, entraînant la négligence du risque : la banque d’Enron lui a consenti des prêts
jusqu’au jour de la faillite !
Le profit à court terme a pratiquement toujours été privilégié dans les décisions
politiques comme dans les comportements des différents agents sur le marché. Stiglitz
stigmatise la corruption, la perte de l’éthique du marché, issue d’une interprétation erronée de
la « main invisible » smithienne : cela a nourri l’économie-bulle. L’Etat a affaibli son rôle de
régulateur : la baisse d’impôt sur la plus-value apporta des recettes fiscales nouvelles à court
terme, en libérant les actions des détenteurs « captifs », mais les conséquences furent
désastreuses à terme : l’effondrement des courts signifie que les capitaux ont été gaspillés et
non pas investis dans la formation, la recherche, qui visent le long terme. Il a même été
envisagé de privatiser la Social Security, et ainsi lier les retraites aux résultats extraordinaires
de la bourse. L’idée de soumettre l’épargne de toute une vie de travail à l’instabilité du
marché financier traduit bien l’insouciance face au risque : la spéculation prime sur la valeur
travail. ___
Emettre l’idée de la perte des valeurs n’est pas dresser un tableau alarmiste de la
réalité, mais a pour but de souligner l’incohérence du capitalisme tel qu’il fut pratiqué pendant
les « folles années 1990 ». D’autant que ce capitalisme s’est exporté à travers les institutions
internationales, et a révélé l’ « hypocrisie » américaine, c'est-à-dire l’incohérence entre une
rhétorique libérale et un unilatéralisme en fait.
La volonté d’instaurer un « Nouvel ordre économique mondial » a parfois rendu plus
vulnérable les économies nationales. Les promesses « merveilleuses » de baisse du coût de la
vie et de croissance ont parfois laissé place à la récession (- 40% dans les pays d’Europe de
l’est anciennement communistes) et la pauvreté (multipliée par 10).

4
Le discrédit de la mondialisation marqué à Seattle en 1998 illustre les conséquences
néfastes des politiques inspirées par le FMI et le libéralisme américain : l’austérité budgétaire
et monétaire ont conduit les PED d’Amérique du Sud et d’Asie du sud-est à une
déstabilisation économique et sociale. Au contraire, la Chine suit sa voie d’expansion
budgétaire et monétaire, tandis que la Corée opère un tri critique des sollicitations du FMI :
elle a ainsi pu éviter de subir un excès de demande au moment de la reprise (le FMI lui avait
conseillé de supprimer ses surcapacités de production). Il ressort de l’analyse qu’il y a un
manque de prise en compte des spécificités historiques et géographiques évident. Le FMI
n’est pas toujours capable d’anticiper correctement les retombées de sa politique –
standardisée !
Le Trésor américain et le FMI prônent une libéralisation rapide des marchés financiers, au
risque de déséquilibrer les économies nationales, mais ce qui fournit un avantage certain aux
firmes américaines. Elles ont tout intérêt à voir s’ouvrir de nouveaux marchés.
Dans les accords internationaux, les Etats-Unis prônent une politique de libéralisation, et c’est
le succès des années 1990 avec la fin de l’Urugway Round et la création de l’Organisation
Mondiale du Commerce. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils cessent les subventions de leurs
firmes, dans une véritable « aide sociale aux entreprises », et des barrières à l’entrée des
marchandises aux Etats-Unis subsistent.
Aujourd’hui, les flux de capitaux vont encore des pays pauvres vers les pays riches, et
le déficit américain (tant stigmatisé par les institutions internationales lorsqu’il se produit dans
les PED) est financé par les PED, par le biais des Bons du Trésor. Le « Consensus de
Wasington » ou l’unilatéralisme américain pèse sur le monde en développement. L’auteur
préconise une « vision mondiale », où primeraient la justice et la solidarité humaine.
Stiglitz entend « déboulonner les mythes » : celui de l’efficacité de l’équilibre
budgétaire, du héros capitaliste américain, du marché autorégulateur panacée de la prospérité,
bref du capitalisme américain des années 1990 comme seule modèle de prospérité. Alors que
l’urgence l’emporte sur les valeurs et le long terme, il est nécessaire de formuler un nouvel
idéal, plus pragmatique. Il y a une place pour un équilibre entre l’Etat et le marché, qui ne
peut être une fin, mais un moyen, qui, orienté par l’Etat, doit concrétiser des valeurs : la
justice sociale, la démocratie, la liberté, dans une perspective d’auto-détermination et d’action
collective. Démocratiser la mondialisation, c’est poser la question de des normes : elles ne
doivent pas entraîner le formatage ni restreindre la liberté des nations.
1
/
4
100%

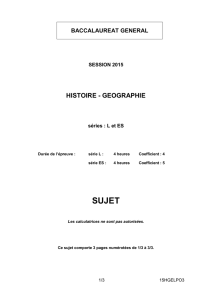
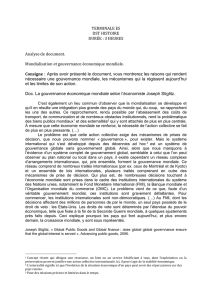
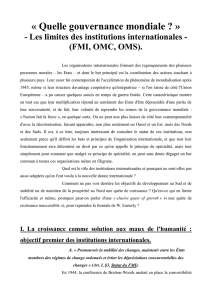

![Quand le prix d`un bien correspond à l`équilibre, [le plus] de](http://s1.studylibfr.com/store/data/001607953_1-b1e8d310d6a3161232aec38b6aae1e5a-300x300.png)