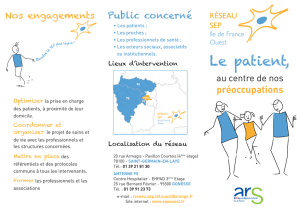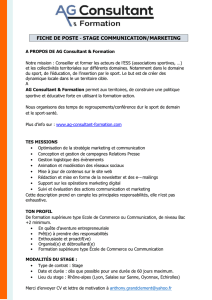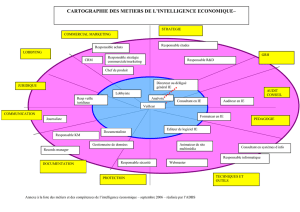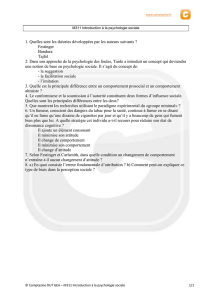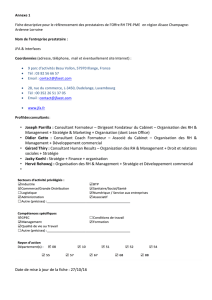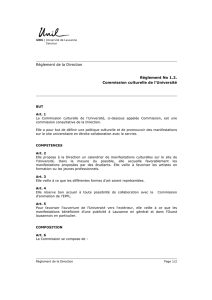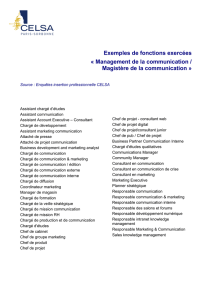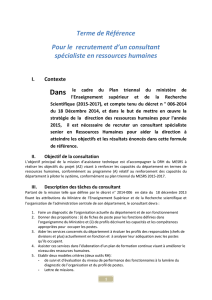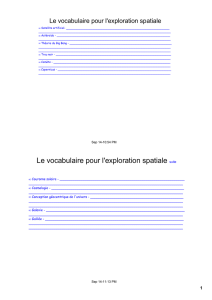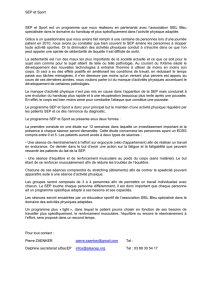Bandura et le bilan de compétences : applications et perspectives

Théorie sociale cognitive de Bandura et bilan de compétences :
applications, recherches et perspectives critiques1
Pierre-Henri FRANÇOIS
Maître de Conférences au Département de Psychologie de l’Université de Poitiers
André E. BOTTEMAN
Directeur adjoint de la revue Carriérologie
auteur
résumé/abstract
La confiance en ses capacités à accomplir avec succès une tâche ou sentiment d’efficacité
peut être rehaussée par le bilan de compétences. D’après Bandura, c’est surtout la réussite des
conduites qui permet d’obtenir cet effet. D’après les conceptions de Rogers, il convient aussi
que le bénéficiaire s’aperçoive que cette confiance est reflétée positivement par le conseiller,
que l’attitude de ce dernier permette la construction ou l’amorce d’un parcours professionnel
par le bénéficiaire. Le choix professionnel est encouragé non seulement parce que le métier
intéresse le consultant, mais aussi parce que l’environnement témoigne accueil et empathie
face à ce choix. Bandura et Rogers apportent ainsi des points de repères contrastés, mais qu’il
est salutaire pour le conseiller bilan de rendre complémentaires dans ses pratiques. Le bilan de
compétences est alors conçu comme une rencontre de deux personnes, ce qui est un gage de
sa réussite.
contenu
Introduction
Aspects fondamentaux de la théorie sociale cognitive pour le bilan
Aspects appliqués des conceptions de Bandura pour le bilan
Questions à propos du modèle de l’auto-efficacité
Conclusion
Introduction
Les travaux de Bandura connaissent un succès marqué depuis de nombreuses années. Ils ont
d’abord été célèbres dans le domaine de l’apprentissage social (Bandura, 1980), ils le sont
aujourd’hui avec le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) (Bandura, 1986, 1997). Mais ces
concepts phares valent surtout par leur intégration dans un ensemble théorique éprouvé : la
théorie sociale cognitive (TSC) qui inspire des recherches et des applications dans des
secteurs aussi variés que la psychologie clinique et pathologique, l’éducation, la santé, le
travail ou le sport. Nous-mêmes avons trouvé, dans cette TSC, des fondements solides pour
étayer nos réflexions sur la formation par alternance (François et al., 1997), l’éducation
(François, 1998a), l’orientation et l’insertion professionnelles (François, 2000a), les pratiques
de management et de gestion des ressources humaines (Eneau, Cassereau et François., 2000,
François, 2000b), les représentations des compétences (François et Aïssani, 2000). Mais c’est

plus particulièrement le bilan de compétences (François et Botteman, 1996, François, 1998b,
François et Langelier, 2000) qui nous a permis de mesurer la pertinence et la portée pratique
de cette TSC.
Lévy-Leboyer (1993, 1996) souligne la centralité de l'image de soi pour la démarche de bilan
de compétences. Elle se réfère aux travaux de Bandura à propos du développement et de
l'actualisation de l'image de soi et du rôle de cette dernière dans le processus de motivation à
l'égard du travail et de la vie professionnelle. Certains auteurs comme Bujold et Gingras
(2000) ont indiqué que la théorie de l'apprentissage social appliquée au développement et à la
prise de décision vocationnels par des chercheurs tels que Krumbholtz (Mitchell, Jones et
Krumbholtz, 1979, Mitchell et Krumbholtz, 1984) ne pouvait encore être considérée comme
une théorie majeure mais qu'il y avait tout intérêt à surveiller ses développements à venir.
Ces différents indices nous ont incité à explorer davantage l’application de la théorie sociale
cognitive et ses développements par rapport à la démarche et aux pratiques de bilan de
compétences. Notre présentation commencera par les aspects les plus fondamentaux pour
aller vers les plus concrets. Parmi les différents concepts utilisés par les chercheurs, nous nous
centrerons davantage sur le SEP qui intervient dans les processus dits d’auto-efficacité. Pour
nous aider à situer l'apport de la théorie de Bandura au bilan, nous la comparerons à plusieurs
reprises à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers (1977) à laquelle sont référées de
nombreuses pratiques de la relation d'aide ou du conseil d'orientation.
Aspects fondamentaux de la théorie sociale cognitive pour le bilan
La théorie sociale cognitive est basée sur la notion d'interaction. Bandura (1986) précise qu'il
ne suffit pas de considérer le comportement comme étant fonction des effets réciproques des
facteurs personnels et environnementaux les uns sur les autres mais que l'interaction doit être
comprise comme un déterminisme réciproque des facteurs personnels, environnementaux et
des comportements selon le schéma de la figure 1.
Figure 1
Ainsi, dans cette conception, l'influence de l'environnement sur les comportements reste
essentielle, mais à l'inverse de ce qu'on trouve dans les théories behavioristes de
l'apprentissage (conditionnements classique et opérant) une place importante est faite aux
facteurs cognitifs, ceux-ci pouvant influer à la fois sur le comportement et sur la perception de
l'environnement. Cette perception est en effet plus déterminante que les conditions réelles
dans lesquelles se trouve l'individu. Pour Bandura, les humains ne répondent pas seulement à
des stimuli, ils les interprètent (1980)2. Bandura cite plusieurs exemples montrant que l'effet
de la situation sur le comportement (renforcement) ne devient vraiment significatif que
lorsque le sujet prend conscience de ce renforcement. Mais ce modèle de causalité triadique et
réciproque n'implique ni que chacun des trois facteurs intervienne avec la même force dans
une situation donnée ni que les trois facteurs soient concernés en même temps. La bi-

directionnalité de l'influence signifie aussi que les personnes sont à la fois produit et
productrices de leur environnement (Wood et Bandura, 1989, p 362).
Pour Bandura (1980, 1986), les croyances d'un individu à l'égard de ses capacités à accomplir
avec succès une tâche ou un ensemble de tâches sont à compter parmi les principaux
mécanismes régulateurs des comportements. Le SEP renvoie « aux jugements que les
personnes font à propos de leur capacité à organiser et réaliser des ensembles d'actions
requises pour atteindre des types de performances attendus » (Bandura, 1986), mais aussi aux
croyances à propos de leurs capacités à mobiliser la motivation, les ressources cognitives et
les comportements nécessaires pour exercer un contrôle sur les événements de la vie (Wood et
Bandura, 1989). Ces croyances constituent le mécanisme le plus central et le plus général de
la gestion de soi (personal agency). En particulier, le SEP est supposé aider les gens à choisir
leurs activités et leurs environnements et déterminer la dépense d'efforts, leur persistance, les
types de pensées (positives vs négatives) et les réactions émotionnelles face aux obstacles.
Le SEP influe positivement sur la performance. Il a un rôle direct en permettant aux
personnes de mobiliser et organiser leurs compétences. Il a un rôle indirect en influençant le
choix des objectifs et des actions. Les résultats de la méta-analyse effectuée par Sadri et
Robertson (1993) confirment que le SEP est corrélé avec la performance (r après correction =
.40) et avec le choix du comportement (r après correction = .34). La liaison du SEP avec la
performance est plus faible dans les études en milieu naturel (r = .37) que dans les situations
expérimentales (r = .60).
Le meilleur moyen de développer un sentiment d'efficacité personnelle est de vivre des
expériences qu'on maîtrise et réussit. Les croyances dans sa propre efficacité peuvent aussi
être développées par modelage en prenant connaissance d'expériences réalisées par d'autres
personnes. La persuasion verbale, par exemple les encouragements, peut accroître le
sentiment d'efficacité, mais celui-ci ne survivra pas longtemps à l'épreuve de la réalité s'il a
été "artificiellement" mené à un niveau irréaliste. Enfin les états physiologiques expérimentés
dans certaines situations peuvent être interprétés par l'individu comme le signe de difficultés
pour atteindre un résultat visé. Ainsi, les manifestations somatiques du stress sont-elles
souvent attribuées à un manque de capacité.
L'ensemble substantiel de recherches sur les différents effets du SEP est résumé ainsi par
Bandura, (1995).
Les personnes qui ont un faible SEP dans un domaine particulier évitent les tâches difficiles
qu'elles perçoivent comme menaçantes. Elles ont des niveaux faibles d'aspiration et une faible
implication par rapport aux buts qu'elles ont choisis. Confrontées à des difficultés, elles butent
sur leurs déficiences personnelles, sur les obstacles et sur les conséquences négatives de leurs
actes plutôt que de se concentrer sur la façon d'obtenir une performance satisfaisante. Elles
diminuent leurs efforts et abandonnent rapidement face aux difficultés. Elles sont lentes à
retrouver leur sens de l'efficacité après un échec ou un délai dans l'obtention de résultats. Elles
considèrent une performance insuffisante comme la marque d'une déficience d'aptitude et le
moindre échec entame leur foi en leurs capacités. Ces caractéristiques minimisent les
opportunités d'accomplissements et exposent l'individu au stress et à la dépression.
Au contraire, un SEP élevé augmente les accomplissements et le bien-être personnel de
plusieurs façons. Les personnes avec une forte assurance concernant leurs capacités dans un
domaine particulier considèrent les difficultés comme des paris à réussir plutôt que comme

des menaces à éviter. Une telle approche des situations renforce l'intérêt intrinsèque et
approfondit l'implication dans les activités. Ces personnes se fixent des buts stimulants et
maintiennent un engagement fort à leur égard. Elles augmentent et maintiennent leurs efforts
face aux difficultés. Elles recouvrent rapidement leur sens de l'efficacité après un échec ou un
retard. Elles attribuent l'échec à des efforts insuffisants ou à un manque de connaissances ou
de savoir-faire qui peuvent être acquis. Elles approchent les situations menaçantes avec
assurance car elles estiment exercer un contrôle sur celles-ci. Cet ensemble de caractéristiques
d'auto-efficacité favorise les accomplissements personnels, réduit le stress et la vulnérabilité
face à la dépression.
Bandura, dans l’introduction d’un chapitre qu’il consacre à la vie professionnelle (1997),
avance que la vie professionnelle est une « source majeure de l’identité personnelle et du sens
de la valeur personnelle » et souligne un peu plus loin l’enjeu et la difficulté de cette
construction de soi : « En prenant des décisions pour leur carrière, les gens sont aux prises
avec les incertitudes quant à leurs capacités, la stabilité de leurs intérêts, la recherche à court
et long terme de différentes professions alternatives, l’accessibilité des carrières envisagées, et
le type d’identité qu’ils tentent de se construire ». Pour Lent et Brown (1996), la Théorie
Sociale Cognitive des Carrières (TSCC) représente un courant émergeant qui tente de
compléter et de lier des théories de la carrière déjà existantes. Reposant sur un
constructivisme selon lequel l’être humain est capable d’influencer activement son propre
devenir et celui de son environnement, cette théorie met l’accent sur les processus
dynamiques intervenant dans la formation des intérêts, le choix des carrières et dans le
parcours professionnel. Dans la TSCC, les gens forment des intérêts durables pour une
activité quand ils s’y considèrent eux-mêmes comme compétents et quand ils en attendent des
résultats par eux valorisés (Ibid.). Ils choisissent une profession en fonction de leurs intérêts
mais aussi des éléments contextuels qui “ encouragent ” ceux-ci (par exemple support social,
difficultés modérées) (Ibid.). Le niveau et la stabilité de réalisation professionnelle, dans la
TSCC, sont influencés par les aptitudes, le SEP, les attentes de résultats et les objectifs de
performance.
Introduit dans la littérature relative aux carrières par Hackett et Betz en 1981, le SEP est,
selon Lent et al. (1994), l'élément de la théorie sociale cognitive ayant retenu le plus
l'attention dans la littérature carriérologique. Le SEP s'est avéré être un prédicteur des choix
d'études et de carrière et des indices de performance.
Le SEP intervient notamment comme médiateur du développement des intérêts
professionnels, des choix de carrière et des niveaux de performance. Ainsi, les gens
développeraient des intérêts pour les activités dans lesquelles ils conçoivent pouvoir réussir et
cette anticipation de succès est en grande partie étayée par les expériences antérieures
positivement renforcées, elle peut l'être aussi par l'observation des résultats obtenus par
d'autres personnes (modelage). Le choix de carrière et celui des actions pour y arriver (par
exemple études, formation) dépend des intérêts mais aussi des chances estimées de succès,
elles-mêmes dépendantes du SEP et de l'environnement réel et perçu (débouchés,
sélection ...). Plus les gens ont un SEP fort et plus ils envisagent des carrières nombreuses
comme possibles et mieux ils s'y préparent. Les gens s'auto-limitent dans leurs choix de
carrière, souvent parce qu'ils doutent de leurs capacités. Par exemple, les femmes limitent
leurs intérêts pour certaines activités traditionnellement masculines, même si leurs capacités
ne sont pas, en fait, inférieures à celles de ceux-ci (Lent et al., 1994).
Dès 1983, Taylor et Betz ont publié des travaux sur le SEP relatif au processus de choix de

carrière. Cette étude a montré que les personnes ayant peu de confiance dans leurs capacités à
réaliser efficacement les opérations nécessaires à un choix de carrière obtenaient aussi des
scores d'indécision vocationnelle plus élevés. Les résultats obtenus par Taylor et Popma
(1990) confirment les précédents. Le SEP à l'égard des tâches à effectuer pour le choix de
carrière est modérément et négativement lié à l'indécision vocationnelle et au locus de
contrôle externe. Ce type de SEP, dans cette dernière étude s'avère être le meilleur prédicteur
de l'indécision vocationnelle des lycéens.
Bandura (1997) rapporte d’autres résultats importants de la recherche dans ce domaine. Les
personnes éliminent des classes entières de professions, en délaissant leur éventuel caractère
attractif, en fonction de leurs croyances dans leur efficacité. Par exemple, l’efficacité perçue
en mathématiques contribue au choix d’études et de professions de façon plus significative
que la quantité d’enseignements suivis ou les résultats dans cette matière. C’est moins l’auto-
évaluation de compétences spécifiques considérées isolément qui prédit les choix que la
croyance qu’on pourra les utiliser ensemble dans des contextes requis. Ceci indique qu’il n’est
pas suffisant de décomposer un poste de travail en compétences spécifiques et d’évaluer le
SEP d’une personne pour chacune de ces compétences pour avoir accès au SEP à l’égard du
poste. Les stéréotypes de genre attachés à certaines professions qui suggèrent un moindre
niveau de capacités de l’un ou l’autre sexe peuvent amener les personnes de ce sexe à sous-
évaluer leurs capacités. Dans la TSC, les intérêts et le SEP sont liés mais de façon
asymétrique, c’est-à-dire que le SEP influence plus les intérêts que l’inverse. Le sentiment de
pouvoir réussir dans un domaine stimule l’intérêt pour ce domaine. L’intérêt favorise
l’implication dans le domaine ce qui augmente les chances de réussite, principale source de
SEP. Le SEP contribue à la persévérance et aux performances davantage que les intérêts.
Bandura (Ibid.) conclut de l’ensemble des travaux sur le choix professionnel que l’efficacité
perçue contribue de façon “ robuste ” au développement de carrière. « Il [le SEP] prédit
l’étendue des carrières envisagées, les intérêts professionnels et les préférences, l’engagement
dans des enseignements qui fournissent connaissances et compétences pour diverses carrières,
la persévérance devant les difficultés, la réussite académique dans les domaines qui ont été
choisis, et même le choix des milieux culturels dans lesquels l’individu poursuivra sa
carrière ».
Aspects appliqués des conceptions de Bandura pour le bilan
L'interaction telle que conçue dans la théorie sociale cognitive paraît bien correspondre à des
pratiques de bilan à la fois réalistes et constructives. Les désirs (ou intérêts) de l'individu sont
à prendre en compte, en tant que moteur de son action à venir mais le conseiller est attentif
aussi à la réalité des comportements passés, actuels et projetés et à celle des environnements
socioprofessionnels concernés. Disposer d'une information suffisamment détaillée, objective
et fiable sur les compétences (comportements potentiels évalués par des personnes
connaissant bien le domaine professionnel concerné) et sur l'environnement concourt bien
évidemment au réalisme de la démarche. On connaît mieux ce que la personne est capable de
faire et on envisage les environnements où ces capacités ont quelque chance de s'avérer
utilisables. Le travail du conseiller ne s'arrête pas à fournir cette information très précieuse ou
à faciliter son obtention, il continue avec l'accompagnement de son intégration dans les
projets d'orientation, d'actions. Le point essentiel est bien de fournir au consultant une
information valide sur lui-même mais aussi de le guider dans l'utilisation de cette information.
L'approche de Bandura met l'accent sur la façon dont l'individu va aborder les différentes
éventualités de comportement que le bilan lui révèle ou lui confirme.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%