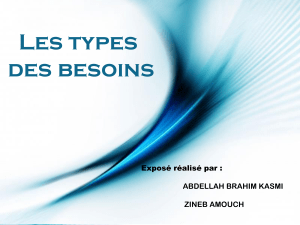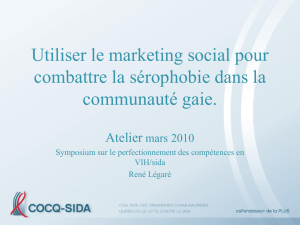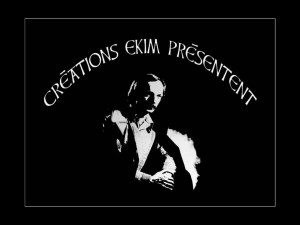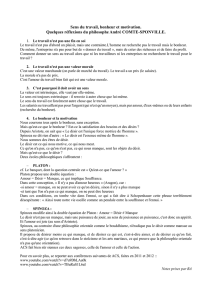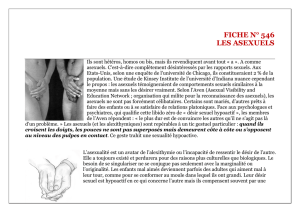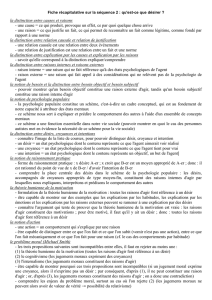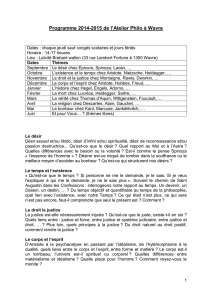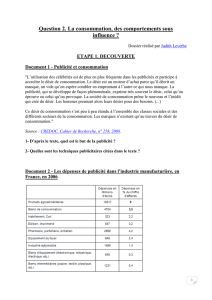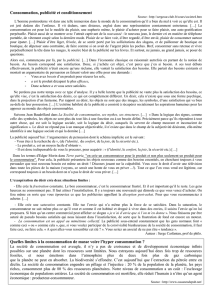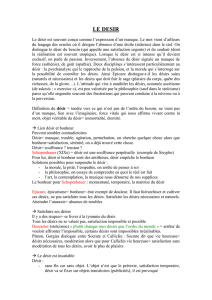CHAPITRE : LE DESIR ET LE BONHEUR – Être heureux, est

1
CHAPITRE : LE DESIR ET LE BONHEUR – Être heureux, est-ce assouvir tous ses désirs ?
«D'ailleurs les désirs de l'homme sont insatiables : il est dans sa nature de vouloir et de pouvoir tout désirer, il n'est pas à sa
portée de tout acquérir.» Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, II.
Texte de MOLIERE, Don Juan, Acte I, scène 2.
DOM JUAN: « Quoi? tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui, et
qu'on n'ait plus d'yeux pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour
toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux! Non,
non: la constance n'est bonne que pour des ridicules; toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée
la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me
ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé,
l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres; je conserve des yeux pour voir le mérite
de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon
cœur à tout ce que je vois d'aimable; et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les donnerais tous. Les
inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On
goûte une douceur extrême à réduire, par cent hommages, le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès
qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre
les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un
honneur et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien
à dire ni rien à souhaiter; tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, si
quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs, et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire.
Enfin il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des
conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien
qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs: je me sens un cœur à aimer toute la terre; et comme Alexandre, je souhaiterais
qu'il y eût d'autres mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. »
[en gras, les citations utiles à savoir]
- Ce texte montre que le désir est lié à la quête de bonheur et de liberté : Don Juan se sent exister lorsqu’il désire.
- En même temps, nous remarquons le caractère insatiable de ce désir : il s’éteint dès qu’il atteint son objet : « il n’y a
plus rien à dire ni à souhaiter ; tout le beau de la passion est fini ». Le désir assouvi plonge Don Juan dans le sommeil.
Son désir se porte alors sur un autre objet, indéfiniment. Or, cet aspect dévorant est-il source de souffrance ou au
contraire source d’affirmation ?
Définition de désir : Le désir est une tendance consciente d’elle-même, dirigée vers une fin (un but) conçue ou imaginée.
». Une tendance désigne une force orientée vers un but. Le désir désigne ainsi tout mouvement qui nous porte à rechercher la
jouissance ou la possession d’un objet.
Etymologie : Désir vient du latin desidare, « regretter l’absence de quelqu’un ou de quelque chose ». Le désir est donc lié à
une absence. Nous retrouvons le terme sidus, « étoile », « astre ». Ce que nous désirons est lointain, inatteignable.
La multiplicité du désir : Le désir paraît avoir des formes diverses comme l’amour, la soif, la volupté, la cupidité, la curiosité,
le souhait, l‘envie: le désir est une « bête multiforme et polycéphale » disait Platon, dans la République, une hydre aux mille
têtes qu‘aucune définition ne paraît pouvoir épuiser.
Distinctions conceptuelles: Le désir s’oppose ainsi aux notions suivantes:
Du besoin: tendance de l’organisme, purement physiologique. Le désir, contrairement au besoin, est spirituel.
De l’instinct: tendance innée. Contrairement à l‘instinct animal qui se caractérise par un comportement spécifique, irréfléchi
et immuable, le désir humain possède un caractère historique, c’est à dire qu’il évolue sans cesse. Comme le souligne
Rousseau, l’homme est cet animal sans instinct qui peut se métamorphoser en vertu de sa perfectibilité.
Du fantasme : mise en scène imaginaire, consciente ou inconsciente, par laquelle le sujet exprime et satisfait un désir plus ou
moins refoulé.
De la pulsion: chez Freud, processus dynamique, issu de l’inconscient, et consistant en une poussée, une force, faisant tendre
l’organisme vers un but, de manière à supprimer un état de tension organique. Le désir, par opposition à la pulsion, est
conscient.
De l’acte volontaire, lequel suppose réflexion, délibération, décision. Le désir semble constituer le premier niveau de l’activité
volontaire, sans atteindre le degré de rationalité de celle-ci.
De la passion: du latin « patior », « souffrir », « pâtir », « subir »; au 17ème siècle (cf. Descartes), les passions désignent tous
les phénomènes passifs de l’âme. À partir du 18ème siècle, la passion est comprise comme une tendance d’une certaine
durée, accompagnée d’états affectifs et intellectuels assez puissante pour dominer la vie de l’esprit. La passion est ainsi
devenue une inclination non maîtrisable, conduisant à une rupture de l’état psychologique. Chez Hegel, plus
particulièrement, la passion devient la force qui nous pousse à agir: « Rien de grand n’a jamais été accompli ni ne saurait
s’accomplir sans les passions » (Hegel, Philosophie de l‘esprit). Contrairement au désir, la passion marquerait le moment
où un désir ponctuel et passager est devenu capable d’influencer l’ensemble de la vie psychique.
De l’amour : l’amour est désir d’un autre homme.

2
Définition de bonheur : Etat de complète satisfaction (de « bon » et « heur », qui vient du latin augurium, présage, chance,
le bonheur est donc lié à l’idée de chance). Cet état est durable.
Distinctions conceptuelles : Le bonheur se distingue :
De la joie, état de satisfaction intense, et du plaisir, sensation agréable, qui sont toutes deux des émotions éphémères, toujours
liées à un objet particulier
De la béatitude : état de plénitude et de bonheur parfait (dans la théologie chrétienne, état de bonheur absolu et éternel auquel
accéderont les justes dans l’autre monde).
Problématique : Par définition, le désir est un manque, tandis que le bonheur désigne un état de plénitude, où rien ne manque.
Il semble donc que le bonheur exige que tous nos désirs soient comblés. Mais, être heureux, est-ce assouvir tous ses désirs ?
1) Le fait de désirer n’est-il pas l’expression d’un manque, d’une imperfection ?
2) Ne désirons-nous que le bonheur ?
3) Faut-il éliminer les désirs ?
I. DESIRER : UNE SOURCE DE SOUFFRANCE OU DE BONHEUR ?
Dans cette première partie du cours, nous étudierons la nature du désir. Quelle est la spécificité du désir par rapport à toute
autre forme de tendance ? D’un côté, le désir serait la manifestation de notre insertion dans la nature, dont témoigne notre corps,
ses tendances et ses besoins, pulsions ou instincts ; mais il est aussi le signe de notre singularité d’humain : le désir fait intervenir
l’imagination, l’intellect, et nous emporte plus loin que notre corps. En quoi le désir est-il spécifiquement humain ? Nous
verrons que c’est parce que l’homme est un sujet qu’il a des désirs.
1/ Le besoin est naturel quand le désir est culturel:
Le désir est souvent défini par différence avec le besoin : le besoin serait naturel, nécessaire, limité, tandis que le désir serait
artificiel, superflu, illimité.
- Des privations différentes : Autrement dit, on ne peut se passer de nos besoins, alors qu’on peut réprimer nos désirs.
Nous pouvons remarquer que la privation d’un besoin et celle d’un désir s’opposent: la carence, qui désigne un besoin
non satisfait diffère de la frustration, qui exprime un désir non satisfait.
- Artificiel : Le désir est artificiel, autrement dit, il relève de l’acquis et non de l’inné. Sa dimension culturelle s’observe
dans sa variabilité historique et géographique.
- Limité : Le besoin est limité, parce qu’une fois comblé, il disparaît (provisoirement). Le désir, lui, est insatiable (cf.
Don Juan). A peine satisfait, le désir renaît, se porte sur un nouvel objet.
Le désir est spirituel : On dit encore que le corps a des besoins tandis que l’âme a des désirs. Le désir est ainsi une notion qui
implique la subjectivité. Le besoin, au contraire, est une réalité naturelle, qui enracine l’homme dans son corps et dans une
nature animale. Il est la traduction psychique d’un déséquilibre physique. Le désir, lui, s’il prend souvent sa source dans le
besoin, relève d’une construction intellectuelle.
À partir de quand un besoin devient-il un désir? Le désir n’est-il que le prolongement du besoin, son expression
humaine, ou bien le désir recèle-t-il une différence irréductible? Entre besoin et désir, y a-t-il continuité ou
discontinuité?
Désir et conscience du temps : Besoin et désir sont irréductibles car le désir suppose la conscience du temps, quand le besoin
s’enracine dans l’instinct et dans l’immédiateté. Or l’homme possède ce que Hegel appelle une « double existence ». Grâce à
sa conscience, l’homme est capable d’accéder au temps alors que les animaux vivent dans un instant éternel. La conscience
humaine est mémoire nous disait Locke. C’est parce qu’il possède une mémoire, il peut entretenir le souvenir d’un objet, le
désirer dans l’avenir. DESCARTES dans Les Passions de l’âme, article 86, définit ainsi le désir : « La passion du désir est une
agitation de l’âme causée par les esprits qui la dispose à vouloir pour l’avenir les choses qu’elle se représente être convenables.
Ainsi on ne désire pas seulement la présence du bien absent, mais aussi la conservation du présent, et de plus l’absence du
mal, tant de celui qu’on a déjà que de celui qu’on croit pouvoir recevoir au temps à venir. »
- Le désir est corporel : Le désir est une « passion », autrement dit, il est quelque chose qui est subi par l’âme et qui
prend sa source dans le corps (au contraire d’une action, où c’est l’âme qui dirige le corps). Les « esprits » dont parle
ici Descartes sont les esprits animaux qui circulent dans notre corps, et qui permettent la communication entre l’âme
et le corps : dans le cas d’une passion, ce sont les esprits animaux qui atteignent la glande pinéale et qui lui
transmettent une passion qui vient du corps.
- Désir et conscience : Mais s’il provient du corps, le désir exige la conscience du temps : c’est « vouloir pour l’avenir »
quelque chose. Le désir renvoie toujours à notre présent (le bien que nous n’avons pas, le mal que nous avons) et
suppose la capacité de se projeter dans le futur.
- Autre définition (Spinoza) : L’importance de la dimension consciente dans la caractérisation du désir se retrouve
chez Spinoza lorsqu’il définit le désir comme « l’appétit accompagné de la conscience de lui-même » (Ethique, III,
scolie de la proposition 9).
Prolongement [LE BONHEUR] : PASCAL, Les Pensées :
« Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent venir, comme pour hâter son
cours ; ou nous rappelons le passé, pour l'arrêter comme trop prompt : si imprudents que nous errons dans les temps qui ne
sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient : et si vains que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et
échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C'est que le présent, d'ordinaire, nous, blesse. Nous le cachons à notre vue parce
qu'il nous afflige et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir, et
pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance, pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver.
Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent
; et, si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin : le
passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre ;

3
et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. »
- Le divertissement : Dans ce texte, Pascal tire une conséquence de cette conscience humaine du temps : la tendance
au divertissement. L’homme ne sait pas profiter du temps présent, il passe son temps à regretter le passé ou à anticiper
l’avenir. Il s’étourdit avec de multiples activités pour fuir ce présent : c’est ce qu’il appelle le divertissement (qui n’a
plus ici le sens ordinaire de « loisir »). Or, le temps présent est « le seul qui nous appartient », et le seul qui puisse
nous apporter la plénitude. Le divertissement nous éloigne du bonheur : « La seule chose qui nous console de nos
misères est le divertissement, et cependant c’est la plus grande de nos misères. »
- La fuite du présent : « Nous ne tenons jamais au temps présent » observe Pascal ; Si nous fuyons le présent, c’est
pour deux raisons : soit « il nous afflige », et alors nous voulons le voir cesser ; soit « il nous est agréable », et alors
la conscience de son caractère éphémère nous empêche d’en profiter. « Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous
espérons de vivre ; et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. »
- Les désirs, ennemis du bonheur : Ainsi, nous voyons que nos désirs participent à cette fuite du moment présent, et
nous conduisent à « [errer] dans les temps qui ne sont pas nôtres ». Les désirs semblent ainsi s’opposer au bonheur.
[Pour approfondir : objection : même un besoin est culturel : tout besoin n’est-il pas aussi une construction artificielle ?
MARX, Travail salarié et capital
« Qu’une maison soit grande ou petite, tant que les maisons d’alentour ont la même taille, elle satisfait à tout ce que,
socialement, on demande à un lieu d’habitation. Mais qu’un palais vienne s’élever à côté d’elle, et voilà que la petite maison
se recroqueville pour n’être plus qu’une hutte.
C’est une preuve que le propriétaire de la petite maison ne peut désormais prétendre à rien, ou à si peu que rien ; elle aura
beau se dresser vers le ciel tandis que la civilisation progresse, ses habitants se sentiront toujours plus mal à l’aise, plus
insatisfaits, plus à l’étroit entre leur quatre murs, car elle restera toujours petite, si le palais voisin grandit dans les mêmes
proportions ou dans des proportions plus grandes … Nos besoins et nos jouissances ont leur source dans la société ; la mesure
s’en trouve donc dans la société, et non dans les objets de leur satisfaction. Etant d’origine sociale, nos besoins sont relatifs
par nature. »
- La relativité des désirs : Lorsque Marx affirme : « étant d’origine sociale, nos besoins sont relatifs par nature », il
souligne la dimension sociale du besoin. L’homme est constitutivement un être social. Le besoin ne peut être défini
que dans une société déterminée qui conditionne l’individu à ressentir tel ou tel besoin.
- Besoin et reconnaissance : Ici, le besoin n’a pas pour but une satisfaction physiologique mais une reconnaissance de
soi par autrui. Le besoin est ici défini comme un manque par comparaison avec autrui. Va l’attirer et être éprouvé
comme privation intolérable ce qui est possédé par l’autre, perçu comme socialement supérieur. De là le caractère
inépuisable des besoins humains.
Nous atteignons une caractéristique essentielle du désir humain : il est désir d’un autre désir ]
Conclusion : Désir et besoin s’opposent, comme la culture et la nature s’opposent. Le désir, contrairement au besoin,
est une construction de notre conscience (qui peut éventuellement prend sa source dans un besoin). Le désir suppose en
effet la capacité de se représenter le temps. Par conséquent, les désirs humains subissent une évolution historique et
dépendent de la culture dans laquelle nous vivons. Il peut être un obstacle au bonheur, en ce qu’il nous empêche de
goûter au présent.
2/ Le désir comme manque :
Le désir possède une structure négative: le désir prend la forme du manque. L’étymologie nous l’indique : désir vient de
« desiderium », de « sidus », étoile, qui signifie « regret d’un astre perdu ».
Le désir est la marque de la finitude humaine: Quel que soit l’objet de mon désir, le désir est manque de cet objet vers lequel
il me porte.
citation: DESCARTES, Méditation métaphysique, III: « Car comment serait-il possible que je pusse connaître que je doute et
que je désire, c’est à dire qu’il me manque quelque chose, si je n’avais en moi aucune idée d’un être plus parfait que le mien,
par la comparaison duquel je connaîtrais les défauts de ma nature? »
- Le désir comme manque d’être et le doute comme manque de connaissance valent pour signe de l’existence de
Dieu. C’est la marque de notre nature finie, de notre défaut, de notre « misère » et de notre imperfection.
Texte: PLATON, Le Banquet: « Le mythe d’Aristophane »
L’ouvrage : Le Banquet est un dialogue de Platon qui se déroule pendant un banquet organisé par Agathon, qui vient de
remporter le 1er prix de tragédie, et qui a pour objet de caractériser ce qu’est l’amour. Chacun des convives du banquet doit
faire l’éloge d’Éros, dieu de l’amour. Pour Platon, l’amour équivaut au désir. Aristophane, un des invités, propose une définition
du désir : le désir est manque de son objet, c’est à dire qu‘il est désir de quelque chose qu‘on ne possède pas. « Ce qu'on n'a
pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » Pour illustrer cela, Aristophane, un convive
du banquet, raconte un mythe (connu sous le nom mythe d’Aristophane):
- Les hommes primitifs : A l’origine, l’humanité était composée de 3 genres: masculin, féminin, androgyne. Leurs
corps est rond, ils ont 4 jambes, 4 bras, deux visages.
L’orgueil de ces hommes : Ces hommes primitifs entreprennent de s’attaquer aux dieux. Zeus, pour les punir,
décide de les couper en deux. Les dieux tenaient à garder en vie les hommes pour qu’ils continuent à les honorer de
leurs sacrifices. Apollon s’occupe de cette opération, dont le nombril est la cicatrice. Depuis cette coupure, qui a
donné l’homme tel que nous le connaissons maintenant, chacun recherche sa moitié perdue. Le désir est donc un
châtiment humain destiné à expier l’orgueil humain.
- Apparition de l’homme actuel : Mais les hommes, qui n’aspiraient qu’à retrouver leur moitié, mourraient de faim et
d’inaction. Zeus, pris de pitié, inventa l’amour et l’enfantement, de façon à ce que les hommes puissent connaître des
périodes de satiété momentanées pendant lesquelles ils puissent travailler sans être tiraillés par le désir. Cela explique
que les 3 sortes d’amour (homme/homme, femme/femme et homme/femme) soient possibles.

4
L’amour exprime la nostalgie de l’unité perdue de l‘homme, ainsi que le désir de ne plus faire qu‘un.
Le désir de l’impossible et de l’interdit : Ainsi s’explique chez l’homme sa tendance à désirer l’impossible et l’interdit, car
l’impossible est ce qui, par définition, lui manquera toujours (exemple : Orphée et la quête d’Eurydice).
Conclusion : Contrairement au besoin, le désir est par nature manque. Il est toujours désir de ce que nous n’avons pas.
Par là, le désir nous expose à l’altérité, à ce qui nous est extérieur.
Transition : Le problème d’une telle caractérisation du désir est qu’elle ne rend pas compte de la variabilité de nos désirs et
de leur plasticité.
3/ Désir et imagination :
Le désir est construit par l’imagination : L’imagination est la faculté qu’a la pensée de se représenter des objets absents. Son
rôle dans l’élaboration et l’entretien du désir s’avère ainsi considérable.
Texte [LE BONHEUR] : ROUSSEAU, La Nouvelle Héloïse, 1761
« Malheur à qui n'a plus rien à désirer ! il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que
de ce qu'on espère, et l'on n'est heureux qu'avant d'être heureux. En effet, l'homme avide et borné, fait pour tout vouloir et
peu obtenir, a reçu du ciel une force consolante qui rapproche de lui tout ce qu'il désire, qui le soumet à son imagination, qui
le lui rend présent et sensible, qui le lui livre en quelque sorte, et pour lui rendre cette imaginaire propriété plus douce, le
modifie au gré de sa passion. Mais tout ce prestige disparaît devant l'objet même; rien n'embellit plus cet objet aux yeux du
possesseur ; on ne se figure point ce qu'on voit; l'imagination ne pare plus rien de ce qu'on possède, l'illusion cesse où
commence la jouissance. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité et tel est le néant des choses
humaines, qu'hors l'Être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Si cet effet n'a pas toujours lieu sur
les objets particuliers de nos passions, il est infaillible dans le sentiment commun qui les comprend toutes. Vivre sans peine
n'est pas un état d'homme; vivre ainsi c'est être mort. Celui qui pourrait tout sans être Dieu, serait une misérable créature ; il
serait privé du plaisir de désirer ; toute autre privation serait plus supportable. »
- Le rôle de l’imagination : L’imagination est ici décrite comme « une force consolante qui rapproche de lui tout ce
qu’il désire ». En effet, l’imagination nous permet d’avoir « en esprit » l’objet de notre désir, et permet donc
d’entretenir ce désir.
- Supériorité de l’imaginaire sur le réel : Mais la conséquence de cette jouissance imaginaire de l’objet du désir est
qu’elle est toujours supérieure à la jouissance réelle de celui-ci. En effet, l’imagination le « modifie », l’« embellit »,
le « pare », même si c’est une illusion. Pour Rousseau, « le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’être
habité », « il n’y a rien de beau que ce qui n’est pas ».
- Désir et bonheur : Par conséquent, c’est le désir, et non la jouissance qui nous rend heureux : l’homme qui pourrait
tout obtenir serait, aux dires de Rousseau, le plus malheureux des hommes.
[Pour approfondir : le désir, moteur de l’activité humaine : LEIBNIZ, Nouveaux Essais sur l’entendement humain
(1704).
« L’inquiétude (uneasiness) qu’un homme ressent en lui-même pour l’absence d’une chose qui lui donnerait du plaisir si elle
était présente, c’est ce qu’on nomme désir (desire), qui est plus ou moins grand selon que cette inquiétude est plus ou moins
ardente (…) L’inquiétude est le principal, pour ne pas dire le seul aiguillon qui excite l’industrie et l’activité des hommes.
Car quelque bien qu’on propose à l’homme, si l’absence de ce bien n’est suivie d’aucun déplaisir, ni d’aucune douleur, et que
celui qui en est privé, puisse être content et à son aise sans le posséder, il ne s’avise pas de le désirer, et moins encore de faire
des efforts pour en jouir. Il ne sent pour cette espèce de bien qu’une pure velléité, terme qu’on emploie pour signifier le plus
bas degré du désir, et ce qui approche le plus de cet état où se trouve l’âme à l’égard d’une chose qui lui est tout à fait
indifférente, et qu’elle ne désire en aucune manière, lorsque le déplaisir que cause l’absence d’une chose est si peu
considérable, et si mince, pour ainsi dire, qu’il ne porte celui qui en est privé qu’à de faibles souhaits sans se mettre autrement
en peine d’en rechercher la possession. Le désir est encore éteint ou ralenti par l’opinion où l’on est, que le bien souhaité ne
peut être obtenu, à proportion que l’inquiétude de l’âme est dissipée, ou diminuée par cette considération. »
- Définition du désir : Dans ce texte, Leibniz identifie désir et inquiétude : « L’inquiétude (ou uneasiness en anglais) qu’un
homme ressent en lui-même par l’absence d’une chose qui lui donnerait du plaisir si elle était présente, c’est ce qu’on
nomme désir. »
- Le moteur de notre activité : Or, poursuit Leibniz, « l’inquiétude est le principal, pour ne pas dire le seul aiguillon qui
excite l’industrie et l’activité des hommes », c’est-à-dire que l’état de tension intérieure dans lequel nous plonge le désir
est le moteur de notre action. Si l’absence d’un objet n’engendre pas de souffrance, alors nous ne ferons rien pour l’obtenir ;
tout au plus aurons-nous une « velléité » d’avoir cet objet, mais nous ne nous donnerons pas les moyens pour le posséder.
- Autre citation : Nous pouvons reprocher la position de Leibniz de celle de Rousseau : « Quoi qu'en disent les moralistes,
l'entendement humain doit beaucoup aux passions, qui, d'un commun aveu, lui doivent beaucoup aussi. C'est par leur
activité que notre raison se perfectionne; nous ne cherchons à connaître que parce que nous désirons de jouir. » Sur
l'origine de l'inégalité, 1755.]
Conclusion : Si le désir porte sur ce qui nous manque, c’est parce que « l’imagination ne pare plus rien de ce qu’on
possède ». Seul ce que nous n’avons pas est magnifié par l’imagination. C’est aussi ce que disait Proust dans Les Plaisirs et
les Jours, 1896 : « Le désir fleurit, la possession flétrit toutes les choses. »
Le désir est à la fois source de souffrance (car il témoigne d’un manque) et de bonheur (c’est le fait de désirer, non
de posséder qui rend heureux).
Transition : Le désir entretient une relation ambigüe avec son objet : comme le remarque Montaigne, « nous défendre quelque
chose, c’est nous en donner envie, nous l’abandonner tout à fait, c’est nous en engendrer mépris ». Si les désirs portent sur ce
que nous n’avons pas, l’absence suffit-elle à rendre un objet désirable ? Qu’est-ce qui explique que je désire tel objet plutôt que
tel autre ?

5
II. NE DESIRONS-NOUS QUE LE BONHEUR ?
Quel est l’objet de mon désir ? L’objet que je désire est-il naturellement désirable, ou bien est-ce ma subjectivité qui lui attribue
ce caractère désirable ?
1/ Tous les hommes désirent d’être heureux :
L’homme désire le souverain bien : La tradition grecque considère que l’homme désire un objet par nature désirable.
ARISTOTE, dans l’Ethique à Nicomaque, livre I observe que tous les hommes désirent être heureux.
- Le souverain bien : Le bonheur constitue le Souverain Bien, car il est recherché comme une fin absolue et non
relative.
- Les biens particuliers : Chaque activité particulière tend vers quelque bien: la médecine vers la santé, l’art militaire
vers la victoire, l’art financier vers la richesse.
- La fin la plus haute : Ces biens, cependant, ne sont pas poursuivis pour eux-mêmes, mais seulement comme des
moyens en vue d’une fin plus haute qui est le bonheur. Toutes les fins particulières se subordonnent à cette fin
suprême unique qui n’est pas un moyen en vue d’une fin ultérieure, mais qui est recherchée en elle-même et pour
elle-même. Nous désirons être heureux pour être heureux.
[Pour approfondir [LE BONHEUR] : Les trois modèles de vie : Mais qu’est-ce qu’une vie heureuse? Aristote définit trois
types de vie, et trois idéaux de bonheur :
- La vie de jouissance, propre à la foule. Le but d’une telle vie est le plaisir. Selon Aristote, chaque être vivant possède
une hexis, une vertu propre, et l’excellence pour chacun consiste à remplir au mieux la fonction qui convient à sa
nature. Or, une vie sensitive ne nous distingue en rien des bêtes qui éprouvent comme nous les sensations de plaisir
et de peine. Une vie de plaisir ne nous permet pas de nous accomplir comme humain. Le plaisir ne doit pas être la fin
dernière de nos activités, mais une fin surajoutée qui les couronne lorsqu’elles sont menées à bien. Le plaisir, trop
éphémère, ne peut constituer le bien suprême.
- La vie politique, à laquelle aspirent surtout les gens cultivés soucieux de l’honneur. C’est l’idéal timocratique. Mais
« l’honneur apparaît une chose trop superficielle pour être l’objet recherché. » selon Aristote. Il met l’homme à la
merci de l’opinion inconstante de la foule. Un bien qui ne dépend pas de nous et qui peut être ravi selon les caprices
de la fortune n’est pas un bien véritable. De même, la richesse n’est qu’un moyen utile en vue d’une fin. C’est un
bien relatif et périssable, qui n’est pas à l’abri des revers de fortune. Honneur et richesse ne peuvent être le bien
suprême.
- [LA DEMONSTRATION] La vie contemplative prisée par les sages. Selon Aristote, la contemplation est la fin
suprême de l’existence humaine. La vie contemplative est supérieure en dignité à la vie active, tournée vers les
affaires humaines. Seule la philosophie est à même de procurer la vie heureuse. Aristote définit la sagesse au livre
VII de l’Ethique à Nicomaque: « La sagesse sera la plus achevée des formes du savoir. Le sage doit non seulement
connaître les conclusions découlant des principes, mais encore posséder la vérité sur les principes eux-mêmes. La
sagesse sera ainsi à la fois raison intuitive et science, science munie en quelque sorte d’une tête et portant sur les
réalités les plus hautes. »
- Définition de la science : La science est pour Aristote un ensemble de connaissances destinées à expliquer les
phénomènes en les rattachant à leurs causes et fondées sur des démonstrations. Or, une démonstration consiste
à tirer des conclusions à partir de principes admis et indémontrables. Elle est imparfaite, car elle repose sur des
principes dont on ne rend pas raison.
- Définition de la philosophie : La philosophie, elle, s’attache aux fondements des principes et s’efforce de
contempler les causes premières. Elle sera donc science, car elle s’appuie elle aussi sur des démonstrations, et
raison intuitive, car elle saisit immédiatement les principes. La philosophie est métaphysique, « science de l’être
en tant qu’être », science qui détermine l’existence d’un principe suprême, cause de l’être et de son mouvement.
Sa tâche essentielle consiste à élever l’intellect vers des objets d’une réalité supérieure à l’homme, à savoir les
astres dont les révolutions constantes et régulières offrent un modèle de nécessité, pour le tourner enfin vers la
contemplation du « premier moteur », substance première.
- La vie prudente ou vie « mixte » (politique + contemplation) : mais, la vie contemplative semble inaccessible aux
hommes: « une vie de ce genre sera trop élevée pour la condition humaine, car ce n’est pas en tant qu’homme qu’on
vivra de cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent en nous » nous dit Aristote. À côté de cette
vie contemplative, il existe un autre type de sagesse, elle typiquement humaine, symbolisée par la prudence. La
prudence, phronésis, est cette vertu intellectuelle qui est le propre des hommes capables de délibérer correctement
sur ce qu’ils doivent faire. La prudence est la sagesse de la vie politique. Le prudent est celui qui voit et qui prévoit
ce qui lui est profitable. La prudence est la qualité d’adaptation aux circonstances, contrairement à une sagesse
immuable et universelle. La prudence est une vertu à caractère humain et, à ce titre, elle ne peut prétendre l’emporter
sur une sagesse à caractère divin. Aristote préconise donc un genre de vie mixte qui réconcilie la vie politique et la
vie contemplative.]
Conclusion : nous désirons ce qui est suprêmement désirable, le Souverain Bien, autrement dit le Bonheur.
Transition : mais si la vie contemplative est un idéal très difficile à atteindre, il semble que l’objet du désir porte moins sur le
Souverain Bien que sur un bien à la portée des humains. Reste à déterminer un tel bien.
2/ Nous estimons ce que nous désirons, et non l’inverse :
Le désir source de valeur : SPINOZA, dans la 3ème partie de l’Ethique, plus précisément dans le scolie de la proposition 9,
procède donc à une révolution axiologique en invalidant la thèse d’une objectivité absolue des valeurs: les choses ne sont pas
bonnes en elles-mêmes mais relativement à notre désir. Selon Spinoza, c’est donc le désir qui est à l’origine de la valeur
que nous attribuons à la chose. Les choses ne sont pas désirées parce qu’elles sont bonnes, mais parce que nous les
désirons : nous « ne nous efforçons à rien, ne voulons, n’appétons ni ne désirons aucune chose, parce que nous la jugeons
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%