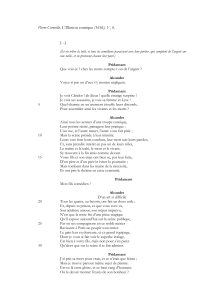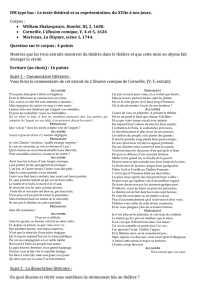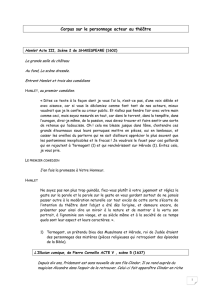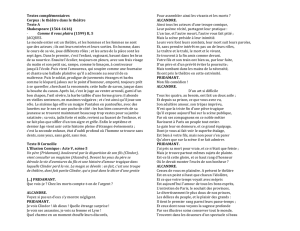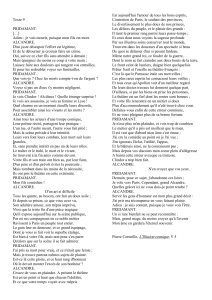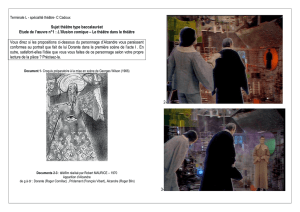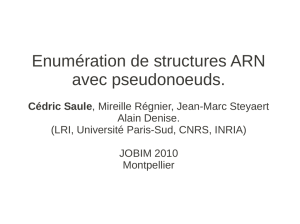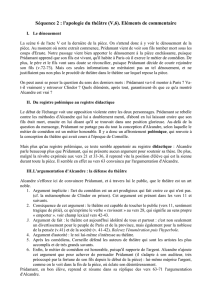un mouvement littéraire et culturel : le baroque

LYCEE PIERRE LAROUSSE
6, rue des montagnes, 89130 Toucy
Tél. : 03 86 44 14 34
BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL
EPREUVE ANTICIPEE DE FRANÇAIS
SESSION DE JUIN 2009
Classes de 1ère Scientifique
DESCRIPTIF
DES LECTURES
ET ACTIVITES
NOM :
PRENOM :
Ce descriptif contient 6 séquences.
Le chef d’établissement Le professeur de français
Mr Thierry Mme Tellier

SEQUENCE N°1 : Arthur Rimbaud, ou la recherche d'une écriture
poétique
Objet d’étude : la poésie
Problématique retenue : en quoi le langage poétique se distingue-t-il du langage
ordinaire ?
LECTURES ANALYTIQUES :
1. Rimbaud, « Le Dormeur du val », octobre 1870
2. Rimbaud, « Ma Bohême », octobre 1870
3. Rimbaud, « Le bateau Ivre », strophes 18 à 25, 1871
4. Rimbaud, « Aube »,
Illuminations
, 1886
THEMES ET PROBLEMATIQUES ABORDES :
1. les formes poétiques, du vers à la prose (le travail du rythme et des sonorités ; les figures de
style)
2. poésie et autobiographie : le « je » poétique ; le lyrisme
3. poésie et engagement
4. poésie et initiation : l'expérience poétique
5. les mouvements poétiques au XIXe siècle : le romantisme, le Parnasse, le symbolisme
LECTURE CURSIVE ET DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES :
- Lecture cursive de l'œuvre de Rimbaud (Poésies, Une Saison en Enfer, Illuminations)
- Groupements de textes :
1. manifestes poétiques au XIXe siècle : Rimbaud, extraits de la « Lettre du Voyant » ;
Rimbaud, « Voyelles » ; Gautier, « L'Art » ; Verlaine, « Art Poétique »
2. le mythe de Rimbaud : Pierre Michon, Rimbaud le fils, 1991; René Char, « Tu as bien fait de
partir, Arthur Rimbaud ! », Fureur et mystère, 1947
– Dans le cadre de « Lycéens au cinéma », projection de Dead Man de Jim Jarmusch :
- présentation de William Blake
- Dead Man, ou la réalisation du programme poétique de Rimbaud : « Voici le temps des
Assassins », « La poésie ne rythmera plus l'action ; elle sera en avant »
- cinéma et poéticité
ACTIVITE PERSONNELLE :
Réalisation d'une anthologie de quatre poèmes de Rimbaud, dont un en prose. Les élèves doivent
apprendre ces poèmes et réaliser un travail d'écriture libre d'une page par poème.

SEQUENCE N°2 : Lecture de L’Illusion Comique de Corneille
Objets d’étude : le theâtre
un mouvement littéraire et culturel : le baroque
Problématique retenue : en quel sens peut-on dire que le théâtre est un art de
l'illusion ?
LECTURES ANALYTIQUES :
1. Matamore : acte II, scène 2 (v.257-290 et 317-346)
2. le monologue de Clindor : acte IV, scène 7 (v.1237-1296)
3. l’apologie du théâtre : acte V, scène 6 (v.1745-1824)
4. Alcandre et Pridamant : étude comparée de acte I, scène 2 (v.121-153) et acte V,
scène 6 (v.1725-1747)
THEMES ET PROBLEMATIQUES ABORDES :
2. le mélange des genres et des registres dans la pièce
3. le théâtre dans le théâtre et la mise en abyme
4. l’apologie du théâtre, le théâtre comme illusion et révélation
5. mise en scène et interprétation du texte
LECTURES ET DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES :
1. Lecture intégrale :
- Corneille, L’Illusion Comique, première version (1635)
2. Lecture cursive :
– Tennessee Williams, Un tramway nommé désir (1947)
3. Textes complémentaires :
4. un groupement sur les genres dramatiques dans les années 1630
5. divers textes de théâtre accompagnant les extraits étudiés
4. Sortie au théâtre :
Organisation d'une sortie au théâtre d'Auxerre : Rêve d'A, de et par Olivier Brunhes
– travail autour du mythe d'Orphée et de sa réécriture
– un spectacle baroque ? Réflexion sur la mise en scène du rêve dans la pièce et sur les différents
procédés mis au service de l'illusion (lumière, musique, décors...)
5. Dans le cadre de « Lycéens au cinéma », projection de Tout sur ma mère d'Almodovar :
1. l'exploitation d'Un Tramway nommé désir et les différents procédés de mise en abyme
2. la notion de point de vue
3. une réflexion sur l'art et son pouvoir d'illusion (écriture, cinéma, théâtre dans le film)
ACTIVITE PERSONNELLE :
Rédaction d'une critique du spectacle Rêve d'A, à partir de la lecture de critiques professionnelles.

SEQUENCE N°3 : des animaux et des hommes, l'apologue dans tous ses
états
Objets d’étude : convaincre, persuader, délibérer : l’apologue
la poésie
Problématique retenue : l’apologue est-il un moyen efficace pour convaincre et
persuader ?
LECTURES ANALYTIQUES :
1. La Fontaine, « Les Animaux malades de la peste »,
Fables
, VII, 1, 1678
2. Charles Perrault, « Le Petit Chaperon rouge »,
Contes du temps passé
, 1697
3. George Orwell,
La Ferme des Animaux
, chapitre 2, 1945 (traduit de l'anglais par
Jean Quéval)
4.
Evangile selon saint Jean
, X, 1-21, traduction de Lemaître de Sacy (XVIIe siècle)
THEMES ET PROBLEMATIQUES ABORDES :
1. L’apologue
– plaire : l’art du récit, la poésie
– instruire : l’argumentation indirecte et le rapport entre fable et morale ; la notion d'allégorie
– les différentes formes de l'apologue, fable, conte, contre-utopie, parabole
2. Histoire littéraire : le classicisme, la querelle des Anciens et des Modernes
3. Culture générale : la pensée chrétienne
LECTURE CURSIVE ET DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES :
4. Lectures cursives :
La Ferme des Animaux d'Orwell
Un Evangile au choix parmi les trois évangiles synoptiques
1. Deux autres versions du Petit Chaperon rouge
une version populaire et la version des frères Grimm
ACTIVITE PERSONNELLE :
L'animal dans la bande dessinée : lecture au choix des bandes dessinées suivantes et compte-rendu
de lecture.
2. Blacksad, Artic-Nation de Diaz Canales et Guarnido, Dargaud
3. Garulfo, 1. De Mares en châteaux, Ayroles et Maïorana, Delcourt
4. De capes et de crocs, 1. Le Secret du janissaire, Ayroles et Masbou, Delcourt

SEQUENCE N°4 : Lecture de Frankenstein de Mary Shelley
Objet d’étude : le roman
Problématique retenue : en quoi le thème de la créature artificielle met-il en
évidence les artifices de la création romanesque ?
LECTURES ANALYTIQUES :
3. la création du monstre : début du chapitre 5 jusqu'à « à qui j'avais donné la
vie de façon si misérable »
4. un monstre philosophe : fin du chapitre X (extraits)
5. la naissance du mal : fin du chapitre XVI depuis « C'était le soir »
6. l'épilogue : fin du roman depuis « Vous qui appelez Frankenstein votre ami »
THEMES ET PROBLEMATIQUES ABORDES :
– Histoire littéraire : le roman gothique ; le romantisme
– De Prométhée à Frankenstein : la dimension mythique du roman
– Création divine, création scientifique et création artistique
– Une réflexion sur l'origine du mal : Rousseau et Sade
– Structure du roman et enjeux narratifs
– La notion de personnage romanesque
– Initiation à la littérature comparée : étude du texte original du chapitre 5, esquisse d'une
traduction et comparaison avec la version proposée par Germain d'Hangest
LECTURE INTEGRALE ET DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES :
– Lecture intégrale du roman (édition conseillée : Garnier-Flammarion, traduction de Germain
d'Hangest)
– Introduction à l'édition de 1831
– Divers extraits de la Bible, et notamment les premiers versets de la Genèse
– Dans le cadre de « Lycéens au cinéma », projection de Vertigo de Hitchcock et de Tout sur ma
mère d'Almodovar :
– la narration au cinéma : espace, temps, voix, points de vue
– la créature artificielle : Scottie et Pygmalion ; la représentation du corps dans Tout sur ma mère,
de la transplantation d'organes au transexualisme
ACTIVITE PERSONNELLE :
Réflexion personnelle et rédaction d'un texte argumentatif autour de la question du progrès
scientifique : le progrès scientifique peut-il et doit-il être illimité ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%