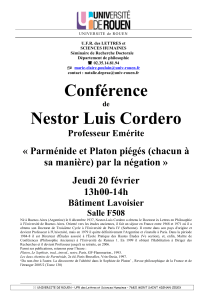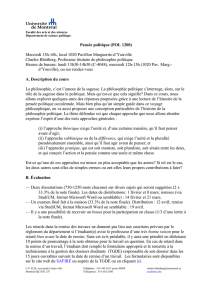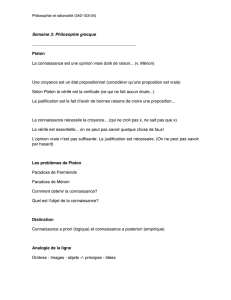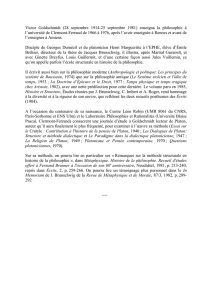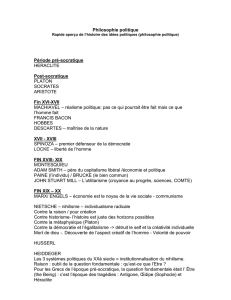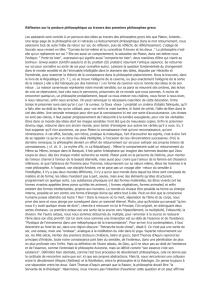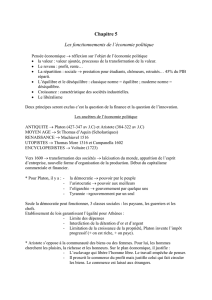1 - Free

1. Une science est généralement définie par son objet propre ce qui fait défaut à la
philosophie même en passant par son étymologie, « amour de la sagesse » en grec. De
plus l’usage courant que l’on en fait dénature également son sens premier. Ce sens
premier, Aristote sera le premier à le définir en introduisant la philosophie comme
épistémologie.
Aristote 384 AJC, Athènes à 17 ans, élève de Platon, précepteur d’Alexandre le grand,
fonde sa propre école vers 334. C’est Andronichos de Rhodes qui réunira ces textes
dans un corpus divisé en deux parties, une Physique, l’autre, Métaphysique.
Considérée plus tard comme trans physicam plutôt que post physicam. Aristote la
définissait lui-même comme « philosophie première ».
« C’est une science qui étudie l’étant en tant qu’étant et les attributs qui lui
appartiennent essentiellement. Et elle ne se confond avec aucune des sciences
dites particulières, car aucune de ces autres sciences ne considère en général
l’étant en tant qu’étant » (Métaphysique, livre gamma, 1003 à 20-24)
Etant = ce qui est ou encore l’objet DONC la philosophie est une science qui étudie
l’objet en tant que tel en général.
Cet objet en général étant pourvu d’attributs, ces attributs peuvent s’appliquer à tout
objet et seront appelés déterminations. (Espèce, genre, un/multiple, …)
Par là nous pouvons considérer la philosophie comme une théorie générale de la
connaissance ou de la science.
Le problème que l’on trouvait déjà chez Platon est de confondre une théorie de la
connaissance avec une théorie de l’objet ou ontologie. Il manque donc une théorie du
sujet.
2. Gaston Bachelard (1884-1962) est une figure assez originale du monde universitaire
français. Fonctionnaire des PTT, il étudia en dilettante les sciences et la philosophie,
présenta les concours et finit sa carrière comme professeur à la Sorbonne. Comme
Husserl il soutient que la science à besoin d’une philosophie pour se comprendre elle-
même. Il reproche à l’empirisme de manquer de clairvoyance sur ce qu’est la science.
Dans Le nouvel esprit scientifique de 1934, Bachelard dénonce l’empirisme et donc
l’observation des faits comme allant contre le propre de l’activité scientifique. Pour lui
l’organe le plus important de la science n’est pas la « vue » mais « l’interprétation ».
L’homme crée la science de par son esprit. Pour lui la science procède de la négation
du réel pour lui substituer quelque chose de plus profond que son expérience
immédiate.
Cela ne touche pas les empiristes, Claude Bernard nous dira par exemple qu’un théorie
scientifique n’a de sens que si elle est confirmée par des expériences, ce qui n’a de
véritable chance de se produire que si la théorie elle-même est induite des faits.
Bachelard nous aide donc « a contrario » à comprendre l’empirisme qui n’et non pas
un négativisme mais un positivisme ce qui signifie deux chose :
- Tout d’abord l’empiriste admet que la science accepte ou fait droit à quelque
chose comme une réalité qui lui préexiste. Quant à cette réalité, à moins d’en

trahir le sens, elle n’est pour nous qu’un ensemble de faits ou d’états de chose
dont nous faisons l’expérience par l’observation.
- La constitution scientifique des lois et des théories ne procède donc que de
cette position des faits dans l’expérience, laquelle constitue la seule assurance
préalable du scientifique.
D’où la seconde caractéristique de l’empirisme qui découle directement du
positivisme : l’inductivisme. Cela signifie que les lois scientifiques sont tirées des faits
d’observation par induction. Quant à l’induction on la définira simplement comme le
moyen par lequel on passe des faits aux lois.
3. Cette induction est également mentionnée par Newton dans les principes
mathématiques de philosophie naturelle (1687).
« Quant à la raison de ces propriétés de la gravité, je ne peux encore la déduire
des phénomènes, et je ne forge pas d’hypothèses (hypotheses non figo). En
effet, tout ce qui n’est pas déduit des phénomènes doit être appelé hypothèse et
les hypothèses, quelles soient métaphysiques, physiques, se rapportant aux
qualités occultes ou mécaniques, n’ont pas de place en philosophie
expérimentale. En cette philosophie, les propositions sont déduites des
phénomènes et rendues générales par induction. (Principes, trad. Française, p.
117-118. ed. Bourgeois, Paris, 1985).
Il parle d’induction pour qualifier le passage des propositions scientifiques
particulières aux propositions générales ou aux lois, tandis qu’il parle de déduction
pour qualifier le passage des phénomènes aux propositions particulières de la science.
A→ B : Déduction B→ C : Induction
Pourquoi dès lors Newton parle-t-il tantôt de déduction, tantôt d’induction pour
traduire le même processus de passage des phénomènes aux propositions de la
science ? Manifestement, parce qu’il les tient pour égales.
Déduction :
Tous les acides libèrent les atomes d’hydrogène au contact d’un métal.
La molécule de H2SO4 est un acide.
→ J’en déduirai donc :
La molécule de H2SO4 libère ses atomes d’hydrogène au contact d’un métal.
Induction :
Dans une induction, par contre, il n’existe pas à proprement parlé de
raisonnement et il semble donc impossible de considérer l’induction comme
une opération logique. Tout au plus, s’agit-il d’un acte de généralisation opérée
sur la base de l’observation des phénomènes, selon certaines règles
contraignantes.

LOIS
OBSERVATION induction déduction PREDICTIONS
EXPLICATIONS
Nous le nommerons désormais le scénario OLPE, et nous nous contentons de dire, que
ce scénario est celui qui défendu, au début du siècle passé jusqu’au moins 1930, par ce
courant de pensée très influent que l’on appelle l’empirisme logique ou aussi parfois le
néopositivisme. Mais c’est en Autriche autour du Cercle de Vienne ou Wiener Kreis
qu’il connut le plus de succès.
4. Platon s’opposait en fait à une version antique du relativisme, la mouvance sophiste.
Celle-ci prônait le langage comme outil par excellence, il s’agissait d’éducateurs
puisque vraisemblablement fort bien rémunérer, dont l’enseignement portait
uniquement sur la rhétorique.
Tout l’art du sophisme consiste à faire passer ce qui est faux pour vrai par le langage,
nous entendons encore aujourd’hui par « sophisme », un raisonnement faux qui sait se
donner les apparences de la vérité.
Il n’est pas utile de posséder un savoir théorique c’est-à-dire une connaissance des
choses pour un sophiste. Gorgias et Protagoras soutiennent que la vérité n’est qu’un
vain mot et dût-elle exister quelque part, elle nous serait inconnaissable. En fait, celle-
ci, bien entendu, diffère d’un homme à l’autre. Protagoras résumera dans un de ses
ouvrages la thèse relativiste de la sophistique en écrivant : « L’homme est la mesure de
toute chose». C’est en niant de la sorte toute possibilité d’une connaissance vraie ou
objective que le relativisme sophiste suscitera la réaction platonicienne et, avec elle, le
commencement de la philosophie.
5. Les mathématiques de l’époque se réduisaient à la géométrie inductive et graphique,
apparue en Grèce au 6ème siècle ACN avec Thalès de Milet (pyramide de Kheops),
Pythagore quant à lui, disciple de Thalès, connaissait déjà la méthode dite
d’apposition, les nombres étaient toujours représentés par des lignes ou des surfaces.
Toutefois, aussi puissante fut-elle sur le plan rationnel la géométrie de Pythagore
manquait encore de systématicité. Ce n’est qu’avec Euclide au 3ème siècle ACN que la
géométrie change de visage pour désormais se présenter comme un ensemble cohérent
de théorèmes et de démonstrations architectoniquement ordonnés à partir d’un nombre

très limité d’axiomes ou de postulats élémentaires. La géométrie euclidienne devient
une science purement hypothético-déductive.
Un siècle avant lui, Platon parlait déjà d’une science hypothético-déductive. Il y eut
donc des prédécesseurs mais il ne reste que « les éléments » d’Euclide comme trace
écrite. A l’époque moderne, il ne cessera d’être une référence pour les rationalistes qui
estimaient qu’on ne pouvait prétendre à la connaissance objective que si l’on parvenait
à l’établir more geometrico c’est-à-dire à la manière du géomètre.
La devise de l’académie fondée par Platon n’était autre que : « Nul n’entre ici s’il n’est
géomètre ». Platon fut un témoin direct de la décadence de la démocratie athénienne.
Dans La République, la question soulevée est celle de justice. Elle consiste à rendre à
chacun son dû, c’est-à-dire rendre à chacun ce qu’il mérite. Ici sont considérés les
individus.
Il faudra donc se tourner vers l’image de la justice dans la société, où celle-ci est
marque de l’unité, de l’équilibre et de la cohérence. Mais quelles connaissances
devraient posséder les gardiens de l’équilibre d’une telle société ? Bref comment
s’acquiert la connaissance ?
La connaissance ne peut s’édifier qu’en s’arrachant à l’empire des sensations. Au livre
VII de La République, Platon montre que c’est ce qui se passe en mathématique en
travaillant sur des entités totalement indépendantes du sensible et qui ne sont
seulement qu’intelligibles. La connaissance se consacre donc à des objets intelligibles
c’est-à-dire à des idées, à la différence des objets sensibles soumis au changement et
au devenir. C’est pourquoi ces objets peuvent être déduits par voie purement
rationnelle.
« La méthode dialectique est la seule qui en rejetant les hypothèses s’élève jusqu’aux
principes mêmes afin de s’y établir d’une façon solide ». Les mathématiques sont une
science hypothético-déductive, les objets idéaux abordés par les mathématiciens sont
des hypothèses, le travail de la philosophie sera d’en faire des vérités premières grâce
à la dialectique. Il appartient dès lors à la philosophie de démontrer comment nous
devons avoir à faire à de telles idées pour que soit garantie la vérité de ce dont nous
parlons. Comme le dira Husserl dans un discours 1923-1924 : « Il transpose à la
science le principe… de justification radicale ». En d’autres mots, il a assigné à la
philosophie cette tâche qu’aucune science ni aucune connaissance ne s’impose à elle-
même : fournir une justification ultime des vérités qu’elles prétendent établir.
6. Sa seule théorie de la connaissance, si l’on peut encore l’appeler par ce nom, fut alors
de montrer que l’intelligence ne parvient à la connaissance vraie qu’en se détournant
du premier pour uniquement contempler le second.
Ces difficultés sont doubles ou moins. Si le monde des idées est sans rappot avec le
monde sensible, si les réalités idéales fixes et éternelles sont totalement séparées des
réalités naturelles changeantes et en devenir, alors, outre le problème de ce
dédoublement du monde, comment sérieusement penser la possibilité d’une physique,
c’est-à-dire d’une science qui porte sur la nature matérielle comme telle. Et, de ce fait,
s’il n’y a pas de physique chez Platon, c’est tout simplement que lui-même l’a rendue
impossible. Ensuite, s’il faut admettre que les idées constituent une réalité à part

entière, cela suppose qu’elles ne sont pas seulement séparées de la réalité matérielle,
mais tout autant du sujet pensant. Mais où peuvent se trouver les idées et quelle
relation du sujet connaissant peut-il avoir avec elles ? La vision intellectuelle des idées
pensée par Platon n’arrangea rien à l’énigme.
Pourquoi a-t-il substitué à l’épistémologie une ontologie rationnellement
indéfendable ? Mais reconnaître au monde une rationalité interne, ce n’est pas chez les
Grecs le fruit d’une réflexion philosophique, c’est plutôt le fait d’une croyance
religieuse que l’on identifiera à un cosmocentrisme. Conformément à cette mentalité
cosmocentriste, Platon ne pouvait donc que faire exister les idées quelque part dans le
monde.
7. Pas de physique chez Platon. Aristote réhabilite le monde du sensible (l’être et le
devenir). Pour Aristote le devenir, le mouvement et les changements de toutes sortes
sont régis par des essences ou des formes immanentes au réel lui-même, plutôt que de
lui être transcendante ou extérieure. Il fera donc de la physique une science qualitative
encore prisonnière du cosmocentrisme. Chez Aristote, une théorie du sujet est abordée
dans son Traité sur l’Ame mais on ne nous explique pas comment des essences
générales peuvent se constituer en rapport avec le sujet connaissant. Ici encore
l’ontologie prend le pas sur l’épistémologie. La question devrait être : Comment les
choses nous apparaissent-elles de façon à être porteuse d’essences ? mais pour
Aristote, il va de soi que la réalité naturelle et sensible possède son propre principe
d’ordre et de permanence. On devra attendre l’intermède médiéval et chrétien pour
passer du cosmocentrisme au logocentrisme.
8. C’est reconnaître au monde une rationalité interne, ce qui n’est pas chez les Grecs le
fruit d’une réflexion philosophique mais plutôt le fait d’une croyance religieuse que
l’on identifiera à un cosmocentrisme. Conformément à cette mentalité cosmocentriste,
Platon ne pouvait donc que faire exister les idées quelque part dans le monde. Quant à
Aristote, il pensait que la réalité naturelle et sensible possède son propre principe
d’ordre et de permanence. On devra attendre l’intermède médiéval et chrétien pour
passer du cosmocentrisme au logocentrisme. Si la conception chrétienne du monde lui
considère encore un ordre qui vaille comme principe de la connaissance, cet ordre ne
provient que de l’intelligence divine et non plus du monde lui-même. Si en créant le
monde Dieu l’a rendu cohérent et connaissable, c’est qu’il lui a appliqué en même
temps des idées ou des essences. Nous passons donc d’un cosmocentrisme vers un
Théocentrisme avec un sujet unique au centre de tout et créateur. Apparaît alors pour
la première fois l’idée de constitution du monde.
L’homme n’est pas encore au centre mais il occupe néanmoins une place important
dans le monde. L’homme a été créé à l’image de Dieu, il existe alors une analogie
d’être entre l’homme et Dieu qui pourrait se traduire dans l’intelligence ou l’exercice
de la raison. Ce rapprochement entre la raison humaine et la raison divine contribua à
libérer les principes de la connaissance par rapport à l’ancien dogme cosmocentriste
selon lequel il y aurait un ordre ou une raison du monde auquel la connaissance n’avait
qu’à se conformer.
9. Un grand débat, plus connu sous le nom querelle des universaux, est un bel exemple
de cette libération.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%