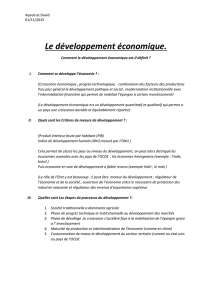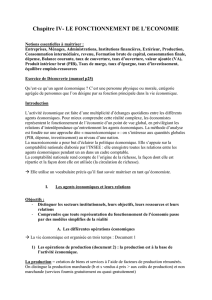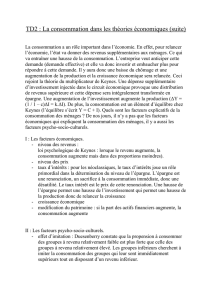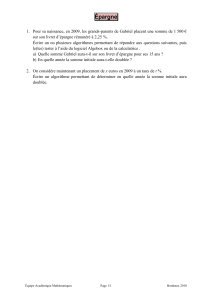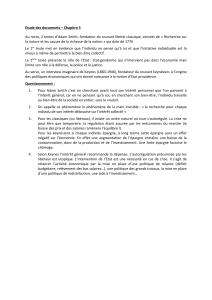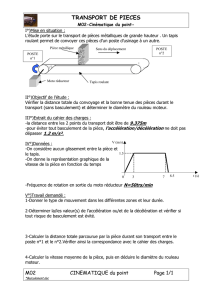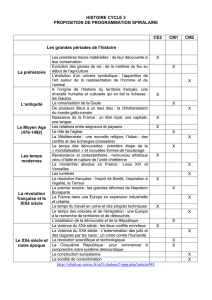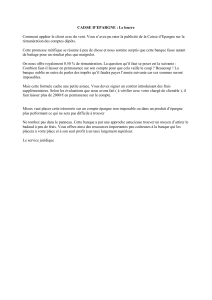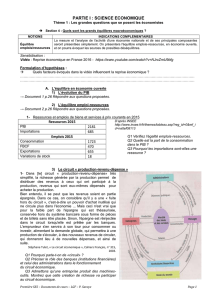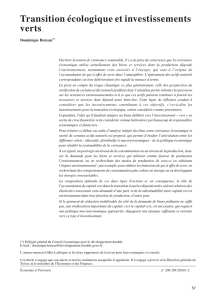Note de lecture sur le livre "Le Grand Basculement"

PSP/APR/ARL Paris, le 4 avril 2012
OLIVIER RAY, JEAN-MICHEL SEVERINO
LE GRAND BASCULEMENT
Odile Jacob
Septembre 2011
Sous un titre évoquant « La Grande Transformation », œuvre de l’historien hongrois, Karl
Polanyi, cité en introduction, l’ouvrage d’O. Ray et de J.M. Severino analyse le « grand
basculement » du monde. Comme il y a cent ans, le basculement économique résultant de
l’émergence de nouvelles puissances mondiales est assurément historique. Au début du XXè
siècle, le basculement euro-atlantique avait ouvert un siècle de catastrophes. « Rien n’indique
qu’il pourrait en être autrement aujourd’hui » estiment les auteurs, annonçant ainsi les défis
non moins redoutables du basculement actuel qui concerne aussi bien l’environnement que les
modèles économiques.
Du point de vue environnemental, les modèles de croissance qui ont fait le succès du XXè
siècle ont atteint leur limite : ils polluent les océans, détruisent la biodiversité, réchauffent
l’atmosphère, désertifient les continents. Comment sortir des milliards d’habitants de la
pauvreté sans rendre la planète inhabitable ? Les auteurs observent le passage en moins d’un
siècle d’une situation où les ressources naturelles paraissaient abondantes et l’homme rare
(sous l’effet du plein emploi permis par la seconde Guerre Mondiale), à une situation où l’on
perçoit la fin de l’abondance des ressources naturelles, l’homme étant devenu « jetable »
entretemps. La perte de quelques millions d’âmes est désormais sans importance pour la
survie de l’espèce.
Du point de vue économique, comment assurer l’écoulement de la production des centres
industriels bourgeonnant dans les pays pauvres ? Ces centres se sont multipliés au point que la
consommation des pays de l’OCDE n’y suffit plus. Comment passer de l’ancien modèle de
croissance par l’exportation, cher aux institutions internationales (FMI, Banque mondiale…),
à des modèles de développement par le marché intérieur ?
Il faut, nous disent les auteurs, « ré-inverser les raretés » : préserver les ressources naturelles
pour qu’elles suffisent aux besoins, et restaurer l’intégrité humaine et sociale de l’homme.
Cependant, la mondialisation impose désormais des décisions au-delà des frontières
nationales. C’est donc à l’échelle planétaire qu’il faut agir pour ré-inverser les raretés,
notamment en mettant en place une protection sociale dont les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) ont esquissé les contours.
L’analyse fait comprendre les enjeux auxquels les nouvelles générations sont confrontées
mais les bases idéologiques qui ont conduit à l’impasse méritent d’être explicitées. Au-delà de
Beveridge, le fondateur de l’Etat providence britannique, et par extension l’inspirateur de la
protection sociale préconisée, et de Ricardo, le fameux économiste classique du XIXè siècle
que les auteurs proposent « d’enterrer », il n’est pas inutile d’examiner ce qui a pu inspirer les
recommandations des auteurs, notamment sur le développement des marchés intérieurs.
La théorie du développement qui fonde les efforts des pays de l’OCDE depuis la seconde
Guerre Mondiale s’appuie essentiellement sur la théorie classique. Selon cette théorie, le libre
fonctionnement des marchés produit l’effet optimal en matière de croissance car il alloue les
ressources de manière parfaite et automatique. Cet effet de la « main invisible » émerveillait
Adam Smith et conduisit David Ricardo à proposer la loi des avantages comparatifs : chacun

2
trouverait mathématiquement son avantage à ce que l’Angleterre produise des cotonnades et
le Portugal du vin. Au XXè siècle, Polanyi exprimera des réserves sur une telle
« marketization » de l’économie. Mais au début du XIXè siècle, J.B. Say estimait que la
théorie classique était fermement soutenue par une loi selon laquelle, affirmait-il, l’offre
produit sa propre demande. Selon cette loi, dite de J.B. Say, devenue une base de la théorie
classique, il n’y a donc pas lieu de se préoccuper de chômage ; ne sont chômeurs que ceux qui
ne souhaitent pas travailler ! Pour la théorie classique, le libre fonctionnement des marchés
assure le plein emploi, du moins des personnes qui veulent sincèrement travailler.
On peut pourtant observer, dans une économie monétaire, que tout revenu est le résultat d’une
dépense. Dès lors, si la dépense, pour une raison quelconque, diminue, les revenus et donc
l’emploi diminuent également. Ils risquent alors de provoquer une réaction en cascade,
entrainant une nouvelle chute de la dépense. Il faut donc une vigilance permanente de
l’autorité publique sur son marché intérieur, pour compenser les fluctuations de la dépense (ce
qu’on appelle la demande) et maintenir le revenu et l’emploi à des niveaux élevés, permettant
le développement du marché intérieur.
Dans la vision classique de l’économie, qui suppose le plein emploi des ressources (absence
de chômage), il faut épargner pour investir. En effet, c’est seulement en réduisant la
consommation qu’on peut dégager les ressources nécessaires pour l’investissement. Mais en
situation de sous-emploi, l’investissement ne dépend plus de l’épargne comme le voudrait la
théorie classique. C’est au contraire l’épargne qui résulte de l’investissement, l’investisseur
décidant en fonction non de l’épargne mais de la consommation, et du retour attendu sur son
investissement. L’épargne, comptablement égale à l’investissement, est forcée de s’ajuster au
montant de l’investissement.
Or, l’aide au développement a tendance à reposer sur l’idée classique, rappelée au Chapitre 2,
que les pays pauvres manquent d’épargne et qu’il faut leur apporter l’épargne extérieure
nécessaire (« l’investissement suppose l’épargne », p. 40). S’écartant de ce schéma simpliste,
les auteurs attirent l’attention au Chapitre 9 sur la vraie difficulté, celle du développement des
marchés et des institutions nécessaires: marchés financiers, mécanismes de répartition de
richesse et de réduction des inégalités, etc.. Dans un ouvrage récent publié par l’AFD, Thierry
Paulais fait la même observation en ce qui concerne le financement des villes en Afrique
1
et
au forum de Busan sur l’efficacité de l’aide au développement (décembre 2011), les pays
émergents, Chine en tête, ont interdit aux pays de l’OCDE de poursuivre dans leur ancienne
voie. Ils ont fait insérer un paragraphe en tête du document soulignant que la coopération Sud-
Sud était différente de la coopération Nord-Sud ; manière sans doute de faire comprendre que
le « vrai besoin »
2
est précisément celui d’institutions efficaces et que celles-ci ne sauraient
résulter du simple transfert d’apports extérieurs.
Le Chapitre 9 évoque accessoirement le problème actuel du déséquilibre des balances des
paiements. Il faut en effet développer la consommation intérieure des pays excédentaires
(Chine, Japon, Allemagne…) pour rééquilibrer les balances des paiements autrement que par
le surcroît d’austérité appliqué aux pays déficitaires. La difficulté de ce rééquilibrage résulte
sans doute de problèmes techniques et institutionnels. Mais il se heurte aussi à des positions
idéologiques.
La théorie classique du laissez-faire est naturellement défendue par les intérêts qui dominent
les marchés. A court terme cette théorie les favorise. Mais la crise européenne montre que
1
Financer les villes d’Afrique. L’enjeu de l’investissement local. Thierry Paulais. 2012 Pearson Education
France
2
Il est tentant de rappeler par analogie un des quatre principes de la coopération chinoise : « répondre aux vrais
besoins ».

3
cette théorie conduit à l’impasse car à moyen terme, même les intérêts dominants ont besoin
de marchés. Pourtant, l’histoire enseigne qu’il faut un talent politique exceptionnel pour faire
prévaloir la vision salutaire à moyen et long terme. Franklin Roosevelt fut l’exemple
emblématique de ce talent, lui qui inventa sur le terrain, de manière autonome et concrète, les
mesures que Keynes devait ensuite présenter dans une construction intellectuelle cohérente. Il
reste au XXIè siècle à trouver les nouveaux visionnaires qui sauront affronter les défis du
« grand basculement ».
1
/
3
100%