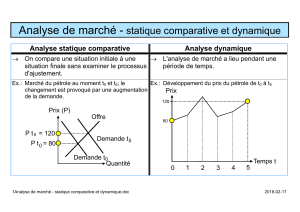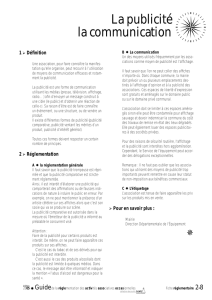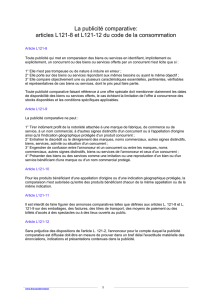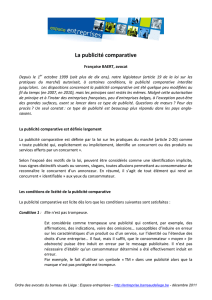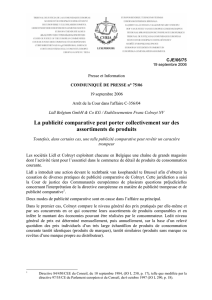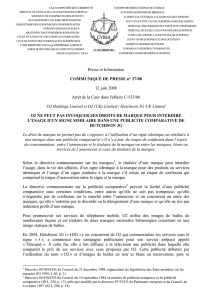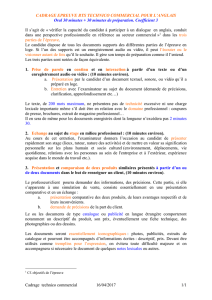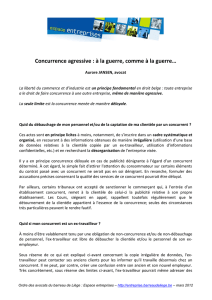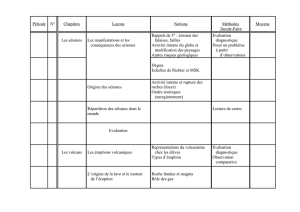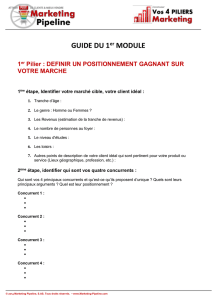I. Introduction

1
Version définitive (21 juillet 2004)
LIDC - 2004
Question A : Publicité comparative
Quel cadre pour réglementer la publicité comparative ?
RAPPORT SOMMAIRE
Rapporteur international : Dr. Gusztáv Bacher, avocat
CABINET D'AVOCATS SZECSKAY – MOQUET BORDE (Hongrie)
gusztav.bacher@szecskay.hu
I. INTRODUCTION .................................................................................................................... 3
II. QUESTIONS CONCERNANT LA LÉGALITÉ DE LA PUBLICITÉ COMPARATIVE ................. 5
1. CADRE LÉGAL POUR LES REGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ
COMPARATIVE ........................................................................................................................ 5
1.1 Sources du droit ...................................................................................................... 5
1.2 Domaine du droit .................................................................................................... 6
1.3. Intérêts à protéger ........................................................................................................ 7
1.4. Justification des lois spécifiques ................................................................................. 7
2. DÉFINITION DE LA PUBLICITÉ COMPARATIVE .............................................................. 8
2.1 Définition légale ..................................................................................................... 8
2.2 Méthodes d'identification du concurrent ................................................................ 9
2.3 Publicité attestant la supériorité ........................................................................... 10
3. CONDITIONS POUR UNE PUBLICITÉ COMPARATIVE LEGALE .................................. 11
3.1 Admissibilité de la publicité comparative en général .......................................... 11
3.2 Critères d'une comparaison objective ................................................................... 13
3.2. Critères pour les mêmes besoins/mêmes objectifs des marchandises ...................... 14
3.4 Caractère mensonger des publicités comparatives ........................................... 15
3.5 Créer la confusion avec le concurrent dans la publicité comparative .................. 16
3.6. Discréditer ou dénigrer le concurrent ................................................................... 16
3.7 Comparaison de prix ............................................................................................ 17
3.8. Autres critères pour l’admissibilité de la publicité comparative .............................. 19
3.8.1 Dispositions du droit national ...................................................................... 19
3.8.2 Dispositions des codes de conduite auto-réglementés ................................. 19
3.9 Concept de la Directive proposée par la Commission européenne sur la nature
mensongère d'une publicité .............................................................................................. 19
4. UTILISATION DES MARQUES DÉPOSÉES OU DES MARQUES COMMERCIALES DU
CONCURRENT ....................................................................................................................... 21
4.1 Conflit entre la loi sur les marques déposées et le besoin de se référer à la marque
déposée d'un concurrent dans la publicité comparative ................................................... 21
4.2 Limitations à l'utilisation d'une marque déposée d'un tiers .................................. 22
4.2.1 Tirer indûment avantage de la marque d'un tiers ......................................... 22
4.2.2 Limitations du format des caractères d'une marque déposée ....................... 24
4.3 Utilisation de la propriété intellectuelle d'un tiers (par exemple : dessin, droits
d'auteur) ............................................................................................................................ 25
5. APPELLATION D’ORIGINE ............................................................................................. 26
6. CHARGE DE LA PREUVE ............................................................................................... 27
7. CODE DE CONDUITE AUTO-REGLEMENTE ................................................................ 29
7.1 Types de codes de conduite auto-réglementés et force obligatoire ...................... 29

2
7.2 Organisations professionnelles et loi antitrust dans l'UE ..................................... 30
7.3 Règles spéciales applicables à la publicité comparative dans les codes de conduite
auto-réglementés .............................................................................................................. 31
8. COMPARAISON RÉALISÉE PAR DES TIERS .................................................................... 31
8.1 Comparatifs .......................................................................................................... 32
8.2 Utilisation des résultats de tests dans la publicité comparative ........................... 32
9. MISE EN VIGUEUR DES PLAINTES CONTRE LA PUBLICITÉ COMPARATIVE INTERDITE,
PUBLICITÉ TRANSFRONTALIERE .......................................................................................... 33
III. EVALUATION, HARMONISATION ....................................................................................... 33
_____________________________________________________________________
Le présent rapport sommaire a été préparé sur la base des rapports nationaux obtenus auprès
des groupes de travail dans les pays suivants :
Ce rapport présente les réponses à un questionnaire obtenu auprès des groupes de travail dans
les pays suivants :
PAYS/GROUPE
RAPPORTEUR NATIONAL
Autriche
Dr. Peter Pöch
Mag. Melanie Gufler
Belgique
Laurent de Brouwer
Françoise Jacques de Dixmude
France
Maître Jean-Jacques Le Pen
Allemagne
Prof. Dr. Helmut Köhler
Hongrie
Dr. Alexander Vida
Italie
Avv.Vincenzo Franceschelli
Espagne
Raul Bercovitz
Suisse
Dr. Dominique Junod Moser
Pays-Bas
Erik Vollebregt
Royaume-Uni
Katherine Tsang
Etats-Unis
John M. Richardson
J'aimerais remercier tous les rapporteurs nationaux pour le rapport excellent et complet qu'ils
nous ont remis et qui présente la situation dans leur juridiction respective. Les rapports font
état d'une parfaite connaissance et d'un grand intérêt pour les thèmes évoqués par cette
question.

3
Nous n'avons encore reçu aucun rapport du Brésil et du Japon. Le manque de rapports écrits
de ces pays est regrettable car le rapport sommaire ci-dessous est uniquement basé sur les
droits nationaux de certains Etats membres de l’UE, de la Suisse et des Etats-Unis. Étant
donné que, à partir du 1er mai 2004, le droit européen servira de base juridique harmonisée
pour la législation des 25 Etats membres, le droit de l'UE peut être considéré comme la
synthèse des droits nationaux en Europe. Toutefois, l’examen des droits applicables dans les
pays extérieurs à l'Europe est un élément à la fois essentiel et indispensable afin d’évaluer la
problématique d'une harmonisation plus poussée au niveau mondial. En outre, aux États-Unis,
la publicité comparative représente depuis longtemps déjà une forme de publicité parfaitement
acceptable et reconnue. Elle se base sur une approche différente alors que, dans d’autres pays,
elle est considérée comme une forme de pratique commerciale per sé abusive. Le point de vue
spécial des pays extérieurs à l'UE revêtirait donc une importance toute particulière et
permettra d'obtenir une vue générale parfaitement équilibrée. C'est pour cette raison que nous
enjoignons les rapporteurs nationaux représentant ces pays de présenter leurs droits nationaux
lors des discussions qui auront lieu à Budapest.
I. INTRODUCTION
Puisque le présent rapport sommaire sera lu par d'autres membres du LIDC outre les
rapporteurs nationaux ayant déjà pris part au projet, il est intéressant de rappeler les postulats
essentiels et les remarques préliminaires sur lesquels le questionnaire circonstancié est basé.
A. La publicité comparative est une forme particulière de publicité et donc un outil de
promotion à la vente visant à comparer les produits ou les services fournis par un tiers
avec ceux d'un ou plusieurs autres concurrents.
Une publicité comparative objective améliore la qualité des informations accessibles
aux consommateurs et leur permet de prendre une décision fondée et en meilleure
connaissance de cause quant au choix de produits ou de services en concurrence sur le
marché en en démontrant les mérites. De cette façon, la publicité comparative peut
également stimuler la concurrence entre les fournisseurs de marchandises ou de
services à l'avantage du consommateur.
Toute publicité comparative vise à mettre en évidence les avantages des produits ou
des services proposés par l'annonceur par rapport à ceux d'un concurrent. Pour mener à
bien cet objectif, le message de la publicité doit nécessairement évoquer les
différences entre les marchandises ou les services comparés grâce à une description de
leurs caractéristiques principales. La comparaison réalisée par l'annonceur émanera
nécessairement de cette description.
En affaires, le principe constitutionnel (fondamental) en matière de liberté
d'expression est étroitement lié à la liberté de publicité
1
.
1
Conformément à l’Article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (Rome, 1950), toute
personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit inclut la liberté d'avoir des opinions et de partager des
informations et des idées sans intervention des autorités publiques. L'exercice de ces libertés, puisqu'elles sous-
entendent des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à de telles formalités, conditions, restrictions ou
amendes dans les mesures prévues par la loi. Celles-ci s'avèrent nécessaires dans une société démocratique...
pour la protection de la réputation ou des droits d’autrui. (Cette limite joue un rôle important en cas de
publicité comparative.)

4
Toutefois, les comparaisons entre les marchandises et les services de différentes
entreprises comportent certains risques importants. Le risque est néanmoins présent
que, lorsque les entreprises font état des mérites et des inconvénients de certains
produits ou services concurrents, elles peuvent être tentées de les dénigrer ou de tirer
un avantage déloyal de comparaisons faussées. À l'instar des formes traditionnelles de
publicité, la publicité comparative vise à la fois à contribuer au développement de
l'entreprise en question et à informer les clients. Bien que les deux formes de publicité
recherchent l'attrait du client, dans le cas de la publicité comparative, les relations
commerciales peuvent être la proie de pratiques déloyales constantes. Il est donc ardu
de contester la nécessité de règles complètes et claires régissant la publicité
comparative et d'exigences strictes basées sur des études en toute bonne foi et des
pratiques loyales dans les rapports commerciaux.
En effet, la nature même de la publicité comparative influe sur les intérêts des
consommateurs ainsi que sur les intérêts des concurrents et par conséquent, sur les
intérêts du grand public.
B. Alors qu'aux États-Unis, la publicité comparative est une forme de publicité
acceptable, la majorité des pays européens ont longtemps rejeté cette forme de
publicité qui était considérée comme une pratique commerciale déloyale per se. C’est
seulement récemment, suite à la Directive 97/55/EC du 6 octobre 1997 adoptée par le
Parlement Européen et le Conseil, que la publicité comparative a été introduite dans
l'ordre juridique national de chaque État membre (ci-après : la « Directive 97/55 »)
en terme de principe bien qu'elle soit régie par des conditions très strictes dont les
circonstances dans lesquelles ce type de publicité est autorisé. À cette fin, la Directive
97/55/EC a amendé la Directive 84/450/EEC sur la publicité mensongère de sorte à y
inclure la publicité comparative (ci-après : la « Directive ») sur base de la
considération que l'acceptation ou le rejet de la publicité comparative dans les diverses
lois nationales peut représenter un obstacle au libre mouvement des marchandises et
des services et peut donner lieu à des distorsions vis-à-vis de la concurrence. Par
conséquent, la liberté de recourir à la publicité comparative doit être assurée.
La Cour Européenne de Justice (CEJ) et le Tribunal de Première Instance ont
interprété le sens de certaines dispositions de la Directive dans trois affaires : (i)
Affaire C-112/99, Toshiba Europe GmbH contre Katun Germany GmbH, 25 octobre
2001 ; (ii) Affaire C-44/01, Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG contre Hartlauer
Handelsgesellschaft mbH, 8 avril 2003, et (iii) Affaire T-144/99, Institute of
Professionnal Representatives before the European Patent Office contre la
Commission des Communautés Européennes.
C. Le LIDC a déjà eu affaire à la question de la publicité comparative : en 1980, le LIDC
a adopté une résolution sur la publicité comparative et en 1994, lors du Congrès de
Berlin, le LIDC a adopté la résolution sur l'harmonisation des lois relatives à la
concurrence déloyale incluant les principes devant être pris en considération lors de
l'utilisation d'une marque déposée d'un tiers en publicité comparative.
D. L'harmonisation des règles en matière de publicité est un élément important car les
sociétés dépensent de lourdes sommes dans leurs campagnes publicitaires. Plus
particulièrement, les multinationales peuvent souhaiter recourir à la même publicité

5
dans tous les pays où elles exercent leurs activités (à l'exception des langues et des
éléments allant à l'encontre de la morale et de la culture locale). La publicité
comparative, lorsqu'elle est fiable et non mensongère, est une source d'informations
importante pour les consommateurs et peut les aider à prendre des décisions
rationnelles dans leurs choix de produits. Ainsi, la publicité comparative peut
encourager l'amélioration de produits, l'innovation et contribuer à la baisse des prix sur
le marché.
Par conséquent, la réalisation d'enquêtes détaillées concernant les lois nationales en
matière de publicité comparative et l'adoption d'une résolution quant à l'harmonisation
des exigences est à la fois justifiée et actuelle.
Autre raison en faveur de ces études : les études précédentes dans ce domaine ont été
réalisées avant l'adoption de la Directive 97/55 ou peu de temps après. Suite à cette
étude, l'OMPI a publié un dossier sur le droit comparé intitulé Protection contre la
concurrence déloyale (Genève, 1994). Dans le cadre des travaux du LIDC, on
retrouvera quelques références à l'étude réalisée par Michael Golding et David Lathan
(Revue 1./1997). Lors du Congrès de Rio en 1998, l'AIPPI a étudié la question de la
publicité comparative et plus particulièrement la question du non-respect de la cote
d'estime ou le dénigrement qui en découle (Question 140).
Il est temps d'analyser les expériences et les pratiques qui ont émergé au cours de ces
dernières années et qui sont soumises à la nouvelle règle et à l'interprétation moderne
des conditions à remplir pour les publicités comparatives. L'amendement de la
Directive proposé par la Commission européenne peut représenter une opportunité
pour ces propositions visant à l'harmonisation définitive des lois en vigueur.
En ce qui concerne l'harmonisation au niveau mondial, il convient de préciser que les
Dispositions type de l'OMPI sur la protection contre la concurrence déloyale (1996)
ne prennent pas en considération la publicité comparative quoique l'introduction de
cette thématique aurait été la bienvenue.
C'est dans ce contexte que le LIDC a décidé d'introduire la Question de la publicité
comparative à l'ordre du jour du Congrès de Budapest en 2004.
II. QUESTIONS CONCERNANT LA LÉGALITÉ DE LA PUBLICITÉ COMPARATIVE
1. CADRE LÉGAL POUR LES REGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ
COMPARATIVE
1.1 Sources du droit
Dans les pays de l'Europe continentale, les lois régissant la publicité comparative sont basées
sur le droit écrit bien que l'interprétation et l'élaboration de ces lois aient été développées par
la jurisprudence. Outre ces lois écrites, il existe des codes professionnels et des règlements
d’auto-régulation propres aux industries en matière de publicité comparative (voir Chapitre
7 ci-dessous). En outre, dans certains pays (Espagne), des pratiques ont évolué en fonction des
jugements arbitraux rendus par une telle association auto-régulée. Au Royaume-Uni, les lois
sur la publicité comparative comprennent à la fois la loi écrite et la jurisprudence pour former
un système en trois parties comprenant : i) la législation créant un système d'actions civiles et
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%