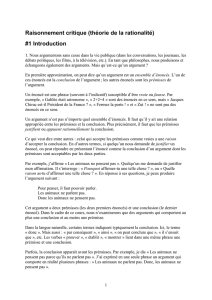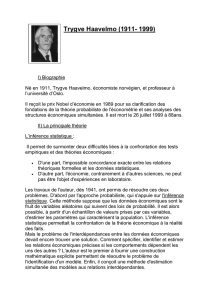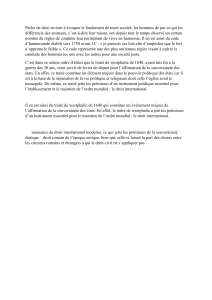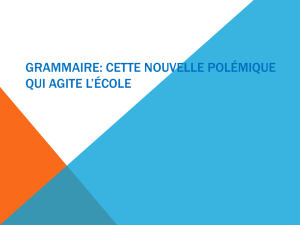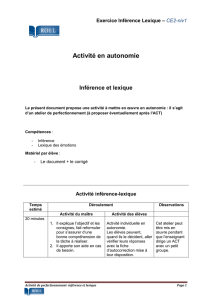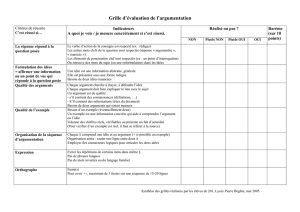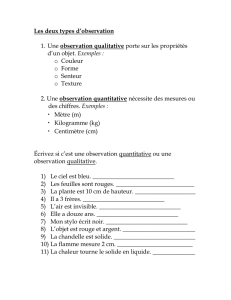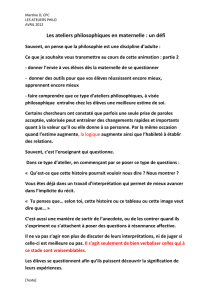Télécharger

Chapitre 2
Quelques conséquences de quatre incapacités *
Descartes est le père de la philosophie moderne, et l’esprit du cartésianisme, c’est-à-dire ce qui
le distingue pour l’essentiel de la scolastique dont il a pris la place, pourrait se formuler globalement
de la manière suivante :
1. Il enseigne que la philosophie doit partir d’un doute universel ; alors que la philosophie
scolastique n’avait jamais mis en doute les fondements.
2. Il enseigne que l’ultime mise à l’épreuve de la certitude doit être recherchée dans la
conscience individuelle ; alors que la philosophie scolastique la fait reposer sur le témoignage des
sages et de l’Église catholique.
3. L’argumentation multiforme du Moyen Age est remplacée par une chaîne unique
d’inférences dépendant de prémisses implicites.
4. La philosophie scolastique avait ses mystères de la foi, mais elle entreprenait d’expliquer
toutes choses créées. Mais il y a beaucoup de faits que le cartésianisme non seulement n’explique pas,
mais qu’il rend absolument inexplicables, sauf à considérer que « Dieu les a faits comme ils sont » est
une explication suffisante.
Sous l’un ou l’autre de ces aspects, la plupart des philosophes modernes ont été en effet
cartésiens. Or, sans pour autant vouloir revenir à la scolastique, il me semble que la science et la
logique modernes nous imposent de partir d’une toute autre base.
1. Nous ne pouvons commencer par douter de tout. Il nous faut commencer avec tous les
préjugés que nous avons quand nous abordons l’étude de la philosophie. Une maxime ne les chassera
pas, car ce sont de ces choses dont il ne vient pas à l’esprit qu’on puisse les mettre en question. Par
conséquent ce scepticisme préalable sera totalement illusoire ; ce ne sera pas un doute réel ; et
quiconque suivra la méthode cartésienne ne sera jamais satisfait tant qu’il n’aura pas formellement
retrouvé toutes ces croyances qu’il aura abandonnées formellement. C’est donc une condition
préliminaire aussi inutile que d’aller au pôle Nord pour atteindre Constantinople en descendant
régulièrement le long d’un méridien. Il est vrai qu’une personne peut au cours de ses recherches
trouver une raison de douter de ce qu’elle avait commencé par croire ; mais dans ce cas elle doute
parce qu’elle a une raison positive de le faire, et non pour se plier à la maxime de Descartes. Ne
faisons pas semblant de douter en philosophie de ce dont nous ne doutons pas dans nos coeurs.
2. Le même formalisme apparaît dans le critère cartésien qui revient à dire : « Tout ce dont je
suis clairement convaincu est vrai ». Si j’étais vraiment convaincu, j’en aurais fini avec le
raisonnement et n’aurais pas besoin de preuve de certitude. Mais admettre ainsi que des individus
puissent être les juges absolus de la vérité est tout à fait pernicieux. Le résultat en sera que les
métaphysiciens s’accorderont pour reconnaître que la métaphysique a atteint un degré de certitude
bien supérieur à celui des sciences physiques ; — seulement, ils ne pourront s’accorder sur rien
d’autre. Dans les sciences où les hommes parviennent à des accords, quand une théorie a été proposée,
elle est considérée comme étant à l’épreuve, tant qu’on n’est pas parvenu à un accord. Une fois
l’accord obtenu, la question de la certitude devient oiseuse parce que plus personne n’en doute. Nous
ne pouvons raisonnablement espérer atteindre individuellement la philosophie ultime que nous
poursuivons ; nous ne pouvons par conséquent la chercher que pour la communauté des philosophes.
Par suite, si des esprits droits et disciplinés examinent soigneusement une théorie et refusent de
l’accepter, cela devrait créer des doutes dans l’esprit de l’auteur même de la théorie.
3. Dans ses méthodes, la philosophie devrait imiter les sciences qui ont déjà fait leurs preuves,
c’est-à-dire ne procéder qu’à partir de prémisses tangibles qu’il est possible de soumettre à un examen
soigneux et faire confiance à la multiplicité et à la variété des arguments plutôt qu’à l’aspect définitif
* “Some Consequences of Four Incapacities”, Journal of Speculative Philosophy, 1868, pp. 140-157.

2
de l’un d’entre eux. Le raisonnement philosophique ne devrait pas constituer une chaîne qui ne serait
pas plus forte que son maillon le plus faible, mais un câble dont les fibres peuvent être très ténues
pourvue qu’elles soient assez nombreuses et assez solidement liées les unes aux autres.
4. Toute philosophie non-idéaliste suppose qu’il existe quelque chose d’ultime qui est
absolument inexplicable ou inanalysable, en bref, quelque chose qui résulterait d’une médiation mais
qui ne serait pas lui-même susceptible de médiation. Or, que quelque chose soit ainsi inexplicable,
nous ne pouvons le savoir qu’en raisonnant à partir de signes. Mais la seule justification d’une
inférence à partir de signes, c’est que sa conclusion explique le fait. Supposer le fait absolument
inexplicable, n’est pas l’expliquer et partant cette supposition n’est jamais admissible.
Dans le numéro précédent de cette revue, on trouvera un article intitulé “Questions concernant
certaines facultés que l’on attribue à l’homme”, qui a été rédigé dans cet esprit d’opposition au
cartésianisme. Cette critique de certaines facultés a débouché sur quatre négations que je peux répéter
ici pour la commodité :
1. Nous n’avons aucun pouvoir d’introspection. Toute notre connaissance du monde interne
dérive par raisonnement hypothétique de notre connaissance des faits externes.
2. Nous n’avons aucun pouvoir d’Intuition : toute cognition est logiquement déterminée par des
cognitions antérieures.
3. Nous n’avons aucun pouvoir de penser sans signes.
4. Nous n’avons aucune conception de l’absolument inconnaissable.
Ces propositions ne peuvent être considérées comme certaines ; et afin de les soumettre à une
autre épreuve, nous proposons maintenant de les suivre jusqu’en leurs conséquences. Nous
considérerons d’abord la première seule ; ensuite nous tirerons les conséquences de la seconde jointe à
la première ; ensuite, nous tenterons de voir ce qui résulte de l’adoption de la troisième et enfin, nous
ajouterons la quatrième à nos prémisses hypothétiques.
Lorsque nous acceptons la première proposition, nous devons faire abstraction de tous les
préjugés issus d’une philosophie qui fait reposer notre connaissance du monde externe sur la
conscience de soi. Nous ne pouvons admettre aucun énoncé sur ce qui se passe à l’intérieur de nous-
mêmes sauf en tant qu’hypothèse nécessaire pour expliquer ce qui se passe dans ce que nous avons
coutume d’appeler le monde externe. En outre, une fois que nous avons, sur de telles bases, admis
l’existence d’une faculté ou d’un mode d’action de l’esprit, il nous est bien entendu impossible
d’adopter une autre hypothèse pour expliquer un fait que notre première supposition est en mesure
d’expliquer ; nous devons développer celle-ci jusqu’à ses ultimes conséquences. En d’autres termes,
nous sommes tenus de réduire toutes les actions mentales à un seul type dans la mesure où nous
pouvons le faire sans introduire d’hypothèses supplémentaires.
La classe des modifications de conscience par laquelle il nous faut commencer notre enquête
doit être une classe dont l’existence est indubitable et dont les lois sont les plus connues. Il doit donc
s’agir (puisque cette connaissance nous vient de l’extérieur) d’une classe de modifications qui suit de
plus près des faits externes ; c’est-à-dire il doit s’agir d’une sorte de cognition. Ici nous pouvons
admettre comme hypothèse la seconde proposition de notre article précédent selon laquelle il n’y a
absolument aucune cognition première d’un objet quelconque : la cognition se développe selon un
processus continu. Nous devons donc commencer avec un processus de cognition et avec ce processus
dont les lois sont les mieux comprises et qui suivent au plus près les faits externes. Il ne peut s’agir
que du processus d’inférence valide, qui va d’une prémisse A à sa conclusion B seulement si, en fait,
une proposition telle que B est toujours ou habituellement vraie lorsqu’une proposition A est vraie.
C’est donc une conséquence des deux premiers principes mentionnés dont nous essayons de tracer ici
les résultats, que nous devons réduire, dans la mesure du possible, toute action mentale à la formule du
raisonnement valide sans introduire d’autre supposition que le fait que l’esprit raisonne.

3
Mais est-ce que l’esprit passe effectivement par un processus syllogistique ? Il est certes
douteux qu’une conclusion — en tant que quelque chose qui existe indépendamment dans l’esprit,
comme une image — vienne remplacer subitement deux prémisses qui existent dans l’esprit de
manière semblable. Mais nous avons l’expérience constante du fait que si l’on obtient le consentement
de quelqu’un aux prémisses, au sens où cette personne est alors disposée à agir d’après elles et à dire
qu’elles sont vraies, elle sera également disposée, dans des circonstances favorables, à agir d’après la
conclusion et à dire que celle-ci est vraie. Il y a donc quelque chose qui survient dans l’organisme et
qui est équivalent au processus syllogistique.
Une inférence valide est soit complète, soit incomplète. Une inférence incomplète est une
inférence dont la validité dépend de quelque état de fait qui n’est pas contenu dans les prémisses. Ce
fait impliqué aurait pu être énoncé comme une prémisse et son rapport à la conclusion est le même,
qu’il soit explicitement posé ou non, puisqu’il est au moins virtuellement considéré comme accordé ;
de sorte que tout argument incomplet valide est virtuellement complet. Les arguments complets se
divisent en simples et en complexes. Un argument complexe est un argument qui à partir de trois
prémisses ou plus conclut ce qui aurait pu être conclu par étapes successives dans des raisonnements
dont chacun serait simple. De cette manière, une inférence complexe revient en fin de compte à la
même chose qu’une succession d’inférences simples.
Une argument complet simple et valide, ou syllogisme, peut être soit apodictique soit probable.
Un syllogisme apodictique ou déductif est un syllogisme dont la validité dépend inconditionnellement
du rapport entre le fait inféré et les faits posés dans les prémisses. Un syllogisme dont la validité
dépendrait non seulement de ses prémisses mais de l’existence d’une autre connaissance, serait
impossible ; car soit cette autre connaissance serait posée, auquel cas elle ferait partie des prémisses,
soit elle serait implicitement assumée, auquel cas l’inférence serait incomplète. Mais un syllogisme
dont la validité dépend partiellement de la non-existence de quelque autre connaissance, est un
syllogisme probable.
Quelques exemples vont nous rendre ceci plus clair. Les deux arguments suivants sont
apodictiques ou déductifs :
1. Aucune série de jours dont le premier et le dernier sont des jours différents de la semaine
n’excède de plus d’une unité un multiple de sept ; or, le premier et le dernier jours d’une année
bissextile sont des jours différents de la semaine et par conséquent aucune année bissextile n’est
constituée d’un nombre de jours qui est supérieur de plus d’une unité à un multiple de sept.
2. Parmi les voyelles il n’y a aucune lettre double ; mais l’une des lettres doubles (w) est
composée de deux voyelles ; par conséquent, une lettre composée de deux voyelles n’est pas
nécessairement elle-même une voyelle.
Dans ces deux cas, il est évident que tant que les prémisses seront vraies, les conclusions le
seront également, quels que soient par ailleurs les autres faits. Par contre, supposons que nous
raisonnions de la manière suivante : — « Un certain homme avait le choléra asiatique ; il était dans le
coma, livide, tout glacé, et son pouls était imperceptible ; on le saigna copieusement. Au cours du
processus, il sortit du coma, et le lendemain matin, il se sentit suffisamment bien pour se lever. Par
conséquent la saignée tend à guérir le choléra ». Il s’agit là d’une inférence assez probable, à la
condition que les prémisses représentent la totalité de nos connaissances sur le sujet. Mais si nous
savions qu’il est possible de guérir très soudainement du choléra, et que nous sachions que le médecin
qui a fait état de ce cas connaissait une centaine d’autres essais de ce genre de remède, sans en avoir
communiqué le résultat, l’inférence perdrait alors toute sa validité.
L’absence d’une connaissance qui est indispensable à la validité d’un argument inférence
probable est en rapport avec quelque question qui est déterminée par le raisonnement lui-même. Cette
question, comme toutes les autres, porte sur le fait de savoir si certains objets possèdent certains
caractères. Dès lors la connaissance qui nous fait défaut porte sur le fait de savoir si, en dehors des
objets qui, d’après les prémisses, possèdent certains caractères, d’autres objets ne les possèdent pas

4
également ; soit encore, sur le fait que, en dehors des caractères qui d’après les prémisses,
appartiennent à certains objets, d’autres caractères qui ne sont pas nécessairement impliqués par ceux-
ci n’appartiennent pas aux mêmes objets. Dans le premier cas, le raisonnement procède comme si tous
les objets qui possèdent certains caractères étaient connus ; il s’agit alors d’une induction ; dans le
second cas, l’inférence procède comme si tous les caractères nécessaires à la détermination d’un
certain d’objet ou classe étaient connus ; il s’agit alors d’une hypothèse. On peut encore rendre cette
distinction plus claire grâce à des exemples.
Supposons que nous comptions le nombre d’occurrences des différentes lettres dans un certain
livre en anglais que nous appelons A. Bien entendu, toute nouvelle lettre que nous ajoutons à notre
décompte modifie le nombre relatif des occurrences des différentes lettres ; mais au fur et à mesure
que nous progressons dans notre comptage, cette modification devient de moins en moins importante.
Supposons par exemple que plus nous comptons de lettres, la proportion des “e” représente à peu près
11 1/4 % de l’ensemble, celle des “t” 8 1/2 %, celle des “a” 8 %, celle des “s” 7 1/2 %, etc. Supposons
maintenant que nous répétions les mêmes observations sur une demi-douzaine d’autres écrits en
anglais (que nous pouvons désigner par les lettres B, C, D, E, F et G) avec le même résultat. Dans ce
cas, nous pouvons en inférer que dans tout texte anglais de quelque longueur, les occurrences des
différentes lettres atteignent à peu de chose près les fréquences relatives mentionnées ci-dessus.
Or, la validité de cet argument dépend du fait que nous ignorons quelle est la fréquence relative
des différentes lettres dans les textes rédigés en anglais en dehors de A, B, C, D, F, et G. Parce que si
nous connaissons cette fréquence relative pour un texte H, et qu’elle n’est pas, à peu de chose près,
identique à ce qu’elle est dans les textes que nous avons analysés, notre conclusion est aussitôt
détruite ; si au contraire elle est identique, alors l’inférence procède à partir de A, B, C, D, E, F, G et
H, et non plus seulement à partir des sept premiers. Par conséquent, il s’agit d’une induction.
Supposons ensuite qu’on nous présente un texte codé, mais sans la clef qui nous permettrait de
le déchiffrer. Supposons qu’il contienne un peu moins de 26 caractères, dont l’un revient
approximativement 11 fois sur cent, un autre 8 1/2 fois sur cent, un autre encore, 8 fois sur cent et un
quatrième, 7 1/2 fois sur cent. Supposons ensuite que lorsque nous remplaçons ces caractères
respectivement par “e”, “t”, “a” et “s”, nous nous apercevons de quelle manière nous pouvons
substituer à chacun des autres caractères une seule lettre de façon à produire un sens cohérent en
anglais, à condition toutefois que nous admettions que l’orthographe puisse être erronée dans certains
cas. Si ce texte a une longueur suffisante, nous pouvons en inférer avec une très grande probabilité que
nous avons bien trouvé la signification du texte codé.
La validité de cet argument dépend du fait qu’il n’existe aucun autre caractère connu de cet écrit
codé qui pourrait avoir quelque importance dans cette affaire ; car s’il y en a — si nous savons par
exemple qu’il y a ou qu’il n’y a pas d’autres manières de déchiffrer ce code — il faut tenir compte de
son effet, qui tend à renforcer ou à affaiblir la conclusion. Dans ces conditions il s’agit d’une
hypothèse.
Tout raisonnement valide est soit déductif, soit inductif, soit hypothétique ; ou encore, il
combine deux ou plusieurs de ces caractères. La déduction est assez correctement traitée dans la
plupart des manuels de logique, mais il nous faudra dire quelques mots de l’induction et de
l’hypothèse afin de rendre plus compréhensible ce qui suit.
L’induction peut être définie comme un argument qui tient pour acquis que tous les membres
d’une classe ou d’un agrégat ont tous les caractères qui sont communs à tous les membres de cette
classe à propos desquels nous savons qu’ils ont ou qu’ils n’ont pas ces caractères ; en d’autres termes,
qui assume qu’est vrai de toute une collection ce qui est vrai d’un certain nombre d’instances qu’on y
a choisies au hasard. On pourrait qualifier ceci d’argument statistique. A long terme, ce type
d’argument fournit généralement des conclusions assez correctes à partir de prémisses vraies. Si nous
avons un sac de haricots dont les uns sont noirs et les autres blancs, nous pouvons, en comptant les
proportions respectives des deux couleurs dans plusieurs différentes poignées, donner une

5
approximation à peu près exacte de ces proportions relatives dans l’ensemble du sac, puisqu’un
nombre suffisant de poignées constituerait l’ensemble des haricots contenus dans le sac. La
caractéristique essentielle de l’induction, celle qui en donne la clef, c’est qu’en prenant la conclusion à
laquelle nous sommes ainsi parvenus comme majeure d’un syllogisme, et en prenant comme mineure
une proposition énonçant que tels ou tels objets appartiennent à la classe en question, l’autre prémisse
de l’induction s’ensuivra déductivement. Ainsi dans l’exemple ci-dessus, nous avons conclu que dans
tous les livres en anglais, les “e” représentent environ 11 1/4 % des lettres. En prenant ceci comme
majeure, et en prenant comme mineure la proposition que A, B, C, D, E, F et G sont des livres rédigés
en anglais, il s’ensuit déductivement que dans A, B, C, D, E, F et G environ 11 1/4 % des lettres sont
des “e”. Ainsi, Aristote a pu définir l’induction comme l’inférence de la majeure d’un syllogisme à
partir de sa mineure et de sa conclusion. La fonction d’une induction est de substituer à une série de
nombreux sujets un seul qui les embrasse tous et un nombre indéfini d’autres. C’est donc une espèce
de “réduction du divers à l’unité”.
On peut définir l’hypothèse comme un argument qui tient pour acquis qu’un caractère dont on
sait qu’il en implique nécessairement un certain nombre d’autres, peut être probablement prédiqué de
tout objet qui a tous les caractères dont on sait qu’ils sont impliqués par le caractère en question. De
même que l’induction peut être considérée comme l’inférence de la majeure d’un syllogisme, de
même l’hypothèse peut être considérée comme l’inférence de la mineure à partir des deux autres
propositions. Ainsi, l’exemple ci-dessus consiste en deux inférences de cette sorte de la mineure des
syllogismes suivants :
1. Tout texte de quelque longueur rédigé en anglais et dans lequel tels et tels caractères
désignent des “e”, des “t”, des “a” et des “s” possède à peu près 11 1/4 % de la première
sorte de signes, 8 1/4 de signes de la seconde, 8 de la troisième et 7 1/2 de la quatrième.
Ce texte codé est un texte rédigé en anglais, d’une certaine longueur, dans lequel tels et
tels caractères dénotent des “e”, des “t”, des “a” et des “s” respectivement.
Ce texte codé possède environ 11 1/4 % de caractères de la première sorte, 8 1/2 de la
seconde, 8 de la troisième et 7 1/2 de la quatrième.
2. Un passage écrit avec un alphabet de ce genre a du sens quand telles et telles lettres
sont respectivement substituées à tels et tels caractères.
Ce passage codé est écrit avec un alphabet de ce genre.
Cet écrit codé présente du sens lorsque ces substitutions sont effectuées.
La fonction de l’hypothèse est de substituer à une grande série de prédicats qui ne forment pas
en eux-mêmes une unité, un prédicat unique (ou un petit nombre) qui les implique tous et qui (sans
doute) en implique également un nombre indéfini d’autres. C’est par conséquent aussi une forme de
réduction du divers à l’unité
1
. Tout syllogisme déductif peut être réduit à la forme suivante :
1
Plusieurs personnes versées dans la logique ont objecté que j’ai ici utilisé fautivement le terme hypothèse, et que ce que je
désigne ainsi est un argument par analogie. Il est suffisant de répondre que l’exemple du chiffre a été donné comme
illustration correcte de l’hypothèse par Descartes (Règle 10, Œuvres choisies, Paris, 1865, p. 334), par Leibniz (Nouveaux
Essais, lib. 4, ch. 12, § 13, Ed. Erdmann, p. 383 b), et (comme je l’ai appris de D. Stewart : Works, vol. 3, pp. 305 sq.) par
Gravesande, Boscovich, Hartley, et G.L. Le Sage. Le terme Hypothèse a été utilisé dans les sens suivants : — 1. Pour le
thème ou proposition formant le sujet du discours. 2. Pour une assomption. Aristote divise les thèses ou propositions
adoptées sans aucune raison en définitions et hypothèses. Celles-ci sont des propositions énonçant l’existence de quelque
chose. Ainsi, le géomètre dit, « Soit un triangle ». 3. Pour une condition en un sens général. On dit que nous cherchons
autre chose que le bonheur , dans certaines circonstances. La meilleure république est idéalement parfaite, la
seconde la meilleure sur terre, la troisième la meilleure , conditionnellement. La liberté est la ou
condition de la démocratie. 4. Pour l’antécédent d’une proposition hypothétique. 5. Pour une question rhétorique qui
assume des faits. 6. Dans le Synopsis de Psellos, pour la référence d’un sujet aux choses qu’il dénote. 7. Plus
communément, à l’époque moderne, pour la conclusion d’un argument à partir de la conséquence et du conséquent à
l’antécédent. C’est ainsi que j’utilise ce terme. 8. Pour une conclusion telle qu’elle est trop faible pour être une théorie
acceptée dans le corps d’une science.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%