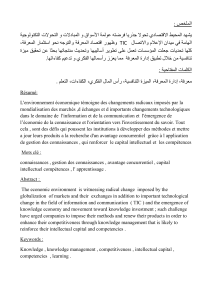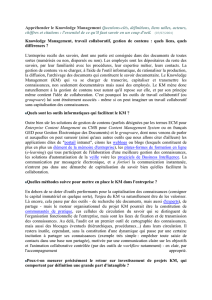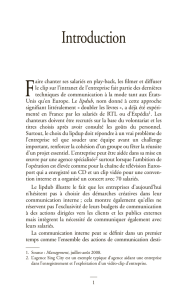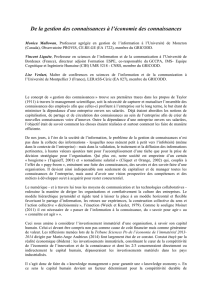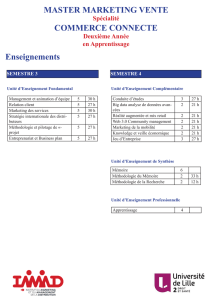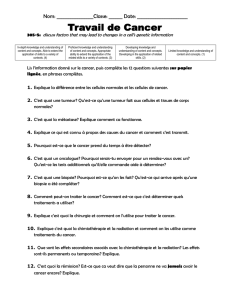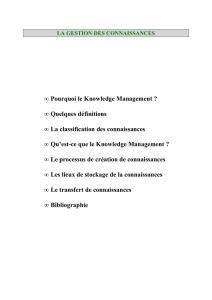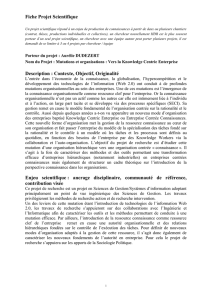Le Rôle de la confiance

Le rôle de la confiance dans
le management des connaissances
Cas des communautés de pratique chez Schneider Electric
Haythem BEN AMOR
ATER, Université Paris XIII
Tél. : + 33 6 87 50 49 54
45 A, Bd Jourdan, 75014 Paris (France)
Résumé :
L’objectif de cette recherche est d’identifier le rôle de la confiance dans le
management des connaissances et ce à travers une étude qualitative menée auprès
des communautés de pratique chez Schneider Electric.
L’identification du rôle de la confiance constitue une base de réflexion pour l’étude
des facteurs qui peuvent influencer la conduite d’un projet de knowledge
management au sein des entreprises et le choix du facteur de la confiance revient au
fait qu’on considère que les facteurs sociaux et humains sont des facteurs
primordiaux dans la promotion d’une culture de partage des connaissances.
Mots clés :
Connaissance ; knowledge management ; communauté de pratique ; confiance .

2
Introduction:
L’intérêt porté aux problématiques des connaissances est relativement récent
bien qu’elles aient été abordées depuis les années soixante notamment dans les
travaux de Galbraith (1968), Drucker (1968, 1988, 1993), Bell (1973) et Toffler (1990)
qui ont essayé de démontrer que la principale source de création de richesses pour
les entreprises proviendrait d’activités intellectuelles.
Les activités fondées sur le savoir, occupent donc, aujourd’hui une place centrale
dans la chaîne de valeurs de l’entreprise. En effet, la plus grande part de l’activité des
employés consiste actuellement à traiter l’information ou à gérer les savoir. Le succès
d’une entreprise dépend désormais, très largement, de sa capacité à développer,
rassembler, intégrer, mobiliser et exploiter de véritables flux de connaissances.
Ce constat pousse de plus en plus les entreprises à adopter les techniques du
knowledge management (KM) pour résoudre différents problèmes, entre autres, la
« surinformation » qui caractérise leur environnement et la mobilité accrue,
volontaire ou contrainte, des salariés (Tisseyre, 1999).
Cependant, la pratique du knowledge management n’implique pas forcément
son succès. En effet, différents facteurs peuvent l’influencer, notamment la culture, le
leadership, la technologie, le temps, la motivation… et, surtout, la confiance (Roberts,
2000), un facteur déterminant de la performance collective et, en particulier, dans le
cas des communautés virtuelles et d’équipes dont la production est à forte intensité
immatérielle (Prax, 2003).
Cette recherche vise donc, à identifier le rôle de la confiance dans le
management des connaissances, autrement dit à déterminer comment la confiance
peut influencer la conduite d’un projet de knowledge management et ce, dans
l’objectif de montrer que la réussite d’une démarche KM dépend en grande partie du
développement et du maintien d’une relation de confiance d’une part, entre les
acteurs concernés et, d’autre part, entre les employés et leur organisation.
Pour ce faire, nous avons entamé une recherche qualitative (qui est encore en cours)
au sein des communautés de pratique chez Schneider Electric.

3
1. Cadre conceptuel :
1.1. Les connaissances dans l’entreprise :
Dès lors que l’on souhaite étudier la préservation, l’application et la
communication des connaissances au sein de l’entreprise, une question surgit
immédiatement : Une entreprise peut elle détenir des connaissances au même titre
qu’un individu ?
Se poser cette question revient à se demander si une entreprise peut acquérir
des connaissances en tant qu’une entité propre, ce qui soulève la problématique de
«l’apprentissage organisationnel».
Lorino (2000) répond à cette question en affirmant « qu’il n’y a plus de savoir porté
par l’organisation que de pensée organisationnelle. Il peut tout au plus arriver qu’il y
ait des savoirs ou des modes de pensée « partagés » communs à plusieurs acteurs ».
Il définit ainsi les notions de « savoir organisationnel » et « d’apprentissage
organisationnel » comme étant « non un savoir ou un apprentissage portés par
l’organisation au lieu de l’être par un sujet individuel, ce qui n’aurait guère de sens,
mais plutôt comme des schémas interprétatifs individuels utiles au déroulement de
l’action organisationnelle ».
Dans cette perspective, Guillon et Huard (1999) affirment que lorsqu’elle est conçue
comme learning organization, « la firme est alors appréhendée comme un « espace
de normalisation » dans lequel les bases de connaissances, les normes et les
croyances partagées permettent de coordonner la diversité des comportements
individuels et d’assurer sa cohésion sociale ».
Toutefois, Argyris (1999) s’oppose à cette idée et à ceux qui considèrent que
l’idée même d’un apprentissage attribué aux organisations est contradictoire,
paradoxale et dénuée de sens, et que seuls les individus, faisant certes partie d’une
organisation, peuvent apprendre. Il affirme entre autres, que l’apprentissage
organisationnel est un processus selon lequel les organisations ou leurs composants
s’adaptent aux environnements changeants et adoptent de manière sélective des
routines organisationnelles. Ce processus est opérant lorsque les réflexions, les
actions et les interactions des membres d’une organisation influent sur les théories de

4
l’action de cette organisation. Ces routines, issues d’un processus d’apprentissage,
guident l’action de la firme et établissent des règles de décision procurant des
solutions à des problèmes (Munier, 1999).
Dès lors que les routines sont à l’organisation ce que les compétences sont à
l’individu (dans le sens où elles permettent d’agir et de résoudre des problèmes),
parler des connaissances de l’entreprise, sur lesquelles s’appuient en partie ces
routines, est pertinent.
Ainsi, les connaissances sont avant tout portées par les acteurs de l’entreprise ;
mais, dans la mesure où les brevets et autres artefacts que possède l’entreprise
recèlent des informations sources de connaissances. Ceci rend l’entreprise capable de
posséder des connaissances, à la condition près qu’elle soit capable de guider ses
acteurs dans leur interprétation de ces informations de façon à recréer les
connaissances de ceux qui les ont formalisés. Ainsi, l’entreprise détient des
connaissances lorsqu’elle a mis en place un processus d’apprentissage assurant la
pérennité de celles de ses acteurs.
1.2. Le management des connaissances : une discipline émergente ?
1.2.1. Knowledge Management (KM) et Information Management (IM) : Quelle
différence ?
Est-ce que le KM est une discipline ou c’est un nouveau label du management
de l’information (IM) seulement ?
La distinction entre le KM et l’IM est loin d’être bien traitée dans la littérature
managériale et il n’y a pas de consensus concernant la considération du KM comme
un nouveau domaine avec ses propres bases de recherche.
En effet, il y a quelques années, en parlant du management de l’information Cornell
(1981) a considéré que l’idée de gérer l’information comme une ressource était « une
tentative de fournir une sinécure pour les services informatiques ». Eaton et Bawden
(1991) le rejoignent dans son point de vue en remettant en cause l’idée que
l’information est une ressource qui pourrait être facilement contrôlée.
La même approche a été adoptée concernant le KM par Yates-Mercer et Bawden
(2002) qui considèrent que la gestion des connaissances ne diffère pas du

5
management de l’information. Ceci revient essentiellement à la confusion entre le
concept de connaissance et celui de l’information . En effet, pour pouvoir identifier la
différence entre le KM et l’IM, on doit examiner les distinctions établies entre donnée,
information, intelligence et connaissance.
Pour Meadow (2000), « la donnée se rapporte à un ensemble de symboles que
ce soit des chiffres ou des lettres » ; il précise que « l’information n’a aucune
signification universellement reçue mais généralement elle porte des données
évaluées et validées ».
La connaissance, par contre, implique un degré plus élevé de certitude et de validité
que l’information et a la caractéristique d’une information partagée et convenue au
sein d’une communauté (Meadow, 2000).
Wiig (1999), pour sa part, définit l’information comme « des faits et des données
organisées pour caractériser une situation et la connaissance comme un ensemble de
vérités et croyances, des perspectives et des concepts, des jugements et des
espérances, des méthodologies et du savoir-faire ».
Par conséquent, l’information peut être considérée comme données rendues
significatives en étant mises dans un contexte alors que la connaissance comme
données rendues significatives par l’intermédiaire d’un ensemble de croyances
portant sur la relation causale entre les actions et leurs conséquences probables et
acquises par l’expérience ou l’inférence (Mitchell, 2000).
La connaissance diffère de l’information parce qu’elle est prédictive et, parfois,
utilisée pour guider l’action tandis que l’information est simplement un ensemble de
données dans un contexte donné. En d’autres termes , la connaissance se rapproche
de l’action plus que l’information.
Cependant, quelques auteurs considèrent encore que l’expression de « gestion
des connaissances » est « fausse ». Gourlay (2000) par exemple, suggère que la
connaissance ne peut pas être gérée et que le KM se concentre sur l’étude « des
représentations de la connaissance » et non pas sur la connaissance elle-même.
Abram (1997), pour sa part, a établi que « l’environnement de la connaissance ou les
conditions de son utilisation sont les seules dimensions qui peuvent être gérées ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%