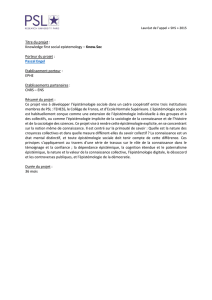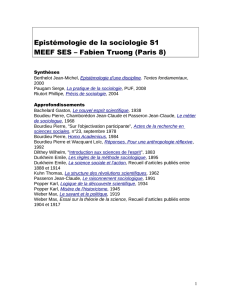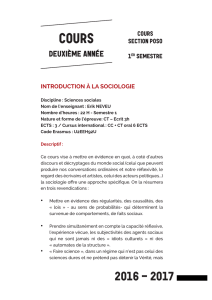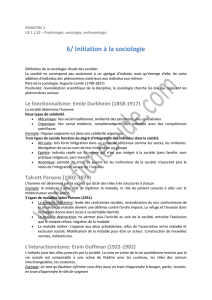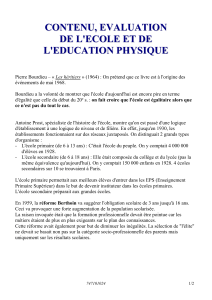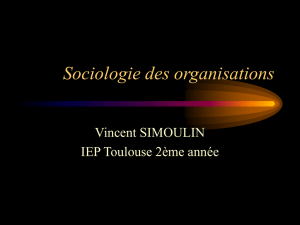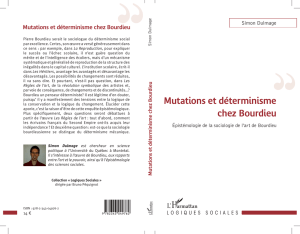LES LOGIQUES D`ACTIONS INDIVIDUELLES

Exposé d’épistémologie
Benoît Koch/Florence Skalli/ Mathilde Morisset-Fénery 1
LES LOGIQUES D’ACTIONS INDIVIDUELLES

Exposé d’épistémologie
Benoît Koch/Florence Skalli/ Mathilde Morisset-Fénery 2
LA PROBLEMATIQUE 3
ELEMENTS DE COMPREHENSION A PARTIR DE LA PRESENTATION DES
PRINCIPALES THEORIES 8
PIERRE BOURDIEU 9
L’HABITUS 9
LA NOTION DE CHAMP 10
LA VIOLENCE SYMBOLIQUE 11
RAYMOND BOUDON 12
ANTHONY GIDDENS 16
L’ACTION 17
L’AGENT COMPETENT 17
LE POUVOIR 18
LE STRUCTUREL 19
LE SYSTEME SOCIAL 20
LA DUALITE DU STRUCTUREL 21
COMMENT ANALYSER UNE ORGANISATION DANS LA PERSPECTIVE
STRUCTURATIONNISTE 22
CROZIER 23
AUTRE THEORIE COMPLEMENTAIRE 24
LES PROBLEMATIQUES PRATIQUES QUI SE POSENT A PARTIR DE CES THEORIES 25
QUELQUES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA DISCUSSION 30
A PROPOS DE L’ACTION INDIVIDUELLE ELLE-MEME 30
COMMENT S'ARTICULE LA DEMARCHE DU CHERCHEUR ET SON OBSERVATION FACE AUX ACTIONS
INDIVIDUELLES ? 30
TEXTES COMPLEMENTAIRES 31
L’ HOMME PLURIEL - BERNARD LAHIRE 31
« LE RETOUR DE L'ACTEUR » (EXTRAITS) PAR THOMAS FERENCZI 32
ARTICLE PARU DANS LE MONDE DU 15.04.88 32
EXTRAITS DE TEXTES PHILOSOPHIQUES 35
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 37

Exposé d’épistémologie
Benoît Koch/Florence Skalli/ Mathilde Morisset-Fénery 3
La problématique
L’entreprise étant composée d’hommes, comment expliquer les comportements individuels de
ses membres ?
Le contexte organisationnel, la structure va-t-elle prescrire le comportement des individus,
contingent de cette structure (théorie structurale et post-structuraliste, analyse de
Bourdieu…) ? L’homme est alors un être « pensé » par l’organisation. Ces modèles holistes
postulent en effet que « les comportements individuels doivent être fondamentalement pensés
comme la conséquence des structures sociales qui sont ainsi posées comme premières dans
l’ordre d’explication », (Boudon R., Bourricaud F., Dictionnaire critique de la sociologie, PUF, 1982,
p196).
Cf. ci-dessous, article de l’Encyclopédie Universalis « Sociologie, les méthodes : Causalité,
déterminisme et explication ».
SOCIOLOGIE - Les méthodes
Causalité, déterminisme et explication
La technologie de l’enquête a sans doute favorisé le développement d’une sociologie réduite
à la recherche de relations entre variables. Mais elle y a d’autant plus facilement contribué
qu’elle s’accordait parfaitement à un type d’analyse, l’analyse causale, et à une approche des
phénomènes sociaux fondée sur la généralisation du paradigme structurel. Ce qu’observe
l’enquête, c’est en effet un individu abstrait, une unité statistique définie comme une simple
addition de variables. Ce qui fonde l’analyse causale, c’est le postulat selon lequel une
variable dépendante peut être conçue comme une fonction d’un certain nombre d’autres
variables dites indépendantes ou explicatives, que cette fonction peut être statistiquement
mesurée et que les relations mises en évidence traduisent des dépendances structurelles.
Enfin, ce que postule le paradigme structurel, c’est que les phénomènes sociaux sont les
produits de structures et ne sauraient être analysés comme le résultat de l’action des
individus, que seules les structures ont une réalité et que les individus n’en sont que les
simples supports. La multiplication des typologies dans la production sociologique est sans
doute l’expression la plus caractéristique de cette convergence.
Sous l’influence de cette trilogie indissociable – enquête, analyse causale et structure –, la
sociologie s’est trouvée engagée dans une recherche systématique de relations causales,
suffisamment fortes pour que l’on croit pouvoir leur attribuer une valeur d’explication,
suffisamment stables et généralisables pour que l’on s’imagine pouvoir leur conférer le statut
de loi. Et c’est précisément sur ce point que les méthodes qui ont dominé la sociologie
pendant les trois dernières décennies paraissent le plus contestables. Comme l’a montré
Raymond Boudon, l’erreur n’est pas tant d’avoir cherché systématiquement à établir des lois,
même s’il n’est pas une seule loi dans les sciences sociales qui puisse se prévaloir d’une
validité universelle, mais d’avoir suggéré que ces lois pouvaient être considérées comme des
explications. En d’autres termes, on peut admettre que le chercheur s’efforce d’établir dans
quelle mesure par exemple la classe sociale détermine la réussite scolaire. Ce qui n’est pas
acceptable, c’est que, ayant observé entre ces termes une relation forte, il estime avoir donné
une explication suffisante des inégalités devant l’école. En croyant par une simple corrélation
tenir une explication du phénomène qu’il propose d’étudier, le sociologue s’engage dans une
double impasse. Lorsque la relation observée paraît insuffisante, on cherchera à l’améliorer
plutôt qu’à comprendre pourquoi elle est faible. Et, quand on aboutit à une relation de
causalité forte, on a l’impression que la mission est achevée. La sociologie électorale offre un
bon exemple des limites d’une telle démarche. Ainsi l’obsession du sociologue électoral a-t-
elle souvent été d’aboutir à une corrélation multiple parfaite; derrière la démarche de la
plupart des études électorales il y a l’idée, généralement implicite, qu’on doit pouvoir mettre le
vote en équation. Pourtant, avec d’importantes batteries de variables, on est rarement
parvenu à rendre compte de plus du tiers de la variance des phénomènes électoraux. Et les
quelques corrélations observées n’ont de surcroît jamais fourni par elles-mêmes l’explication
de leur existence. Ainsi la corrélation mille fois confirmée entre la pratique religieuse et le vote

Exposé d’épistémologie
Benoît Koch/Florence Skalli/ Mathilde Morisset-Fénery 4
de droite apparaît comme l’une des relations les mieux assurées de la sociologie électorale
française: mais on attend encore une explication permettant d’en comprendre la signification.
Le plus étonnant, peut-être, c’est que, malgré la relative faiblesse des relations observées, on
semble admettre difficilement qu’il puisse y avoir d’autres types d’explication et qu’une
corrélation faible (par exemple entre la classe sociale et le vote) puisse être le signe de
structures donnant aux électeurs des possibilités de choix stratégiques indifférents.
La volonté d’établir des relations causales tenues pour explicatives et généralisables va
également écarter du champ de la recherche tout ce qui ne paraît pas s’accorder avec cette
démarche.
Ainsi la supériorité prêtée à la généralisation va-t-elle entraîner la mise au second plan des
recherches qualitatives. Celles-ci avaient pourtant connu leur heure de gloire dans les années
1920 à 1932 sous l’impulsion de l’école de Chicago, mais elles furent vite délaissées au profit
du quantitatif.
Dès 1930, Stouffer estimait que, si les deux approches pouvaient conduire à des conclusions
semblables, la méthode statistique était à la fois plus rapide et plus facile à mettre en œuvre.
Puis le qualitatif s’est vu confiné soit à des fonctions préstatistiques (par exemple la
réalisation d’entretiens non directifs devant servir à l’élaboration d’un questionnaire
d’enquête), soit à un rôle secondaire post-statistique (comme l’étude en profondeur de cas
déviants).
En tout état de cause, parce qu’elle ne permettait pas de généraliser, l’analyse qualitative ne
pouvait apparaître comme une forme de connaissance ayant sa propre validité. Aujourd’hui,
sans doute la généralisation n’apparaît-elle plus comme un objectif prioritaire ou même
simplement accessible, mais aussi, par réaction contre des données quantifiées jugées
insuffisantes, voire trompeuses, l’analyse qualitative paraît retrouver une certaine faveur,
notamment par l’analyse des histoires de vie.
Dans une sociologie qui s’est essentiellement développée autour de la notion de structure et
de la recherche de lois, l’événement ne pouvait lui non plus avoir droit de cité. Alors que la
physique des quanta et la biologie moderne intègrent la notion de système aléatoire où
l’événementiel devient fondamental, la sociologie, dominée par l’idée que les structures sont
productrices d’invariance, de reproduction, que l’improbable ne peut être qu’antiscientifique et
aberrant, continue à chasser l’événement de son champ d’analyse, croyant ainsi gagner en
scientificité.
Mais, là encore, les tendances paraissent évoluer comme le montre par exemple la prise en
compte des données de conjoncture dans l’analyse des phénomènes électoraux.
Ces remarques ne doivent cependant pas conduire au rejet pur et simple de la notion de
cause dans les sciences sociales. La mise en évidence de relations bien établies n’est pas
dépourvue d’intérêt heuristique et fournit au chercheur d’utiles points de repère. Il faut
cependant se souvenir que le postulat qui fonde l’analyse causale et selon lequel le
phénomène à expliquer est la résultante directe de causes bien définies peut ne pas être
approprié au problème étudié. Et il convient surtout de se rappeler que ce type d’analyse ne
peut être qu’une étape de la recherche et qu’une relation n’est pertinente que si on peut la
comprendre.
___________________________________
© 1997 Encyclopædia Universalis France S.A.Tous droits de propriété intellectuelle et
industrielle réservés.
Les comportements individuels vont-ils au contraire construire les situations et le système
organisationnel (théories de l’acteur, analyse de Boudon, analyse stratégique de Crozier,
théorie comportementale de Cyert et March…) ? L’homme est alors un être « pensant » le
système organisationnel. Si les actions individuelles ne sont plus dans cette perspective de
simples variables dépendantes, sans finalités spécifiques propres, deux orientations sont
envisageables :
celle de l’économie néoclassique où il y a universalité des mobiles d’action,
(maximisation rationnelle de l’utilité en contexte d’information parfaite ou modèle
« assoupli » de H. Simon ne reconnaissant à l’individu qu’une rationalité limitée)

Exposé d’épistémologie
Benoît Koch/Florence Skalli/ Mathilde Morisset-Fénery 5
celle qui va intégrer le mobile de l’action individuelle dans la situation dans laquelle
cette action se forme, (sociologie de l’acteur : individualisme méthodologique
contextualisé).
Cf. ci-dessous, article de l’Encyclopédie Universalis « Sociologie, les méthodes :
L’individualisme méthodologique ».
SOCIOLOGIE - Les méthodes
L’individualisme méthodologique
Renouant avec une tradition sociologique ancienne, et notamment avec la sociologie
allemande classique (Weber, Simmel, Sombart...), l’individualisme méthodologique propose
une autre stratégie pour l’analyse des phénomènes sociaux. Pour ce courant de pensée, qui
se développe en France à travers les recherches de sociologues comme Raymond Boudon,
François Bourricaud ou Michel Crozier, les structures sociales ne définissent que le champ du
possible. Les relations entre variables, reflétant les régularités structurelles, ne peuvent donc
être qu’une étape de la recherche: il reste alors à décrire les comportements élémentaires qui
permettent de rendre compte de la relation observée. Expliquer un phénomène social, c’est,
dans cette perspective méthodologique, reconstruire sous la forme d’un modèle abstrait la
motivation des individus concernés par le phénomène et analyser celui-ci comme le produit
agrégé de ces microcomportements. L’individualisme méthodologique implique trois notions
fondamentales: la notion d’émergence, corollaire de la notion d’agrégation; la notion de
modèle, procédure indispensable de simplification face à la multitude des cas de figure
singuliers; la notion de rationalité, liée au postulat de motivation compréhensible.
Concevoir les phénomènes sociaux comme l’agrégation d’actions individuelles ne
présenterait sans doute qu’un intérêt limité si le résultat de cette agrégation ne produisait que
la somme des actions concernées. L’importance des effets d’agrégation tient au fait que ceux-
ci présentent souvent un caractère émergent. La notion d’émergence (ou effet de
composition) signifie que l’agrégation de comportements individuels peut se traduire au
niveau collectif par l’apparition de phénomènes non désirés par les individus. Le produit de
cette agrégation pourra même être diamétralement opposé aux préférences et aux objectifs
visés: on parlera alors d’effets pervers. Ainsi le fait que dans un incendie chaque individu
souhaite logiquement s’échapper au plus vite peut aboutir à ce que tout le monde périsse
dans les flammes. Bien des phénomènes sociaux sont le produit de mécanismes
comparables. En face de situations qui paraissent d’autant plus incompréhensibles qu’on
imagine difficilement que des individus puissent agir d’une manière qui leur soit défavorable,
on peut être tenté de conclure à l’irrationalité et d’invoquer l’effet, évidemment invérifiable, de
structures perverses manipulant les individus de manière inconsciente. En recherchant
comment des actions individuelles logiques ont pu introduire des effets non voulus, on peut
en revanche proposer des explications parfaitement rationnelles à ce qui paraissait
énigmatique.
L’individualisme méthodologique implique également la notion de modèle. Chercher à
comprendre un phénomène social, c’est d’abord en construire une représentation simplifiée et
abstraite; on appellera modèle le produit de cette élaboration. Parce qu’il n’est pas possible
de prendre en compte toutes les actions et toutes les motivations qui contribuent à
l’émergence d’un phénomène social, on ne retiendra que quelques catégories d’acteurs
auxquels on attribuera des logiques de comportement simplifiées, et on ne prendra en compte
parmi l’ensemble des caractéristiques du système social que celles qui paraissent suffire à
l’explication. Qu’il se présente sous une forme mathématique, statistique ou verbale (l’idéal
type wébérien est un modèle), un modèle est une simplification formelle et une abstraction; il
pourra se révéler plus ou moins utile à la démonstration, mais il ne pourra être tenu pour vrai
ou pour faux.
Enfin, l’individualisme méthodologique postule que les actions individuelles obéissent au
principe de rationalité. Cela ne veut pas dire que l’acteur procède, avant toute décision, à un
ajustement optimal des moyens aux fins, mais simplement qu’il a de bonnes raisons d’agir
comme il le fait. La notion de rationalité est la contrepartie nécessaire à la capacité prêtée au
chercheur de comprendre et de reconstruire les motivations de ceux qui ont produit le
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%