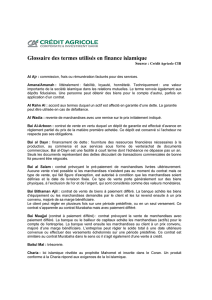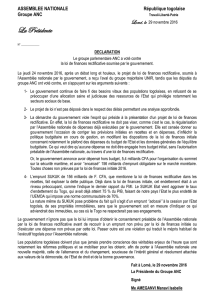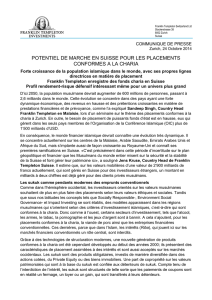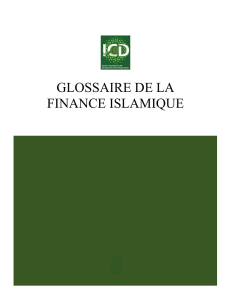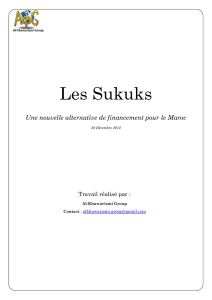que nul n`en ignore [

Document 1 : Le taux d’intérêt dans la religion catholique
Il faut d'abord écarter une équivoque. L'histoire a étroitement lié l'image de l'usurier à celle du Juif.
Jusqu'au XII° siècle, le prêt à intérêt qui ne mettait pas en jeu des sommes importantes et se faisait en
partie dans le cadre de l'économie-nature (on prêtait du grain, des vêtements, des matières et des objets et
on recevait une quantité plus grande de ces mêmes choses prêtées) était pour l'essentiel aux mains des
Juifs. A ceux-ci en effet on interdisait peu à peu des activités productrices que nous appellerions
aujourd'hui « primaires » ou « secondaires ». Il ne leur restait plus, à côté de certaines professions
« libérales » comme la médecine, longtemps dédaignée par les Chrétiens qui abandonnaient à d'autres les
soins d'un corps laissé pour les puissants et les riches aux médecins juifs et pour les autres aux guérisseurs
« populaires » et à la nature, qu'à faire produire l'argent auquel précisément le christianisme refusait toute
fécondité. Non chrétiens, ils n'éprouvaient pas de scrupules et ne violaient pas les prescriptions bibliques
en faisant des prêts à des individus ou à des institutions hors de leur communauté. (…) Le grand essor
économique du XII° siècle multiplia les usuriers chrétiens. Ils nourrirent d’autant plus d’hostilité contre
les juifs que ceux-ci étaient parfois de redoutables concurrents. (…) En théorie, l’Eglise présentait les
usuriers chrétiens comme pires que les juifs, « Car les juifs ne font pas de prêts usuraires à leurs frères ».
L'usure est un vol, donc l'usurier un voleur. Et d'abord, comme tout voleur, un voleur de propriété.
Thomas de Chobham le dit bien: « L'usurier commet un vol ou une usure ou une rapine car il reçoit un
bien étranger contre le gré du « propriétaire » c'est-à-dire Dieu. L'usurier est un voleur particulier ;
même s'il ne trouble pas l'ordre public, son vol est particulièrement haïssable dans la mesure où il vole
Dieu. Que vend-il en effet, sinon le temps qui s'écoule entre le moment où celui où il prête et celui ou il
est remboursé avec intérêt ? Or le temps n'appartient qu'à Dieu. Voleur de temps, l'usurier est un voleur
du patrimoine de Dieu. Tous les contemporains le disent, après saint Anselme et Pierre Lombard.
« L'usurier ne vend rien au débiteur qui lui appartienne, seulement le temps qui appartient à Dieu. Il ne
peut donc tirer un profit de la vente d'un bien étranger ». Plus explicite mais exprimant un lieu commun
de l'époque, la Tabula exemplorum rappelle : « Les usuriers sont des voleurs car ils vendent le temps qui
ne leur appartient pas et vendre le bien d'autrui, contre le gré du possesseur, c'est du vol ». Voleur de
« propriété », puis voleur de temps, le cas de l'usurier s'aggrave. Car la « propriété », notion qui, au
Moyen Age, ne réapparaît vraiment qu'avec le droit romain aux XII° et XIII° siècles et ne s'applique
guère qu'à des biens meubles appartient aux hommes. Le temps appartient à Dieu, et à Lui seul. (…)
Étrange situation que celle de l'usurier médiéval. Dans une perspective de longue durée, l'historien
d'aujourd'hui lui reconnaît la qualité de précurseur d'un système économique qui, malgré ses injustices et
ses tares, s'inscrit, en Occident, dans la trajectoire d'un progrès: le capitalisme. Alors qu'en son temps cet
homme fut honni, selon tous les points de vue de l'époque. Dans la longue tradition judéo-chrétienne, il
est condamné. Le livre sacré fait peser sur lui une malédiction bimillénaire. Les valeurs nouvelles du
XIIIe siècle le rejettent aussi comme ennemi du présent. La grande promotion, c'est celle du travail et des
travailleurs. Or il est un oisif particulièrement scandaleux. Car le diabolique travail de l'argent qu'il met en
branle n'est que le corollaire de son odieuse oisiveté. Ici encore Thomas de Chobham le dit clairement :
« L'usurier veut acquérir un profit sans aucun travail et même en dormant, ce qui va contre le précepte
du Seigneur qui dit: « A la sueur de ton visage tu mangeras ton pain. » (Genèse, III, 19) ». (…)
Je n'évoquerai que rapidement ici la naissance, à la fin du XIIe siècle, d'un nouveau lieu de l'au-delà, le
purgatoire, que j'ai longuement, décrite et analysée ailleurs. Le christianisme avait hérité de la plupart des
religions antiques un double au-delà, de récompense et de châtiment : le paradis et l'enfer. Il avait hérité
aussi d'un Dieu bon mais juste, juge pétri de miséricorde et de sévérité qui, ayant laissé à l'homme un
certain libre arbitre, le punissait quand il en avait mal usé et l'abandonnait alors au génie du mal, Satan.
L'aiguillage vers le paradis ou vers l'enfer se faisait en fonction des péchés commis ici-bas, lieu de
pénitence et d'épreuves pour l'homme entaché du péché originel. L'Eglise contrôlait plus ou moins ce
processus de salut ou de damnation par ses exhortations et ses mises en garde, par la pratique de la
pénitence qui déchargeait les hommes de leur péché. La sentence se réduisait à deux verdicts possibles:
paradis ou enfer. Elle serait prononcée par Dieu (ou Jésus) au Jugement dernier et vaudrait pour l'éternité.
Dès les premiers siècles, les Chrétiens, comme en témoignent notamment les inscriptions funéraires,
espérèrent que le sort des morts n'était pas définitivement scellé à leur décès et que les prières et les
offrandes – les suffrages - des vivants pouvaient aider les pécheurs morts à échapper à l'enfer ou que, du

moins, en attendant la sentence définitive au Jugement dernier, ils bénéficieraient d'un traitement plus
doux que celui des pires condamnés à l'enfer.
Quand, dans l'essor de l'Occident, de l'An Mil au XIIIe siècle, les hommes et l'Eglise estimèrent
insupportable l'opposition simpliste entre le paradis et l'enfer, et quand les conditions se trouvèrent
réunies pour définir un troisième lieu de l'au-delà où les morts pouvaient être purgés de leur reliquat de
péchés, un mot apparut, purgatorium, pour désigner ce lieu enfin identifié : Le purgatoire. (…)
Il y a certes un moyen pour l'usurier d'échapper à l’enfer et même au purgatoire, c'est de restituer.
Etienne de Bourbon le souligne: « L'usurier, s'il veut éviter la damnation, doit rendre (le mot est très
fort, evomat, c'est rendre par vomissement) par restitution l’argent mal acquis et sa faute par la
confession. Autrement il les rendra par vomissement [evomet, à prendre sans doute dans ce cas au pied de
la lettre] par châtiment en enfer ». Mais il faut tout restituer et à temps. Or non seulement beaucoup
d'usuriers hésitent et sont réticents jusqu'à ce qu'il soit trop tard mais, de surcroît, la restitution n'est pas
toujours très simple à réaliser. La victime de l'usurier peut être morte et ses descendants introuvables. La
réalisation de l'argent gagné usurairement peut être difficile si cet argent a été dépensé ou investi dans un
achat qu'on ne peut annuler ou récupérer. L'usure porte sur le temps. L'usurier a vendu, volé du temps, et
cela ne pourrait lui être pardonné que s'il rendait l'objet volé. Peut-on rendre, remonter le temps ? (…)
Une hirondelle ne fait pas le printemps. Un usurier en purgatoire ne fait pas le capitalisme. Mais un
système économique n'en remplace un autre qu'au bout d'une longue course d'obstacles de toutes sortes.
L'histoire, ce sont les hommes. Les initiateurs du capitalisme, ce sont les usuriers, marchands d'avenir,
marchands du temps que, dès le XV°siècle, Léon Battista Alberti définira comme de l'argent. Ces
hommes sont des Chrétiens. Ce qui les retient sur le seuil du capitalisme, ce ne sont pas les conséquences
terrestres des condamnations de l'usure par l'Église, c'est la peur, la peur angoissante de l'enfer. Dans une
société où toute conscience est une conscience religieuse, les obstacles sont d'abord - ou finalement -
religieux. L'espoir d'échapper à l'enfer grâce au purgatoire permit à l'usurier de faire avancer l'économie et
la société du XIIIe siècle vers le capitalisme.
La bourse et la vie (1986) Jacques Le Goff
Document 2 : L’irrésistible envol de la finance islamique
Les sukuk sont des certificats d'investissement conformes à la loi islamique, qui proscrit notamment le
prêt à intérêt. Contrairement à des obligations classiques, ils ne sont pas fondés sur une émission de
dette. Un sukuk correspond à un projet déterminé, un actif tangible dont les gains produiront une
rémunération : les investisseurs se partagent les profits - mais aussi les pertes éventuelles. Par exemple,
dans le cadre d'un sukuk créé en France en juillet 2012, les investisseurs sont copropriétaires d'une
centrale photovoltaïque ; leur revenu est assuré par la revente d'électricité à EDF.
Bien avant la fin 2012, beaucoup annonçaient une année exceptionnelle pour les émissions
d'obligations conformes à la charia, les sukuk. Le volume des émissions, pronostiquaient-ils, allait
franchir la barre des 100 milliards de dollars avant la fin de l'année. Ils avaient raison - et leurs prévisions
se sont même avérées très prudentes. Selon les chiffres publiés par KFH Research, un cabinet koweïtien
spécialisé dans la finance islamique, le volume total de sukuk commercialisés en 2012 se monte en effet à
131 milliards de dollars - une progression de 54 % par rapport à l'année précédente.
En dépit de cette envolée, certains craignent toujours que l'offre de sukuk, un instrument dont la
structure permet de générer des revenus sans enfreindre la loi islamique, soit incapable de répondre à la
demande des investisseurs. Cette dernière devrait représenter 900 milliards de dollars à l'horizon 2017,
selon le cabinet Ernst & Young. "La demande de sukuk est en forte progression depuis quatre ans",
constate Jubin Jose, conseiller auprès du Fonds d'investissement du Qatar. "Force est de constater que les
émissions ne suivent pas."
La progression exponentielle de la demande est d'abord la conséquence de la croissance à deux chiffres
du secteur bancaire islamique et de l'appétit grandissant pour des placements fiables, liquides et
compatibles avec la charia. Selon les spécialistes du secteur, la demande émane d'institutions financières
islamiques mais aussi de gestionnaires de fonds et de particuliers très fortunés. La crise de la dette de la

zone euro a en outre ravivé l'intérêt des établissements traditionnels pour les sukuk. S'ils apprécient les
produits islamiques, c'est essentiellement parce ces derniers sont adossés à des actifs tangibles.
"Il faudra sans doute des années avant que l'offre soit en mesure de satisfaire la demande. Les coûts
liés à l'émission des sukuk refroidissent nombre d'entreprises et d'Etats, à l'exception notable de la
Malaisie et des pays membres du Conseil de coopération du Golfe [Arabie Saoudite, Bahrein, Emirats
arabes unis, Koweït, Oman et Qatar]", analyse Jason Kabel, responsable de la gestion obligataire à la
Bank of London and the Middle East. Ces coûts découlent notamment de la pénurie d'actifs respectant les
principes de la charia et de la multiplicité de cadres juridiques et fiscaux [selon les pays], qui peuvent
rendre les titres compatibles avec la charia plus compliqués à concevoir que des obligations standards.
"Le marché primaire des sukuk est tourné vers l'Asie et le Moyen-Orient", reconnaît Jesse Liew, un
gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les placements internationaux en sukuk chez BNP Paribas
Investment, basé en Malaisie. "Les autres régions rechignent sans doute à émettre des sukuk en raison de
la jeunesse de ce marché et du nombre limité d'initiatives publiques visant à promouvoir l'utilisation de
ces instruments comme sources de financement."
Jubin Jose, du Fonds d'investissement du Qatar, n'est pas de cet avis. Selon lui, le spectre des émetteurs
s'élargit. "General Electric [via sa branche de services financiers], HSBC et [le conglomérat malaisien]
Sime Darby font d'ores et déjà appel au marché des sukuk et, à l'avenir, des Etats comme l'Afrique du
Sud, la Tunisie, la Turquie et le Maroc pourraient à leur tour s'y intéresser."
L'Egypte est déjà dans ce cas. Le gouvernement, qui met la dernière main à un projet de loi autorisant
la mise sur le marché de sukuk, compte lever 1 milliard de dollars avant le mois de juin en vendant ses
premières obligations islamiques.
" Il y a cinq and le marché était organisé autour de deux pôles : les pays membres du Conseil de
coopération du Golfe et la Malaisie", constate Mohammed Dawood, responsable international du marché
des sukuk pour HSBC. "Aujourd'hui, une multitude de pays s'y mettent, dont la Turquie et l'Indonésie. Au
fil des ans, d'autres pays ou régions, comme l'Australie, Hong Kong, l'Afrique du Nord, la Jordanie, le
sultanat d'Oman et Singapour, devraient leur emboîter le pas."
Cela étant, les statistiques montrent que l'an dernier, plus de 70% des émissions mondiales de sukuk
ont eu lieu en Malaisie, tandis que l'Arabie Saoudite se classait deuxième avec 7,5 % du total. C'est
d'ailleurs en Malaisie qu'ont été conçus les premiers sukuk en 2000. "Nous pensons que 2013 sera une
année record, reprend Mohammed Dawood. A elles seules, les émissions des pays membres du Conseil de
coopération du Golfe devraient représenter 35 milliards de dollars. Cela s'explique notamment parla
disparition progressive de plusieurs obstacles, comme l'absence de cadre juridique." L'ambition de Dubaï
- devenir le centre économique du monde islamique - devrait accélérer ce processus, poursuit-il. "Cela
facilitera l'uniformisation des modalités d'émission ainsi que la formation d'un consensus parmi les
conseils d'administration et les théologiens musulmans. Le mécanisme des émissions de sukuk deviendra
plus efficace." —Financial Times (extraits) Londres —Chris Newlands
Courrier International, n°1167 du 14 mars au 20 mars 2013
***********************************************************************
1°) Pourquoi l’Eglise catholique a-t-elle longtemps interdit le prêt à intérêt ?
2°) Le juifs étaient-ils soumis aux mêmes commandements religieux que les catholiques en matière
d’argent ? Pourquoi prêtaient-ils quand même avec un intérêt ?
3°) Qu’appelait-on un usurier au Moyen-âge ? Et de nos jours ?
4°) Rechercher sur le site de la Banque de France les niveaux actuels des taux d’usure.
5°) A quoi a servi l’invention du « purgatoire » par la religion catholique ? Quelle conséquence cela –t-
il eu sur le développement du capitalisme ?
6°) Montrer que les sukuk sont une « autre » façon de se conformer aux interdits religieux.
7°) Qu’est-ce qu’une obligation ? Pourquoi est-ce plus difficile pour une entreprise d’émettre un sukuk
qu’une obligation ?
8°) Les prêteurs ont-ils financièrement intérêt à investir dans des sukuk ou dans des obligations
standards ?
9°) Quelle rationalité anime ceux qui préfèrent investir dans les sukuk ?
10°) Dans quelle mesure les sukuk peuvent-ils être considérés comme compatibles ou en contradiction
avec la théorie économique néoclassique ?
1
/
3
100%