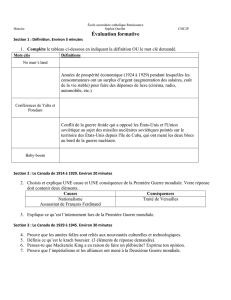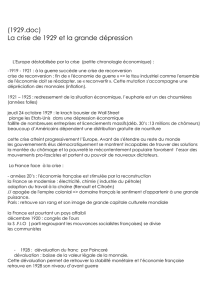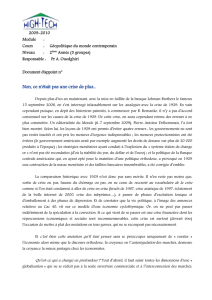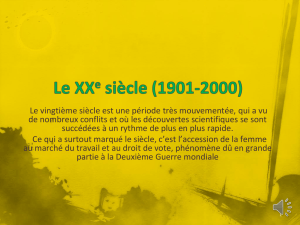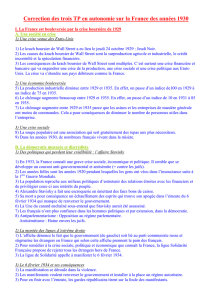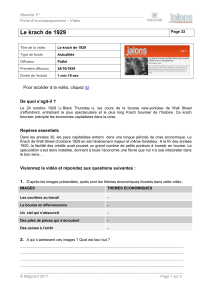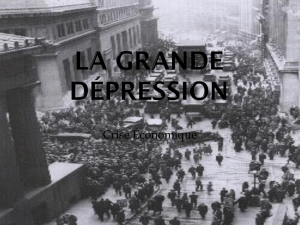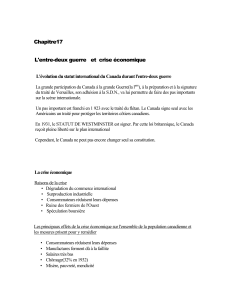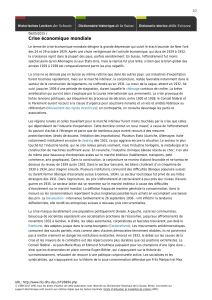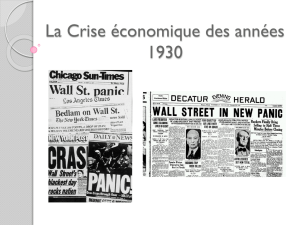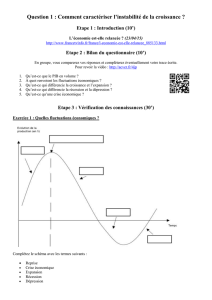Tout ce qu`on ne vous a pas dit sur 1929 Chaque fois qu`une crise

Tout ce qu'on ne vous a pas dit sur 1929
Chaque fois qu'une crise financière menace la marche du monde surgit immanquablement le spectre de
1929. Dans un livre publié en 1955 et réédité en... 1987, John Kenneth Galbraith, avec humour, écrivait, à
l'occasion du grand krach boursier qui avait fait plonger en octobre 1929 les places financières mondiales
: « Il en est des années comme des poètes, des hommes politiques et des belles femmes : la célébrité les
distingue bien au-delà du lot commun, et visiblement 1929 est de celles-là. C'est une année dont chacun se
souvient. Pendant une décennie, toutes les fois que les Américains ont été affligés de doutes sur la péren-
nité de leur état de prospérité habituel, ils se sont demandé : est-ce que c'est 1929 qui va recommencer ? »
L'année 2008 n'a pas failli à cette comparaison qui fait figure de lieu commun et de modèle de la pensée
unique. La crise de 1929 est un défi pour les « libéraux », qui se voient reprocher leur aveuglement sur les
tares du « système ». C'est une aubaine pour les marxistes, les postmarxistes, les socialistes ou ce qu'il en
reste, les keynésiens et les antilibéraux de tout poil, qui peuvent dénoncer les « orgies spéculatives » et en
appeler à la main ferme et juste de l'Etat. Pour tous, c'est bien l'étalon de mesure auquel il faut toujours se
comparer, la mère de toutes les crises qui conduirait, si ceux qui nous gouvernent n'y prenaient garde, à
l'avènement de nouveaux Hitler et à une nouvelle déflagration mondiale. (…)
Une affreuse banalité
Première observation d'importance : la crise « financière » qui éclate en octobre 1929 à Wall Street,
comme celle d'octobre 1987, de septembre - octobre 2000, de septembre - octobre 2008, est d'une af-
freuse banalité. Comme toutes les crises boursières qui l'ont précédée et l'ont suivie, elle sanctionne les
excès de la phase économique précédente et ramène à la raison tous ceux qui pensaient voir les arbres
monter jusqu'au ciel. A sa manière, Isaac Newton a sans doute le mieux expliqué ces crises financières en
écrivant en 1720, au lendemain de l'éclatement de la bulle boursière sur la South Sea Company qui avait
englouti ses économies : "Je peux mesurer le mouvement des corps, mais je ne peux pas mesurer la folie
des hommes."
En octobre 1929, selon un mécanisme bien huilé, la crise éclate au cœur de la « prospérité », comme en
1857, comme en 1907 ou comme en 2007 où elle survient après cinq années de très forte croissance.
Après la crise de 1921 qui a vu chuter le PIB de près de 7 %, la croissance s'emballe à partir de 1922, au
rythme de 3,3 % l'an en dollars constants. C'est l'entrée dans une « nouvelle ère » avec la prolifération des
gratte-ciel, de l'automobile, du téléphone, de la radio, du jazz, du cinéma et l'engouement pour la Floride
où la spéculation, animée par Charles Ponzi, l'ancêtre de Madoff, transforme les marécages en plages pa-
radisiaques. En 1929, un Américain sur cinq possède une voiture -taux d'équipement que la France at-
teindra quarante années plus tard. De 1922 à septembre 1929, le Dow Jones, l'indice des valeurs new-
yorkaises, est multiplié par 4 et atteint le 3 septembre l'indice 381. Le célèbre économiste Irving Fisher
déclare alors : « Les cours ont atteint ce qui semble être un plateau perpétuellement élevé. »
Comme toujours, en fait, personne n'avait manigancé cette hausse des cours qui avait presque doublé
entre le début de 1928 et septembre 1929. Elle était simplement le produit du choix et de la décision libre
de centaines de milliers d'individus poussés par cette « folie » bien naturelle qui amène à penser qu'il est
possible de devenir très riche en peu de temps, exactement comme ceux qui, entre 1996 et 2000 ou entre
2003 et 2007, ont pu penser que leurs gains en Bourse pouvaient tripler ou quintupler en quelques an-
nées alors que la croissance des richesses n'augmentait que d'un peu plus de 2 % par an. Nul besoin, en la
matière, de chercher des boucs émissaires dont le métier, vieux comme le monde, est d'exploiter la cupidi-
té et l'imbécillité des hommes.
De « banale » la crise devient « exceptionnelle »
A cet égard, Herbert Hoover, l'homme qui condamnait le plus cette « folie », était celui qui allait être élu en
novembre 1928 président des Etats-Unis. Ce quaker d'origine modeste, devenu ingénieur de réputation
mondiale vers 1910, secrétaire au Commerce en 1920, avait déclaré, dès le début de 1925, qu'il était in-
quiet de cette « marée croissante de la spéculation », ajoutant à son propos : « Il y a des crimes bien pires
que l'assassinat et pour lesquels les hommes devraient être blâmés et punis. » Ces propos « inamicaux »
du futur président américain traduisaient une méfiance à l'égard du marché boursier que ne pouvaient
imaginer ceux qui le portèrent à la Maison-Blanche.
En octobre 1929 -peut-être l'automne a-t-il une influence psychologique particulière sur l'humeur des
milieux financiers-, le marché se retourna logiquement, tout mouvement spéculatif étant en fait program-
mé pour s'achever par un krach. Les 18, 19 et 23 octobre, les premières ventes massives se produisent. Le
jeudi 24-dit le « jeudi noir »-, l'indice Dow Jones perd 22,6 %. Le lundi 28, il perd encore 13 % et encore 12
% le mardi 29 octobre. Le 13 novembre, l'indice est retombé à l'indice 198, soit le niveau de 1928. 39 % de
baisse en trois semaines sans toutefois que s'envole la courbe des suicides. Galbraith, qui s'est amusé de

cette sinistre légende, montre même qu'il y eut moins de suicides en octobre et en novembre que durant
les mois de l'été où la Bourse marchait merveilleusement bien !
Symbolisée par ce krach boursier de Wall Street, la crise de 1929 ne peut pourtant se réduire à cette cause
unique, et encore moins aux défaillances du système capitaliste américain. Les faillites des banques, la
baisse du PIB de 9 % en 1930 et la hausse du chômage font tristement partie de toutes les crises qui ont
émaillé son histoire, du XIXe siècle aux années 30. Et c'est cette mémoire des crises antérieures qui ame-
nait Hoover à penser qu'elle se résorberait d'elle-même, comme les autres. En avril 1931, en effet, le chô-
mage n'avait pas encore pris une ampleur catastrophique. Dès novembre 1929, Hoover avait réuni les
chefs d'entreprise les plus représentatifs pour leur demander de ne pas réduire les salaires. En 1930, il
avait fait ouvrir 700 millions de crédits pour financer des travaux publics (dont le fameux Boulder Dam,
barrage sur le Colorado) et pris des mesures pour élargir les bases du crédit. Des mesures que Franklin
Roosevelt allait critiquer en accusant Hoover de mener les Etats-Unis sur la voie du socialisme et en an-
nonçant que, s'il était élu, il imposerait à l'administration fédérale de sévères économies et réduirait les
dépenses de l'Etat de 25 % pour équilibrer le budget !
Il est trop commode, aujourd'hui, de brocarder celui qui annonçait le prochain retour de la prospérité, car
prédire un désastre n'exige ni courage ni prescience. Qui, en 2007, avait prédit, au terme de cinq années
d'exceptionnelle prospérité, qu'une crise majeure allait surgir en 2008 ?
Mieux vaut essayer de comprendre pourquoi ces mesures n'ont pas suffi et pourquoi la crise financière «
banale » de 1929 s'est transformée en crise économique « exceptionnelle ». Pour en prendre la mesure, il
faut d'abord rappeler qu'elle s'inscrit dans une période singulière de l'histoire du monde qui en a amplifié
les manifestations. Les crises ne sont jamais seulement économiques, elles sont aussi le miroir des socié-
tés qu'elles déstabilisent. Ce n'est pas la cupidité ni la sottise des hommes qui expliquent le caractère ex-
ceptionnel de la crise de 1929, mais plus fondamentalement la folie nationaliste de ceux qui ont provoqué
la Première Guerre mondiale et les désastres qui se sont ensuivis.
Herbert Hoover, encore lui, n'avait pas tort d'écrire : « Au sens large, la cause première de la Grande Dé-
pression fut la guerre de 1914-1918. Sans la guerre, il n'y aurait pas eu de dépression d'une pareille di-
mension. Il aurait pu se produire une récession cyclique normale, mais avec la périodicité coutumière ce
réajustement ne se serait pas transformé en Grande Dépression. » La chronologie de la crise des années
30 semble effectivement lui donner raison. Certes, il y avait bien des faiblesses dans l'économie améri-
caine et bien des dysfonctionnements dans le système financier, mais ce n'était rien en comparaison des
bouleversements qu'avait provoqués la Première Guerre mondiale sur les économies européennes. Une
hécatombe démographique sans précédent a tout d'abord fauché près de 11 millions d'Européens entre
1913 et 1919 et empêché 11 autres millions de naître. C'était ramener la population de l'Europe à ce
qu'elle était avant 1900 et la priver d'une grande partie de sa population masculine d'âge militaire. Les
dégâts matériels (plus la production qui ne fut pas réalisée) dépassaient 700 milliards de francs de
l'époque, soit près de 20 fois le PIB français- l'équivalent aujourd'hui du PIB mondial. Sans la guerre, on a
calculé que la production industrielle de l'Europe en 1929 aurait été atteinte dès 1921, ce qui veut dire
que huit années furent perdues. L'inflation- un mot qui, dans « Le Petit Larousse » d'avant guerre, était
défini comme « enflure, terme pathologique : peu usité » - avait multiplié les prix par 5 : 400 % de hausse
en quelques années... En France, la fortune moyenne avait été divisée par 3 ! De plus, les traités de paix de
1919 eurent des effets dramatiques que John Maynard Keynes dénonça sur-le-champ dans un pamphlet, «
Les conséquences économiques de la paix », qui s'avéra fort prophétique. La disparition de l'empire aus-
tro-hongrois provoqua le protectionnisme exacerbé des nombreux petits Etats nouveaux. La question des
réparations, aggravée par celle des dettes interalliées, empoisonna l'atmosphère des années 20. L'hype-
rinflation allemande en 1922-1923 en fut la plus hallucinante des manifestations. Seule contre tous, l'An-
gleterre rétablit en 1925 la parité de la livre sterling à sa valeur d'avant guerre, aggravant le chômage et
les problèmes structurels de l'industrie britannique. Pour la première fois de l'Histoire, des mouvements
de capitaux brutaux et déstabilisateurs s'attaquèrent aux monnaies nationales. La Grande-Bretagne perdit
un quart de ses investissements à l'étranger, la France la moitié et l'Allemagne la totalité. Troisième puis-
sance économique mondiale en 1913, derrière les Etats-Unis et la Chine, la Russie s'écarta des circuits
économiques internationaux (c'est comme si aujourd'hui l'Allemagne disparaissait de la carte du monde).
Comment oser, aujourd'hui, disserter sur la crise de 1929 et accabler les défaillances du « libéralisme »
sans prendre en compte cette nouvelle donne qui ne doit rien aux turpitudes de l'économie de marché ?
Cascades de dévaluations en Europe
En fait, le grand centre de la tempête qui ravagea les économies mondiales durant les années 30 était bien
l'Europe. Depuis 1928, la conjoncture se dégradait fortement en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en
Grande-Bretagne et même en France, où l'indice des valeurs cotées à la Bourse baissa de plus de 10 %
entre février et octobre 1929, soit avant le krach de Wall Street. En France toujours, Le Figaro écrivait, le

26 octobre 1929 : « Ce qui semble avoir réconforté notre marché, c'est l'orage qui a secoué assez forte-
ment Wall Street hier... Maintenant que l'abcès de Wall Street est crevé, on peut envisager l'avenir immé-
diat sous de plus agréables couleurs », cela pendant que plusieurs indices annonçaient un recul marqué de
l'activité. Ainsi, la valeur moyenne des exportations s'effondrait de 1 833 francs en 1926 à 1 256 francs en
1929. De même, les exportations d'automobiles chutaient de 3,8 milliards en 1926 à 2,3 milliards en 1929,
avant le krach d'octobre. Celles de l'industrie textile baissaient pour la même période de 15 milliards de
francs à 12,6 milliards. L'industrie de la soie, qui était la première branche exportatrice, voyait son activité
reculer de 23,9 % entre le deuxième trimestre 1928 et le troisième trimestre de 1929. Autant d'indica-
teurs d'un retournement de conjoncture antérieur à la crise américaine, à laquelle il est trop facile d'impu-
ter la responsabilité du désastre qui allait suivre.
En mai 1931, la faillite de la Kreditanstalt de Vienne, la plus grande banque d'Autriche, fragilisée par la
division de l'Autriche-Hongrie et l'hyper-inflation des années 20, provoqua une panique qui se propagea
dans les pays danubiens, en Pologne et en Allemagne, où la Danatbank fait également faillite en juillet. Le
21 septembre 1931, la Grande-Bretagne, qui avait beaucoup prêté à l'Allemagne, doit dévaluer, provo-
quant une vaste crise des changes et des échanges dans le monde. A la suite du Royaume-Uni, 14 pays
dévaluent avant la fin de l'année 1931, du Danemark au Canada, de l'Egypte à la Bolivie, de la Norvège à la
Suède, de la Finlande au Portugal.
Comment les Etats-Unis auraient-ils pu échapper à cette tempête ? La chronologie fine répond une nou-
velle fois à cette question. C'est bien entre la mi-1931 et la mi-1932 que la production industrielle améri-
caine chute lourdement, que l'indice du cours des actions s'effondre et que le chômage passe de 8,7 % de
la population active à près de 25 %. C'est 1932 qui a été l'année tragique aux Etats-Unis, pas 1929. Et c'est
cette année de forte crise qui assura, comme en 2008, la victoire du candidat démocrate (avec 43,1 %
d'abstentions). Tout juste investi, Franklin Roosevelt annonce, dès le 10 mars 1933, qu'il va réduire les
dépenses publiques pour mettre le budget fédéral à l'équilibre et torpille, en juillet 1933, la conférence de
Londres dont le but était de remédier à la désorganisation du commerce international et d'endiguer la
marée montante du protectionnisme.
A partir de cette date, chaque pays va jouer sa partition pour lutter contre la crise. A ce jeu, ce fut l'Angle-
terre qui s'en sortit le mieux. En dévaluant avant tous les autres, elle s'attribua un avantage comparatif
décisif. Le PIB par habitant, qui s'élevait à 5 138 dollars (de 1990) en 1931, monta à 6 266 dollars en 1938,
une hausse de près de 22 % qui contraste avec celle de 5,5 % seulement enregistrée dans les années 20.
De 1920 à 1930, on avait construit un million et demi de maisons. On en construisit 2 700 000 dans les
années 30. Ce fut aussi l'Allemagne... nazie qui, en lançant une politique « keynésienne » de grands travaux
publics et surtout d'armement tout en pratiquant une politique d'argent bon marché, permit au PIB par
habitant d'augmenter de 48,5 % de 1931 à 1938, alors qu'il n'avait augmenté que de 41,2 % au cours des
années 20, et de retrouver le plein-emploi ! Un modèle de politique de relance keynésienne qui ne mérite
guère de faire école.
Les Etats-Unis, en revanche, malgré le New Deal, n'avaient toujours pas retrouvé en 1938 le PIB par habi-
tant de 1929. A cette date, il s'élevait à 6 899 dollars (de 1990). Il plafonnait à 6 126 en 1938. Le déficit du
budget fédéral était passé de 20,9 milliards de dollars en 1933 à 43 milliards, et le pays comptait toujours
9 millions de chômeurs, soit 17 % de la population active. Autant de chiffres qui invitent à ne pas accorder
au New Deal les vertus que lui prête aujourd'hui la pensée unique.
Ce fut enfin la France, désespérément accrochée à sa politique du franc fort, comme dans les années 90,
qui fut lourdement déclassée. En 1929, ses exportations représentaient 6 % des exportations mondiales et
12,2 % des exportations européennes. En 1937, elles n'en représentaient plus respectivement que 3,7 %
et 5 %. A cette date, ses exportations industrielles ne représentaient plus que 32,3 % de celles de la
Grande-Bretagne au lieu de 50,5 % en 1929. En 1938, le PIB par habitant (4 466 dollars de 1990) était,
comme aux Etats-Unis, inférieur à celui de 1929 (4 710). Enfin, si le chômage recensé apparaît modeste au
regard de celui enregistré en Allemagne, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, la dégradation du marché du
travail enregistrée dans les années 30 contrastait avec l'amélioration enregistrée dans les autres pays.
Comme celles des années 70-80, la crise des années 30 souligne le comportement « original » de l'écono-
mie française : relativement épargnée dans un premier temps, elle connaît dans les deux cas un chômage
élevé et durable. Vers 1938, le déclin de la France annonce finalement la déroute de 1940.
(…)
Jacques Marseille – Le Point – janvier 2009
1
/
3
100%