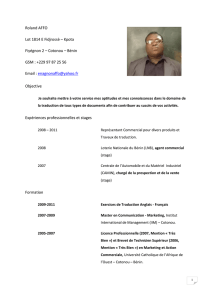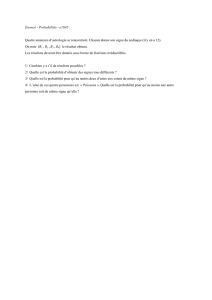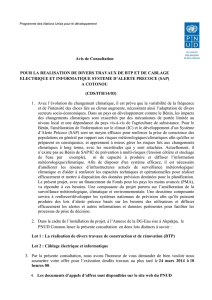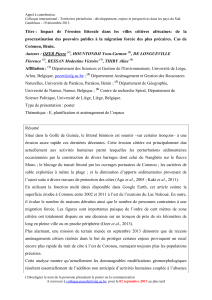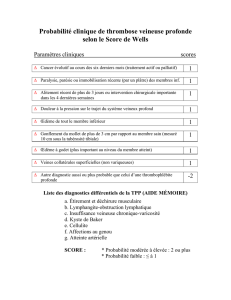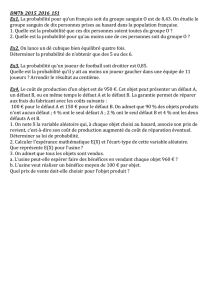Titre Concentration des entreprises et dynamique territoriale au

Titre Concentration des entreprises et dynamique territoriale au Bénin
Auteur ACACHA Hortensia
Ecole Nationale d’économie appliquée UAC Bénin
Résumé
La localisation des entreprises dans un milieu a suscité beaucoup de réflexion dans la
littérature. Alors que certains auteurs s’appuient sur les variables territoriales Porter et al
(1998) Torre et Rallet (2005), d’autres prennent en compte les variables liées au management
Desbaies (2005) . Ce papier a voulu analyser les formes de concentrations et déterminer les
conditions qui pourraient renforcer la localisation des entreprises pour une dynamique
territoriale dans les communes du Bénin. La méthodologie a utilisée la base des données de
L’INSAE. Les outils d’analyse sont le coefficient de localisation et la régression logistique.
Les résultats montrent que la concentration des activités dépend des secteurs d’activités. Dans
toutes les conditions, les communes situées au sud abritent plus d’entreprises que les autres.
Il en résulte une différence dans la capacité des communes par rapport à l’analyse de la
dynamique territoriale.
Mots clés : concentration, localisation, économie locale, dynamique territoriale
1. Introduction
L’analyse de l’économie locale d’un territoire passe par plusieurs axes d’entrée à partir de la
littérature. Soit par l’efficacité des firmes présentes sur le territoire, expliquée par la fonction
de la demande et de la production d’un bien (la micro-économie des entreprises) ; soit par la
quantité des entreprises et les interactions entre acteurs, Porter et al (1998) Torre et Rallet
(2005) qui définissent les clusters comme des formes de concentration d’entreprises
fonctionnelles en réseau; ou encore soit par des dynamiques territoriales qui se basent sur la
capacité d’innovation de l’espace dont la performance repose sur la dynamique de
l’entrepreneur.
Desbaies (2005) considère le management stratégique comme un meilleur axe d’analyse de la
localisation industrielle. Il met l’accent sur la dynamique des acteurs qui se traduit par
l’ensemble des décisions et des activités favorables à la progression de l’entreprise dans son
environnement.
L’analyse de la localisation cherche à identifier le lieu le plus pertinent et le plus avantageux
pour le développement de l’entreprise. Ce papier aborde cet axe d’analyse et son champ
d’investigation de terrain est la république du Bénin. Ce pays retient l’attention par rapport à
la localisation des entreprises dans une dynamique territoriale. En effet, la crise keynésienne
des années 80 et sa politique de redistribution a fragilisée beaucoup de gouvernements des

pays africains dont la République du Bénin. Les mesures de redressement proposées par la
Banque Mondiale et le programme d’ajustement structurel ont suscité des départs de la
fonction publique, l’augmentation du taux de chômage, la faiblesse du pouvoir d’achat des
consommateurs (Rapport sur l’économie nationale du Bénin 1989).
La décentralisation comme une politique de redressement de cette situation a donné un
nouveau visage administratif et une réorganisation du territoire en soixante-dix-sept
communes dont trois communes à statut particulier et les soixante-quatorze restantes sont des
communes de simple exercice. Chacune d’elle possède une autonomie financière de gestion et
un espace de pouvoir de développement. Dans ce nouveau contexte, le développement
économique locale ne peut se faire sans la présence des entreprises privées et semi-publiques
présentes sur chacun de ces territoires à construire. Le problème est de savoir comment
orienter le développement économique local de ces communes à partir de la localisation des
entreprises sur le territoire ? Il faudrait connaître les facteurs qui orientent leur choix de
localisation.
De plus, la politique de décentralisation a favorisé l’émergence de nouveaux entrepreneurs
privés, la mise en œuvre d’un nouveau climat politique d’affaire et de nouvelle restructuration
de l’espace grâce à la localisation de nouvelles entreprises Adjaho (2005). Il s’agit donc de
décrire dans ce nouveau contexte institutionnel, les formes de concentration des entreprises
dans les communes suivant la taille et la distance puis la dynamique territoriale de ces
communes béninoises par rapport à la localisation de nouvelles entreprises. Dans cet article,
nous cherchons à analyser les concentrations des entreprises au sein des communes et la
capacité des communes à attirer la localisation de nouvelles entreprises en fonction de la
distance par rapport à la capitale économique du Bénin qui est Cotonou. Comment les
concentrations d’entreprises varient t’elles au sein des communes du Bénin? Quelles sont les
formes de concentrations d’entreprises qu’abritent ces différentes communes? Est ce que ces
concentrations sont fonction du nombre d’emplois présent sur le territoire? Quelles sont les
caractéristiques des communes qui attirent les entreprises à se localiser en leur sein?
Comment se comportent les communes face à la localisation de nouvelles ’entreprises? Est-ce
que la localisation d’une entreprise est fonction de la distance de la commune par rapport au
centre de la capitale économique du Bénin, de la taille de la ville ou de l’âge des entreprises
ou finalement du secteur d’activité. Nous postulons comme hypothèse dans ce travail que la
distance affecte négativement la localisation des entreprises au sein des communes, ce qui
fera que les communes les plus éloignées abriteront moins d’entreprises et gagneront moins
dans la localisation de nouvelles entreprises que les communes plus proches de la capitale.
Le développement de ces communes serait ralenti.
Pour réaliser cet objectif, le travail est structuré en trois parties. Après la revue de littérature
qui aborde les facteurs liés à la localisation et les théories inhérentes, la méthodologie
explique la typologie effectuée au sein des communes et les variables prises en compte. Enfin,
nous avons présenté les concentrations des entreprises suivant la taille des communes et
suivant la distance des communes par rapport à Cotonou et ensuite nous avons analysé la
dynamique territoriale des communes pour bénéficier de nouvelle localisation d’entreprises.

2. Revue de littérature
Nous mènerons quelques réflexions liées aux facteurs de localisation des entreprises sur un
territoire, puis sur les économies d’agglomérations et les externalités marshalliennes en
économie d’agglomération.
2.1Les facteurs de localisation des entreprises sur un territoire
Il existe des facteurs liés aux avantages comparatifs du milieu et des facteurs liés aux
économies d`échelle. Avant d’aborder ces deux points, définissons le facteur de localisation.
Selon Mérenne-schoumaker (1996), le facteur de localisation est tout phénomène susceptible
d’influer d’une manière ou d’une autre sur le choix d’une localisation. Elle définit trois grands
principes qui déterminent ce facteur:
1-Un facteur ne pourrait à lui seul expliquer une localisation;
Un même facteur pourrait exercer des influences diverses;
Le choix d’une localisation est la résultante d’un nombre plus ou moins grand de facteurs dont
le poids et la diversité varient fortement d’une situation à l’autre. Pour Polèse 2009, la
sélection finale d’une localisation est toujours une question de compromis et d’option car il
est impossible de trouver un emplacement parfait permettant une implantation parfaite pour
un prix parfait (Polèse 2009).
2.1.1 Les facteurs liés aux avantages comparatifs du milieu
2.1.1.1L’influence de la taille
La densité permet de mesurer la taille. Les facteurs qui contribuent à la formation de la
densité selon Prager et Thisse 2009 sont : la productivité croissante dans le secteur agricole,
un progrès technologique favorable à la production accompagnée d’une migration des
travailleurs vers les villes, et enfin, une spécialisation des tâches. Aussi, une spécialisation du
travail Selon Adams Smith, cité par (Prager et Thisse 2009) pousse à une forte concentration
et renforce la densité.
2.1.1.2 L’influence de la distance
La distance est mesurée par le coût de transport. Kim (1989) conclut dans ces études qu’un
coût de transport élevé favorise la dispersion des activités alors qu’un coût de transport faible
pousse à une concentration. De même, Bairock (1983) considère que la taille des villes est
limitée par un coût de transport élevé. La distance représente ainsi par contre un frein à la
formation d’une densité élevée et par conséquent, à une forte concentration.
2.1.2. Les facteurs liés aux économies d’échelle

La localisation d’une entreprise dans un milieu donné n’est pas simplement fonction de la
production, ni de la distance et de la taille, mais d’autres facteurs que Victor (2004) et Polèse
(2009 :233) classent en deux catégories.
Les avantages de première nature. On y retrouve la présence de terres arables, de
ressources minières, l’accès à la mer et de certaines entreprises qui bénéficient d’un
fort ensoleillement comme facteur entrant dans le processus de production. Ces
avantages sont liés aux caractéristiques intrinsèques du territoire. Costes Nicolas
(2000) classe ces déterminants dans les avantages comparatifs de Ricardo de façon
classique.
L’accès aux marchés. Les entreprises vont s’installer auprès de la demande finale. Plus
le rendement de l’entreprise est croissant et plus elle va se rapprocher de la demande
ou va s’implanter sur un territoire regroupant plus de consommateurs ou ceux donnant
le meilleur accès à la demande.
Selon Polèse (2009), les villes portuaires, les villes frontalières et les villes abritant un grand
réseau de communication obtiennent des rendements plus que proportionnels grâce à
l’influence de ces facteurs que les inputs qui rentrent dans la production d’un bien.
2.1.3. La prise en compte de l’espace dans la localisation des entreprises
Si la taille, la distance et la main d’œuvre représentent les principales variables à considérer
dans la formation d’une économie d’agglomération, la prise en compte de l’espace dans
l’analyse économique de la localisation des entreprises est aussi une autre variable.
L’espace chez les classiques et les néoclassiques
L’espace a été faiblement prise en compte dans les analyses économiques chez les classiques
ni à travers la division du travail ; la recherche de l’équilibre du marché et même dans
l’analyse du jeu de la concurrence. Même chez les néoclassiques ; cette tentative n’a pas été
prise en compte dans la fonction de production, de consommation et dans l’analyse de marché
unique de Walras.
Chez Ricardo (1817) ; la prise en compte de l’espace a été très simpliste. Si son analyse des
facteurs de production liés aux avantages comparatifs de produits échangeables au niveau des
marchés nationaux et même internationaux laisse croire à une mobilité parfaite des produits, il
n’a pas fait ressortir l’idée d’une mobilité parfaite des inputs au niveau national comme
international. De ce fait ; son analyse reste limitée au niveau de la prise en compte de
l’espace. RICARDO considère l’espace comme un support neutre dans la localisation des
activités économiques pour le commerce international.
L’espace au niveau des différentes théories de localisation

La littérature se réfère à Polèse et alii (2009), Lajugie et alii.(1985 : 20-58) pour une
synthèse des écrits classiques de Weber Alfred (1962), Richard Cantillon, Beckmann (1968),
Isard (1956) et Hover (1948) Aydalot(1985) dans la localisation des activités. Ici, la majorité
des travaux s’est surtout orienté sur la structuration économique de l’espace suivant la taille et
la distance par rapport au centre d’une agglomération et sur la minimisation du coût en
général et du coût de transport en particulier dans la localisation.
Cantillon cité par Belhedi (2010) a étudié la localisation des populations en relation avec les
activités économiques et constate que le choix de localisation d’un bien minimise le coût de
transport. Ce qui fait que le prix d’un bien dans un espace dépend de la distance parcourue par
le bien, son coût de transport et du revenu du consommateur. Cette analyse a aboutit à
l’explication des zones de concentrations des activités et des populations.
Von Thunen cité par Belhedi (2010), reprend la même idée sur la localisation, mais son
analyse a porté sur les activités agricoles par rapport aux aires de marché. Il constate comme
chez le précédent auteur que le choix dépend de la distance mais qui varie dans son cas selon
la valeur de la terre, c’est-à-dire la manifestation de la rente foncière.
Le modèle de localisation des activités industrielles de Weber (1909) s’est intéressé à la
minimisation des coûts dans la fonction de production. La localisation optimale d’une firme
dans un espace constitué de trois points fixes, deux lieux d’extraction et un lieu de vente
dépend du coût total du transport sur le coût du bien à l’entreprise. La localisation dépend du
coût des facteurs dans la production et du facteur dont la quantité pour la production du bien
est plus élevée. Il définit ainsi l’indice matériel de l’entreprise pour une production donnée qui
représente le rapport entre le poids total des intrants sur le poids total des extrants.
Les travaux de Weber ont été repris par Hotelling et Palander, cité par Belhedi (2010) par
rapport à la localisation des producteurs ou des vendeurs en situation de duopole ou
d’oligopôle. Ils définissent des lieux où le coût de transport est identique à cause de la durée
constante du déplacement et des lieux où les coûts de transport sont identiques pour les
matières premières et pour le produit fini. Ces différents espaces indiquent des formes de
concentrations et de vente différentes.
Plus tard, la prise en compte de l’espace a été faite à travers la notion d’attractivité dans
l’analyse de la localisation en économie urbaine. L’attractivité de deux villes est fonction de
la taille et de l’inverse du carré de leur distance au lieu considéré. Christaller cité par Belhedi
(2010) a étudié la taille des villes avec leur zone d’influence et les différents agencements
dans l’espace. Son analyse par rapport à l’attractivité a aboutit à une hiérarchisation des villes
ou on définit les zones de faibles influence qui représentent les espaces à fonctions courantes
et des zones d’influence plus élevée qui représentent les plaques centrales.
Losch, cité par Belhedi (2010) a repris les travaux de Christaller, mais appliqué sur les
activités industrielles et agricoles au niveau des aires de marché. Il aboutit à une segmentation
des réseaux suivant des systèmes hexagonaux. Les travaux de cet auteur ont été approfondis
par plusieurs autres auteurs comme Isard (1956) qui associe les théories de localisation aux
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%