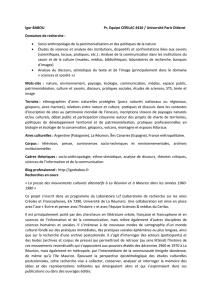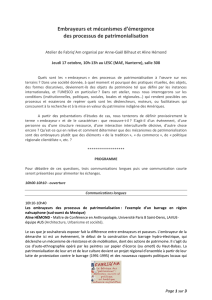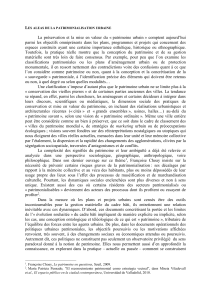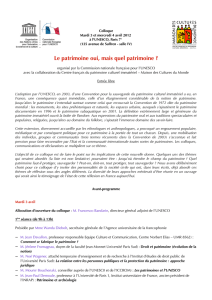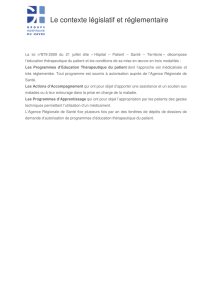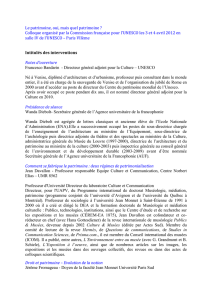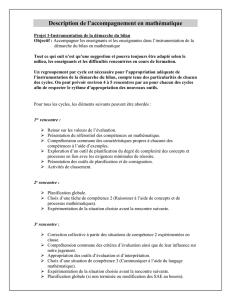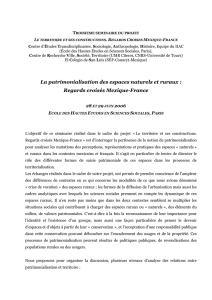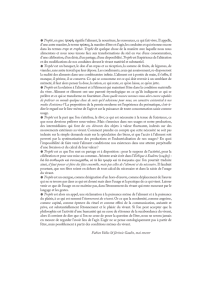Version Word Linck et Barragan 2009a

1
Economie et patrimonialisation
Les appropriations de l'immatériel
1
Thierry Lincka
Rémi Boucheb
Résumé
Les savoirs, les valeurs sociales et les trames cognitives qui leur donnent sens forment les patrimoines, c'est-
à-dire les mémoires collectives qui animent les groupes sociaux. Dans des sociétés largement marquées par
le commerce des valeurs symboliques et la privatisation des connaissances, le patrimoine est un objet que
l'économie ne peut plus ignorer. La marchandisation de ressources dotées d'attributs de biens collectifs,
présuppose une révision des rapports d'appropriation et renvoie à la mise en oeuvre de choix collectifs. Ce
champ problématique échappe totalement à une économie formaliste trop étroitement structurée par le
dogme de la rationalité individuelle et trop engluée dans ses présupposés idéologiques. L'appropriation
collective repose en effet sur un principe d'exclusion qui s'exprime dans l'imbrication de multiples
dimensions. Il porte sur les images associées à la marchandise, sur l'usage de la dénomination et
l'instrumentalisation d'une réputation ; il engage les capacités à gérer les ressources patrimoniales et à
reconfiguer le patrimoine lui-même ; il s'applique enfin au partage des bénéfices attendus. Par là,
l'appropriation instruit un processus de patrimonialisation qui engage bien davantage que la marchandise
elle-même : elle pèse sur la reconnaissance des mémoires collectives, sur leur reconfiguration et sur la
construction des identités et du lien social. Dans cette perspective, l'économie patrimoniale, loin de
constituer une catégorie spécifique d'une discipline ordonnée par le paradigme du « choix rationnel », ne peut
que viser à en renouveler les fondements.
mots clé: patrimoine, patrimonialisation, marchandisation, choix collectif, appropriation
Abstract:
Knowledge, social values and cognitive devices constitute the substance of the collective memory and
patrimonies of social groups. So, in a world deeply marked by the business of the symbolic values and the
privatization of knowledge, the economists cannot ignore any more the notion of patrimony. The patrimonial
goods possess attributes of collective and non merchant goods . Their valuation supposes a modification of
the modalities of appropriation, and thus calls particular collective choices. The economic science which
remains a prisoner of the individual rationality dogma cannot explore such a problem. The collective
appropriation rests on a principle of exclusion which expresses itself in various ways. It can refer to the
images associated with a product or to a name. It can concern the management of the resources, affect the
patrimony itself and naturally, the sharing of the expected benefits. Therefore exchange value and
patrimonial appropriation affect the configuration of the collective memories, the identities and the social-
relationship itself.
key words: patrimony, patrimonialization, exchange value, collective choice, appropriation
1
Cette réflexion s'inscrit pour partie dans le cadre du programme européen TRUEFOOD. Les arguments développés
n'engagent que la responsabilité des auteurs.
a Laboratoire de Recherche sur le développement de l'élevage, INRA-SAD Corte. linck@corte.inra.fr
b Laboratoire de Recherche sur le développement de l'élevage, INRA-SAD Corte. rbo@corte.inra.fr

2
Economie et patrimonialisation
Les appropriations de l'immatériel
Thierry Linck
Rémi Bouche
Du patrimoine à la patrimonialisation
La notion de patrimoine déroute tout autant qu'elle fascine. Elle déroute parce qu'elle est ambiguë,
floue et fortement connotée. Le terme est ancien et a des acceptions changeantes selon l'époque et
ses dépositaires. Officielles, elles sont tour à tour religieuses, monarchiques, familiales, nationales,
administratives et scientifiques. Ces acceptions variables sont sources de confusions toutes
relatives : toutes cadrent avec une définition qui invite à assimiler le patrimoine à une mémoire
collective. Plus largement, il peut être reconnu comme mémoire partagée propre à un groupe, à un
lieu, à une nation et, en un mot, à un ordre. Davantage qu'un simple registre, c'est l'expérience d'une
communauté, dans sa double acception d'ancrage dans un passé où elle s'est constituée et de
capacité d'action. Dans la mesure aussi où elle est mobilisée pour affirmer la position de chacun et
de tous dans le temps, dans la société et donc pour produire l'histoire, cette mémoire collective ne
peut pas être neutre. La notion de patrimoine est ainsi indissolublement liée à celle de pouvoir et la
façon dont elle est constituée et définie - et donc appropriée - en constitue un enjeu de premier plan.
C'est ainsi l'Eglise d'abord, l'Etat moderne, ensuite, qui réglementent la constitution, la conservation
et la gestion du patrimoine ainsi que les droits d'accès des particuliers. Il reste que si le patrimoine
est une affaire d'État, c'est aussi celle des contre-pouvoir. C'est alors le point autour duquel tendent à
se focaliser toutes les résistances, celles des peuples et des sociétés dominées ou colonisées, celles
du local face à l'emprise de la globalisation, celles des communautés de croyances et celles, enfin,
des banlieues dans des sociétés trop cloisonnées. Il reste que la mémoire peut être trop lourdement
amputée et le combat dévoyé dans une entreprise d'enfermement et de repli sur soi. Le patrimoine
ne tend alors qu'à être un alibi, l'image tronquée et flatteuse d'un passé glorifié qui sollicite les
volontés sans donner de sens. Il en est alors du patrimoine comme de ces « lieux de mémoire »
dont Pierre Nora (1994) nous dit qu'ils « ne sont plus tout à fait la vie, pas tout à fait la mort,
comme ces coquilles vides sur le rivage quand se retire la mer de la mémoire vivante. (...) Ils
apparaissent comme des buttes-témoin d'un autre âge, des illusions d'éternité ».
Rien d'étonnant donc, au final, que la notion de patrimoine soit relativement peu présente dans les
sciences sociales, bien moins en tout cas de ce que l'on aurait pu attendre. Elle est peu sollicitée par
les historiens et les anthropologues qui en redoutent probablement l'ambiguïté et le risque de couper
les témoignages du passé de leur contexte originel ; elle l'est moins encore par les sociologues et les
économistes
2
déroutés, probablement, par l'énormité et la complexité de l'objet auquel ils seraient
confrontés. La notion de patrimoine a pourtant de quoi fasciner. S'il est posé en tant que mémoire
collective, le patrimoine peut être reconnu comme un héritage transmis de génération en génération
et façonné par chacune d'elles. Mais il émerge alors aussi en tant qu'accumulation de savoirs
techniques et relationnels: il est alors question de connaissances, de règles, de valeurs... présentes en
l'état ou dans les objets qu'ils ont permis de façonner. Dans un cas, le patrimoine apparaît comme un
ancrage, à la fois dans le passé et dans l'ordre social; dans l'autre, il peut être perçu comme une
capacité d'action, une projection dans le futur et dans un ordre social en construction ou en
2
Le patrimoine s'apparente pourtant à un capital, au détail près qu'il est largement situé hors de l'univers marchand et
qu'il ne peut pas être, en tant que tel, l'objet de transactions.

3
gestation. Il s'agit bien là des deux faces d'un même objet, d'une même ressource sociale fondatrice
qui oriente et cadre les relations inter-individuelles. Considéré sous cet angle, le patrimoine peut
être considéré comme une institution première au sens de Veblen, celle-là même dont la disparition,
selon Hobbes, plongerait toute société dans un chaos absolu, ou encore comme cet ensemble de
valeurs qui, selon Durkheim, fait consensus et constitue le dernier rempart contre l'anomie et
l'anarchie. Il n'y a pas de société sans mémoire et le patrimoine peut à juste titre apparaître alors
comme le fondement premier, l'objet ultime et inaccessible de la Science Sociale.
Inaccessible, le patrimoine l'est à plus d'un titre. En premier lieu parce qu'il est partout et pourtant
insaisissable. Comment en faire l'inventaire s'il est présent dans chacun des objets qui nous
entourent, dans les savoir-faire, les savoir utiliser et les savoir nommer que nous mobilisons à
chaque instant, s'il imprègne, enfin, nos représentations, nos valeurs, nos croyances, nos règles ?
Enfin, comment l'aborder ? A quels paradigme se rattacher si l'on considère que l'on a affaire à un
objet susceptible d'intéresser tous les domaines des sciences sociales ? Le patrimoine forme de toute
évidence un tout dont aucun composant ne saurait être détaché sans risque de le convertir en l'une
de ces coquilles vides qu'évoque Pierre Nora. En tant que mémoire - et donc information -, on peut
sans risque considérer le patrimoine comme un système, structuré par des trames cognitives
individuelles et collectives. Mais alors, comment en dénouer les fils, en repérer les hiérarchies, tant
ces trames sont nombreuses et enchevêtrées?
Autant dire que ce défi ne peut pas être relevé: le patrimoine restera longtemps encore cet objet
ultime et inaccessible. Cela ne veut pas dire que la problématique patrimoniale ne soit pas digne
d'intérêt ni même hors de portée. Si le patrimoine reste insaisissable en tant que tel, il n'en va pas
nécessairement de même des logiques activées dans les usages qui en sont faits et des forces qui
sous-tendent sa production et sa transformation. Nous serons ainsi conduits à parler davantage de
patrimonialisation que de patrimoine. Le terme n'est pas pris dans son sens courant
d'enregistrement, de « mise en patrimoine »; mais bien plutôt en tant que processus d'activation, de
gestion et de renouvellement des patrimoines. Ces aspects portent directement sur les usages et la
production de composants patrimoniaux et, de ce fait, interpellent plus directement la Science
économique.

4
Le patrimoine comme ressource
Ainsi entendue, la notion de patrimonialisation dévoile des clivages révélateurs. En premier lieu, le
patrimoine constitue de toute évidence une ressource, mais une ressource qui présente la
particularité d'être mobilisée tout autant dans la production de richesses marchandes que dans celle
de la société: la question des interactions entre le marchand et le non marchand, largement délaissée
par l'économie se trouve ainsi placée au coeur du débat. En second lieu, un patrimoine se gère, se
dilapide ou s'enrichit, son usage est donc l'expression d'un choix. À la différence de l'économie
normative qui ne s'intéresse qu'à la décision individuelle, le choix est ici collectif : il s'agit encore là
d'une dimension largement délaissée par les économistes. Les biens patrimoniaux sont dotés
d'attributs de biens collectifs: comment en envisager la gestion sans remettre en cause ce postulat
implicitement partagé qui veut qu'un bien collectif soit par essence un bien libre ? En troisième lieu,
un patrimoine fait système, il sollicite par là l'ensemble des sciences sociales et appelle une
transgression de frontières du champ disciplinaire de l'économie. Cela est également vrai pour ce
qui touche ses rapports aux sciences exactes et aux sciences de la vie et à l'ensemble des disciplines
concernées par la problématique du développement durable: dans la mesure où le développement
durable ouvre une réflexion sur notre engagement collectif vis-à-vis des générations futures, il peut
être étroitement relié à la problématique de la patrimonialisation. Enfin, la patrimonialisation
appelle une réflexion sur le statut et les fonctions des biens immatériels: il est bien question là
d'information, de connaissances, de représentations et donc de ce qui constitue en dernier ressort la
substance même de tout patrimoine. La production de l'information, son contrôle et ses
manipulations ainsi que ses effets sur la société, en un mot la problématique de la
patrimonialisation, trouvent alors une pertinence évidente pour la science économique si l'on
considère le poids de l'information et de l'image dans nos économies et nos sociétés
contemporaines.
Des éléments qui viennent d'être évoqués, deux méritent une attention particulière. Il s'agit en
premier lieu de l'attention portée à la construction des choix collectifs. Face aux paradigmes de
l'utilitarisme et aux présupposés de l'économie formelle qui, à la suite de Robins, voit son domaine
réduit à la question du « choix rationnel » (l'allocation de biens et ressources rares à usage
alternatif), l'ouverture du champ épistémologique de l'économie à la question de la construction du
choix collectif permet d'ouvrir une dimension supplémentaire en renouvelant la problématique du
conflit et des rivalités d'usage. La conception formaliste de l'économie implique en effet un
corollaire: les biens et ressources collectifs, ceux-la même dont l'activation appelle la construction
de choix collectifs, ne peuvent être considérés que comme des biens libres, qui ne font donc l'objet
d'aucune rivalité. Pour reprendre la définition de Mancour Olson (Olson, 1976), cela suppose en
effet que la surconsommation d'un individu ne porte préjudice à aucun autre usager. Envisager que
cela ne soit pas le cas et assumer qu'aucun artifice ne permet de réduire la problématique du choix
collectif à celle de la décision individuelle conduirait à remettre en cause les postulats les plus
fondamentaux de l'utilitarisme et de l'individualisme méthodologique.
Tel est à la fois notre objectif et le point de départ de notre argumentation: considérer le patrimoine
comme une ressource complexe, dotée d'attributs de biens collectifs et pourtant soumise à des
rivalités d'usage. Le patrimoine ne constitue pas un bien libre: tous ne jouissent pas des mêmes
droits et capacités d'accès et tous n'en tirent pas le même bénéfice, que celui-ci soit apprécié en
termes de statut social ou d'accumulation de richesses marchandes. La complexité du patrimoine,
son double ancrage dans l'univers de l'échange marchand et celui de la construction du lien social
ainsi que ses temporalités multiples invitent à reformuler les hypothèses de comportement sur
lesquelles l'économie formelle fonde son argumentaire. Il n'est pas pour cela nécessaire de remettre
en cause le principe de l'intérêt particulier mais, plus simplement, l'axiome qui prétend qu'il ne peut

5
être satisfait que par l'échange. Considérée sous cet angle, la patrimonialisation repose sur un
paradoxe: elle est fondée sur un rapport de coopération et se résout dans la mise en scène de conflits
qui mettent en balance l'intérêt collectif - accroître les capacités d'action présentes ou futures du
groupe par une incrémentation de son patrimoine - et l'intérêt particulier qui pousse les individus
(sans qu'ils en soient nécessairement conscients) à accroître leur capacité à prélever une part plus
importante de la ressource commune. La clé de ce paradoxe tient à un aspect qui, logiquement, n'a
pas retenu l'attention de l'économie formelle: la construction de l'appropriation collective, c'est-à-
dire du corpus de règles qui pose, spécifie et cadre (tant en interne que vis-à-vis de l'extérieur) un
principe d'exclusion hors duquel l'appropriation n'a aucun sens (Weber, 1993 et Linck, 2006). Au-
delà de la critique de l'économie formelle, la question de l'appropriation constitue le socle sur lequel
l'économie patrimoniale doit être construite.
Le dogme du choix rationnel
Selon les formalistes - l'approche néo-classique -, l’économie s’intéresse à
l’allocation de biens et de ressources rares à usages alternatifs. Dans cette
perspective, l’économie est entièrement structurée autour d’une théorie du choix
qui met sur le devant de la scène des individus parfaitement autonomes. Ainsi,
l’homo economicus de la théorie est un être parfaitement rationnel dont les
comportements (et donc les choix) sont entièrement expliqués par une obsession :
satisfaire son intérêt particulier indépendamment de toute considération morale
et hors de tout cadre institutionnel. Ainsi posé, le principe de rationalité suppose
que rien - c’est-à-dire, pas davantage le jeu de dérives compulsives que
d’éventuelles contraintes morales ou juridiques - ne fera dévier l’individu de la
ligne que trace son obsession : quelles que soient les circonstances qu’il aura à
affronter, le choix qu’il effectuera sera toujours, nécessairement, celui qui lui
apporte le plus grand bénéfice. Ce postulat appelle un préalable: l’homo
economicus est calculateur, il est en mesure d’évaluer (et donc de comparer) de
façon complète, précise et certaine, toutes les conséquences des choix qu’il peut
envisager d’effectuer. Cette aptitude appelle à son tour une autre condition, elle
aussi posée en postulat : l’homo economicus est également parfaitement informé.
Il l’est pour ce qui concerne la connaissance de ses propres aspirations: le
consommateur connaît parfaitement l’ordre de ses préférences personnelles, de
même, l’entrepreneur maîtrise parfaitement l’ensemble des options techniques en
fonction desquelles il organisera la production. L'un et l'autre le sont également
pour ce qui concerne la connaissance de leur environnement et en particulier les
conditions d’accès aux biens que leur intérêt leur dicte d'acquérir.
Dans un univers entièrement régi par la recherche de l’intérêt particulier, l’homo
economicus - le décideur individuel - constitue l’unité élémentaire, et d’ailleurs la
seule, de l’ordre social. La société telle que l'entend l'économie formelle est
dépourvue d'institutions, de mémoire et donc privée de patrimoine. Elle ne
constitue en définitive qu’un conglomérat informe d’individualités qu’opposent
l'égoïsme, la diversité des aspirations et la prégnance des comportements
opportunistes. Est-ce à dire que ce monde idéal posé par la théorie néo-classique
exclut, en même temps que les institutions et les valeurs morales, l’existence de
tout lien social ? Certainement pas : la démarche des néo-classiques pose au
contraire le principe de l'existence d’un ordre sous-jacent, immanent ou
« naturel », que le concept même d’homo economicus vise à mettre en évidence. Ce
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%