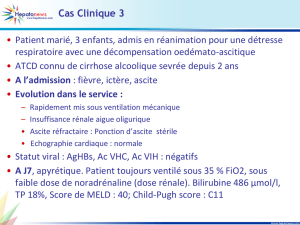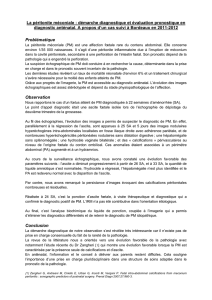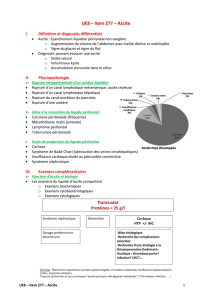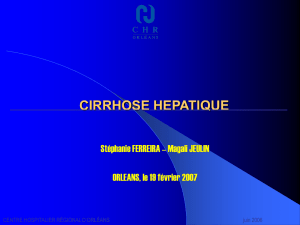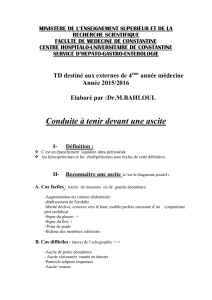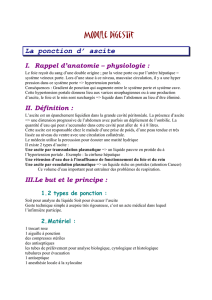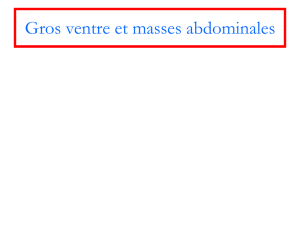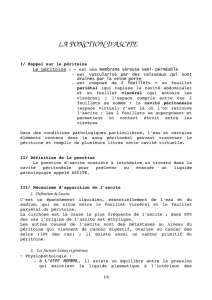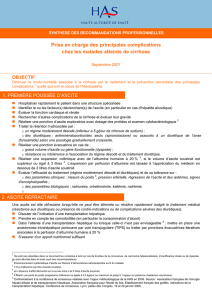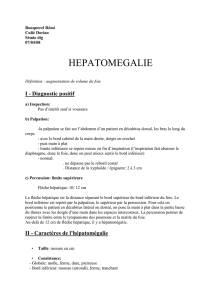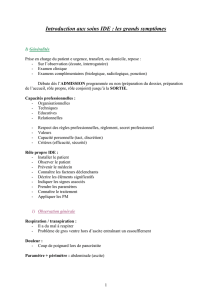DIAGNOSTIC DEVANT UNE ASCITE - polys-ENC

Ascite (N° 298) - 1 -
QUESTION N° 298 :
ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT UNE ASCITE
Devant une ascite, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les
examens complémentaires pertinents
L’ascite est un épanchement liquidien dans la cavité péritonéale. Les 2 causes
principales sont la cirrhose et la carcinose péritonéale. L’examen clinique et la ponction
d’ascite exploratrice sont les éléments déterminants du diagnostic étiologique.
DIAGNOSTIC POSITIF
L’ascite s’installe souvent progressivement sous la forme d’une augmentation du
volume de l’abdomen et une prise de poids. Elle peut être précédée de douleurs et de
météorisme simulant un syndrome occlusif. Cliniquement, on observe un abdomen distendu.
La percussion montre une matité des flancs, déclive et mobile, à concavité supérieure et
encadrant une sonorité péri-ombilicale. En décubitus dorsal, cette matité occupe l’hypogastre,
les fosses iliaques et les flancs. En décubitus latéral, la matité est localisée dans la fosse
iliaque et les flancs inférieurs. Lorsque l’ascite est abondante, la distension abdominale
devient de plus en plus évidente avec déplissement de l’ombilic et écartement des muscles
droits. En cas d’ascite très abondante, la sonorité de la région ombilicale peut être absente, de
même que le caractère déclive mobile de la matité. A ce stade, le signe du flot et le signe du
glaçon peuvent être objectivés. Le retentissement clinique de l’ascite doit être évalué (dyspnée
importante, éversion de l’ombilic, hernie ombilicale, inguinale ou crurale) afin de réaliser
rapidement une ponction évacuatrice.
Le diagnostic différentiel en cas d’ascite libre (situation la plus fréquente) se pose
rarement. Les diagnostics de globe vésical et de volumineuse masse abdominale (fibrome
utérin ou kyste ovarien) sont facilement écartés par la percussion (matité convexe vers le
haut). Les autres difficultés diagnostiques concernent l’ascite cloisonnée observée en cas
d’ascite infectée ou néoplasique. Elle se traduit par une matité en damier pouvant évoquer un
kyste du mésentère.

Ascite (N° 298) - 2 -
DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE
Les données de l’interrogatoire et l'examen clinique orientent le diagnostic plus de 9
fois sur 10. Dans le contexte connu d’une cirrhose ou d’un cancer digestif ou ovarien, le
diagnostic ne pose pas de problème. Dans les autres cas, il faut chercher des arguments en
faveur :
- d’une hépatopathie chronique : facteurs de risques viraux (transfusion,
toxicomanie) ou toxiques (alcool, médicaments), signes d’insuffisance
hépatocellulaire ou d’hypertension portale ;
- d’une maladie tumorale : signes d’occlusion associés, nodules tumoraux
palpables au niveau de l’abdomen, tumeur rectale ou masse du douglas au
toucher rectal, foie tumoral, ganglion de Troisier ;
- des causes plus rares : signes d’insuffisance cardiaque droite, de
pancréatopathie, de syndrome néphrotique, des antécédents de tuberculose.
La ponction d’ascite exploratrice avec analyse du liquide d’ascite est l’étape
fondamentale de la démarche diagnostique. L’aspect macroscopique peut apporter les
informations utiles au diagnostic (couleur, limpidité, caractère hémorragique). Le plus
souvent le liquide est de couleur citrin. Un liquide trouble est en faveur d’une infection, un
liquide hémorragique en faveur d’une cause tumorale, un liquide laiteux en faveur d’une
ascite chyleuse. Les différents prélèvements sont destinés à une étude histologique (avec
numération des leucocytes, polynucléaires neutrophiles et lymphocytes, des globules rouges
et recherche des cellules mésothéliales), anatomopathologique (recherche de cellules
néoplasiques), bactériologique (avec examen direct et culture) et biochimique (dosage des
protides et, selon le contexte, de l’amylase, des triglycérides et de l’albumine ou d’autres
marqueurs). La distinction entre transsudat et exsudat est classiquement basée sur le taux de
protéines dans l’ascite : < à 25 g/l pour les transsudats et > à 25 g/l pour les exsudats. Cette
classification a une valeur d’orientation mais elle est imparfaite. Le gradient [albumine
sérique – albumine dans ascite] permet de différencier les ascites avec HTP (gradient > 11 g/l)
et sans HTP (gradient < 11 g/l). En pratique, il n’est toutefois pas utilisé par tous.
L’échographie abdominale permet d’explorer le foie et ses vaisseaux (aspect
dysmorphique en faveur d’une cirrhose, signes d’hypertension portale, thrombose porte ou

Ascite (N° 298) - 3 -
des veines sus-hépatiques, foie secondaire), la tomodensitométrie abdominale apporte des
informations importantes en cas d’ascite de cause non hépatique (exploration du pelvis chez la
femme, mise en évidence d’une carcinose péritonéale). Les autres explorations paracliniques
seront orientées par la clinique (à visée cardiovasculaire, rénale, pancréatique, ovarienne). La
laparoscopie est utile lorsqu’une pathologie péritonéale sera suspectée sans avoir pu être
affirmée par l’analyse du liquide d’ascite et les autres examens.
Hépatopathie (> 85%)
La survenue d’une ascite au cours des hépatopathies aiguës est exceptionnelle. Dans la
large majorité des cas, elle vient compliquer une hépatopathie chronique connue ou non.
Il s’agit le plus souvent d’une cirrhose (par bloc intra-hépatique). L’apparition d’une
ascite a une valeur pronostique péjorative. Elle est prise en compte dans le score pronostic de
Child-Pugh. Le taux de protides dans l’ascite est en général inférieur à 20 g par litre, mais
peut être plus élevé. La mise en évidence d’une ascite dans un contexte de cirrhose va
immédiatement conduire à la recherche d’une infection spontanée du liquide d’ascite (taux de
polynucléaires neutrophiles supérieur à 250 par mm3). Cette infection est indépendante de la
cause, de l’ancienneté de la cirrhose et de l’abondance de l’ascite. Rarement latente, elle est le
plus souvent symptomatique et doit être évoquée en premier lieu devant un décalage
thermique et des douleurs abdominales. Le diagnostic doit également être suspecté devant une
diarrhée, des nausées ou vomissements, une encéphalopathie hépatique, un état de choc.
L’examen clinique peut révéler des signes d’irritation péritonéale.
D’autres hépatopathies non cirrhotiques peuvent exceptionnellement générer une
ascite : hépatite aiguë grave (alcoolique, virale, médicamenteuse ou autre), stéatose hépatique
aiguë gravidique, l'infiltration massive du foie par des métastases.
Autres étiologies
Le taux de protides est le plus souvent supérieur à 30g/litre.

Ascite (N° 298) - 4 -
L’ascite néoplasique (10%) survient le plus souvent dans un contexte d’altération de
l’état général. La carcinose péritonéale secondaire est la cause la plus fréquente d’ascite
d’origine péritonéale et survient principalement au cours des cancers ovariens, de l’estomac,
du côlon, du pancréas. Les touchers pelviens peuvent révéler une tumeur ou des granulations
dans le cul de sac de Douglas. La ponction d’ascite ramène un liquide souvent hémorragique
dans lequel on peut parfois mettre en évidence des cellules néoplasiques. Le mésothéliome
péritonéal (carcinose péritonéale primitive) est rare, survenant le plus souvent chez des
patients exposés à l’amiante. L’analyse du liquide d’ascite montre un taux élevé d’acide
hyaluronique.
L’ascite tuberculeuse (1%) est suspectée lorsqu’il existe des antécédents de
tuberculose, dans un contexte de dénutrition, d’immunodépression, d’altération de l’état
général, avec fièvre et atteinte d’autres organes. La ponction d’ascite ramène un liquide
souvent citrin, lymphocytaire (plus de 1000 GB/mm3 dont plus de 70% de lymphocytes). La
recherche de BARR au direct est généralement négative. Parfois la cœlioscopie est nécessaire
pour confirmer le diagnostic montrant un péritoine très inflammatoire avec de nombreuses
adhérences couvertes d'un semis de nodules blanchâtres. La biopsie de ces nodules va montrer
le garnulome tuberculoïde à l’analyse anatomopathologique.
L'ascite pancréatique est en rapport avec la rupture de faux kystes et/ou des canaux
pancréatiques, le plus souvent en cas de pancréatite chronique. Elle est à évoquer, chez un
éthylique chronique, en cas de signes évocateurs d'une pathologie pancréatique (douleurs
épigastriques, amaigrissement parfois majeur), souvent associés à un épanchement pleural
généralement à gauche. La ponction d’ascite ramène un liquide citrin ou ambré riche en
amylase. Les explorations morphologiques utiles au diagnostic de maladie pancréatique sont
essentiellement l'échographie et la tomodensitométrie abdominale.
L'ascite de l'insuffisance cardiaque est à évoquer en cas d'anasarque chez un
insuffisant cardiaque (insuffisance cardiaque droite, péricardite constrictive). Il existe alors
une turgescence spontanée des jugulaires, un reflux hépato-jugulaire et une hépatomégalie
douloureuse. La ponction d’ascite ramène un liquide citrin acellulaire. Les explorations
morphologiques utiles au diagnostic sont la radiographie pulmonaire, l'échographie cardiaque
et l'écho-doppler couleur hépatique qui va montrer une dilatation des veines sus-hépatiques.

Ascite (N° 298) - 5 -
L'ascite en cas de syndrome néphrotique est à évoquer en cas d'anasarque avec
œdèmes proximaux (visage, mains). La ponction d’ascite ramène un liquide citrin avec un
taux de protides inférieur à 25g/l. Le diagnostic sera confirmé par une protidémie inférieure à
60g/l, une albuminémie inférieure à 30g/l et une protéinurie supérieure à 3g/24 heures.
Causes plus rares
Le syndrome de Budd-Chiari est l'ensemble des manifestations liées à l'existence
d'un obstacle organique total ou partiel à l'écoulement du flux sanguin sus-hépatique (bloc
sus-hépatique). Les principales causes sont les thrombopathies et la compression ou
l'envahissement tumoral des veines sus-hépatiques. Le tableau est souvent aigu avec
hépatomégalie douloureuse et apparition rapide de l'ascite. Le diagnostic est confirmé par
l'écho-doppler couleur hépatique.
L'ascite par bloc sous-hépatique par compression extrinsèque du tronc porte (lésion
tumorale, adénopathies infectieuses ou malignes), atrésie de la veine porte ou thrombose
portale (polyglobulie, pyléphlébite, carcinome hépato-cellulaire envahissant la lumière
portale). C’est une situation rare, car l’hypertension portale seule donne exceptionnellement
une ascite.
L'ascite par bloc intra-hépatique en cas de bilharziose.
L'ascite chyleuse, définie par un épanchement de liquide lymphatique dans la cavité
péritonéale. Trois mécanismes peuvent expliquer son apparition: une exsudation à partir des
vaisseaux lymphatiques entéro-mésentériques dilatés par une obstruction (lymphomes +++,
cancer ovarien, gastrique, pancréatique, tuberculose) ou une hyperpression (cirrhose), une
fistule suite à une rupture traumatique ou une blessure chirurgicale des vaisseaux
lymphatiques, une exsudation de la paroi de mégalymphatiques rétropéritonéaux (congénital
ou acquis). La ponction d’ascite ramène un liquide lactescent riche en triglycérides,
essentiellement des chylomicrons (TG >1,1 mmol/l et/ou supérieur à 2 à 8 fois le taux sérique
de TG).
 6
6
 7
7
1
/
7
100%