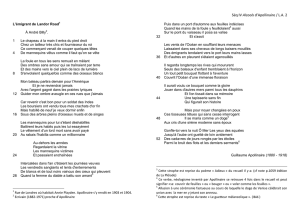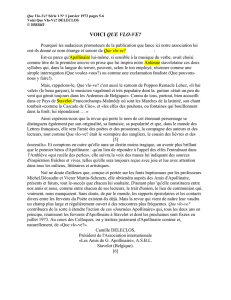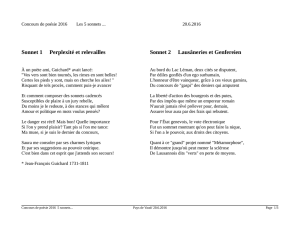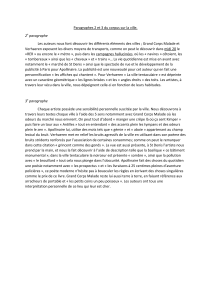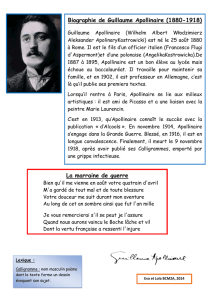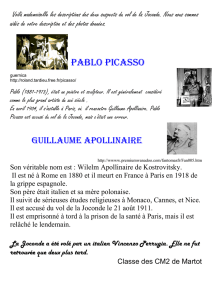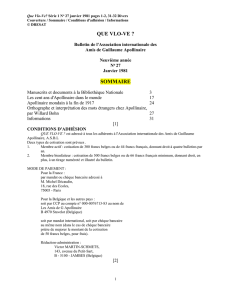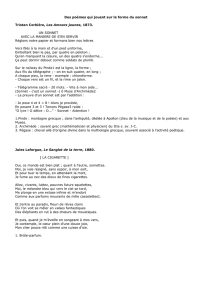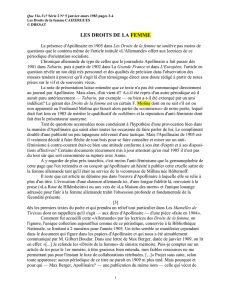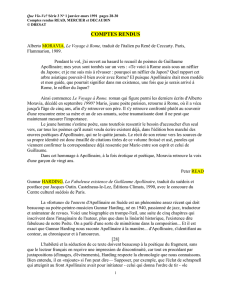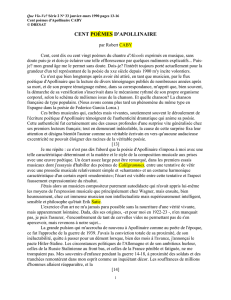Antoine FONGARO

Que Vlo-Ve ? Série 4 No 5 janvier-mars 1999 pages 1-16
Apollinaire traducteur des Sonnets luxurieux de l’Arétin FONGARO
© DRESAT
1
Antoine FONGARO
APOLLINAIRE
TRADUCTEUR DES SONNETS LUXURIEUX
DE L'ARETIN
A Michel Décaudin. Sans lui, une nouvelle fois, ce travail n'aurait pas pu être entrepris.
A la mémoire de l'ami Henri Monnier.
Dans le cadre d'une étude d'ensemble sur Apollinaire «traducteur» (les guillemets
s'imposent, on le sait) de textes italiens1, l'objet des remarques qui vont suivre est uniquement
d'examiner la traduction des Sonnets luxurieux figurant au tome 1 de L'Œuvre du divin Arétin 2,
ouvrage publié en 19U9 dans la «Bibliothèque des curieux».
Voilà qui économise tout développement sur la vie de l'Arétin, sur son œuvre, sur son art.
Il n'y aura même pas à s'occuper de l'histoire (compliquée) ni de l'établissement du texte
arétinesque, puisqu'on ne peut juger d'une traduction que d'après l'original qu'elle traduit, et
Apollinaire ne connaissait que le texte établi par Alcide Bonneau3 en 1882. Il ne sera même pas
nécessaire de relever les imperfections de ce texte tant pour le nombre des syllabes dans les vers,
que pour les étrangetés morphologiques ou syntaxiques : il est reproduit ici scrupuleusement,
sans qu'il ait paru utile de multiplier les [sic]. Il n'y aura pas non plus, de toute évidence, A tenir
compte d'une édition de ces sonnets datant des environs de 1530, avec les gravures de l'époque :
elle n'est venue au jour qu'assez récemment et Alcide Bonneau ne la connaissait pas4.
Il suffira de donner ici quelques indications générales.
Les sonnets sont au nombre de seize; ils sont à queue (colla coda, en italien). Apollinaire
reprend dans sa première note (p. 192) à peu près littéralement ce qu'avait dit A. Bonneau (éd. de
1904, p. 78, n. 1) :
On appelle ainsi des sonnets auxquels on ajoute une queue d'un ou plusieurs tercets dont le premier vers
n'est qu'un simple hémistiche rimant avec les derniers vers du tercet précédent. La queue des sonnets
luxurieux n'est que d'un tercet.
Et Apollinaire ajoute de son cru : «Je pense que la mode de cette sorte de sonnets
provenait d'Espagne». Mais il faut préciser que le premier vers du tercet ajouté n'est pas
vraiment un hémistiche : le sonnet étant, en principe, composé d'hendécasyllabes (comme c'est
le cas ici), le premier vers de l'ajout est un vers de sept syllabes (settenario).
Les sonnets sont en forme de dialogue entre les deux partenaires, sauf le sonnet XI, où
l'on a trois interlocuteurs : l'homme, une vieille, la femme, et le sonnet XIV, où seul l'homme
parle. Le passage d'un interlocuteur à l'autre est indiqué par un tiret dans l'édition d'A. Bonneau.
[3]
Reste le problème des gravures : à l’origine chaque sonnet commentait un dessin de
Giulio Romano, gravé par Marcatonio Raimondi, au-dessous duquel il était placé. Les gravures
de l'édition des environs de 1530 sont parfois fort différentes de celles de l’édition d’A. Bonneau
(on le verra surtout pour le sonnet XIV). Apollinaire se demande (p. 17), avec raison semble-t-il,
s'il n'y a pas «quelque supercherie» dans les illustrations de l’édition Honneau de 1904:

Que Vlo-Ve ? Série 4 No 5 janvier-mars 1999 pages 1-16
Apollinaire traducteur des Sonnets luxurieux de l’Arétin FONGARO
© DRESAT
2
Ces images coïncident presque entièrement avec la description qu'avait donnée Bonneau de l’apparence que
devaient avoir les gravures disparues. Mais sont-ce bien là des calques datant du XVIIIe siècle ou bien ne
s'agirait-il pas plutôt d'une habile reconstitution faite d’après la description de Bonneau et où l'on a mis
quelques différences pour que l'authenticité des calques parût moins discutable? Je ne sais.
I
J’espère ne scandaliser personne si je déclare d'emblée et sans ambages que la traduction
de ces sonnets proposée par Apollinaire est lamentable. C’est peut être pour se démarquer tant
soit peu de la traduction d'A. Bonneau (qu’il plagie sans honte), qu'Apollinaire commet sur le
texte des sonnets de l'Arétin un contresens fondamental généralisé.
Pour le lecteur le moins averti, même pour celui qui ne connaît guère la langue italienne,
il saute aux yeux que l'originalité de ce texte arétinesque réside toute dans le fait que l'Arétin
appelle chat un chat et con un con ou un cul un cul. La première tricherie d'Apollinaire a été de
ne pas publier le texte italien en regard de sa traduction.
Alcide Bonneau, lui, avait bien vu que les sonnets de l'Arétin n'avaient d’autre mérite que
d'être, franchement et sans voiles, pornographiques. Il s’agit d'une pornographie élémentaire :
aucune trace d'érotisme, de raffinement sexuel, encore moins de déviations (nous sommes aux
antipodes de Sade, par exemple). On peut aller jusqu'à dire qu'une telle pornographie est saine
dans ce qu'elle a de direct, d'immédiat, presque d'innocent dans son animalité (les animaux
s'accouplant ne sont pas érotiques, ils sont naturels),
Dès la première page de son édition de 1904, Bonneau déclare à propos des sonnets :
«Comme morceaux de poésie, ils n'ont de remarquable que leur crudité et leur cynisme». Il a
donc rendu à la lettre culo par cul, cazzo par vit, potta par con, fottere par foutre. Le malheureux
Apollinaire a complètement oblitéré le caractère essentiel de ce texte arétinesque, en produisant
une traduction qui pue à plein nez la pudibonderie victorienne et n'a plus rien à voir avec la
manière directe et crue de l'original. [4]
Si l'on suppose, pour justifier Apollinaire, qu'il a eu le dessein de conférer un certain air
littéraire à un texte original qui n'en possède absolument pas, cela ne fait qu'aggraver son erreur.
Car le trait distinctif du vocabulaire des sonnets est sa réduction extrême, je dirais même son
misérabilisme; et le trait distinctif de leur style est la répétition mécanique des quatre termes
fondamentaux (culo, cazzo, potta, fottere). Au point qu'on est en droit de se demander si l'Arétin
n'a pas voulu réaliser une espèce de gageure, un tour de force (voir surtout le sonnet V,
entièrement construit sur les deux mots culo et cazzo à toutes les rimes). De ce point de vue, la
traduction d'Apollinaire ajoute au contresens fondamental une nouvelle trahison par son
caractère hybride mêlant le détail grossier à des expressions rares ou recherchées et à des tours
pseudo-élégants, ce qui anéantit le minimum d'originalité littéraire que peut avoir le texte
arétinien.
Apollinaire semble, tout de même, s'être rendu compte que quelque chose n'allait pas; il
écrit en effet à la fin de l'Introduction de son volume (p. 20) :
En ce qui concerne les sonnets, on en a parfois adouci les termes, et malgré cela on est persuadé que ces
poèmes n'ont pour ainsi dire rien perdu de leur vivacité gaillarde. D'ailleurs, le lecteur est libre de
remplacer les mots qui lui paraissent faibles par les plus forts qu'il connaisse, et suppléant ainsi par la
perspicacité de son entendement à ce que le traducteur a dû gazer, par pudeur, il formera avec certitude son
opinion sur l'œuvre du Divin Pierre Arétin dont on a écrit en son temps qu'il était la règle de tous et la

Que Vlo-Ve ? Série 4 No 5 janvier-mars 1999 pages 1-16
Apollinaire traducteur des Sonnets luxurieux de l’Arétin FONGARO
© DRESAT
3
balance du style.
Déconcertant et décevant, cet Apollinaire «adoucisseur des termes» et qui «gaze» le texte
«par pudeur».
Parfois cela frise le ridicule. Comment celui qui a publié des vers tels que ceux-ci :
Dame de mes pensées au cul de perle fine
Dont ni perle ni cul n'égale l'orient5
peut-il traduire l'italien culo par «les hanches» (sonnets VI, v. 1; XI, v. 2 et 3; XIV, v. 12 et 15),
ou par des euphémismes fades du genre «derrière» ou «de l'autre côté» (sonnets VIII, v. 4, 10,
12, 17; X. v. 1; XIII, v. 7), ou par un archaïsme inusité comme «le pertuis» (sonnets II, v. 1; IV,
v. 15; VII, v. 9)?
Les archaïsmes sont la ressource de la pudibonderie. Il serait trop long de relever toutes
les occurrences où le simple et direct (et encore usité en italien) potta, c'est-à-dire (pour parler
aussi crûment que l'Arétin) le con, est traduit par «le mirely» chez Apollinaire (mais pas chez
Bonneau). Il n'est pas jusqu'aux naturels et élémentaires coglioni (sonnet I, v. 16), où même un
enfant reconnaît les couillons, qui ne deviennent les solennels et
[5]
inconnus «appendages» 6 chez Apollinaire. Quant au terme noble, il est toujours incongru dans
ce contexte, comme lorsque, par exemple, Apollinaire traduit cazzo par «virilité» (sonnets X, v.
10 ; XI, v.16).
Le comble est atteint, l lorsque le vers 3 du sonnet XIV : «ch’io vo fotter in potta e non in
culo» devient : «Je veux faire l’amour dans la bonne voie et non dans la prohibée». La brièveté
vigoureuse du texte italien («Je veux foutre en con et non en cul», traduisait Bonneau) s'amollit
en délayage flasque. C’est à se demander si Apollinaire avait lu ce qu'il prétend traduire.
Tout cela ne veut pas dire que la traduction des termes crus du langage pornographie ne
présente pas quelques difficultés.
Si les choses vont de soi pour culo = cul, elles se compliquent déjà avec cazzo < une. A.
Bonneau traduit toujours ce mot par vit, sémantiquement exact. Mais la sonorité aiguë de «vit»
est quasiment le contraire de la sonorité, disons, solide de «cazzo». Le meilleur équivalent
français de cazzo est donc cas, en raison de l'analogie phonique7 ; et c'est bien «cas» que met
Apollinaire, en général; sauf, hélas! au sonnet V, où toutes les rimes sont en «cazzo» et «potta».
La difficulté est d'un autre genre avec l'emploi métaphorique du mot cazzo en italien, alors qu'en
français le mot cas n'est jamais pris au sens figuré. On en rencontre deux exemples dans les
Sonnets luxurieux. Au vers 4 du premier sonnet «e saria '1 mondo un cazzo senza questp», la
traduction «Car le monde ne serait rien qui vaille sans cela» rend bien le sens du texte; en effet,
le mot cazzo s'emploie au figuré, en italien populaire et grossier, péjorativement et avec mépris
(non vale un cazzo ; testa di cazzo; etc); mais le tour «rien qui vaille» escamote complètement la
verdeur et la vigueur du texte italien; d'autre part, la traduction littérale : «car le monde ne serait
qu'un cas sans cela» est tout à fait incompréhensible. La langue française emploie, dans la même
fonction péjorative que cazzo en italien, le mot con ou couillon, quand il s'agit de personnes
(c'est un jeu de con; c'est un couillon; etc.), et l'abstrait connerie on ( (nullonnade, quand il s'agit
d'événements, de choses; il vaut donc mieux traduire ici : «sans cela, le monde ne serait qu'une
connerie». C'est une autre nuance de l'emploi figuré de cazzo en italien qui se présente au vers 11
du sonnet X. L'homme dit à la femme :

Que Vlo-Ve ? Série 4 No 5 janvier-mars 1999 pages 1-16
Apollinaire traducteur des Sonnets luxurieux de l’Arétin FONGARO
© DRESAT
4
il cazzo è suo, e se '1 vi piace tanto
com'a cazzo gli havete a comandare
La traduction littérale «comme à un cas vous n'avez qu'à lui commander» (Apollinaire) ou
«comme à un vit, c'est à vous de lui ordonner» (Bonneau) n'a aucun sens en français; en italien,
cazzo est pris ici au sens de niais, balourd, andouille, etc.; l'équivalent français dans ce sens est,
dans le langage populaire : manche (quel manche; c'est un manche; il s'est débrouillé comme
[6]
un manche; etc.). mot qui est (comme «andouille», d'ailleurs) une métaphore du sexe masculin,
bien sûr.
Le mot potta pose un intéressant problème de traduction. Le correspondant français
immédiat de ce terme dans la langue de tous les jours, oserai-je dire, est con. L'utiliser ici permet
des allitérations avec cas et cul (sonnet I, v. 3 «e se tu '1 cazzo adori, io la potta amo» == Si tu
adores le cas, moi j'aime le con; sonnet III, v. 10 «e in potta e *n culo il cazzo» -et en con et en
cul le cas; sonnet VI, v. 1 «Tu m'hai il cazzo in la potta, e il cul mi vedi» = tu as mon cas dans le
con et tu me vois le cul; etc.). Apollinaire, on l'a vu, n'emploie jamais le mot con, et quand il est
bien obligé de le mettre, comme au sonnet V, où il est répété systématiquement à la rime,
Apollinaire écrit pudiquement «c...». Bonneau, lui, met con, on l'a vu; mais il perd bonne part
des allitérations, parce qu'il emploie vit pour traduire cazzo. Cependant, outre qu'ajouter des
allitérations à un texte c'est le trahir (en italien, potta n'allitère ni avec cazzo, ni avec culo), le
mot con présente un double défaut : d'abord, il est du masculin, alors que potta est du féminin;
ensuite, sa sonorité (nasale, typiquement française) est radicalement différente de la sonorité du
terme italien. C'est pourquoi il semble préférable d'employer le mot féminin motte, qui a le
même sens, et où seule l'initiale est changée par rapport à potta 8.
Il faut encore signaler les contradictions qui déparent la traduction d'Apollinaire. Par
exemple, pour rendre l'italien fottere il y a le verbe français foutre (tout à fait usuel : on s'en fout;
il est foutu; va te faire foutre; etc.); et c'est bien ce verbe qu'utilise sagement Bonneau. Quant à
Apollinaire, il rend bien le dernier vers du sonnet IX, «di voi meglio vestite, ma non fottute», par
«mieux vêtues que vous, mais non mieux foutues», et dans tout le sonnet XII il emploie le verbe
foutre, même si, pudiquement, il l'abrège en «f...». On ne comprend plus alors pourquoi les deux
premiers vers du premier sonnet :
Fottiamci, anima mia, fottiamci presto,
poichè tutti per fotter nati siamo
deviennent:
Faisons l'amour, mon âme, faisons vite l'amour,
Puisque nous sommes tous nés pour faire l'amour
où l'opposition, certainement voulue par l'Arétin, entre fottiamci et anima mia9 s'estompe en une
atmosphère sentimentalo-romantique. Les exemples analogues ne manquent pas : comme au vers
12 du sonnet III, «Chi n'ha poco, in cul fotti dì e notte», traduit par «Qui en a peu qu'il fasse
l'amour [7]
à la sodomite jour et nuit» ; ou comme au vers 12 du sonnet XII, «Signor sì, che con voi
fottendo, sguazzo» traduit par «Oui, Seigneur, car je jouis beaucoup en me donnant à vous»10,

Que Vlo-Ve ? Série 4 No 5 janvier-mars 1999 pages 1-16
Apollinaire traducteur des Sonnets luxurieux de l’Arétin FONGARO
© DRESAT
5
ah ! qu’en termes galants ces choses-là sont dites, pourrait-on ironiser en parodiant Molière11
Au total, il est difficile d'expliquer, sinon par le désir de se démarquer de la traduction de
Bonneau qu'il pillait, pourquoi Apollinaire, qui s'y entendait pourtant en gaillardise et en
paillardise12, a publié une traduction qui oblitère à ce point le langage dru et cru des sonnets de
l'Arétin. D’autant plus qu'il semble avoir vu au moins une fois (il est vrai que cela crevait les
yeux) la nécessité de respecter le texte. C'est au sonnet V, où il a mis en note (p. 200) : «Il fallait,
pour ce sonnet, essayer d'en rendre l'aspect si particulier que lui donne la répétition alternée des
deux mots à la fin des vers» (ces deux mots sont cazzo et potta). Mais il ajoute : «On a dû, pour
Cela, recourir au déplaisant artifice typographique des trois points qu'on pourrait appeler points
de discrétion ou d'hypocrisie». Qu'Apollinaire use, en pleine conscience, d'hypocrisie dans ce
domaine, c'est un comble. Craignait-il une condamnation pour outrage aux bonnes mœurs?
Incontestablement un tel danger existait. Cependant, pour ce qui le regardait personnellement, il
suffisait de ne pas mettre de nom d'auteur, ou de prendre un pseudonyme (comme il a signé
«Germain Amplecas» l'édition de L’œuvre libertine des poètes du XIXe siècle, en 1910). Quant à
l'éditeur, le risque qu'il courait était peut-être moins grand qu'on ne croit : c'est bien dans la
Bibliothèque des Curieux, que sont publiés, comme L'Œuvre du divin Arétin en 1909, L'Œuvre
libertine des poètes du XIXe siècle en 1910, et Parnasse satyrique du XVIIIe siècle en 1912, deux
ouvrages où l'obscénité n’est certes pas voilée.
Le résultat est que la langue systématiquement grossière et populaire de l’Arétin est
transformée en un texte pour lecteurs gourmés et cultivés. Il est amusant de constater
qu'Apollinaire mérite le reproche qu'Antonia adresse à Nanna, dans la première journée (la vie
des Nonnes) des Ragionamenti de l'Arétin (à la p. 58 du volume d'Apollinaire) :
Parle donc librement et dis cu, ca, po et fo sinon tu ne seras comprise de personne que de la Sapienza
Capranica, avec ton cordon dans l'anneau [suit un chapelet de métaphores évoquant l'acte ou les deux
sexes]. Allons! disons oui pour oui, et non pour non, sinon garde-le pour toi.
Or Apollinaire avait lu ce passage, puisqu'il y a mis deux notes : l'une aux syllabes en
italique : «Première syllabe de culo, cazzo, potta et fottere, que l'on entend assez»; l'autre à
Sapienza Capranica : «Université de Rome» mais probablement il s'est contenté de reproduire les
notes qu'avait mises Alcide Bonneau à sa traduction des Ragionamenti en 1882).
[8]
II
À côté de ce radical contresens généralisé, les erreurs ponctuelles de traduction peuvent
sembler peu de chose. Il faut les signaler tout de même; car Apollinaire se flatte, dans
l'Introduction de son livre (p. 19), d'avoir amélioré la traduction qu'il reprend : «Les traductions
que l'on donne ici paraîtront souvent plus exactes que celles qui les ont précédées»; et il poursuit
en jetant la poudre aux yeux du lecteur avec quelques remarques de détail13. En réalité,
Apollinaire ne connaît pas grand-chose à la langue italienne, et pour les Sonnets de l'Arétin non
seulement il reprend toutes les erreurs commises par Alcide Bonneau, mais encore, à chacune de
ses interventions personnelles, il ajoute une nouvelle erreur à la traduction de son prédécesseur.
Voici quelques remarques au fil du texte.
Dans le premier sonnet, au vers 7 : «di là fotterem Eva e Adamo», Apollinaire suit
Bonneau, qui a traduit : «Après, nous irons foutre Adam et Eve», et écrit «À partir de ce
moment-là nous ferons l'amour avec Adam et Eve». C'est confondre di là avec da lì\ di là
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%