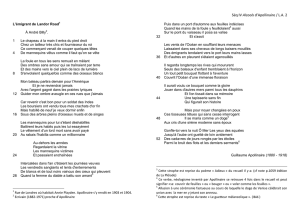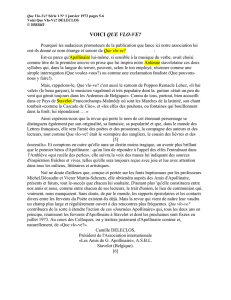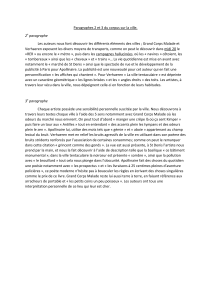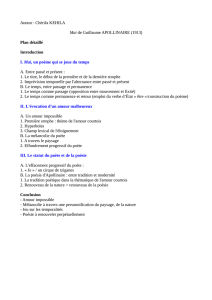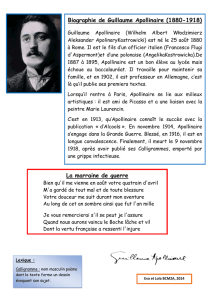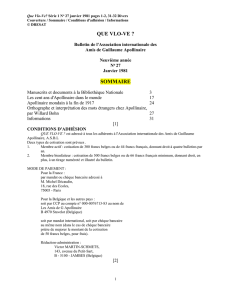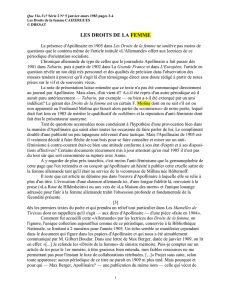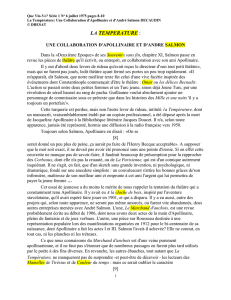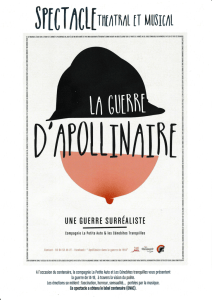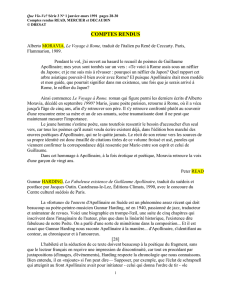CENT POÈMES D`APOLLINAIRE

Que Vlo-Ve? Série 2 No 33 janvier-mars 1990 pages 13-16
Cent poèmes d'Apollinaire CABY
© DRESAT
1
CENT POÈMES D'APOLLINAIRE
par Robert CABY
Cent, cent dix ou cent vingt poèmes du chantre d'Alcools exprimés en musique, sans
doute puis-je et dois-je éclairer une telle efflorescence par quelques rudiments explicatifs... Puis-
je? mon grand âge me le permet sans doute. Dois-je? l'intérêt toujours porté actuellement pour la
grandeur d'un tel représentant de la poésie du xxe siècle depuis 1900 m'y incite volontiers.
Ce n'est que bien longtemps après avoir été attiré, en tant que musicien, par le flux
poétique d'Apollinaire que la lecture de divers témoignages publiés de nombreuses années après
sa mort, et de son propre témoignage même, dans sa correspondance, m'apprit que, bien souvent,
la démarche de sa versification s'inscrivait dans le mécanisme rythmé de son propre organisme
corporel, selon le schéma de mélismes issus de la chanson. Et quelle chanson? La chanson
française de type populaire. (Nous avons connu plus tard un phénomène du même type en
Espagne dans la poésie de Federico Garcia Lorca.)
Ces bribes musicales qui, cachées mais vivantes, soutiennent souvent le déroulement de
l'écriture poétique d'Apollinaire témoignent de l'authenticité dramatique qui anime sa poésie.
Cette authenticité fut certainement une des causes profondes d'une surprise vite généralisée chez
ses premiers lecteurs français; tout en demeurant indécelable, la cause de cette surprise fixa leur
attention et désigna bientôt l'auteur comme un véritable écrivain en vers qu'aucune audacieuse
excentricité ne pouvait éloigner des racines de la véritable poésie.
[13]
Je me répète : ce n'est pas dès l'abord que la poésie d'Apollinaire s'imposa à moi avec une
telle caractéristique déterminant et la matière et le style de la composition musicale aux prises
avec une œuvre poétique. Un écart assez large peut être remarqué, dans les premiers essais
musicaux dont j'essayais d'habiller des poèmes de Calligrammes, entre une tentative de vêtir
avec une prosodie musicale relativement simple et «chantante» et un costume harmonique
caractéristique d'un certain esprit «moderniste»; l'écart est visible entre cette tentative et l'aspect
faussement expressionniste du résultat.
J'étais alors un musicien compositeur purement autodidacte qui n'avait appris lui-même
les moyens de l'expression musicale que principalement chez Wagner, mais ensuite, bien
heureusement, chez cet immense musicien non intellectualiste mais supérieuremenet intelligent,
sensible et philosophe qu'était Erik Satie.
L'exercice d'un art ne m'a jamais paru possible sans la nourriture d'une vérité vivante,
mais apparemment lointaine. Dada, dès ses origines, -et pour moi en 1922-23 -, n'en manquait
pas, je puis l'assurer, -l'encombrement de tant de cervelles vides ne permettant pas de s'en
apercevoir, mais revenons à notre sujet...
La grande pulsion qui m'accrocha de nouveau à Apollinaire comme au poète de l'époque,
ce fut l'approche de la guerre de 1939. J'avais la conviction totale de sa proximité, de son
inéluctabilité, quitte à passer pour un dément lorsque, bien des mois à l'avance, j'annonçai le
pacte Hitler-Staline. Les circonstances politiques de l'Allemagne et de son ambitieux hurleur,
celles de la Russie Stalinienne au front bas, et celles de la France pénible et fatiguée, ne me
trompaient pas. Mes souvenirs d'enfance pendant la guerre 14-18, à proximité des soldats et des
tranchées remontèrent dans mon esprit comme un inquiétant décor. Les souffrances de millions
d'hommes allaient réapparaître, et la [14]

Que Vlo-Ve? Série 2 No 33 janvier-mars 1990 pages 13-16
Cent poèmes d'Apollinaire CABY
©Association internationale des amis de Guillaume Apollinaire
2
soumission à la fatalité de ces souffrances. Je relus Apollinaire, ses Calligrammes. Les jeux
merveilleux et les sursauts du Surréalisme allaient être contraints de se camoufler. Une force
énergétique sans pareille avait poussé Apollinaire à entrer dans la guerre en 1915; n'y avait-il
pas, de sa part, alors, volonté de convaincre qu'en dépit de l'immense et abominable voile de
deuil imposé aux populations il fallait de toute nécessité, auprès des monstrueux engins de mort
pratiquant le nouvel «amour des peuples» imprévisible, brandir encore et toujours la puissance
de l'amour ressort de l'homme, là même où se tenaient des millions d'hommes prêts au combat et
à la mort, et cela jusqu'à faire des feux atroces de cet «amour des peuples» des illuminations de
la beauté? Suprême défi de poète!... face à la mort, et jusqu'à la mort.
En 1939 telle n'était certes pas ma propre attitude : des soucis plus radicaux sans doute
offraient un sol bouleversé à l'équilibre de mes propres volitions sociales et politiques. Mais cette
force de la poésie d'Apollinaire demeura pour moi un exemple inoubliable.
Ah, Guillaume, toi, ce charmeur à vingt-deux ans tout imprégné de germanisme rhénan,
te voilà maintenant fonçant dans la «tranchée Goethe»? une tranchée-adverse qui portait le nom
de mon cher Goethe, ce Goethe que j'auréolais d'une telle admirative lumière dans laquelle déjà
en 38-39 je m'évertuais à placer, plus éclatants, les strass de musique de mes versions chantées
de ses poèmes?
Et moi, dans la débâcle de l'an 40, à deux pas des descentes des parachutistes de l'armée
allemande, j'étais là, comme une épave volontaire, la nuit, pour attaquer, aux côtés de deux autres
débris de ma compagnie, à un tournant de la route, le premier char hitlérien qui se présenterait, et
qui n'eût fait de nous et de notre fusil-mitrailleur, au premier coup de feu, qu'une boucherie dans
la ferraille, alors quesauver ma femme et mes enfants était la hantise brûlante de mon cerveau!
[15]
... Oui, j'ai continué, «après la bagarre...» (comme disent les hommes) à musicaliser
Apollinaire(l), et pas seulement celui des calligrammes du temps de la guerre. Plus de cent
poèmes... cent dix ou cent quinze en comptant les tout premiers...
Détresse, horreur, amour, désir de l'amour... Lisez Apollinaire :
Le jeune fantassin «presque un enfant», cagoule par le masque à gaz, Apollinaire nous le
montre hanté par la pensée que, tandis qu'il n'«y» est pas («y», là-bas, à l'arrière, à la vie), tant de
filles deviennent belles, et que cette beauté, avec le temps, «s'éloignera d'elles» et qu'il doit
l'imaginer, cette beauté, «faute d'avoir des souvenirs», et que cette beauté, c'est de la «lueur
ardente des tirs» qu'elle tire son origine, nous dit Apollinaire; - et ce fantassin, j'en ai fait le sujet
d'une véritable complainte populaire. Est-il symbole plus éclatant de cette force puissante dont
j'ai caractérisé plus haut la poésie magique de Guillaume de Kostrowitzky? Ses poèmes les plus
délicatement fleuris par l'amour, comme aussi les strophes apparemment les plus mélancoliques,
la recèlent. Elle tonifie, sans contamination de sophistication intellectualiste. Cette mécanique de
bribes populaires chantées, dont son propos versificateur s'est nourri si souvent, s'impose au
compositeur qui veut par la musique rendre sensible l'âme qui meut cette poésie. Elle ne peut que
l'éloigner de tout cet intellectualisme «concret» ou... «abstrait» dont est encombrée de nos jours
une si grande part de la «musique contemporaine», vieille dame déjà si lointaine et fanée...
1. Le fait que déjà en 1938-39 furent composés une douzaine de poèmes d'Apollinaire me satisfaisant
musicalement ne contredit absolument pas l'observation générale de la relation qui me rattacha à sa poétique et qui
explique cette accumulation de compositions musicales qui persista pendant des années. Ils furent chantés à l'époque
et diffusés sur les ondes de la Radiodiffusion nationale (par Maud Laury en particulier).
[16]
1
/
2
100%