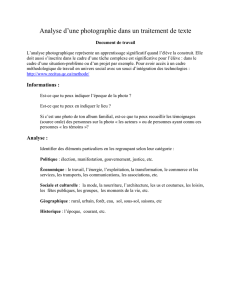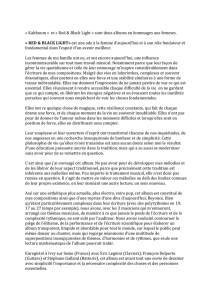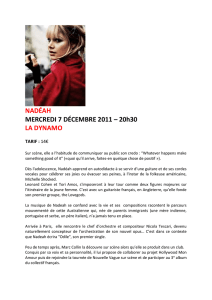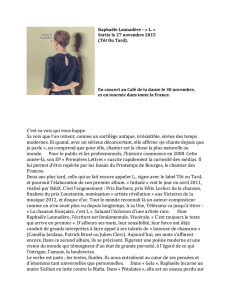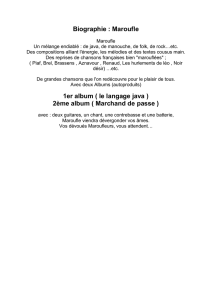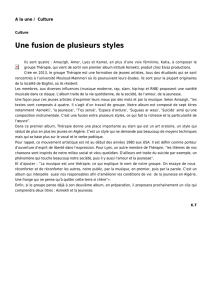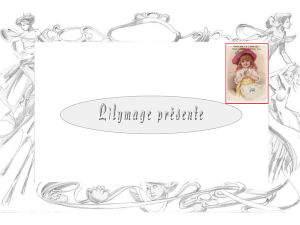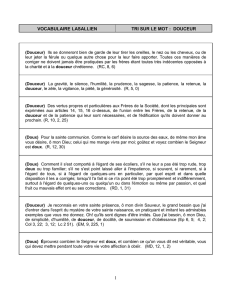Quand le livre pour enfants se veut promenade accompagnée

1
Quand le livre pour enfants se veut promenade accompagnée
à la découverte de soi.
par Anne Guibert-Lassalle
Comment mettre en œuvre en littérature pédagogique des situations d’apprentissage qui aident
les lecteurs à construire librement leur personnalité ? Les enchaînements dramatiques de la
fiction narrative peuvent-ils remplir ce rôle ? Michel Piquemal, auteur prolifique et
protéiforme, qui a choisi de se consacrer à l’écriture pour enfants et à l’édition après avoir
enseigné, semble habité par ce questionnement. Il a signé en 2004 chez Didier jeunesse un
album original, illustré avec un talent remarquable par Elodie Nouhen, et intitulé Mon miel
ma douceur. Ce livre, destiné à des enfants très jeunes (3-6 ans), se veut une promenade
accompagnée à la découverte de soi.
Le récit rapporte les impressions d’une petite fille élevée en Europe et qui passe ses vacances
auprès de sa grand-mère au Maghreb. Le texte qui se clôt sur le deuil de l’aïeule et l’accès à la
parole de la petite Khadidja est aussi une évocation tendre de la culture et de la langue arabes.
L’album est particulièrement intéressant pour le traitement des représentations identitaires. Il
suit avec délicatesse le cheminement psychologique de la jeune héroïne. Il a été voulu par
l’éditrice, Michèle Moreau, comme une forme d’accompagnement littéraire destinée aux
enfants de l’émigration qui, confrontés à une double culture, tiraillés entre deux
appartenances, peinent à la construction de leur identité symbolique.
*
Avec ce livre rare, Michel Piquemal a conçu un message à la croisée de plusieurs talents :
celui du conteur, celui du folkloriste, celui du calligraphe, celui de l’illustratrice.
Le conteur livre un récit court (moins de 600 mots), presque exempt de péripéties, si ce n’est
le décès de la grand-mère et un vêtement jeté à la mer et dit, par conséquent, en grande partie
à l’imparfait. Le vocabulaire est simple, les images poétiques dépouillées (très peu d’adjectifs,
aucun adverbe). Les phrases, brèves, sont constituées de propositions simples, rarement
subordonnées. Ce style narratif est accessible aux très jeunes enfants. Il suggère, sollicite et
n’impose rien. Le texte proprement dit reste donc discret et n’étouffe pas les autres modes
d’expression utilisés dans l’album.
Le folkloriste collecte, pour les reproduire en français et en arabe, des comptines
traditionnelles arabes, des débuts de contes, des noms de pâtisseries, des interjections
affectueuses prononcées par la grand-mère ou la mère. Ces phrases, très courtes, sans verbe
pour la plupart, forment en quelque sorte les incipit d’une culture arabe enfantine.
Le calligraphe reproduit en caractères arabes bleus les insertions du folkloriste. Il relie
subtilement le texte, la référence explicite à la langue et l’illustration dont la couleur
dominante est également bleue. La présence des citations arabes confère au message une
apparence d’authenticité et de crédibilité. Ce procédé est courant dans l’expression de
représentations identitaires qui sont, faut-il le rappeler, des opinions subjectives qui se
donnent pour vraies.

2
L’illustratrice crée des figures superposées, inscrites dans un espace déstructuré, qui nous
place d’emblée dans une dimension subjective. L’horizon ondulant, la perspective bousculée,
les disproportions des personnages, leur situation en lévitation, tout concourt à nous persuader
que le message transmis par le texte est de l’ordre du vécu et de l’affect, ce qui est exactement
le cas des représentations identitaires. Parmi les motifs, on note la fréquence des visages de
profil aux lèvres entrouvertes et légèrement protubérantes qui font véritablement parler
l’image et disent l’importance de la parole. L’harmonie des couleurs, choisies dans une
gamme assourdie de bleus, de beiges et d’ocres, ainsi que la diffusion, par jeu de
transparence, de certains motifs décoratifs (fleurs, losanges…) des sujets sur le fond,
suggèrent l’unité et la cohérence du système de représentations imaginaires.
La pluralité, plus feinte que réelle, démultipliée en tout cas, des voix qui s’expriment dans
l’album, celles du conteur, du calligraphe, du collecteur de folklore, du dessinateur, contribue
à diluer la notion d’auteur, à effacer l’autorité du pédagogue par rapport à son lecteur.
La cohérence de l’ouvrage n’est donc pas assurée par le mode d’expression pour lequel on a
fait le choix de la dispersion, mais par la gamme sémantique utilisée pour représenter
l’identité arabe. Elle joue principalement sur les notions de douceur, de lenteur, de saveur et
de sensualité. Ces notions sont portées par le vocabulaire choisi pour le texte et le titre
(« miel », « douceur », « soie », « salades sauvages », « figues » et quelques noms de
pâtisseries…). L’iconographie exprime les mêmes nuances. La prédominance de formes
courbes et enveloppantes et les dessins de mains, omniprésentes, parlent de tendresse et de
caresses. Le grand nombre de visages marque la convivialité, tandis que la récurrence des
motifs floraux évoque la suavité. Cette cohérence sémantique donne l’impression d’une
profonde sérénité symbolique.
En première approche, le lecteur, dans cet album, semble témoin mais non acteur. Dans
l’illustration, le lecteur ne croise jamais un regard, car les visages sont le plus souvent
dessinés de profil. Les rares sujets pris de face ont les yeux fermés. Le livre paraît refuser
d’instaurer un dialogue avec le lecteur. Mais il convient de ne pas s’arrêter à cette première
impression. Cette mise en scène a pour but de donner vie au mutisme de la jeune héroïne.
Comme la petite Khadidja qui prononcera ses premiers mots à la fin de l’album, le lecteur
expérimente une forme particulière de communication et de participation. Il eut été surprenant
que Michel Piquemal qui se rend fréquemment à la rencontre de son jeune public dans les
classes et les bibliothèques se soit converti à l’autisme pour concevoir un livre-spectacle.
Cet album qui donne à voir et à entendre constitue une approche profondément subjective de
la langue arabe. Il ne se contente pas de souligner le rapport affectif qui lie le locuteur à sa
langue. Il témoigne de la charge symbolique de la définition de la langue. Cet objectif,
particulièrement ambitieux pour un ouvrage destiné à de si jeunes lecteurs, est l’un des
mérites principaux de Mon miel, ma douceur..
Une incertitude cependant plane sur cette vision de la culture arabe : le fait que l’on ne
parvient pas à savoir s’il s’agit d’une représentation de soi ou de l’autre. Mon miel ma
douceur figure-t-il la manière dont les Français voient la langue et la culture arabe ou s’agit-il
d’un regard porté de l’intérieur ? L’album en tout cas exprime une vision au style direct. On
pourrait dire qu’il ouvre les guillemets, mais sans jamais préciser qui prend la parole. Ce beau
livre fermé, on ignore qui, au fond, a posé sur la langue et la culture arabes ce regard chargé
d’onirisme.

3
Par ailleurs, les représentations identitaires y sont uniquement positives, ce qui est peu
crédible, même dans le cadre d’une représentation de soi. Cette trop parfaite cohérence
symbolique instaure un climat légèrement euphorique qui rend moins convaincante la
souffrance décrite lors de la mort de l’aïeule. Cette euphorie persistante vient peut-être du fait
que l’album laisse très peu de place aux doutes de l’enfant. Or le questionnement, souvent
douloureux, est central dans le processus de création personnelle des représentations
identitaires. Une partie du livre tourne pourtant autour du retard de langage de Khadidja. Ce
retard, on le devine, est imputable à la difficile expérience du bilinguisme et de l’appartenance
à une double culture. L’enfant est à ce point écartelé qu’il lui faut le choc émotionnel
provoqué par le décès de la grand-mère pour libérer sa parole. Pourtant cette tension
n’apparaît pas dans l’exposé lisse et, en apparence, parfaitement assumé par l’enfant, de ses
représentations de la culture arabe.
* * *
Le recours à un concept d’accompagnement pédagogique suppose de respecter la liberté du
jeune lecteur. Il nécessite souplesse et légèreté. Il exclut d’imposer. La pluralité des voix qui
dilue la présence de l’auteur de Mon miel, ma douceur remet discrètement en question la
prévalence du pédagogue. Elle inscrit de manière convaincante le livre dans une démarche
d’accompagnement, l’enfant-lecteur étant le seul à pouvoir réaliser une synthèse symbolique à
partir des éléments identitaires proposés. Encore faudrait-il, pour que la démarche soit
complète, que les tensions ne soient pas évacuées. L’accueil encourageant réservé à Mon miel,
ma douceur par les professionnels de l’édition a poussé son éditrice à concevoir, avec un
confrère marocain, La librairie nationale, une collection bilingue arabe-français. Les premiers
albums de contes et de comptines sont sortis en 2005.
Du fait de la nature particulière de la pensée symbolique, l’accompagnement semble une
posture pédagogique efficace et réaliste pour tenter de stimuler, par la littérature, la
maturation d’une identité équilibrée chez les enfants de l’émigration. Mon miel, ma douceur
est un ouvrage pionnier dans la mesure où il explore remarquablement l’étendue d’un tel axe
de recherche et de création.
1
/
3
100%