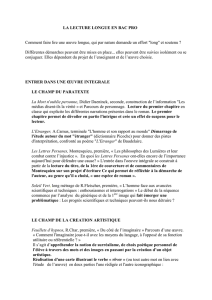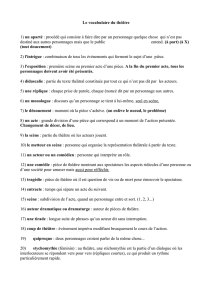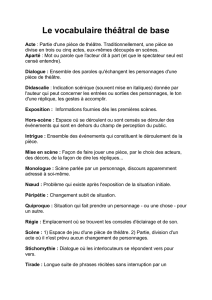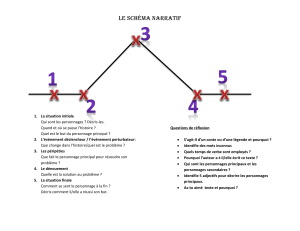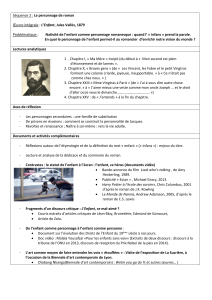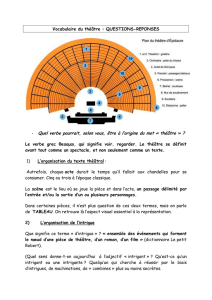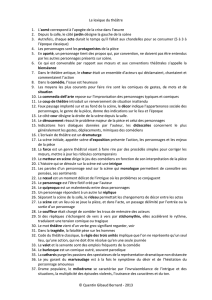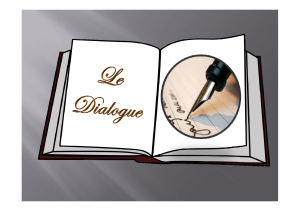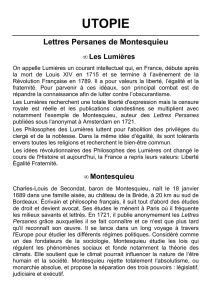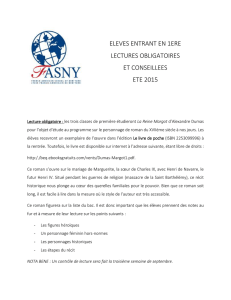Œuvre longue en bac pro

LA LECTURE LONGUE EN BAC PRO
Comment faire lire une œuvre longue, qui par nature demande un effort "long" et soutenu ?
Différentes démarches peuvent être mises en place... elles peuvent être suivies isolément ou se conjuguer. Elles
dépendent du projet de l'enseignant et de l’œuvre choisie.
ENTRER DANS UNE ŒUVRE INTEGRALE
LE CHAMP DU PARATEXTE
La Mort n'oublie personne, Didier Daeninck, seconde, construction de l’information "les médias disent-ils la
vérité ?» et « Parcours de personnage ». Lecture du premier chapitre en classe qui explicite les différentes
narrations présentes dans le roman. Le premier chapitre permet de dévoiler en partie l'intrigue et crée
un effet de suspens pour le lecteur.
L'Etranger, A.Camus, terminale "L'homme et son rapport au monde". Démarrage de l'étude autour du mot
"étranger" (dictionnaire Picoche) pour donner des pistes d'interprétation, confronté au poème "L'Etranger"
de Baudelaire.
Les Lettres Persanes, Montesquieu, première, « Les philosophes des Lumières et leur combat contre
l’injustice ». En quoi les Lettres Persanes ont-elles encore de l’importance aujourd’hui pour défendre une
cause? » L'entrée dans l’œuvre intégrale se construit à partir de la lecture du titre, de la 1ère de couverture
et de commentaires de Montesquieu sur son projet d'écriture, ce qui permet de réfléchir à la démarche
de l'auteur, au genre qu’il a choisi, « une espèce de roman ».
Soleil Vert, long métrage de R.Fleischer, première, « L’homme face aux avancées scientifiques et
techniques : enthousiasmes et interrogations ». Le début de la séquence commence par l’analyse du
générique et de la 1ère image qui fait émerger une problématique : les progrès scientifiques et techniques
peuvent-ils nous détruire ?
LE CHAMP DE LA CREATION ARTISTIQUE
Feuillets d’hypnos, R.Char, première, « Du côté de l’imaginaire » Parcours d’une œuvre.
« Comment l'imaginaire joue-t-il avec les moyens du langage, à l'opposé de sa fonction utilitaire ou
référentielle ? »
Il s’agit d’appréhender la notion de surréalisme, de choix poétique personnel à travers des mots et des
images en passant par la création d’un objet artistique.
Réalisation d'une carte illustrant le verbe « rêver » (ou tout autre mot en lien avec l'étude de l’œuvre) en
deux parties l'une rédigée et l'autre iconographique :
1) Premier temps
- choix d'un texte poétique ou de mots que l'élève associe au verbe rêver (binôme 1)
- choix d'une illustration : photo, image (le professeur peut porter des magazines dans lesquels les élèves
pourront aller découper ce qu'ils souhaitent (binôme 2)
2) Deuxième temps : les élèves s'échangent les cartes et complètent la partie non faite tout en dialoguant
avec l'autre élève pour comprendre ce qui a été écrit et ce qui a été choisi comme image.
LE CHAMP DE LA CULTURE
On ne badine pas avec l'amour de Musset, seconde « Parcours de personnages » . Lancement de la
séquence à partir d'un passage « culte » : la réplique de Perdican (II-5). Exemples de mise en scène du
passage montrés aux élèves. Le passage est analysé, appris par cœur et joué en classe. Prolongement : les
couples célèbres au théâtre, leur destin (recherches élèves). Puis, lecture de l'œuvre.
Le sermon de la chute de Rome, Jérôme Ferrari, terminale « L'Homme et son rapport au monde... »
Lancement par un groupement de textes qui fait écho à l’œuvre intégrale, qui pose les références
culturelles qui permettent d'aborder le roman : ici, le mythe de la fin du monde évoqué dans différentes

œuvres. Le groupement de textes ne doit pas être un prétexte pour bâtir une séance d’histoire
littéraire.
INTERPRETER ET CONSTRUIRE LE SENS D’UNE OEUVRE
A TRAVERS UN PARCOURS DE LECTURE
Ruy Blas, Victor Hugo, seconde, "Parcours de personnages". Les élèves découvrent
l'évolution du personnage à travers une sélection de didascalies qui accompagnent son discours. Des
scènes peuvent ensuite être choisies pour préciser l'analyse.
Combat de nègre et de chiens, BM Koltès, terminale, « L’homme dans son rapport au monde… » et
« Identité et diversité ». A partir des extraits étudiés, les élèves en fin de séquence retracent et s’interrogent
sur le parcours de Léone ou d’Alboury : leur choix de vie. Ils répondent à la question en notant des
citations, des extraits qui justifieront leur réponse.
Tartuffe, Molière, seconde, "Des goûts et des couleurs"On demande aux élèves de lire la pièce ou de
lire les courts résumés de la pièce, découpages par actes/scènes proposées par les différentes éditions
commentées pour connaître l'intrigue. La découverte de la structure de l’œuvre permet de poser des
hypothèses de lecture. Des passages sont ensuite étudiés en classe pour découvrir la figure de Tartuffe.
Les nuits de Paris, Rétif de la Bretonne, première, "Les philosophes des Lumières et leur combat contre
l'injustice". Un travail de groupe est proposé ce qui permet à la classe de se partager les différents
tableaux de l’œuvre : des regroupements par thèmes, par lieux ou par personnages sont constitués. Un
guidage est donné à chaque groupe pour analyser les passages choisis. Chaque groupe lit une partie du
recueil qu'il restitue ensuite à l'ensemble de la classe qui peut reconstituer ainsi l'intégralité de
l’œuvre et lui donner du sens.
PAR COMPARAISON AVEC DES FORMES ARTISTIQUES DIFFERENTES
Elargir la réflexion sur l’œuvre avec d’autres supports
Balzac et la petite tailleuse chinoise, Daï Sijie, terminale, "Identité et diversité" En fin de séquence, une
projection du film réalisé par l'auteur du roman et assez fidèle au récit, permet de compenser les
lectures et de débattre des choix artistiques ou esthétiques opérés (choix du montage, scènes
enlevées ou déplacées…). Le film placé en début ou en fin de séquence permet de lire l’œuvre d’une
autre façon.
Comparer différentes réceptions selon les époques
Alice aux pays des merveilles, L.Carroll, première, « Du côté de l’imaginaire », « La fable, les contes, les
récits imaginaires sont-ils réservés aux jeunes enfants ? ». En comparant le personnage de L.Carroll
avec la version de Tim Burton.
PAR L’ECRITURE ET/OU L’ORAL
Réinvestir et s'approprier les procédés d'écriture
Les lettres persanes, Montesquieu, première, « Les philosophes des Lumières et leur combat contre
l’injustice ». En quoi les lettres persanes ont-elles de l’importance encore aujourd’hui pour défendre une
cause ? A la fin de la séquence, les élèves peuvent rédiger par deux une lettre qui dénonce une injustice
aujourd’hui à la manière de Montesquieu. Ils choisissent le procédé d’écriture parmi ceux
rencontrés dans les lettres étudiées.

Utiliser des références culturelles
En utilisant le portfolio : Les élèves choisissent un texte ou une image qui ferait sens par rapport à la
question traitée de l’objet d’étude travaillé. Ils explicitent à l’oral ou à l’écrit leurs connaissances de
l’œuvre.
Ou le carnet de lecture :
Le carnet accompagne l’élève dans sa lecture. Son contenu est personnel. On peut y trouver des
réflexions, des appréciations sur certains passages de l’œuvre, des citations préférées ; mais aussi
des images, des collages, des souvenirs, des sensations suscitées par la lecture. Clairement centré sur la
réception de l’œuvre, il replace l’élève, en parallèle aux travaux scolaires, dans une position de lecteur.
Les carnets peuvent être aussi l’occasion d’échanges et d’approfondissement dans le cadre de la
classe (cercles de lecture).
Mettre en place des jeux de rôles
La lecture d’un roman, d’une pièce de théâtre peut être accompagnée par différents jeux de rôles. L’un
d’entre eux consiste à demander aux élèves de se mettre dans la peau des personnages : par
exemple dans le cadre d’une émission littéraire fictive dont les invités seraient les personnages du
livre. Les élèves, ainsi sollicités, seront amenés à proposer des explications aux motivations de tel ou
tel personnage, à remplir les « blancs » de l’œuvre, en bref à proposer, d’une façon ludique, leurs
interprétations.
Une autre variante de l’émission littéraire : Inviter les élèves à jouer les critiques de romans ou de
films.
Ressources Humaines, Long métrage de Laurent Canter, terminale, « Identité et diversité »Question :
Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s’intégrer dans la société ? A la fin du film
Ressources Humaines de Laurent Cantet, les élèves rédigent une critique dans laquelle ils expriment
leur point de vue concernant le film. « Selon vous, son ascension sociale représente-t-elle une fierté
ou une trahison ? » Expliquez pourquoi vous avez aimé le film ou non, et surtout si vous avez éprouvé
de la sympathie pour le personnage principal.
On peut également proposer aux élèves d’interviewer de façon fictive l’auteur de l’œuvre intégrale
étudiée
1
/
3
100%