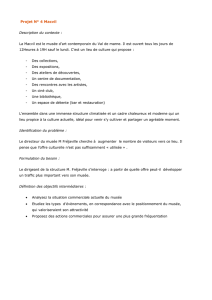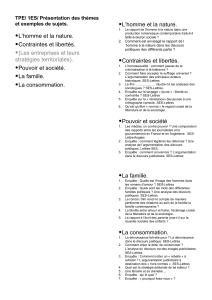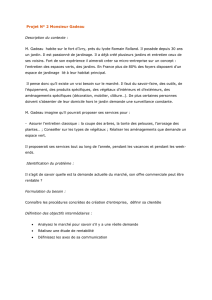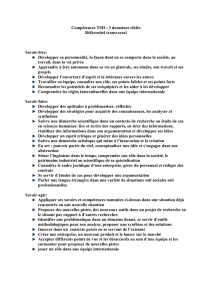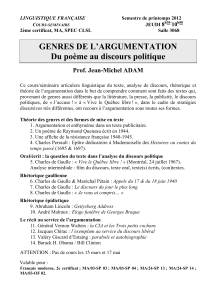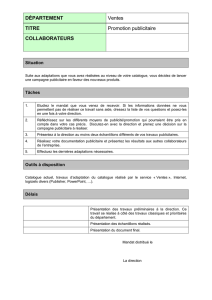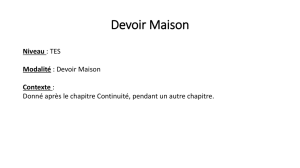MONICA FRUNZĂ

99
Rhétorique argumentative, énonciation et persuasion dans le discours publicitaire
français
Lector univ. dr. Monica FRUNZĂ
Universitatea „Al. I. Cuza”din Iaşi
En tant que discours médiatique, le discours publicitaire possède sans doute des traits qui
nous permettent de le considérer comme appartenant au discours de la propagande. Ces types
discursifs s’inscrivent dans le champ d’application de la rhétorique classique. Il semble que le
discours publicitaire moderne trouve sa place dans une longue tradition qui remonte à l’Antiquité.
Ce sont Jean-Michel Adam et Marc Bonhomme qui, dans leur ouvrage intitulé L’argumentation
publicitaire. La rhétorique de l’éloge et de la persuasion (1997) ont réussi à démontrer cette
hypothèse que nous prenons comme point de départ pour notre propre démarche analytique en vue
de faire découvrir, dans un premier temps, les liens qui attachent cette forme de communication
radicalement différente et unique à sa façon aux grandes formes antiques de discours, de même que
pour démontrer, ensuite, comment, de nos jours, l’argumentation publicitaire glisse vers la
persuasion, phénomène décelable à travers les stratégies énonciatives (comme, par exemple,
l’allègement du dispositif communicatif) astucieusement mises en place par les publicitaires
contemporains.
L’argumentation publicitaire comme « mise en scène »
« Pour moi argumenter c’est chercher, par le discours, à amener un auditeur ou un auditoire
donné à une certaine action. Il s’ensuit qu’une argumentation est toujours construite pour
quelqu’un, au contraire d’une démonstration qui est pour n’importe qui. Il s’agit donc d’un
processus dialogique, au moins virtuellement » (Grize, 1981 : 30).
Ce caractère dialogique de l’argumentation publicitaire a été remarqué également par les
« parents » de la « nouvelle rhétorique » qui précisent eux aussi : « Comme l’argumentation vise à
obtenir l’adhésion de ceux auxquels elle s’adresse, elle est, tout entière, relative à l’auditoire qu’elle
cherche à influencer », la « connaissance de ceux que l’on se propose de gagner » étant une
condition préalable de toute argumentation efficace (Perelman & Tyteca, 1988 : 68). La
réactualisation de la notion d’auditoire et d’échange intersubjectif complexe entraîne la nécessité de
considérer le discours argumentatif comme une véritable « mise en scène » inscrite dans une
théâtralité sociale déterminée (Vignaux, 1976 : 72). La théâtralité de l’argumentation publicitaire ne
signifie pas seulement inscrire explicitement ou implicitement l’auditoire dans le discours, mais
également mettre l’emphase sur l’objet dont il est question (réduit ou augmenté, dévoilé ou caché en
fonction du public auquel il s’adresse).
Une publicité automobile datant de janvier 1985 (qu’on a empruntée à J.-M. Adam et M.
Bonhomme, op. cit. : 96), exceptionnelle par la mise en scène de l’argumentation, vient à l’appui de
ces assertions :
Comment convaincre un homme qu’un bijou est indispensable.
Parfois les hommes sont merveilleusement prévisibles.
Observez-les quand une femme leur parle d’automobile. L’oeil devient sceptique, la lèvre
boudeuse ou ironique.

100
Moralité, si vous avez le coup de foudre pour l’Innocenti, ne dites surtout pas qu’elle est
jolie, ou qu’une voiture signée par Bertone est un vrai bijou.
Soyez modérée, pratique, rassurante.
Commencez par la tenue de route. Traction avant à moteur transversal, l’Innocenti sait
s’accrocher à la route, à toutes les routes.
Quant à l’espace intérieur il est surprenant pour une voiture de cette taille. Le minimum de
place pour le moteur, le maximum pour les passagers, c’est le secret de l’Innocenti.
Installez-vous, allongez les jambes et faites le tour du propriétaire : ceintures à enrouleurs,
essuie-glaces avant et arrière, lunette arrière dégivrante, moquette, vitres teintées... rien ne
manque.
Un coup d’oeil au coffre. Il est « extensible ». Rabattez les sièges et vous obtenez un volume
de près de 1000 dm3, un vrai mini breack.
Maintenant partez, faufilez-vous, garez-vous. Avec ses 3,12 m l’Innocenti passe là où les
autres renoncent.
Le prix de cette liberté : 22670 F clés en main, pour la 90 L.
Finalement, tous les bijoux ne sont pas un luxe.
Il ne vous reste plus qu’à parler de la consommation. Ne lésinez pas sur les chiffres, les
hommes adorent ça. Pour la 90 L : 6 L à 90 km /h, 9,1 L à 120 km/h, 8,4 L en parcours urbain... de
quoi réchauffer le coeur d’un ministre de finances ou même d’un mari.
Enfin, si après tout ça il subsiste un soupçon d’hésitation, revenez au discours que les
hommes ont toujours compris du premier coup. Dites : elle me plaît.
Cette publicité montre que ce qui peut être dit et la manière de le dire dépendent :
de l’objet dont il est question (ici une automobile : Innocenti) ;
de la place
1
socio-discursive et énonciative occupée par les interlocuteurs et qu’ils se
reconnaissent l’un à l’autre ;
des rapports de force qui règlent leurs prises de paroles.
Procédés rhétoriques et argumentation
Dans cette publicité le droit à la parole effective est assumé par l’énonciateur réel du
message qui est en même temps l’énonciateur textuel. Toutefois, cet énonciateur s’adresse aux
femmes en leur fournissant une recette pour qu’elles se fassent offrir une voiture de la part de leurs
maris. Le rôle de la femme est donc assez intéressant au sein de ce dispositif énonciatif : elle est le
récepteur textuel, ayant le rôle de porte-parole d’un énonciateur réel (et textuel) et, en même temps,
elle est conçue être un relais textuel pour un récepteur réel. On n’envisageait donc pas, à l’époque,
d’accorder aux femmes le droit de prendre directement la parole au sein des discours publicitaires.
Pour acquérir cette légitimité il a fallu attendre encore une vingtaine d’années.
Néanmoins, la persuasion est astucieusement développée, s’appuyant fortement sur les
acquis fournis par la rhétorique classique de même que sur un « arsenal » linguistique (lexique,
formes phonologiques et morphosyntaxiques) très bien adaptés à la situation.
Aussi tous les domaines classiques de la rhétorique se retrouvent-ils dans cette publicité en
suivant le choix des arguments (inventio), leur disposition (dispositio) et la définition d’un ton
(elocutio).
1
La théorie des « places » développée par R. Vion (1999) apporte un nouvel éclairage sur la relation interpersonnelle et
interlocutive. Les places « discursives » correspondent à la gestion interactive des tâches discursives particulières,
apparemment « monologuées ». « En tout point du récit, les sujets s’échangent des marques de leur statut discursif
respectif et développent des activités discursives correspondantes » (Vion, 1999 : 252). Les places « énonciatives »
concernent le mode de présence et d’implication des co-locuteurs vis-à-vis de leur production langagière de même que
le degré d’adhésion et de distanciation du locuteur vis-à-vis de son propre discours ou des discours prêtés aux autres.

101
L’inventio consiste à déterminer le thème du discours et surtout les arguments valables pour
l’auditoire qu’il s’agit de convaincre / persuader. Dans notre exemple, ceci se traduit par le choix
d’un contenu connoté et par l’exclusion d’un autre, à savoir le choix d’un discours technique
(représenté par des chiffres), et non pas esthétique (« ne dites surtout pas qu’elle est jolie ») ; choix
d’un langage descriptif (énumération des parties et des propriétés), et non pas métaphorique (un vrai
bijou). Pour ce qui est de la dispositio, ou mise en ordre des arguments, on y trouve
successivement : une réflexion sur l’introduction à éviter (les trois premiers paragraphes), des
indications sur la composition des parties du discours à tenir : « commencez par », « quant à »,
« maintenant », « finalement » et, pour terminer, un dernier paragraphe conclusif.
Le dernier domaine de la rhétorique exploitable dans notre démarche, l’elocutio, apparaît
clairement dès le quatrième paragraphe avec des indications sur le ton et le style à suivre («soyez
modérée, pratique, rassurante »).
A une lecture attentive, on constate à quel point, dans cette publicité, l’argumentation et la
rhétorique se rejoignent. Même si, apparemment, elle habille la forme d’une description,
l’argumentation se fait voir dans le choix des détails qui auront valeur d’argument pour celui auquel
on s’adresse. La règle rhétorique de la gradation y est parfaitement respectée, puisque
l’argumentation se termine par la présentation de deux propriétés déterminantes : le prix (« pas un
luxe ») et l’économie, elle-même renforcée par un renforcement du ton : « Ne lésinez pas sur les
chiffres, les hommes adorent ça ». Ainsi, tout est calculé en fonction du récepteur-auditeur : dans la
mesure où il s’agit de se faire offrir une voiture comme on se fait offrir un bijou, il convient
d’utiliser l’argument-financier susceptible de convaincre le mari-acheteur. Le discours
argumentatif, persuasif est donc un discours orienté, un discours qui s’adapte à l’auditoire qui doit
être convaincu, étant donné qu’il se développe à partir de ce que cet auditoire admet et attend. Cette
adéquation intersubjective (fortement exploitée dans le discours publicitaire) est réglée par une série
de contraintes pragmatiques (psychologiques, sociologiques, etc.) parce que toute interaction se
développe en tenant compte du « fonctionnement » supposé de l’autre.
Jeux énonciatifs et persuasion
Compte tenu des théories sur l’énonciation on se rend compte que tout discours est
interlocutivement dirigé vers une réponse (ci-dessus – accepter ou non d’acheter la voiture). La
compréhension anticipée par la femme que vise la publicité exerce une influence considérable sur la
production de son propre discours ; de même, ce qu’elle sait sur les conditions de réception de son
discours influence la forme de ses propos. « La notion classique de « récepteur », passive par
excellence, ne permet pas de rendre compte de cette influence très réelle d’un co-énonciateur qui
peut, certes, être effectivement actif par ses répliques verbales et/ou non verbales, mais qui est, de
toute façon, avant tout, actif dans l’imaginaire – les représentations – de l’énonciateur. Prendre la
parole, c’est trouver sa place dans ce qui surdétermine l’énonciation : les formations imaginaires qui
définissent, en fait, la compétence linguistique de tout locuteur » (Adam & Bonhomme, op. cit. :
97). Cette compétence ne suppose pas seulement la possession du système de la langue. Comme
le souligne P. Bourdieu (1984 : 100), le langage est fait pour parler à propos. Notre texte
publicitaire en est un exemple : l’opposition d’un discours féminin (bijoux, luxe, séduction) et d’un
discours masculin (chiffres, finances-économie), stéréotypée de façon sexiste
2
, signale l’existence
d’un conflit linguistique. Ce rapport conflictuel d’un discours économique, dominant et supposé
2
Stéphanie Pahud (2004 : 85) remarque à juste titre que « la publicité semble avoir résolument pris acte de la
différenciation des sexes, de leur hiérarchisation et de la naturalisation de cette hiérarchisation qui sont propres à une
société de nature patriarcale, dans laquelle les schémas culturels entretiennent la domination masculine et la sujétion
féminine ». Selon la même auteur, la publicité est le miroir de la symbolique dominante des sociétés occidentales
« c’est-à-dire blanche, occidentale, de classe moyenne supérieure, hétérosexuelle et masculine » (ibidem).

102
légitime (celui de l’homme) et d’un discours charmeur et dominé (celui de la femme) permet de
signaler la différence entre le choix de la langue française en tant que « code » et l’adéquation
intersubjective aux conditions mêmes de l’énonciation.
En poussant plus loin notre analyse, on remarque que les mots-arguments utilisés sont des
indices du système de représentations du sujet-parlant ; ainsi, le critère esthétique (« elle est jolie »)
et la métaphore (« est un vrai bijou ») apparaissent ici comme autant de signes de représentations
féminines, comme signes d’un discours féminin prototypique, totalement différent de celui de
l’homme
3
. Autrement dit, les signes utilisés par les sujets parlants les désignent et nous aident à les
encadrer dans des formations discursives données, spécifiques. C’est pourquoi, dans la conclusion,
la femme reste sur le terrain qui lui est supposé spécifique, en énonçant un simple : « Elle me
plaît », symbole d’un discours non-rationnel de la séduction, du charme et du caprice (censé la
caractériser), choisi pour redonner de l’efficacité à son propos parce qu’en dépit d’un effort
d’ajustement, l’échec est toujours possible.
L’échec est toujours possible parce que la nature profonde du discours publicitaire est
monologique. Dans cette conduite discursive asymétrique, le public-destinataire n’a pratiquement
aucune initiative, étant « tributaire des manoeuvres persuasives de l’annonceur. Le discours
publicitaire ne peut donc donner qu’une apparence d’échange à sa structure fondamentalement
monologique ; se présentant comme un hybride énonciatif, il entremêle, pour ce faire, un ETRE
MONOLOGIQUE et un PARAITRE DIALOGIQUE » (Adam & Bonhomme, op. cit. : 37).
Tout comme le montre la publicité citée, le dialogisme, s’il existe, est simulé, étant mis en
scène à travers non plus une structure de dialogue, mais des formes discursives stéréotypées de
« complétudes »
4
différentes : une technicité (basée sur des chiffres, finances, économie) supposée
représenter la complétude masculine et une non-rationalité séductrice et charmeuse supposée
représenter la complétude féminine. L’efficacité persuasive du discours publicitaire en est ainsi
augmentée passant par un ajustement des mots-arguments orientés vers deux types de destinataires
à la fois : les hommes et les femmes.
Dans une autre publicité, plus récente (1999), pour la Nouvelle Nissan Primera, le même
jeu des complétudes est mis en oeuvre de façon implicite, beaucoup plus subtile. Cette annonce
présente, sur une double page, à gauche, en arrière-plan, le dos nu d’une femme assise sur un
rocher, tandis que le premier plan reproduit la voiture dont il est question ayant comme en titre :
« Nouvelle Nissan Primera. Quand le corps se sent bien, l’esprit va plus loin. » et, en bas,
l’argumentaire suivant :
Dans la Nouvelle Nissan Primera, le plus important c’est vous. Son système de confort actif
préserve votre corps de la fatigue : siège conducteur avec réglage lombaire du dossier, isolation
acoustique optimale, climatisation à régulation automatique, ordinateur de bord. Sa technologie
apporte un vrai plaisir de conduite : souplesse et performance de la boîte de vitesses Hypertronic
CVT M6, système audio RDS 6 haut-parleurs avec volume asservi à la vitesse. Et pour votre
sécurité, elle est la première de sa catégorie à proposer un ABS avec répartiteur et amplificateur de
freinage, 4 airbags dont 2 airbags latéraux tête et thorax, une suspension multibras pour un
comportement dynamique exemplaire. Ainsi vous réagissez mieux, vous êtes plus détendu. Nouvelle
Nissan Primera. Quand le corps se sent bien, l’esprit va plus loin.
Même si ce n’est pas présenté de façon explicite, on comprend bien que cette publicité
s’adresse à la fois aux hommes et aux femmes, en mêlant les arguments choisis compte tenu des
complétudes stéréotypées dont on a déjà parlé. Le dos nu de la femme assise pourrait constituer le
destinataire explicite du message publicitaire. Ce destinataire apparaît également dans le filigrane
de l’argumentaire, connoté par les notions de confort absolu, souplesse, vrai plaisir de conduite,
sécurité. Néanmoins, les hommes sont eux aussi envisagés en même temps, la partie technique de la
3
L’association métaphorique entre « voiture » et « bijoux » a pour but, d’une part, de faire transparaître à travers
l’énonciation les marques de la féminité aussi, et, par ailleurs, de valoriser l’objet publicisé.
4
Flahault (1978) définit la complétude comme un système global de représentations.

103
description les ciblant presque explicitement. Qui plus est, l’horizon d’attente des hommes s’est
tellement modifié de nos jours, qu’on peut facilement estimer que certains mots-arguments censés
toucher les femmes les visent eux aussi. Autant les femmes que les hommes sont sensibles
aujourd’hui au concepts de confort, de dynamisme et de sécurité.
Voyons maintenant comment les publicitaires ont su adapter leur discours à l’évolution du
rôle et de l’image de la femme en société.
Dans une annonce, parue en 2000, pour une auto ALFA ROMEO, on voit en premier plan,
habillée d’une robe très élégante, la célèbre actrice Catherine Zeta-Jones énoncer : Je ne porte pas
de bijoux. Je les conduis. Les deux phrases encadrent en arrière plan la photo d’une voiture ALFA
ROMEO, modèle Sportwagon dont on présente les caractéristiques dans un pavé textuel en bas de la
page : La sportivité sous sa forme la plus séduisante : Alfa Sportwagon. Une ligne unique. Quatre
motorisations essence à 4 et 6 cylindres. Transmissions mécaniques. Q System ou Selespeed. Alfa
Sportwagon, le break de sport signé Alfa Romeo. A partir de 134 000 F (20 428 E)
A part la métaphore commune avec la première publicité analysée qui raccorde bijou et
voiture, le changement de stratégie est évident surtout au niveau du dispositif énonciatif. Si dans la
publicité pour Innocenti l’énonciateur inclut la femme dans son discours mais en ne lui assignant
qu’un rôle en quelque sorte « passif », celui de se faire offrir une voiture, la publicité pour ALFA
ROMEO nous présente une femme qui s’adresse directement aux lecteurs, une femme donc à
laquelle on accorde le droit à la parole. Cette légitimité de prise de parole est fondée sur la
transformation dans l’imaginaire moderne de la catégorisation stéréotypée des positions et des rôles
sexuels. Au niveau des modalités, dans la publicité pour Innocenti, l’opposition homme / femme
peut être perçue comme une priorité attribuée à l’agir face au sentir et au faire opposé à l’être (la
femme dit simplement qu’elle aime cette voiture-là, c’est à l’homme d’agir, de la lui acheter), en
revanche, la publicité pour ALFA ROMEO nous montre une femme nettement orientée vers un faire
efficace et performant (je ne porte pas de bijoux, je les conduis) qui doit être compris comme une
épreuve qualifiante permettant d’accéder à un statut socialement valorisé, à une nouvelle identité
sociale qui n’est en rien en dessous de celle d’un homme. Cette nouvelle représentation de l’identité
féminine autorise cette prise de parole de même que l’option pragmatique énoncée par son discours.
De plus, cette stratégie de persuasion du public féminin de s’acheter une voiture s’appuie
également sur l’utilisation d’un des grands archétypes de la beauté moderne propagés par les médias
en général et par la publicité en particulier : la star. Le choix de Catherine Zeta-Jones présentée dans
une tenue très élégante apporte de plus dans cette publicité les valeurs de standing entendu comme
un niveau de respectabilité socio-économique (de par son statut de femme qui a réussi à faire
carrière) et de raffinement (robe élégante) – valeurs censées se transférer chez les femmes possédant
ladite voiture. Catherine Zeta-Jones représente donc un modèle à suivre, l’exemplarité qu’elle
incarne devenant également une valeur ; la lecture suggérée de cette publicité étant ainsi : si vous
achetez la voiture ALFA ROMEO vous ressemblerez à Catherine Zeta-Jones et l’acte d’achat vous
épargnera l’effort de devenir comme elle !
Mais les femmes ne sont pas les uniques destinataires de cette publicité. L’ambiguïté
d’expression présente dans la partie descriptive de l’automobile qui associe femme et voiture cible
également les hommes qui désireraient posséder une voiture « sous sa forme la plus séduisante » et
ayant « une ligne unique » tout comme ils désireraient une femme
5
. Par ailleurs, la partie technique
qui suit les vise encore plus explicitement.
On observe aisément comment par une économie de moyens remarquable, due en partie
aussi à l’allègement du dispositif énonciatif – la femme n’y étant plus seulement un porte-parole –
5
Cette ambiguïté construite est devenue presque une formule dans les publicités pour les voitures. En voilà un autre
exemple éloquent : Il va vous falloir être fort pour résister aux charmes des SEAT Toledo Gran Via. La pureté de leurs
lignes, l’élégance de leurs courbes, la fluidité de leur silhouette ne pourront vous laisser de marbre. (SEAT)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%