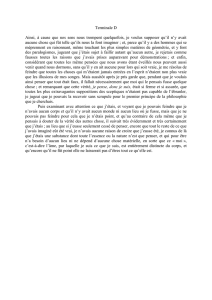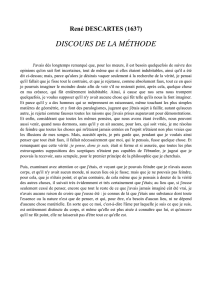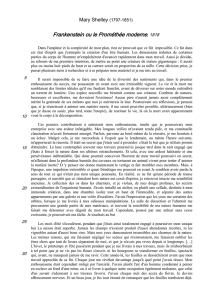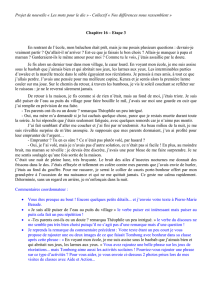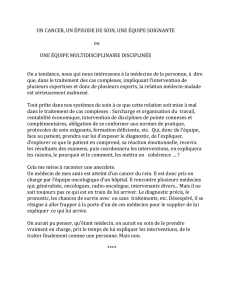TEXTE 1 « L`homme n`est qu`un roseau, le plus faible de la nature

TEXTE 1
« L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant.
Il
ne
faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour
le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue,
parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien.
Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, et non de
l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à
bien penser : voilà le
principe de la morale.
Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma
dignité,
mais c'est du
règlement
de ma
pensée. Je n'aurai pas davantage en possédant des terres. Par l'espace, l’univers me
comprend et m'engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends. »
PASCAL
Pensées l, 10-11
TEXTE 2
« J'aurais ensuite fait considérer l'utilité de cette philosophie, et montré que,
puisqu'elle s'étend à tout ce que l'esprit humain peut savoir, on doit croire que c'est elle
seule qui nous distingue des plus sauvages et barbares, et que chaque nation est d'autant
plus civilisée et polie que les hommes y philosophent mieux ; et ainsi que c'est le plus grand
bien qui puisse être dans un État que d'avoir de vrais philosophes. Et outre cela que, pour
chaque homme en particulier, il n'est pas seulement utile de vivre avec ceux qui s'appliquent
à cette étude, mais qu'il est incomparablement meilleur de s'y appliquer soi-même : comme
sans doute il vaut beaucoup mieux se servir de ses propres yeux pour se conduire, et jouir
par même moyen de la beauté des couleurs et de la lumière, que non pas de les avoir fermés
et suivre la conduite d'un autre ; mais ce dernier est encore meilleur que de les tenir fermés,
et n'avoir que soi pour se conduire. Or c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher
jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher; et le plaisir de voir toutes les choses que
notre vue découvre n'est point comparable à la satisfaction que donne la connaissance de
celles qu'on trouve par la philosophie ; et, enfin, cette étude est plus nécessaire pour régler
nos mœurs et nous conduire en cette vie, que n'est l'usage de nos yeux pour guider nos pas.
Les bêtes brutes, qui n'ont que leur corps à conserver, s'occupent continuellement à
chercher de quoi le nourrir; mais les hommes, dont la, principale partie est l'esprit, devraient
employer leur principaux soins à la recherche de la sagesse, qui en est la vraie nourriture; et
je m'assure aussi qu'il y en a plusieurs qui n'y manqueraient pas, s'ils avaient espérance d'y
réussir, et qu'ils sussent combien ils en sont capables. Il n'y a point d'âme tant soit peu noble
qui demeure si fort attachée aux objets des sens qu'elle ne s'en détourne quelquefois pour

souhaiter quelque autre plus grand bien, nonobstant qu'elle ignore souvent en quoi il
consiste. Ceux que la fortune favorise le plus, qui ont abondance de santé, d'honneurs, de
richesses, ne sont pas plus exempts de ce désir que les autres; au contraire je me persuade
que ce sont eux qui soupirent avec le plus d'ardeur après un autre bien, plus souverain que
tous ceux qu'ils possèdent. Or ce souverain bien, considéré par la raison naturelle sans la
lumière de la foi, n'est autre chose que la connaissance de la vérité par ses premières causes,
c'est-à-dire la sagesse, dont la philosophie est l’étude,
et,
parce que toutes ces choses sont
entièrement vraies elles ne seraient pas difficiles à persuader si elles étaient bien déduites. »
DESCARTES.
Préface des Principes.
TEXTE 3
Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j’y ai faites ; car elles sont
si métaphysiques et si peu communes, qu’elles ne seront peut-être pas au goût de tout le
monde. Et toutefois, afin qu’on puisse juger si les fondements que j’ai pris sont assez fermes,
je me trouve en quelque façon contraint d’en parler. J’avais dès longtemps remarqué que,
pour les mœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu’on sait fort incertaines,
tout de même que si elles étaient indubitables, ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; mais, parce
qu’alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensai qu’il fallait que je
fisse tout le contraire, et que je rejetasse, comme absolument faux, tout ce en quoi je
pourrais imaginer le moindre doute afin de voir s’il ne resterait point, après cela, quelque
chose en ma créance, qui fût entièrement indubitable. Ainsi, à cause que nos sens nous
trompent quelquefois, je voulus supposer qu’il n’y avait aucune chose qui fût telle qu’ils
nous la font imaginer. Et parce qu’il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant,
même touchant les plus simples matières de géométrie, et y font des paralogismes, jugeant
que j’étais sujet à faillir, autant qu’aucun autre, je rejetai comme fausses toutes les raisons
que j’avais prises auparavant pour démonstrations. Et enfin, considérant que toutes les
mêmes pensées, que nous avons étant éveillés, nous peuvent aussi venir, quand nous
dormons, sans qu’il y en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus de feindre que
toutes les choses qui m’étaient jamais entrées en l’esprit n’étaient non plus vraies que les
illusions de mes songes. Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi
penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque
chose. Et remarquant que cette vérité : je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée, que
toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n’étaient pas capables de
l’ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de la
philosophie que je cherchais.
Puis, examinant avec attention ce que j’étais, et voyant que je pouvais feindre que je n’avais
aucun corps, et qu’il n’y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse ; mais que je ne
pouvais pas feindre, pour cela, que je n’étais point ; et qu’au contraire, de cela même que je

pensais à douter de la vérité des autres choses, il suivait très évidemment et très
certainement que j’étais ; au lieu que, si j’eusse seulement cessé de penser, encore que tout
le reste de ce que j’avais jamais imaginé eût été vrai, je n’avais aucune raison de croire que
j’eusse été : je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est
que de penser, et qui, pour être, n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépend d’aucune chose
matérielle. En sorte que ce moi, c’est-à-dire l’âme par laquelle je suis ce que je suis, est
entièrement distincte du corps, et même qu’elle est plus aisée à connaître que lui, et
qu’encore qu’il ne fût point, elle ne laisserait pas d’être tout ce qu’elle est.
Descartes, Discours de la méthode, IV
TEXTE 4
« C'est ce qui me fait souvenir encore de ce qui arriva à Alipe étant à Carthage,
lorsqu'il étudiait sous moi, et que, se promenant sur le midi dans la salle du palais et pensant
à une déclamation qu'il devait faire pour s'exercer selon la coutume des écoliers, il fut arrêté
comme un voleur par les gardes du palais. Car vous permîtes sans doute, mon Dieu, que cet
accident lui arrivât, afin que, devant être un jour une personne si considérable dans votre
Eglise, il apprît dès lors avec combien de retenue et de circonspection un homme doit juger
la cause d'un homme, de peur qu'il ne condamne un innocent par une crédulité
inconsidérée.
Voici donc comment cette histoire se passa. Alipe se promenait seul devant le lieu où l'on
rendait la justice, ayant des tablettes à la main, lorsqu'un jeune écolier, qui était un véritable
voleur, commença, sans qu'il s'en aperçût, à couper avec une cognée qu'il avait apportée en
cachette des barreaux de plomb qui avançaient sur la rue des Changeurs, lesquels, ayant
entendu le bruit de cette cognée, commencèrent à crier, et envoyèrent des gens pour
prendre celui qu'ils trouveraient. Ce garçon, entendant cette rumeur, s'enfuit, et laissa là sa
cognée, de peur qu'on ne le surprît en étant saisi. Alipe qui ne l'avait point vu entrer,
l'entendant sortir, et voyant qu'il se retirait si vite, s'approcha pour en apprendre la cause,
et, ayant trouvé la cognée, il la prit et la considérait tout étonné, ne sachant rien de ce qui
s'était passé. Sur ces entrefaites, ceux qui avaient été envoyés pour prendre le voleur
arrivent et trouvent Alipe seul, tenant à la main cette même cognée qu'ils avaient entendue
d'en bas, et dont le bruit leur avait donné l'alarme. Aussitôt, ils se saisissent de lui,
l'entraînent comme un criminel, et assemblent ceux qui demeuraient dans le palais, se
réjouissant avec eux d'avoir pris sur le fait un voleur public, et le mènent devant le juge pour
lui faire son procès.

Mais comme ce qui était arrivé jusque-là suffisait pour donner à Alipe une instruction si
nécessaire, aussi, mon Dieu, vous ne différâtes pas davantage de justifier son innocence
dont vous étiez l'unique témoin. Car, comme ils le menaient ou en prison ou au supplice, ils
trouvèrent en leur chemin un architecte qui avait
le
soin de tous les édifices publics, ce qui
redoubla encore leur joie, étant ravis d'avoir rencontré si heureusement celui qui avait
accoutumé de les soupçonner d'avoir pris ce qui se volait dans le palais, afin qu'il reconnût
lui-même ceux qui étaient véritablement coupables de tous ces vols. Mais il arriva par
bonheur que cet architecte connaissait Alipe, l'ayant vu souvent chez un sénateur, auquel il
allait rendre ses devoirs: c'est pourquoi il le prit aussitôt par la main, le tira à part, et, lui
ayant demandé la cause d'un si grand désordre, il apprit de lui tout ce qui s'était passé.
L'architecte commanda ensuite à cette populace si émue et si irritée de venir avec lui. Et
comme ils passaient par devant le logis de celui
qui
était coupable de ce vol, ils virent à la
porte un petit garçon qui était
à
lui, et qui était si jeûne qu'il pouvait découvrir aisément tout
ce qu'il savait, sans crainte de fâcher son maître, qu'il avait suivi lorsqu'il avait été pour
couper ce plomb. Alipe l'ayant reconnu, il en avertit l'architecte, lequel lui montrant la
cognée, et lui
dem
andant à qui elle était :
«
Elle est à nous
», répondit
l'enfant; et lui ayant fait
-encore quelques demandes, il en tira tout le reste. Ainsi, ce crime retombant sur cette
maison, et tout ce peuple qui avait déjà commencé de triompher d'Alipe demeurant confus,
votre serviteur, mon Dieu, sortit heureusement de cette rencontre, et apprit par sa propre
expérience à être encore plus sage et plus circonspect à l'avenir, lui qui devait être un jour le
dispensateur de votre parole et le juge de tant d'affaires importantes dans votre Eglise. »
SAINT AUGUSTIN.
Confessions.
TEXTE 5 :
BAZILE. - Bone Deus ! Se compromettre ! Susciter une méchante affaire, à la bonne heure,
et, pendant la fermentation, calomnier à dire d'experts ; concedo.
BARTHOLO. - Singulier moyen de se défaire d'un homme !
BAZILE. - La calomnie, monsieur ? Vous ne savez guère ce que vous dédaignez ; j'ai vu les
plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas
d'horreurs, pas de conte absurde, qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville, en s'y
prenant bien : et nous avons ici des gens d'une adresse !... D'abord un bruit léger, rasant le
sol comme hirondelle avant l'orage, pianissimo murmure et file, et sème en courant le trait
empoisonné. Telle bouche le recueille, et piano, piano vous le glisse en l'oreille adroitement.
Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et rinforzando de bouche en bouche il va le
diable ; puis tout à coup, ne sais comment, vous voyez Calomnie se dresser, siffler, s'enfler,
grandir à vue d'oeil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne,
éclate et tonne, et devient, grâce au Ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus
universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait?

BARTHOLO. - Mais quel radotage me faites-vous donc là, Bazile ? Et quel rapport ce piano-
crescendo peut-il avoir à ma situation ?
BAZILE. - Comment, quel rapport ? Ce qu'on fait partout, pour écarter son ennemi, il faut le
faire ici pour empêcher le vôtre d'approcher.
Beaumarchais, Le Barbier de Séville, Acte II, scène 8 (la calomnie)
1
/
5
100%