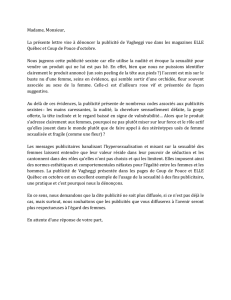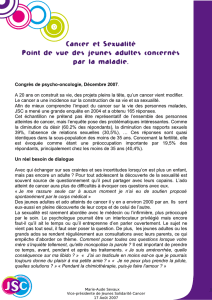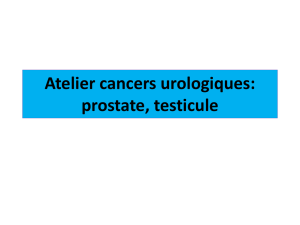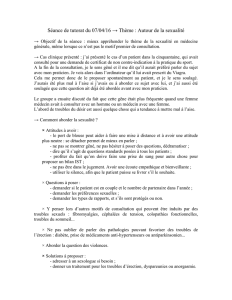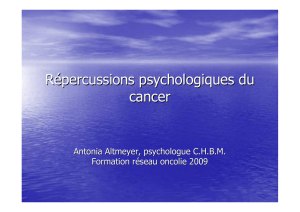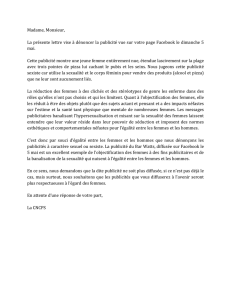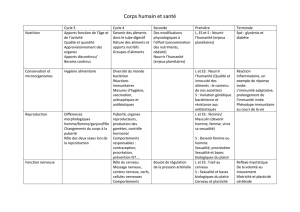«The Political Technology of Individuals» («La technologie - CIP-IDF

«The Political Technology of Individuals» («La technologie politique des individus»; université du
Vermont, octobre 1982; trad. P.-E. Dauzat), in Hutton (P.H.), Gutman (H.) et Martin (L. H.), éd.,
Technologies of the Self A Seminar with Michel Foucault, Amherst, The University of
MassachusettS, 1988, pp. 145-162.
Une question apparue à la fin du XVIIIe siècle définit le cadre général de ce que j'appelle les
«techniques de soi». Elle est devenue l'un des pôles de la philosophie moderne. Cette question
tranche nettement avec les questions philosophiques dites traditionnelles: Qu'est-ce que le monde?
Qu'est-ce que l'homme? Qu'en est-il de la vérité? Qu'en est-il de la connaissance? Comment le
savoir est-il possible? Et ainsi de suite. La question, à mon sens, qui surgit à la fin du XVIIIe siècle
est la suivante: Que sommes-nous en ce temps qui est le nôtre? Vous trouverez cette question
formulée dans un texte de Kant. Non qu'il faille laisser de côté les questions précédentes quant à la
vérité ou à la connaissance, etc. Elles constituent au contraire un champ d'analyse aussi solide que
consistant, auquel je donnerais volontiers l'appellation d'ontologie formelle de la
|PAGE 814
vérité. Mais je crois que l'activité philosophique conçut un nouveau pôle, et que ce pôle se
caractérise par la question, permanente et perpétuellement renouvelée: «Que sommes-nous
aujourd'hui?» Et tel est, à mon sens, le champ de la réflexion historique sur nous-même. Kant,
Fichte, Hegel, Nietzsche, Max Weber, Husserl, Heidegger, l'école de Francfort ont tenté de
répondre à cette question. M'inscrivant dans cette tradition, mon propos est donc d'apporter des
réponses très partielles et provisoires à cette question à travers l'histoire de la pensée ou, plus
précisément, à travers l'analyse historique des rapports entre nos réflexions et nos pratiques dans la
société occidentale.
Précisons brièvement que, à travers l'étude de la folie et de la psychiatrie, du crime et du châtiment,
j'ai tenté de montrer comment nous nous sommes indirectement constitués par l'exclusion de
certains autres: criminels, fous, etc. Et mon présent travail traite désormais de la question: comment
constituons-nous directement notre identité par certaines techniques éthiques de soi, qui se sont
développées depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours? Tel fut l'objet du séminaire.
Il est maintenant un autre domaine de questions que je voudrais étudier: la manière dont, à travers
quelque technologie politique des individus, nous avons été amenés à nous reconnaître en tant que
société, élément d'une entité sociale, partie d'une nation ou d'un État. Je voudrais ici vous donner un
aperçu, non pas des techniques de soi, mais de la technologie politique des individus.
Certes, je crains que les matériaux dont je traite ne soient un peu trop techniques et historiques pour
une conférence publique. Je ne suis point un conférencier, et je sais que ces matériaux
conviendraient mieux à un séminaire. Mais, malgré leur technicité peut-être excessive, j'ai deux
bonnes raisons de vous les présenter. En premier lieu, il est un peu prétentieux, je crois, d'exposer
de manière plus ou moins prophétique ce que les gens doivent penser. Je préfère les laisser tirer
leurs propres conclusions ou inférer des idées générales des interrogations que je m'efforce de
soulever par l'analyse de matériaux historiques bien précis. Je crois cela plus respectueux de la
liberté de chacun, telle est ma démarche. Ma seconde raison de vous présenter des matériaux assez
techniques est que je ne vois pas pourquoi le public d'une conférence serait moins intelligent, moins
averti ou moins cultivé que celui d'un cours. Attaquons-nous donc maintenant à ce problème de la
technologie politique des individus.
En 1779 parut le premier volume d'un ouvrage de l'Allemand J .P. Frank sous le titre System einer
vollständigen Medicinischen Polizey;
|PAGE 815

cinq autres tomes devaient suivre. Et lorsque le dernier volume sortit des presses, en 1790, la
Révolution française avait déjà commencé *. Pourquoi rapprocher un événement aussi célèbre que
la Révolution française et cet obscur ouvrage? La raison en est simple. L'ouvrage de Frank est le
premier grand programme systématique de santé publique pour l'État moderne. Il indique avec un
luxe de détails ce que doit faire une administration pour garantir le ravitaillement général, un
logement décent, la santé publique, sans oublier les institutions médicales nécessaires à la bonne
santé de la population, bref, pour protéger la vie des individus. À travers ce livre, nous pouvons voir
que le souci de la vie individuelle devient à cette époque un devoir pour l'État.
A la même époque, la Révolution française donne le signal des grandes guerres nationales de notre
temps, qui mettent en jeu des armées nationales et s'achèvent, ou trouvent leur apogée, dans
d'immenses boucheries collectives. On peut observer, je crois, un phénomène semblable au cours de
la Seconde Guerre mondiale. On aurait peine à trouver dans toute l'histoire boucherie comparable à
celle de la Seconde Guerre mondiale, et c'est précisément à cette période, à cette époque que furent
mis en chantier les grands programmes de protection sociale, de santé publique et d'assistance
médicale. C'est à cette même époque que fut, sinon conçu, du moins publié le plan Beveridge. On
pourrait résumer par un slogan cette coïncidence: Allez donc vous faire massacrer, nous vous
promettons une vie longue et agréable. L'assurance-vie va de pair avec un ordre de mort.
La coexistence, au sein des structures politiques, d'énormes machines de destruction et d'institutions
dévouées à la protection de la vie individuelle est une chose déroutante qui mérite quelque
investigation. C'est l'une des antinomies centrales de notre raison politique. Et c'est sur cette
antinomie de notre rationalité politique que je voudrais me pencher. Non que les boucheries
collectives soient l'effet, le résultat ou la conséquence logique de notre rationalité, ni que l'État ait
l'obligation de prendre soin des individus, puisqu'il a le droit de tuer des millions de personnes. Pas
plus que je n'entends nier que les boucheries collectives ou la protection sociale aient leurs
explications économiques ou leurs motivations affectives.
Que l'on me pardonne de revenir au même point: nous sommes des êtres pensants.
Autrement dit, que nous tuions ou soyons tués,
* Frank (J. P.), System einer vollständigen Medicinischen Polizey, Mannheim, C.F.
Schwann, 1780-1790, 4 vol.
|PAGE 816
que nous fassions la guerre ou que nous demandions une aide en tant que chômeurs, que nous
votions pour ou contre un gouvernement qui ampute le budget de la Sécurité sociale et accroît les
dépenses militaires, nous n'en sommes pas moins des êtres pensants, et nous faisons tout cela au
nom, certes, de règles de conduite universelles, mais aussi en vertu d'une rationalité historique bien
précise. C'est cette rationalité, ainsi que le jeu de la mort et de la vie dont elle définit le cadre, que je
voudrais étudier dans une perspective historique. Ce type de rationalité, qui constitue l'un des traits
essentiels de la rationalité politique moderne, s'est développé aux XVIIe et XVIIIe siècles au travers
de l'idée générale de «raison d'État» ainsi que d'un ensemble bien spécifique de techniques de
gouvernement que l'on appelait à cette époque, en un sens très particulier, la police.
Commençons par la «raison d'État». Je rappellerai succinctement un petit nombre de définitions
empruntées à des auteurs italiens et allemands. À la fin du XVIe siècle, un juriste italien, Botero,
donne cette définition de la raison d'État: «Une connaissance parfaite des moyens à travers lesquels
les États se forment, se renforcent, durent et croissent *.» Un autre Italien, Palazzo, écrit au début
du XVIIe siècle (Discours du gouvernement et de la véritable raison d'État, 1606) ** : «Une raison
d'État est une méthode ou un art nous permettant de découvrir comment faire régner l'ordre ou la
paix au sein de la République.» Et Chemnitz, auteur allemand du milieu du XVIIe siècle (De ratione
Status, 1647) ***, donne, quant à lui, cette définition: «Certaine considération politique nécessaire
pour toutes les affaires publiques, conseils et projets, dont le seul but est la préservation, l'expansion

et la félicité de l'État» -notez bien ces mots: préservation de l'État, expansion de l'État et félicité de
l'État -«à quelle fin l'on emploie les moyens les plus rapides et les plus commodes».
Arrêtons-nous sur certains traits communs de ces définitions. La raison d'État, tout d'abord, est
considérée comme un «art», c'est-à-dire une technique se conformant à certaines règles. Ces règles
ne regardent pas simplement les coutumes ou les traditions, mais aussi une certaine connaissance
rationnelle. De nos jours, l'expression
* Botero (G.), Della ragione di Stato dieci libri, Roma, V. Pellagallo, 1590 (Raison et
Gouvernement d'État en dix livres, trad. G. Chappuys, Paris, Chaudière, 1599).
** Palazzo (G.A.), Discorso del governo e della ragione vera di Stato, Venetia, de Franceschi, 1606
(Discours du gouvernement et de la raison vraie d'État, trad. A. de Vallières, Douay, B. Bellère,
1611).
*** Chemnirz (B.P. von), Dissertatio de ratione Status in imperio nostro romano germanico,
Freistadii, 1647.
|PAGE 817
«raison d'État», vous le savez, évoque bien davantage l'arbitraire ou la violence. Mais, à l'époque,
on entendait par là une rationalité propre à l'art de gouverner les États. D'où cet art de gouverner
tiret-il sa raison d'être? La réponse à cette question provoqua le scandale de la pensée politique
naissante, à l'aube du XVIIe siècle. Et pourtant, d'après les auteurs que j'ai cités, elle est fort simple.
L'art de gouverner est rationnel à condition qu'il observe la nature de ce qui est gouverné, autrement
dit, l'État lui-même.
Or, proférer une telle évidence, une telle platitude, c'était en vérité rompre simultanément avec deux
traditions opposées: la tradition chrétienne et la théorie de Machiavel. Celle-là prétendait que pour
être foncièrement juste, le gouvernement devait respecter tout un système de lois: humaines,
naturelles et divines.
Il existe à ce propos un texte révélateur de saint Thomas, où il explique que, dans le gouvernement
de son royaume, le roi doit imiter le gouvernement de la nature par Dieu. Le roi doit fonder des
cités exactement comme Dieu créa le monde; il doit conduire l'homme à sa finalité, ainsi que Dieu
le fait pour les êtres naturels. Et quelle est la finalité de l'homme? La santé physique? Non, répond
saint Thomas. Si la santé du corps était la finalité de l'homme, il n'aurait besoin que d'un médecin,
pas d'un roi. La richesse? Non plus. Un régisseur suffirait. La vérité? Non pas, répond saint
Thomas, car pour trouver la vérité, nul besoin d'un roi, seul un maître ferait l'affaire. L'homme a
besoin de quelqu'un qui soit capable d'ouvrir la voie à la félicité céleste en se conformant, ici-bas, à
ce qui est honestum. C'est au roi qu'il appartient de conduire l'homme vers l'honestum comme à sa
finalité naturelle et divine.
Le modèle de gouvernement rationnel cher à saint Thomas n'est pas le moins du monde politique,
alors qu'aux XVIe et XVIIe siècles l'on se mit en quête d'autres dénominations de la raison d'État,
de principes susceptibles de guider concrètement un gouvernement. On ne s'intéressa plus aux
finalités naturelles ou divines de l'homme, mais à ce qu'est l'État.
La raison d'État se trouve aussi opposée à une autre espèce d'analyse. Dans Le Prince, le problème
de Machiavel est de savoir comment l'on peut protéger, contre ses adversaires de l'intérieur ou de
l'extérieur, une province ou un territoire acquis par l'héritage ou la conquête. Toute l'analyse de
Machiavel tente de définir ce qui consolide le lien entre le Prince et l'État, cependant que le
problème posé au début du XVIIe siècle par la notion de raison d'État est celui de l'existence même
et de la nature de cette nouvelle entité qu'est
|PAGE 818

l'État. C'est bien pourquoi les théoriciens de la raison d'État s'efforcèrent de rester aussi loin que
possible de Machiavel: celui-ci jouissait d'une fort mauvaise réputation à cette époque, et ils ne
pouvaient reconnaître leur problème dans le sien, lequel n'était pas le problème de l'État, mais celui
des rapports entre le Prince - le roi - et son territoire et son peuple. En dépit de toutes les querelles
autour du Prince et de l'oeuvre de Machiavel, la raison d'État marque un jalon important dans
l'apparition d'un type de rationalité extrêmement différent du type propre à la conception de
Machiavel. Le propos de ce nouvel art de gouverner est précisément de ne pas renforcer le pouvoir
du Prince. Il s'agit de consolider l'État lui-même.
Pour nous résumer, la raison d'État ne renvoie ni à la sagesse de Dieu ni à la raison ou aux stratégies
du Prince. Elle se rapporte à l'État, à sa nature et à sa rationalité propre. Cette thèse -que le dessein
d'un gouvernement est de renforcer l'État -implique diverses idées que je crois important d'aborder
pour suivre l'essor et le développement de notre rationalité politique moderne.
La première de ces idées concerne la relation inédite qui s'établit entre la politique comme pratique
et la politique comme savoir. Elle a trait à la possibilité d'un savoir politique spécifique. D'après
saint Thomas, il suffisait au roi de se montrer vertueux. Le chef de la cité, dans la République
platonicienne, devait être philosophe. Pour la première fois, l'homme qui doit diriger les autres dans
le cadre de l'État doit être un politique; il doit pouvoir s'appuyer sur une compétence et un savoir
politiques spécifiques.
L'État est une chose qui existe pour soi. C'est une sorte d'objet naturel, même si les juristes tâchent
de savoir comment il peut se constituer de manière légitime. L'État est de lui-même un ordre des
choses, et le savoir politique le distingue des réflexions juridiques. Le savoir politique traite, non
pas des droits du peuple ni des lois humaines ou divines, mais de la nature de l'État qui doit être
gouverné. Le gouvernement n'est possible que lorsqu’est connue la force de l'État: c'est par ce
savoir qu'elle peut être entretenue. Et il faut connaître la capacité de l'État et les moyens de
l'augmenter, ainsi que la force et la capacité des autres États, des États rivaux du mien. L'État
gouverné doit tenir tête aux autres. Le gouvernement ne saurait donc se limiter à la seule application
des principes généraux de raison, de sagesse et de prudence. Un savoir spécifique est nécessaire : un
savoir concret, précis et mesuré se rapportant à la puissance de l'État. L'art de gouverner,
caractéristique de la raison
|PAGE 819
d'État, est intimement lié au développement de ce que l'on a appelé, à cette époque, l'arithmétique
politique -c'est-à-dire la connaissance que donna la compétence politique. L'autre nom de cette
arithmétique politique, vous le savez fort bien, était la statistique, une statistique sans lien aucun
avec la probabilité, mais rattachée à la connaissance de l'État, des forces respectives des différents
États.
Le deuxième point important qui découle de cette idée de raison d'État n'est autre que l'apparition de
rapports inédits entre politique et histoire. Dans cette perspective, la véritable nature de l'État n'est
plus conçue comme un équilibre entre plusieurs éléments que seule une bonne loi pourrait maintenir
ensemble. Elle apparaît alors comme un ensemble de forces et d'atouts susceptibles d'être
augmentés ou affaiblis selon la politique suivie par les gouvernements. Il importe d'accroître ces
forces, puisque chaque État se trouve dans une rivalité permanente avec d'autres pays, d'autres
nations et d'autres États, en sorte que chaque État n'a rien d'autre, devant lui, qu'un avenir indéfini
de luttes, ou tout au moins de compétitions, avec des États semblables. Tout au long du Moyen Âge,
l'idée avait dominé que tous les royaumes de la terre seraient un jour unifiés en un dernier Empire
juste avant le retour du Christ ici-bas. Dès le début du XVIIe siècle, cette idée familière n'est plus
qu'un songe, lequel fut aussi l'un des traits majeurs de la pensée politique, ou de la pensée historico-
politique, au cours du Moyen Âge. Ce projet d'une reconstitution de l'Empire romain s'évanouit à

jamais. La politique doit désormais traiter d'une irréductible multiplicité d'États qui luttent et
rivalisent dans une histoire limitée.
La troisième idée que nous pouvons tirer de cette notion de raison d'État est la suivante: puisque
l'État est sa propre finalité et que le dessein exclusif des gouvernements doit être non seulement la
conservation mais aussi le renforcement permanent et le développement des forces de l'État, il est
clair que les gouvernements n'ont pas à s'inquiéter des individus; ou plutôt, ils n'ont à s'en
préoccuper que dans la seule mesure où ils présentent quelque intérêt à cette fin : ce qu'ils font, leur
vie, leur mort, leur activité, leur conduite individuelle, leur travail et ainsi de suite. Je dirais que
dans ce type d'analyse des rapports entre l'individu et l'État, l'individu n'intéresse l'État que dans la
seule mesure où il peut faire quelque chose pour la puissance de l'État. Mais il est dans cette
perspective un élément que nous pourrions définir comme un marginalisme politique en son genre,
dès lors que seule est en question ici l'utilité politique. Du point de vue de l'État, l'individu n'existe
|PAGE 820
que pour autant qu'il est à même d'apporter un changement, fût-il minimal, à la puissance de l'État,
que ce soit dans une direction positive ou négative. L'État n'a donc à s'occuper de l'individu que
dans la seule mesure où celui-ci peut introduire un tel changement. Et tantôt l'État lui demande de
vivre, de travailler, de produire et de consommer; tantôt il lui demande de mourir.
Ces idées sont manifestement apparentées à un autre ensemble d'idées que nous pouvons trouver
dans la philosophie grecque. Et, à vrai dire, la référence aux cités grecques est très fréquente dans
cette littérature politique du début du XVIIe siècle. Mais je crois qu'un petit nombre de thèmes
semblables dissimule quelque chose de bien différent à l'oeuvre dans cette nouvelle théorie
politique. Dans l'État moderne, en effet, l'intégration marginaliste des individus à l'utilité de l'État
ne prend pas la forme de la communauté éthique caractéristique de la cité grecque. Dans cette
nouvelle rationalité politique, elle s'acquiert à l'aide d'une technique bien particulière que l'on
appelait alors la police.
Nous touchons ici au problème que je voudrais analyser dans quelque travail futur. Ce problème est
celui-ci: quelle espèce de techniques politiques, quelle technologie de gouvernement a-t-on mises
en oeuvre, utilisées et développées dans le cadre général de la raison d'État pour faire de l'individu
un élément de poids pour l'État? Le plus souvent, quand on analyse le rôle de l'État dans notre
société, ou l'on se concentre sur les institutions -armée, fonction publique, bureaucratie, et ainsi de
suite -et le type de personnes qui les dirigent, ou l'on analyse les théories ou idéologies élaborées
afin de justifier ou de légitimer l'existence de l'Etat.
Ce que je cherche, au contraire, ce sont les techniques, les pratiques qui donnent une forme concrète
à cette nouvelle rationalité politique et à ce nouveau type de rapport entre l'entité sociale et
l'individu. Et de manière assez surprenante, il s'est trouvé, au moins en des pays comme
l'Allemagne et la France, où pour différentes raisons le problème de l'État passait pour majeur, des
personnes pour reconnaître la nécessité de définir, de décrire et d'organiser très explicitement cette
nouvelle technologie du pouvoir, les nouvelles techniques permettant d'intégrer l'individu à l'entité
sociale. Ils admirent cette nécessité, et ils lui donnèrent un nom: police, en français, et Polizei en
allemand. Je crois que police en anglais a un sens très différent.) Il nous appartient précisément
d'essayer de donner de meilleures définitions de ce que l'on entendait par ces vocables français et
allemand, police et Polizei.
Leur sens est pour le moins déroutant puisque, depuis le XIXe siècle au moins jusqu'à aujourd'hui,
on les a employés pour
|PAGE 821
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%