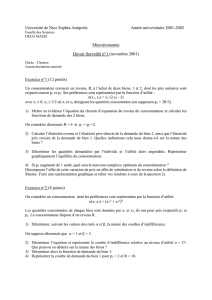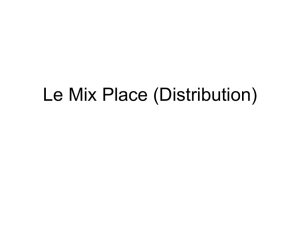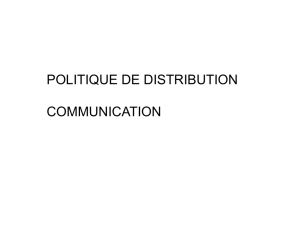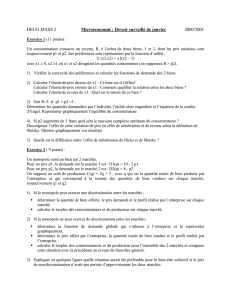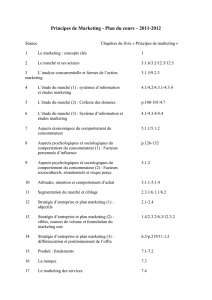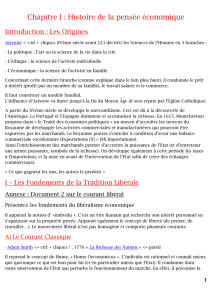Section 1. La nature de l`activité économique

Introduction à l’économie générale
Université de Nîmes
Véronique Thireau
RESUME
Ce cours destiné aux étudiants de première année de licence de droit et d’AES
énumère et décrit les grands courants de la pensée économique de l’antiquité à
nos jours. Il fournit également une base de raisonnement en micro et
macroéconomie. Il est nécessaire de consulter d’autres ouvrages pour compléter
les notions abordées dans ce cours.

Introduction à l’économie générale
2
Introduction ....................................................................................................................................... 4
I. Etymologie du mot « économie » ....................................................................................................... 4
II. Définitions de l’économie .................................................................................................................... 4
III. Bref historique de l’économie .......................................................................................................... 4
Chapitre 1. Nature de l’activité économique et objet de la science économique ....... 5
Section 1. La nature de l’activité économique ........................................................................ 5
I. Les besoins ................................................................................................................................................. 5
II. La rareté .................................................................................................................................................... 5
III. Les choix économiques ....................................................................................................................... 6
Section 2. Objets de la science économique ............................................................................ 6
I. Les agrégats ............................................................................................................................................... 6
A. Les acteurs et leur comportement............................................................................................................... 6
B. Les prix et les revenus ...................................................................................................................................... 7
C. La monnaie et le financement de l’économie .......................................................................................... 7
II. Les outils de la science économique ................................................................................................ 8
A. Evaluation et analyse des grandeurs globales de l’économie .......................................................... 8
B. Les formes d’organisation de l’activité économique............................................................................ 8
C. Les relations économiques internationales ............................................................................................. 8
D. Développement et croissance ....................................................................................................................... 9
Chapitre II. Les grands courants de la pensée économique .............................................. 9
Section 1. Les précurseurs .......................................................................................................... 10
I. Les origines de l’économie ................................................................................................................ 10
II. Le mercantilisme ................................................................................................................................. 10
A. Le contexte historique, économique et social d’origine .................................................................. 11
B. Les idées mercantilistes ................................................................................................................................ 11
Section 2. Le libéralisme ............................................................................................................. 12
I. Le contexte historique, économique et social d’origine ......................................................... 12
A. Les Révolutions technique et philosophique ....................................................................................... 12
B. La réaction des économistes contre le mercantilisme ..................................................................... 13
II. Analyse du courant de pensée libérale ....................................................................................... 13
A. Les traits essentiels du libéralisme économique................................................................................ 13
B. Les grandes écoles de pensée libérale .................................................................................................... 15
Section 3. Le marxisme ................................................................................................................ 17
I. Contexte historique, économique et social d’origine .............................................................. 17
A. Les conséquences de la Révolution Industrielle ................................................................................. 17
B. Le marxisme est une réaction à l’école libérale. ................................................................................. 17
II. Analyse du courant de pensée Marxiste ..................................................................................... 18
A. La pensée de Marx (1818 – 1883) ............................................................................................................ 18
B. Les successeurs de Marx (vulgarisateurs) ............................................................................................ 19
Section 4. Le courant keynésien ............................................................................................... 20
I. Le contexte .............................................................................................................................................. 20
A. La crise économique ....................................................................................................................................... 20
B. La réaction contre l’économie libérale ................................................................................................... 21
II. Analyse du courant de pensée Keynésien .................................................................................. 21
A. Les explications fournies .............................................................................................................................. 21
B. Les propositions ............................................................................................................................................... 21
Section 5. Les grands courants de pensée contemporains ............................................. 22

Introduction à l’économie générale
3
I. Les écoles libérales .............................................................................................................................. 22
A. L’école monétariste ........................................................................................................................................ 22
B. La nouvelle école classique.......................................................................................................................... 23
C. L’école des choix publics ............................................................................................................................... 23
D. L’économie de l’offre ...................................................................................................................................... 24
II. La contestation des politiques libérales ..................................................................................... 24
A. La théorie du déséquilibre ........................................................................................................................... 24
B. La nouvelle école Keynésienne .................................................................................................................. 25
C. L’école de la régulation .................................................................................................................................. 25
CONCLUSION .................................................................................................................................... 25
Chapitre III. Introduction à la microéconomie.................................................................... 26
Section 1. Le marché comme confrontation de l’offre et de la demande ................... 28
I. La formation de la demande ............................................................................................................. 28
A. Le concept de rationalité dans la théorie du consommateur ........................................................ 28
B. La demande du consommateur ................................................................................................................. 30
C. Les nouvelles théories du consommateur ............................................................................................. 32
1. Les limites de la théorie traditionnelle ................................................................................................... 32
II. La formation de l’offre ....................................................................................................................... 34
A. Les hypothèses ................................................................................................................................................. 34
B. L’offre de l’entreprise .................................................................................................................................... 35
Section 2. La rencontre offre et demande vers l’équilibre général concurrentiel . 38
I. Le déplacement des courbes d’offre et de demande ................................................................ 38
II. L’équilibre .............................................................................................................................................. 38
Section 3 : Au-delà de la concurrence pure et parfaite .................................................... 39
I. Les marchés de concurrence imparfaite ...................................................................................... 39
A. La concurrence monopolistique ................................................................................................................ 39
B. L’oligopole .......................................................................................................................................................... 40
C. Le monopole et monopsone ........................................................................................................................ 40
II. Les marchés contestables................................................................................................................. 40
III. Les limites apportées à l’économie de marché ....................................................................... 41
A. Le comportement des entreprises ........................................................................................................... 41
B. Les interventions de l’Etat ........................................................................................................................... 41
Chapitre 4. L’Etat et ses interventions économiques et sociales .................................. 42
Section 1. L’évolution de la nature et de la conception de l’Etat ................................... 42
I. l’Etat arbitre ............................................................................................................................................ 42
II. L’Etat partisan ...................................................................................................................................... 43
III. L’Etat gestionnaire ............................................................................................................................ 43
Section 2. Les fonctions de l’Etat dans les économies développées ............................. 44
I. La fonction d’affectation des ressources ...................................................................................... 44
II. La fonction de redistribution des richesses .............................................................................. 44
III. La fonction de stabilisation de la conjoncture ........................................................................ 44
Section 3. La production de l’Etat ............................................................................................ 44
I. La production des services collectifs ............................................................................................. 44
II. La production de biens et services privatifs.............................................................................. 45
A. Evolution historique des contours du secteur public ....................................................................... 45
B. Les spécificités de la production publique marchande.................................................................... 46

Introduction à l’économie générale
4
Introduction
I. Etymologie du mot « économie »
Le terme d’économie vient du grec « oikos » : maison et « nomos » : administration.
Terme utilisé pour la première fois par Xénophon pour illustrer L’Economique, qui donne les
règles d’une bonne gestion foncière. Le 17ème siècle est un tournant dans la pensée
économique avec la naissance du courant mercantiliste.
II. Définitions de l’économie
Elle enseigne comment les richesses sont produites, distribuées, et consommées dans la
société (J. B. Say).
C’est une science qui traite de la population et de la distribution des richesses (J.S. Mill).
C’est une science qui doit permettre de découvrir les lois naturelles qui régissent l’activité
économique. Ces lois sont donc l’objet même de l’analyse économique.
John Maynard Keynes : l’économie est une science morale dans laquelle l’intuition et
l’éthique, l’introspection et les valeurs jouent des rôles aussi importants que la méthodologie
appelée « scientifique ».
G. Myrdal (cf. politique sociale suédoise) : c’est une science douce (par opposition aux
mathématiques ...)
Lionel Robbins : c’est une branche des sciences humaines qui vise à analyser le
comportement de l’homme dans la gestion des ressources rares à usage concurrent.
Cette définition réaffirme que l’économie est une science sociale. On est donc amenés à
porter des jugements de valeur.
D’un côté : les besoins des individus, qui sont illimités et, en face des biens censés
permettre de satisfaire ces besoins mais qui n’existent qu’en quantités limitées.
III. Bref historique de l’économie
Antiquité : l’économie traite des problèmes domestiques.
Pour la civilisation grec : l’économie de la cité.
17ème siècle : l’économie devient « politique », c’est-à-dire qu’elle se met au service de la
politique. On recherche la manière la plus efficace possible d’utiliser les « ressources rares »
afin de satisfaire des besoins.
L’économie est une science des choix. Son objet traite d’activités fondamentales :
production de richesses, répartition, distribution et consommation (utilisation finale de la
production).

Introduction à l’économie générale
5
Chapitre 1. Nature de l’activité économique et objet de la
science économique
Quelles sont les raisons qui poussent les individus à avoir des activités économiques ?
Section 1. La nature de l’activité économique
Les besoins des individus sont illimités, mais les biens sont disponibles en quantités
limitées. Les hommes essaient donc de satisfaire au mieux leurs besoins, et ce à partir des
biens rares dont ils disposent, à travers l’activité économique.
I. Les besoins
De tous temps, chaque individu a éprouvé un certain nombre de besoins, liés à
l’existence même de l’homme : se nourrir, se vêtir, se loger etc.
Apparition de nouveaux besoins : le progrès technique entraîne un développement de
la production et donc la croissance de l’offre des biens (biens plus diversifiés dans les pays
les plus riches). Ces besoins ont tendance à se généraliser car le désir se transforme en
besoin. Pourquoi ? Le Processus d’imitation entraîne la diffusion des besoins parmi les
individus (appartenance à un groupe). Le développement de la publicité, permet de diffuser la
connaissance, et l’accès aux biens nouveaux (+), mais aussi de transformer ces désirs en
besoins (-).
Remarque : le nombre et la nature des besoins sont illimités ; en revanche, au plan individuel,
ces besoins ont une intensité qui diminue au fur et à mesure qu’ils sont satisfaits (utilité
marginale décroissante : saturation ; on se tourne vers la satisfaction d’autres besoins).
Exceptions : les activités culturelles ne subissent pas la règle de l’utilité marginale
décroissante (musique, lecture, musées...).
On distingue les besoins : individuels (alimentation...) et collectifs (musées, écoles,
hôpitaux...). ce sont eux qui ont le plus progressé dans les économies modernes.
Les besoins évoluent quantitativement et qualitativement. Des besoins inimaginables
à la préhistoire sont à présents fondamentaux : accès à l’emploi, respect, liberté de religion,
accès au système de soins et de protection sociale, à l’éduction... L’état doit mettre en place
des systèmes pour satisfaire ces besoins collectifs.
II. La rareté
La société primaire dispose de deux sortes de richesses qui permettent d’obtenir des
biens susceptibles de satisfaire les besoins des individus : les ressources naturelles (limitées)
et le travail des hommes (limité par le volume de la population active et le temps qui peut être
consacré au travail). Ces deux richesses sont disponibles en quantités insuffisantes pour
répondre aux besoins. L’homme optimise donc l’utilisation des ressources pour produire
plus de biens en moins de temps (augmentation de l’efficacité du travail).
Productivité = quantité de biens / unité de facteur
Un choix consiste à consacrer une partie des ressources à la fabrication d’instruments
(biens de production = capital technique). Le capital technique est la 3ème richesse qui permet
d’obtenir des biens. Les biens économiques, selon 2 critères : qui n’existent qu’en quantités
limitées (rare) ou utiles à la satisfaction des besoins.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
1
/
46
100%