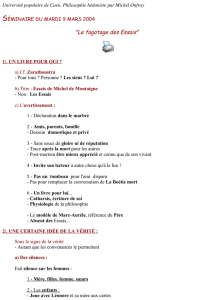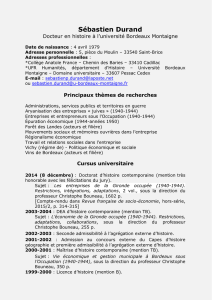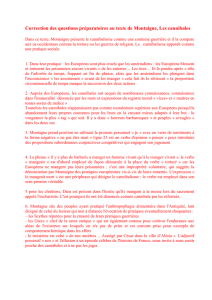T. Berns, Puissances et faiblesses de l`opinion commune

1
Puissances et faiblesses de l’opinion commune
Thomas Berns
Pôle Bernheim Paix et Citoyenneté et
Centre de Philosophie du Droit de l’Université Libre de Bruxelles
« Opinion » est employé plus de 300 fois, par Montaigne dans les Essais, souvent dans son
sens traditionnel de Doxa ou d’opinio, d’idée sans fondement, ou d’idée fondée sur la seule
vraisemblance, conjecture, croyance, etc. Ainsi, on trouve des expressions comme « Non par
opinion mais en verité… » (Essais, III, 9, p.934
1
). L’opinion est très classiquement opposée à
la réalité des choses : « les hommes […] sont tourmentez par les opinions qu’ils ont des
choses, non par les choses mesmes » (Essais, I, 14, p. 49). A première vue, on s’en doute, la
particularité de Montaigne ne résiderait pas tant dans sa définition de l’opinion, que dans le
peu de marge qu’il laisse à tout jugement d’être autre chose que de l’opinion.
Cependant, on doit noter que l’idée d’opinion, en croisant celles de « coutume » et de
« renommée », renvoie de façon assez régulière à quelque chose de collectif : ainsi, il
semblerait que Montaigne est un des premiers à proposer en français l’expression d’opinion
publique, et on trouve très fréquemment dans son texte des expressions comme opinion
commune, mais aussi opinion vulgaire, opinion du peuple, ou encore, dans un registre
proche : voix du peuple, voix commune…
J’entends aborder ici les conceptions développées par Montaigne au sujet de l’opinion
commune en les confrontant au constat de la présence, tout au long de la pensée politique, de
considérations sur une réflexivité du commun, sur un regard du commun sur lui-même, même
si ce regard ne donne lieu qu’à un jugement relevant du vraisemblable, et ce, plus
particulièrement pour ce qui concerne les questions de moralité, et donc nécessairement de
moralité collective. Ce qui m’intéresse est donc l’histoire, souterraine, de la prise en
considération de la capacité du commun à se contrôler lui-même, à intégrer ou même à
développer ses propres normes, par opposition à la prise en considération de l’action
extérieure, verticale, momentanée, exceptionnelle de la loi, c’est-à-dire par opposition à la
relation d’autorité, qui serait l’objet privilégié du questionnement philosophique : cette
relation privilégiée de la philosophie à la loi (et plus généralement, une certaine congruence
1
Cité sur base de Montaigne, Œuvres complètes, Editions Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), Paris, 1962.

2
entre l’ordre philosophique et l’ordre juridique) éclaire ou répète le fait que l’opinion n’est
pas la matière de la philosophie.
Si la renommée ou la gloire sont fréquemment évoquées positivement, surtout dans la longue
tradition républicaine, l’opinion commune, qui pourtant la meut, reste étrangement absente,
voire décriée. Nous verrons cependant, en nous reportant à un texte cité par Montaigne, que
même Platon ne nie pas l’importance du rôle de l’opinion commune, quand il s’agit de veiller
au contrôle de la moralité collective. Non seulement l’opinion commune serait un outil
adéquat, mais elle serait même le seul outil adéquat au vu de l’impuissance de la loi face à un
certain type de problèmes liés à la moralité collective. Les modèles les plus accomplis de cette
histoire longue mais souterraine
2
qui permettraient de penser l’opinion commune sont,
premièrement, la figure antique du censeur, dont le regard « intégré » fait seulement rougir
3
mais permet de punir ou de contrôler même ce qui échappe à la loi
4
; deuxièmement, l’idée
d’opinion publique, telle qu’elle se forge au XVIIe-XVIIIe siècle, mais en supposant toutefois
une prise de distance critique radicale par rapport à l’opinion commune ou opinion du peuple.
Ces deux modèles majeurs (entre lesquels il convient de glisser certaines considérations plus
isolées, comme celles de Locke que nous reprenons plus loin) confirment toutefois la
difficulté d’une approche à la fois philosophique et « positive » de l’opinion commune, c’est-
à-dire d’une approche de l’opinion commune pour elle-même, pour le jugement qu’elle
produit, puisqu’ils supposent, dans un cas l’entremise d’une institution, le censeur, fût-il là
pour seulement donner un nom au regard que le commun porte sur lui-même, et dans l’autre
cas celle d’une prise de distance critique.
Or, comme on le verra, dans cette histoire souterraine, la place de Montaigne est tout à fait
surprenante. De même qu’il ne cesse d’affirmer à la fois la force et la vanité du souci de la
renommée, on remarquera d’une part qu’il objective fortement l’idée d’opinion commune, en
développant de véritables analyses de la question de l’opinion, en envisageant cette question
2
Pour laquelle je me permets de renvoyer à mon article « Le regard du censeur et la naissance de la statistique à
la fin de la Renaissance », in : Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXIV/2, Genève, 2002, p.317-326.
3
Cicéron définit le jugement du censeur par la seule « rougeur » [ruborem] qu’elle provoque : ce jugement
n’agissant que sur le « (re)nom » [in nomine], son verdict est l’ignominia (Rep. IV, vii). A l’époque de
Montaigne, Jean Bodin (Les six livres de la République, VI, 1) et Juste Lipse (Les Politiques, IV, 11) reprendront
cette idée.
4
Et qui sera de surcroît chargé non seulement à Rome, mais plus clairement encore lors de sa revivification
« théorique » à la fin de la Renaissance (Bodin, Lipse, Althussius, Montchrétien), de la première tentative
explicite de quantification du politique (dénombrer les biens et les personnes) donnant ainsi une assise très
morale à notre statistique moderne.

3
en relation étroite avec celle du commun et peut-être même celle de la communauté politique
(dont on sait qu’elle ne se fonde pas dans la justice) ; d’autre part qu’il dénie le peu de
réflexivité attribué auparavant, même si de manière sporadique, au commun. Donc à la fois
l’opinion commune acquiert une véritable consistance, mais en même temps elle se révèle
essentiellement passive. Je vais parcourir les différentes considérations de Montaigne sur
l’opinion commune, sans chercher à les harmoniser ou à dépasser les tensions dont elles
témoigneront entre elles.
I. Négativité de l’opinion commune.
Avant tout, l’opinion commune se définit très banalement de manière négative, comme
n’étant pas « juger librement des choses » (Essais, I, 23, p.117), comme n’étant pas « l’ordre
du cours de nature » (Essais, I, 27, p.179). Elle se mêle intimement à la coutume dont on croit
« desraisonnablement » qu’elle est la raison, car elle forge les « loix de la conscience »
(Essais, I, 23, p.114). La question des cannibales ou des barbares doit être jugée « par la voye
de la raison, non par la voix commune » ou en s’attachant « aux opinions vulgaires » (Essais,
I, 31, p.200). Ou encore, juger par « la voix du peuple » (au même titre que « par la race, les
richesses, la doctrine ») s’oppose à « juger par justice, et […] par raison », et est considéré
comme hasardeux et comme ne permettant pas d’établir « une parfaite forme de police »
(Essais, III, 8, 911). A première vue, nous ne serions donc pas loin du projet cartésien d’une
politique de la raison, qui se méfie plus de l’opinion que de l’erreur. Cependant, et ce projet
ne peut dès lors que s’effriter, toutes les lois semblent se réduire à « cette mer flotante des
opinions d’un peuple ou d’un prince » et appartiennent dès lors au registre changeant de la
« passion » (Essais, II, 12, p.563) : comme annoncé, si le registre de l’opinion se définit donc
négativement, il semble néanmoins difficile de lui échapper.
II. Vanité de l’opinion commune.
L’opinion commune doit aussi s’entendre comme réputation, comme renommée, comme
fama. Au moins trois Essais sont consacrés explicitement à la vanité qu’il y a de régler sa vie
et ses actions sur la renommée ou sur le souci de l’opinion commune, trois essais qui
s’élaborent selon un même mouvement, et sur la base d’une même source.

4
De ne communiquer sa gloire (Essais, I, 41) définit « le soing de la reputation et de la gloire »
comme la « plus universelle » des « resveries du monde », qui nous fait oublier « les
richesses, le repos, la vie et la santé, qui sont biens effectuels et substantiaux, pour suyvre
cette vaine image et cette simple voix qui n’a ny corps ny prise » (p.248) : l’opposition qui se
dessine ici permettrait d’écarter le souci de l’opinion commune, au nom du caractère
absolument vide de cette dernière, et ce au profit de biens effectivement plus substantiels. La
gloire ou la renommée ne sont qu’une « voix », c’est-à-dire un mot, terme communément
employé par exemple dans le cadre de la querelle des universaux pour désigner les mots, qui
comme les genres, les espèces ou les noms, sont des entités purement mentales.
Dans De la vanité (Essais, III, 9), Montaigne affirme que « vivre par la relation à autruy, nous
faict beaucoup plus de mal que de bien. Nous nous defraudons [trompons, frustrons] de nos
propres utilitez pour former les apparences à l’opinion commune. Il ne nous chaut pas tant
quel soit nostre estre en nous et en effaict, comme quel il soit en la cognoissance publique »
(p.932). La « cognoissance publique », vis-à-vis de laquelle on ne peut entretenir qu’une
relation d’apparence, s’oppose cette fois à la réalité de « nostre estre », une réalité qui
supposerait au contraire un retour en nous.
Surtout, dans De la gloire (Essais, II, 16, 601), Montaigne poursuit et développe cette
opposition entre le vide de l’opinion commune et la réalité de notre être propre : il dit suivre
les philosophes cyniques en affirmant son « mespris de la gloire » et des « voluptez » liées à
« l’approbation d’autruy » : la gloire ne justifie « pour elle seule » pas la moindre action. Et
au même titre que la réalité de l’être réclamait plus haut un retour vers le soi, le souci du
regard d’autrui doit être écarté dans la mesure où il serait en tant que tel l’objet du souci.
Cependant, nuance Montaigne, en recréant ainsi de l’extériorité, la gloire « tire souvent à sa
suite plusieurs commoditez pour lesquelles elle se peut rendre desirable » (p.602) ; si on ne
peut la désirer pour elle-même, elle n’en est pas moins désirable. Il ne faut, comme le
conseille Epicure « regler aucunement ses actions par l’opinion ou reputation commune, si ce
n’est pour éviter les autres incommoditez accidentales que le mespris des hommes luy
pourroit apporter » (p.603). Outre le fait que le souci de la gloire signifierait logiquement qu’il
ne « faudroit estre vertueux qu’en public » (p.604), il s’agit surtout d’un but bien trop
hasardeux, « car qu’est-il plus fortuite que la reputation ». Seule la fortune peut décider « que
les actions soient connuës et veuës » (p.605). C’est « une fin si flotante et vagabonde »

5
(p.608)
5
. Ensuite, « la vanité des jugemens humains » ne peut servir de « loyer » pour « les
actions de la vertu » (p.612).
Mais ce n’est pas là seulement pour Montaigne une question pratique (le caractère aléatoire
du regard de l’opinion commune), ni une question morale (la juste mesure de la vertu) : à un
niveau plus ontologique, « agrandir nostre nom » (p.609) ne se conçoit pas, parce que, nous
dit Montaigne « je n’ay point de nom qui soit assez mien » (p.610). Le chapitre débute par ces
mots : « Il y a le nom et la chose ; le nom, c’est une voix qui remerque et signifie la chose ; le
nom, ce n’est pas une partie de la chose ny de la substance, c’est une piece estrangere joincte
à la chose, et hors d’elle » (p.601).
6
La source des considérations de Montaigne sur la gloire et sur le nom est évidemment La
théologie naturelle de Raymond Sebon, qu’il déthéologise cependant sans scrupule pour s’en
servir dans une perspective strictement nominaliste : chez Sebond (chap. 189-199), seul Dieu,
comme premier principe, mérite la gloire. Alors que l’homme, vu son imperfection, ne peut
augmenter qu’au dedans et doit chercher cette augmentation, Dieu, comme perfection, ne peut
augmenter qu’au dehors. Et la gloire, ou l’agrandissement du nom, pour reprendre les mots de
Montaigne, n’entrent pas au dedans de la chose ; il s’agit seulement d’un accident extérieur
aux choses, puisque l’homme peut faire croître Dieu, extérieurement, par ses louanges et
opinions. Glorifier Dieu est une obligation pour l’homme (il y a une sorte d’échange entre
l’agrandissement extérieur de Dieu et l’agrandissement intérieur de l’homme), tandis que
chercher la gloire est à la fois une inanité (elle est qualifiée de « vide », etc.) et une offense à
Dieu.
Ce qui subsiste de ce raisonnement théologique chez Montaigne est le fait que le souci de la
renommée publique, la recherche de la « gloire pour elle seule » nous enferme dans le registre
déraciné de la « simple voix », de la « vaine image », de la « piece estrangere »… un registre
purement mental, ou verbal, langagier qui débouchera en d’autres lieux, c’est-à-dire dans la
critique par Montaigne de la glose juridique
7
, sur ce qu’il considère comme un pur
5
Ici, il faut noter combien Montaigne s’écarte d’une tradition qui présente l’opinion publique, du censeur à la
loi de l’opinion chez Locke (voir plus loin), comme ce à quoi rien n’échappe, contrairement à la loi.
6
Des noms (Essais, I, 46) et De la vanité des paroles (Essais, I, 51) confirment bien sûr cette perspective
nominaliste.
7
A ce sujet, et pour tout ce qui a trait à la question de la loi et de l’autorité chez Montaigne, je me permets de
renvoyer à mon livre Violence de la loi à la Renaissance. L'originaire du politique chez Machiavel et Montaigne,
Kimé, Paris, 2000.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%
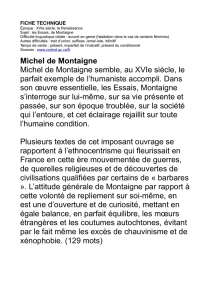


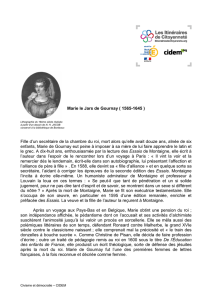

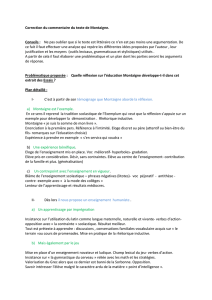
!["Les auteurs" [ / 33.06 Ko]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002766794_1-066a78493fb2577980249b334dcf04ce-300x300.png)