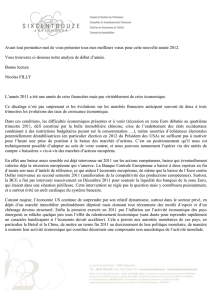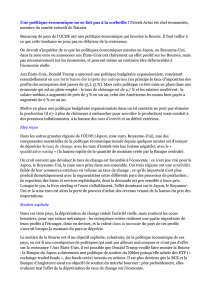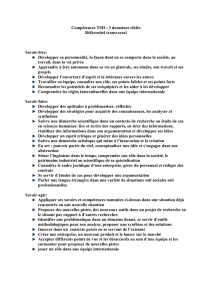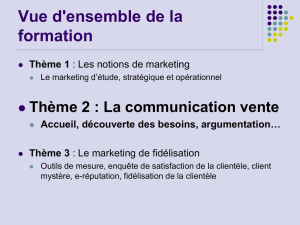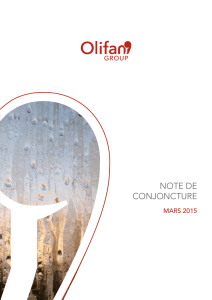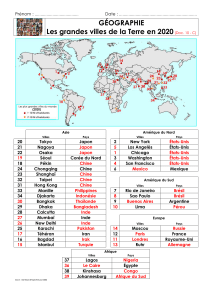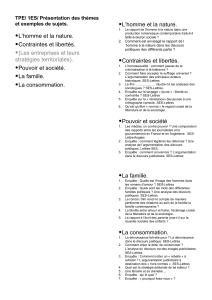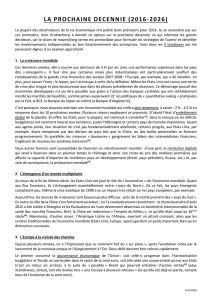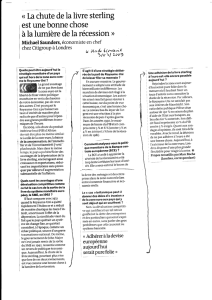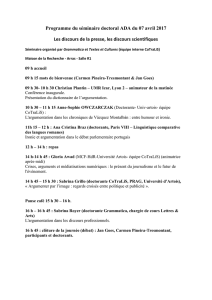DEVOIR SURVEILLE N°1 Date : 5 octobre 2013 Classe : TES

DEVOIR SURVEILLE N°1 Date : 5 octobre 2013 Classe : TES
(4 heures)
EPREUVE COMPOSEE
Cette épreuve comprend trois parties.
1- Pour la partie I (Mobilisation de connaissances), il est demandé au candidat de répondre aux
questions en faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre de l’enseignement obligatoire.
2- Pour la partie 2 (Etude de document), il est demandé au candidat de répondre à la question en
adoptant une démarche méthodique rigoureuse de présentation de document, de collecte et de traitement de
l’information.
3- Pour la partie 3 (Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au
candidat de traiter le sujet :
- en développant un raisonnement ;
- en exploitant les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;
- en composant une introduction, un développement, une conclusion.
PARTIE 1 : Mobilisation de connaissances 6 points
1) Présentez le lien entre productivité globale des facteurs et progrès technique. (3 pts)
2) Comment peut-on expliquer les fluctuations économiques ? (3 pts)
PARTIE 2 : Etude d’un document 4 points
Après avoir présenté le document, vous comparerez les évolutions de l’activité
économique dans les différentes zones géographiques.
Croissance annuelle du PIB en volume entre 1999 et 2012 (en %)
Moyenne annuelle
1999-2008
2009
2010
2011
2012
(Prévisions)
Monde
3,8
-1,2
5,0
3,8
3,4
Etats-Unis
2,5
-3,5
3,0
1,7
2,0
Zone euro
2,1
-4,2
1,8
1,6
0,2
Japon
1,2
-6,3
4,1
-0,3
2,0
Source : Perspectives économiques de l’OCDE, n°90, 2011.

PARTIE 3 : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)
A l’aide du dossier documentaire et de vos connaissances, vous montrerez
comment les institutions publiques sont des acteurs de la croissance.
Document 1 : Les dépenses intérieures de la recherche et développement publique (en millions
d’euros courants)
1992
2007
2008
20091
Etat et collectivités territoriales
5 400
6 427
6 564
6 986
Enseignement supérieur2
3 945
7 663
8 228
8 845
Source : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, septembre 2011.
1. Les données de 2009 sont semi-définitives.
2. Dans les statistiques sur la recherche et développement, on distingue l’Etat de l’enseignement supérieur, qui
comprend les universités et les établissements publics d’enseignement supérieur le CNRS, les centres
hospitaliers universitaires et les centres de lutte contre le cancer. Mais, pour les deux, le financement est public.
Document 2 :
Source : D’après SES terminale, Hatier, 2007.
T.S.V.P

Document 3 :
Dans les pays développés, on a tendance à considérer les droits de propriété comme une évidence ; les
habitants des pays les moins développés savent que l'absence de droits de propriété pose de sérieux
problèmes. En outre, dans de nombreux pays, le système judiciaire est peu efficace : les contrats sont
rarement respectés, la fraude demeure impunie. Dans les situations extrêmes, le gouvernement est non
seulement incapable de faire respecter les droits de propriété, mais il ne les respecte pas lui-même.
Pour pouvoir opérer dans certains pays, les entreprises doivent verser des dessous-de-table aux
représentants des gouvernements. Cette corruption freine le bon fonctionnement des marchés,
décourage l'épargne locale et l'investissement étranger.
Gregory Mankiw, Principes d'économie, Economica, 1998.

CORRECTION DU DS n° 1 DU 5 OCTOBRE 2013
PARTIE 1 :
Q1 : Les éléments qui contribuent à la croissance économique sont essentiellement les facteurs
de production, à savoir le travail et le capital.
● Dans le cas d'une croissance extensive, c'est l'augmentation des quantités de travail et de
capital qui explique l'augmentation proportionnelle de la richesse économique produite.
Cependant, dans le cas d'une croissance intensive, la combinaison des facteurs travail et capital
ne suffit pas pour expliquer la croissance économique.
● La part de la croissance non expliquée par les contributions respectives du travail et du capital
est la productivité globale des facteurs. Celle-ci serait essentiellement due au progrès
technique, c'est-à-dire l'ensemble des innovations qui accroissent la production sans augmenter
les quantités de facteurs, voire en les économisant.
Ainsi, la mise en œuvre de nouvelles méthodes de production ou une nouvelle organisation
du travail permet des gains de productivité, soit une augmentation de la productivité globale des
facteurs.
Q2 : Les fluctuations économiques représentent les mouvements de la croissance économique.
Celle-ci peut connaître des phases d'accélération (expansion) ou de ralentissement (récession),
voire même de dépression si la production baisse durablement. Elles peuvent s'expliquer par des
chocs d'offre et de demande ainsi que par le cycle du crédit.
• La croissance économique peut être affectée par des chocs d'offre et de demande. Dans le
premier cas, les conditions de la production se trouvent modifiées. C'est le cas lorsque le prix des
facteurs de production (salaires, prix des matières premières) évolue. Ainsi, une hausse de ces
prix provoque un choc d'offre négatif et ralentit la croissance. Ce ralentissement peut être
également dû à un choc de demande négatif : baisse des investissements, de la consommation ou
des exportations. À l'inverse, des chocs d'offre et de demande positifs impliquent une
accélération de la croissance qualifiée d'expansion.
• Les variables financières ont également des effets sur les fluctuations économiques. Ainsi, en
période d'expansion, les agents économiques s'endettent et ont des comportements spéculatifs.
La valeur des titres financiers augmente, provoquant une bulle financière qui finit par éclater et
provoquer un krach financier. Dès lors, l'activité économique ne peut plus être financée. C'est ce
qui génère une récession, et parfois une dépression, comme c'est le cas aujourd'hui dans certains
pays de l'Union européenne.
La succession de périodes d'expansion et de récession, constituant les fluctuations
économiques, s'explique par des chocs d'offre et de demande ainsi que par le cycle du crédit.
PARTIE 2 :
Introduction
Ce document est un tableau statistique, publié par l’OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques) en 2011, présente des taux de croissance économique annuels en
pourcentage, sur 2009-2012, ainsi que le taux de croissance annuel moyen (TCAM) en
pourcentage sur la période 1999-2008. Ces données concernent deux pays (Etats-Unis et Japon),
la zone euro et le monde dans son ensemble.
Développement
• Pour chaque ensemble étudié, la croissance annuelle est positive pour la période 1999-2008, ce
qui témoigne d'une augmentation des stocks de richesses créées dans les différentes zones. Il
existe cependant d'importantes disparités entre les zones étudiées.

Les États-Unis connaissent une croissance supérieure de 0,4 % à celle de la zone euro, et l'on
constate qu'elle est deux fois plus élevée que celle du Japon. La croissance mondiale est
supérieure de 1,3 % à celle des États-Unis, cette différence s'expliquant par la forte croissance
des pays émergents, notamment le Brésil, l'Inde et la Chine, véritables moteurs de l'activité
économique mondiale.
• L'année 2009 marque une rupture pour toutes les zones, suite à la crise des subprimes venue
des États-Unis. Le recul de la production de biens et services est alors général. Les économies
développées sont alors davantage touchées que l'ensemble du monde, le Japon connaissant
même un recul (- 6,3 %) supérieur de 2,1 % à celui de la zone euro et de près de 3 % à celui des
États-Unis.
• Les chiffres de l'année 2010 témoignent d'un véritable sursaut pour la croissance économique
par rapport à 2009. L'année 2011 marque un nouveau coup d'arrêt pour les pays de la Triade qui
connaissent une croissance molle (États-Unis, zone euro) voire négative pour le Japon en raison
des conséquences de l'accident nucléaire survenu à Fukushima. L'économie mondiale renoue
quant à elle avec le rythme qui était le sien entre 1999 et 2008.
• Enfin, les prévisions pour l'année 2012 pointent le déficit de croissance de la zone euro par
rapport aux autres zones étudiées. Si la croissance mondiale prévue reste élevée (3,4 %), et que
les prévisions pour les États-Unis et surtout le Japon prévoient une légère progression pour les
premiers et un retour de la croissance pour le second, la zone euro semble s'engager dans la voie
de la récession avec un modeste 0,2 %. La crise de la dette dans nombre de pays européens et les
difficultés des pays de cette zone à s'entendre pour proposer des solutions permettant une sortie
de crise pérenne sont à l'origine de ces prévisions pessimistes.
Conclusion
Après la croissance moyenne honorable du début des années 2000, la crise des subprimes a
constitué un coup d'arrêt pour l'économie de l'ensemble de la planète. Si les États-Unis, le Japon
et plus globalement l'ensemble de l'économie mondiale semblent repartir de l'avant depuis, la
zone euro reste engluée dans une croissance faible, source de chômage et de tensions ins-
titutionnelles.
PARTIE 3 :
Introduction
L'innovation est au cœur de la croissance économique. Selon J. Schumpeter, l'entrepreneur-
innovateur est le principal agent qui favorise l'innovation. Cependant, les institutions publiques
jouent un rôle important, à la fois en créant un environnement favorable à l'innovation et en
l'encourageant.
1. Le rôle des institutions publiques dans l'innovation
• L'innovation constitue, pour l'ensemble de l'économie nationale, une externalité positive, c'est-
à-dire qu'elle profite à l'ensemble des agents économiques sans que ceux-ci aient à rétribuer
l'agent innovateur.
• Elle est le produit du processus de recherche et développement qui nécessite un financement
important dont la rentabilité peut être faible, voire nulle. C'est pourquoi les pouvoirs publics
financent une part non négligeable de ce processus. Entre 1992 et 2009, les dépenses de
recherche et développement de l'État et des collectivités territoriales ont été multipliées par 1,3
environ (doc 1).
• Durant la même période, ce sont les dépenses consacrées à l'enseignement supérieur, - que l'on
distingue dans les statistiques de la recherche et du développement - qui ont le plus fortement
augmenté : elles ont plus que doublé (doc 1). Ce financement public permet surtout de financer
la recherche fondamentale, étape qui précède, dans le processus de recherche et développement,
la recherche appliquée, puis la construction d'un prototype aboutissant enfin à l'innovation.
Cependant, la recherche implique des chercheurs ayant un niveau de formation élevé et
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%