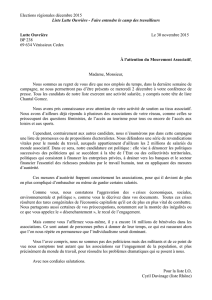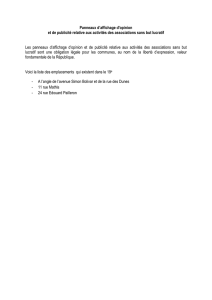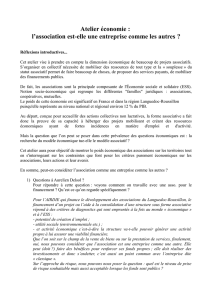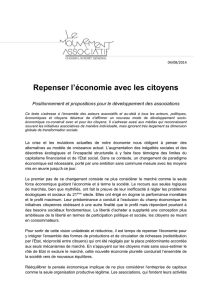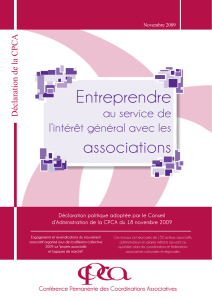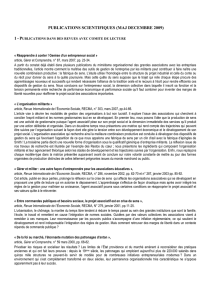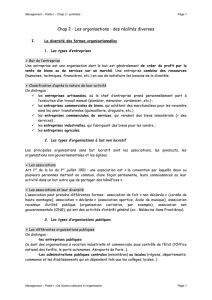Haut du formulaire Bas du formulaire Haut du formulaire Bas du

Quand des associations «entrent en
économie»
Maurice Parodi
Décembre 2000
Les associations gestionnaires, qui exercent une activité économique repérable,
ont connu depuis un quart de siècle un développement exceptionnel, d’abord lié à la
multiplication des politiques publiques, en particulier des politiques sociales (action
sociale, éducation et formation, culture, loisirs, activités sportives...). Les politiques
économiques ont suscité le développement associatif sur le terrain de l’emploi, de
l’aménagement, de l’environnement, du développement local, etc [1]. Mais les
associations gestionnaires se sont aussi développées de manière plus autonome : dès les
années 50, les grands mouvements associatifs caritatifs ou humanitaires et, par la suite,
les grandes Ong de développement du tiers monde.
Ainsi, les questions sur ces associations qui « sont entrées en économie » ou ces «
entreprises associatives » ne concernent pas seulement leurs rapports avec le secteur
privé marchand et la logique de marché. Elles soulèvent aussi, dans la plupart des cas, la
question des rapports avec les pouvoirs publics à l’échelon local, national et européen. Les
associations gestionnaires sont situées diversement dans un espace délimité par un axe
social-économique et un axe privé-public. Ces deux axes définissent schématiquement
quatre types d’associations gestionnaires. Cette présentation en quadrants peut occulter
les nombreux cas d’interférence entre types d’activité et de situation à l’intérieur d’une
même association. Ce chevauchement traduit l’ambivalence de la plupart des associations
gestionnaires. Après avoir précisé les termes du débat, nous aborderons une série de
questions qui s’emboîtent : les entreprises associatives sont-elles des entreprises comme
les autres ? Y a-t-il un management spécifique des associations ? Peut-on concilier
contraintes gestionnaires, logique économique et « spécificités méritoires » des
entreprises associatives ?
Le poids des « associations gestionnaires »
Il n’existe pas de définition réglementaire ou juridique des « associations gestionnaires »,
L’observation empirique amène à distinguer au moins deux grands types d’associations :
des associations plus ou moins professionnalisées et gestionnaires de moyens, d’une part,
et des associations de type militant, d’autre part. Une association gestionnaire grande ou
petite exerce une activité économique. Elle participe au circuit économique : au flux de
production de biens et services échangés sur divers types de marché, ainsi qu’au flux de
revenus qui en est la contrepartie. Elle participe aussi au circuit financier par la gestion de
son budget, de sa trésorerie, par ses placements financiers et ses emprunts.
Peu d’associations, cependant, exercent une activité économique dans le secteur
concurrentiel marchand. Il faut distinguer entre « logique gestionnaire » qui peut jouer
dans toute forme d’organisation (à but lucratif ou sans but lucratif) et logique de marché.
De même, la logique économique ne se réduit pas à la seule logique de marché. Les
acteurs de l’économie sociale et solidaire [2] ne disent pas autre chose en revendiquant la
juste place des associations dans une « économie plurielle ». Des définitions des

associations gestionnaires ou des « entreprises associatives » ont été proposées dans les
années 80 dans la foulée de l’institutionnalisation d’un secteur de l’économie sociale
(l’expression se substituant avantageusement à l’appellation de tiers secteur) ; et les
associations gestionnaires sont formellement reconnues comme l’une des trois
composantes du secteur, à côté de la coopération et de la mutualité.
Grâce aux fichiers de l’Insee, on connaît le volume de l’emploi associatif, sa taille et son
budget, les sources de financement, la contribution du bénévolat, etc [3].
Le nombre d’emplois salariés, le « chiffre d’affaires », le nombre de bénévoles soulignent
combien le poids du secteur associatif est considérable : 1 300 000 salariés (800 000 en
équivalents plein temps), 217 milliards de francs de budget annuel (hors comptabilisation
du bénévolat), près de 600 000 emplois de bénévoles en équivalents plein temps. On peut
aussi en évaluer le poids économique global en intégrant la valeur monétaire du travail
bénévole ; il représente 74 milliards de francs [4], soit un quart de l’ensemble des
ressources du secteur sans but lucratif, et neuf fois le montant total des dons. Au total, le
secteur associatif pèserait donc 291 milliards de francs [5]. Il apparaît très concentré
autour des plus grosses associations gestionnaires des quatre secteurs dominants : les
services sociaux, l’éducation et la recherche, la santé, et la culture, les sports et les loisirs.
Ceux-ci représentent à eux seuls 86 % des dépenses courantes du secteur associatif, 90 %
de l’emploi et 70 % du travail bénévole.
Le domaine des services sociaux est le plus important : 42 % du budget cumulé du secteur
associatif et 38,5 % de l’emploi total, soit 300 000 personnes (le même effectif que
l’industrie automobile). En outre, si 85 % des 750 000 associations existantes n’ont aucun
salarié et échappent donc à la catégorie des associations gestionnaires, elles ne gèrent que
15 % du budget total cumulé du secteur associatif. 15 %, à l’inverse, ont la qualité
d’employeur et donc celle de gestionnaire, selon le critère de l’emploi salarié ; elles gèrent
aussi 85 % du budget total du secteur associatif. Les 7 000 plus grandes réalisent 43 % de
ce budget et reçoivent 70 % de l’ensemble des financements publics locaux et nationaux
destinés aux associations. Cependant, l’ancienneté de ces estimations et les nombreuses
créations laissent supposer une sous-évaluation de ces chiffres.
« L’entreprise associative »
L’entreprise est un concept économique beaucoup plus qu’une notion juridique.
Cependant, de nombreux textes législatifs ou jurisprudentiels, du droit du travail au droit
fiscal, se réfèrent concrètement à l’entreprise individuelle et à l’entreprise collective
propriété d’une personne morale qui peut être une société ou toute autre forme de
groupement dont l’association. D’ailleurs, des lois, comme celles du 1er mars 1984 et du
25 janvier 1985, ont pratiquement assimilé le traitement appliqué aux associations
exerçant des activités économiques, à celui du droit commun, en matière de prévention
des difficultés des entreprises, de redressement, de liquidation judiciaire.
Mais si l’on se réfère au discours économique, ce sont bien les théories économiques
fondées sur le paradigme de l’individualisme qui ont forgé le concept de l’entreprise à
partir de celui de l’entrepreneur individuel. Les théoriciens modernes de la « gouvernance
d’entreprise », qui placent en tête des critères du bon management la profitabilité
optimale des capitaux investis ou la recherche de « valeur » au profit exclusif des
actionnaires des grandes sociétés et de leurs groupes, se sont efforcés de réhabiliter le
dogme individualiste.

Parler d’entrepreneur associatif est un certain abus de langage... A la question posée aux
responsables ou managers associatifs : « L’entreprise associative est-elle une entreprise
comme les autres ? », beaucoup répondent en parlant de « quasi-entreprise [7] ». Elles
présentent les formes d’organisation productive de l’entreprise mais appartiennent à la
catégorie des organisations sans but lucratif. Elles se distinguent fondamentalement à ce
titre du modèle classique de l’entreprise et de l’entrepreneur « capitalistes ».
Le principe de non-lucrativité est clairement formulé dans l’article 1 de la loi de 1901 : il
désigne l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances et leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices ». La loi, la réglementation fiscale et la
jurisprudence se sont efforcées de préciser les conditions d’application de ce principe
général. La dernière instruction fiscale (1998-1999), entrée en application en 2000,
affirme d’abord le principe d’exonération pour les organismes réputés sans but lucratif
(associations, fondations, congrégations) et détermine clairement la démarche
d’appréciation du caractère lucratif des activités associatives en trois étapes :
La gestion de l’association est-elle désintéressée (au regard du non-partage des excédents)
? L’association concurrence-t-elle une entreprise ? L’association exerce-t-elle son activité
dans des conditions similaires à celle d’une entreprise, ce qui renvoie à la règle des «4 P»?
Pour établir si une association doit être assujettie à l’impôt, la circulaire a fixé quatre
critères d’appréciation. Ceux-ci sont examinés selon un ordre décroissant d’importance.
Le produit : l’activité est considérée comme d’utilité sociale si elle tend à satisfaire « un
besoin non pris en compte par le marché ou de façon peu satisfaisante », en particulier
lorsqu’elle bénéficie d’un agrément de la part des administrations publiques.
Le public : pour être d’utilité sociale, les actes payants de l’organisme doivent être réalisés
principalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de
leur situation économique et sociale.
Le prix : il s’agit d’évaluer si les efforts pour faciliter l’accès au public se distinguent de
ceux des entreprises, notamment par un prix inférieur découlant logiquement de la
participation des bénévoles.
La publicité : un recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité, mais
ne seront pas considérées comme tels les appels à la générosité du public et les actions
d’information sur les services rendus.
Cette règle donne les critères d’appréciation du caractère éventuellement lucratif par
l’administration des impôts, ainsi que des repères essentiels pour définir les « spécificités
méritoires [8] » d’une association par rapport aux entreprises commerciales du secteur.
Le principe de non-lucrativité n’exclut ni la réalisation d’excédents, d’ailleurs nécessaires,
ni l’intéressement du personnel salarié, dans le cadre des lois en vigueur.
Un management spécifique ?
Importé du monde anglo-saxon, le mot « management » s’est substitué peu à peu aux
expressions de gestion ou d’administration des entreprises. Mais l’expression plus récente
de « gouvernance de l’entreprise » a déteint à son tour sur le concept. Ce principe

s’impose aujourd’hui comme une règle d’or du management des grandes entreprises. Or
le principe de création de « valeur » optimale au bénéfice exclusif des actionnaires est par
essence non transposable à la gouvernance des entreprises associatives.
Sous cette réserve capitale, la gestion d’une entreprise associative aura beaucoup
d’analogies avec celle d’une entreprise commerciale. Toutes sont soumises aux mêmes
rigueurs et aux mêmes règles de gestion comptable et financière. Le système comptable
des associations et les règles de vérification et de contrôle se sont beaucoup rapprochés de
ceux des entreprises commerciales. La présentation formelle du bilan comporte quelques
spécificités (pas de capital social par exemple) ; toutefois, une association gestionnaire
doit disposer de capitaux propres et d’un fonds de roulement net en rapport avec le
volume de son activité. La gestion de sa trésorerie subit les mêmes contraintes que
n’importe quelle entreprise. Les délais de règlement des « clients » particulièrement longs
(notamment les administrations publiques) les soumettent à des problèmes particuliers
pour gérer leurs découverts bancaires récurrents. Les plus fortunées doivent avoir une
stratégie de placements financiers.
Dans deux autres domaines de la gestion, les associations marquent leurs différences :
Dans la gestion commerciale ou le marketing, tout d’abord. L’expression « marketing
social » est un abus de langage. La jurisprudence établit une distinction entre, d’une part,
les moyens de communication et d’information que se donne toute association pour faire
connaître son objet social et ses activités à ses adhérents actuels et potentiels ou à ses
usagers et, d’autre part, les pratiques de publicité commerciales. Un bon système
d’information et de communication interne, vis-à-vis des adhérents, des salariés et des
tiers (usagers, partenaires privés, commanditaires publics, donateurs, etc.) est d’ailleurs
la condition première de la transparence.
Mais les spécificités les plus manifestes résident dans la gestion des ressources humaines.
Certes, les associations sont soumises aux règles communes du droit du travail. Leur non-
respect, encore trop fréquent, traduit le comportement archaïque de « dirigeants »
paternalistes ou autocrates. Mais d’autres relations se nouent entre employeurs et salariés
(et leurs organisations). Les responsables souhaitent associer toutes les parties prenantes,
non seulement les adhérents et bénévoles mais aussi les collaborateurs salariés. A cet
égard, les relations sociales se devraient d’être exemplaires dans le cadre des associations
gestionnaires, comme dans les autres formes d’entreprise de l’économie sociale
(coopératives et mutuelles).
Pourtant, la spécificité de la gestion des ressources humaines est ici de combiner le travail
salarié et l’activité bénévole des adhérents, des militants et éventuellement des usagers.
Si, dans les associations les plus professionnalisées, notamment dans les services sociaux,
la formation, le tourisme social, etc., les bénévoles ne participent pratiquement plus à la
production directe des services, on les retrouve dans les fonctions d’administrateurs et les
fonctions « politiques » d’élaboration et de contrôle du projet associatif.
Henri Desroche avait schématisé ces relations complexes dans un quadrilatère aux quatre
angles duquel se trouvent les managers, le Président et les administrateurs, les salariés, et
enfin les adhérents ; tous peuvent être reliés par les côtés et par les diagonales... Certains
cas de figure se révèlent préjudiciables à l’efficacité ou l’efficience de l’organisation, ou à
la finalité même de l’association : coalition des managers et salariés contre le président,
les administrateurs et les adhérents ; alliance exclusive du directeur et du président,
caractéristique d’une gestion technocratique et autocratique ; ou plus banalement

(notamment dans les grosses associations « ruminantes [9] ») une fracture entre les
salariés et les autres parties prenantes, etc. Une bonne gestion des ressources humaines,
dans les associations « entrées en économie », réussirait à relier les quatre pôles du
quadrilatère dans une combinaison favorable à l’efficacité de l’organisation et
respectueuse de ses finalités sociales.
Mais plus une association gestionnaire se professionnalise, ou plus grande est sa taille et
plus difficile sera la mise en œuvre d’un modèle démocratique. Alors le modèle de gestion
technocratique (confiscation du pouvoir par les managers salariés) tend souvent à
prévaloir. En effet, dans les associations les plus directement confrontées à la concurrence
dans le secteur marchand, mais aussi dans celles, très professionnalisées, à financement
public du secteur social, les salariés, notamment les cadres, ont légitimement des
motivations et des stratégies de promotion individuelle proches de celles des salariés du
secteur privé lucratif ou du secteur public.
S’esquisse ici une diversité de combinaisons possibles entre motivations ou intérêts
individualistes des salariés et intérêt collectif ou nature sociale de l’association.
Les accords conclus pour la mise en œuvre de la loi sur les 35 heures font apparaître
différents types de compromis selon les secteurs d’activité, le degré d’exposition à la
concurrence, le niveau de professionnalisation, la taille des associations, etc. Les
négociations ont révélé parfois la nécessité ou l’opportunité de déboucher à terme sur un
changement de statut : passage du statut associatif à celui de société coopérative de
production, ou société commerciale de droit commun.
L’association gestionnaire et la logique du marché
Le type de concurrence française et européenne que rencontre une association engagée
sur des « créneaux » exposés du secteur marchand (tourisme social, formation
professionnelle, certains services de proximité, etc.) n’est pas du même ordre que celui
d’une association de service social dans le secteur non marchand.
L’article 58, alinéa 2, du traité de Rome stipule que bénéficient du droit d’établissement
et, parallèlement, du droit de libre prestation de services « les sociétés de droit civil et
commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit
public ou privé, à l’exception de sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif ». A
première vue, les associations sont donc en dehors du traité. Pourtant, l’interprétation de
la notion de « but lucratif » a conduit les autorités communautaires à conclure qu’un très
grand nombre d’associations développaient des activités économiques entrant dans le
champ du traité. « Elles sont donc aussi justiciables de tout le droit de la concurrence
européen postulant la non-discrimination, l’égalité de traitement, la transparence, la
reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et visant les “mauvaises” ententes, les abus
de position dominante, les pratiques anticoncurrentielles, les monopoles, les ventes
sélectives, le bénéfice d’aides publiques, etc. [10] »
La Cour de Justice des Communautés européennes a introduit cependant dans le droit
communautaire une différence de traitement entre organismes privés selon qu’ils
poursuivent ou non un but lucratif, sur un même segment de marché. En invoquant le
principe de subsidiarité qui prévaut dans le champ des politiques sociales, elle a rejeté le
recours posé par la société Sodemare pour deux de ses filiales italiennes, des organismes à
but lucratif gérant des résidences pour personnes âgées, qui demandaient à bénéficier du
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%