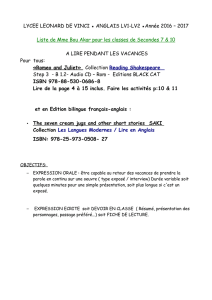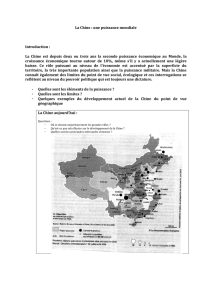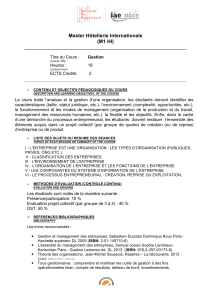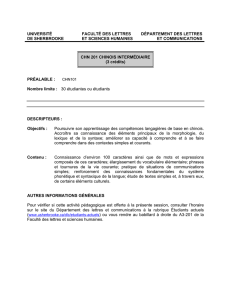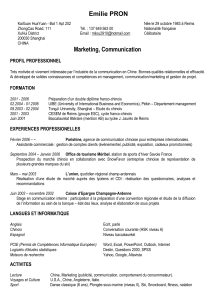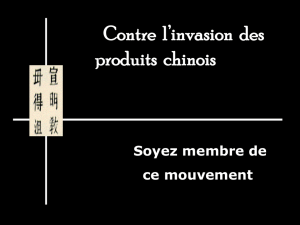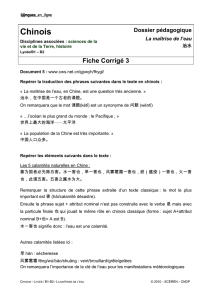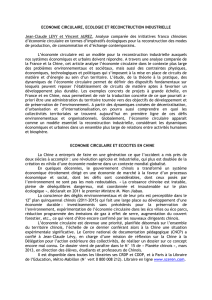La Chine ,un nouvelle eldorado

La Chine ,un nouvelle eldorado économique. Quelle
intégration professionnel pour les occidentaux migrant en
Chine ? seulement si l on est préparer aux chocs culturelles
Travailler en Chine
La Chine n’est pas un pays mais un monde à part : 1,4 milliard d’individus avec une culture et
des règles sociales propres, héritées du confucianisme, du taoïsme et des structures impériales.
Un monde qui, pour un occidental, peut être rempli de contradictions et de chausse-trapes.
Consultante du cabinet Intervenance isalariat et enseignant-chercheur à l’université Paris V,
Pascale Reinhardt conseille les cadres qui partent à l’assaut de l’eldorado économique chinois.
Son leitmotiv ? «En Chine, un seul mot d’ordre : adaptabilité.»
Premiers pas en Chine…
«Sur la Côte Est, les Chinois sont habitués aux comportements et à la manière de vivre
occidentale. Toutefois, des manquements graves aux codes du savoir-vivre chinois risquent de
les froisser durablement». Principal écueil, la rigidité des rapports hiérarchiques héritée de la
célèbre «bureaucratie céleste» impériale. Le respect de l’autorité est absolu, la parole du
supérieur n’est jamais mise en doute. «Les méthodes de management participatif, typiquement
occidentales, sont donc inadéquates : en Chine, un cadre se décrédibilise en demandant son
avis à un subordonné.»
Au quotidien, la culture chinoise est entièrement tournée vers la recherche d’équilibre et de
stabilité. «Pour un Chinois, il est inconcevable de dire non ou même de ne pas répondre à une
question. Ne pas satisfaire les attentes de son interlocuteur, c’est se mettre dans une position
de conflit, incompatible avec l’exigence d’harmonie du confucianisme», explique Pascale
Reinhardt. Une conception des rapports à autrui déstabilisante pour un cadre occidental. Ses
subordonnés préfèreront lui désobéir plutôt que d’exprimer ouvertement leur désaccord, ou
encore lui mentir plutôt que d’avouer leur ignorance… «Face à ces contradictions, surtout ne
jamais céder à l’emportement, ne jamais hausser le ton». La colère est une entorse grave au
contrat social, déshonorante et contre-productive dans une logique managériale de
coopération franco-chinoise.
Premières négociations…
En Chine, l’art de la négociation réside dans la capacité à s’adapter. Selon Pascale Reinhardt,
«les rapports entre partenaires sont extrêmement complexes et fluctuants». Première
difficulté, déchiffrer la trame emmêlée des réseaux d’influence. «Une secrétaire anonyme peut
tout à fait jouer un rôle clé… si elle est un membre influent du Parti». Politique, réseaux
occultes et solidarités familiales… La hiérarchie décisionnaire respecte rarement
l’organigramme apparent de l’entreprise.
«Les Chinois ont une culture de l’adaptation. Le contexte évolue ? Ils adoptent une nouvelle
attitude… et exigent aussitôt une redéfinition des accords» avertit encore Pascale Reinhardt.
L’erreur, pour les Occidentaux, consiste à croire la négociation close avec la signature des
contrats. Accepter la remise en questions de ses schémas personnels est donc la condition sine
qua non d’une collaboration réussie.

Premières relations professionnelles…
«Les Chinois sont capables de déplacer des montagnes. Toutefois, pour mobiliser
efficacement leurs ressources, il faut accepter d’abdiquer ses propres cadres de référence.»
Etape difficile, mais indispensable. Les Chinois acceptent mal qu’on les surveille et qu’on
leur impose de suivre, pas à pas, un raisonnement cartésien. «Les Allemands l’ont mieux
compris que les Français : ils laissent leurs subordonnés libres de leurs méthodes, même si
elles leur semblent moins productives. Essayer de faire pousser des radis en tirant dessus
n’apporte pas des résultats convaincants… (proverbe chinois)».
Reste que le vade-mecum indispensable pour les candidats au départ est de connaître les
rudiments du mandarin. «On n’appréhende jamais mieux une culture qu’en s’appropriant sa
langue. Comprendre l’écriture figurative, c’est déjà admettre le mode de pensée chinois, plus
analogique qu’analytique», ajoute ainsi Pascale Reinhardt.
Spécificités Chine
Qualités nécessaires pour réussir à manager en Chine.
« La Chine n’est pas un pays, c’est un Monde à part, représentant 20% de l’Humanité, avec ses
règles, son Histoire, son mode de pensée, ses non-dits et, avant tout, la Force du Nombre. La
Chine peut fasciner ou faire peur, paraître belle ou inspirer le dégoût, mais, si on se donne la peine
d’essayer d’en découvrir ne serait-ce qu’une petite partie, elle ne peut laisser indifférent. Il faut
donc laisser au placard ses références occidentales, et tout ce qui paraît normal en Occident pourra
induire des montagnes de problèmes en Chine ».
Essayer de faire pousser des radis en tirant dessus n’apporte pas de résultats
convaincants - Proverbe chinois
Prendre du temps
Les Occidentaux, et en particulier les Français, se plient difficilement aux
représentations du monde et aux conceptions spatio-temporelles des Chinois.
Aujourd’hui, seuls le temps passé en Chine et des connaissances culturelles et linguistiques aident
les Français expatriés à dépasser cette contrainte et à atteindre leur efficacité optimale. C’est le
meilleur facteur d’intégration professionnelle en Chine, plus qu’ailleurs ; un minimum de 2 ans
après l’arrivée est indispensable pour obtenir une bonne efficacité.
Se connaître et accepter le point de vue de l’autre
A l’adaptation difficile s’ajoutent des réactions exagérées, naturelles dans un environnement
complexe ou hostile : surgissent alors des comportements peu nuancés, réponse inconsciente à
une situation éventuellement dangereuse. L’adaptation dépendra évidemment de la capacité du
manager à se questionner sur ses propres fonctionnements, ses schémas de représentation, et à
apprendre de ses difficultés : s’interroger, avant de partir, sur ses capacités personnelles à
accueillir des différences de comportement, de management ou de vie quotidienne... et à faire
évoluer ses employés et son management, chinois ou non.
Savoir s’interroger sur son attitude : mesurer à quel point nos croyances peuvent biaiser notre
adaptation. Avoir préparé des arguments et des comportements contre « notre caractère de
missionnaires détenteurs de vérités universelles à propager », « notre prédilection pour l’argutie ».

Faire preuve d’empathie : se mettre à la place de l’autre, le comprendre, pour mieux saisir
l’ensemble des données propres à la relation - sans nécessairement avoir à adopter son point de
vue. Accepter les différences et essayer de mieux les appréhender.
Comprendre sa propre culture du conflit
Une grande partie des personnes interrogées ont confirmé l’impression initiale selon laquelle les
Chinois répugnent au conflit direct et ouvert, réputé socialement inacceptable. Les réactions
individuelles des répondants face à des situations plutôt larvées dépendent de leur personnalité et
de leur capacité à comprendre le point de vue de leur interlocuteur, quelle que soit sa culture. Le
respect de l’harmonie, valeur confucéenne de référence, entraîne une profonde aversion des
Chinois pour les conflits ouverts. Cela se traduit par des jeux indirects, non pas par l’absence de
conflit. Ces données culturelles de base ont des conséquences personnelles et relationnelles
nombreuses pour les Français de l’enquête. Elles sont la principale source de confusion et de
malentendus, qui rendent difficile la communication et compliquent l’harmonie des attitudes. Elles
constituent, pour nombre des personnes interrogées, un frein à l’efficacité de leur travail dans le
contexte chinois.
Développer sa capacité à s’interroger sur ses schémas personnels, accepter l’observation sans
références trop marquées. Savoir s’interroger soi-même en permanence, même après le départ,
sur « ma réaction personnelle par rapport aux engagements non respectés ».
Conserver la vision globale des problèmes : assurer la délégation (surveillée, diront certains) et
le découpage des tâches, qui ne font pas toujours bon ménage avec le management vu par les
Français...
User de diplomatie dans la recherche d’informations
Ne pas contester l’autorité officielle, en France comme en Chine.
Ne pas être franco-français
Une tendance des entreprises qui s’installent en Chine étant de conserver leur culture française ou
occidentale, le risque est grand pour des personnes déstabilisées dans leur environnement
quotidien (mais pas toujours conscientes de l’être) de vouloir plaquer des systèmes de
management qui ne correspondent pas à ce qu’attendent ou peuvent absorber les collaborateurs
chinois, même ceux qui connaissent l’Occident.
Parmi les chausse-trappes fréquentes, le fait de prendre trop en main le nouvel expatrié, de le
protéger d’un « choc culturel » inévitable, ne semble pas bénéfique à l’adaptation. Ceux qui ont le
plus été protégés à leur arrivée sont aussi ceux qui ont ensuite le plus de mal à adapter leur
fonctionnement aux différences montrées par leurs subordonnés chinois, ou même à questionner
ce fonctionnement.
Comprendre l’interpénétration des réseaux : « un maillage complexe dans lequel chaque niveau
de réseau doit être en harmonie avec les autres, en particulier vie personnelle/vie privée ».
Parler (au moins) quelques mots de mandarin
Avoir des connaissances culturelles et historiques
Connaître les rudiments de l’étiquette
Partir en Chine sans connaître au moins quelques phrases ou locutions de chinois courant nous
semble une erreur : tous les managers qui ont qualifié leur expérience de « réussie ou très
réussie » ont montré de l’intérêt, lors de l’entretien, pour la langue et la culture du pays où il
s’implantaient. Que cet intérêt ait été antérieur ou non à leur arrivée, il leur a permis d’aplanir des
difficultés parfois présentées par leurs collègues moins souples comme inéluctables.
Connaître le terrain avant d’arriver pour travailler : « Mon poste précédent comprenait des
missions régulières en Chine. Il était conçu comme une formation/préparation au poste en
expatriation ». « Notre groupe a une structure d’expatriation plutôt étoffée : j’avais fait plusieurs

voyages de préparation et j’avais déjà été envoyé dans un autre pays d’Asie, où j’étais bien plus
isolé ».
OBJECTIFS DE PROGRES
L’expérience de travail en Chine peut être très déstabilisante, sur le long terme, pour une personne
mal préparée à l’opposition des schémas cognitifs. Les principales pistes d’amélioration identifiées
concernent la bonne connaissance de ses propres schémas de représentation, un accompagnement
individuel, et une meilleure compréhension, de la part du management international, de la
spécificité des activités en Chine, par rapport à d’autres expatriations.
L’expression de satisfaction des répondants est mitigée : les personnes les plus satisfaites de leur
expérience sont celles qui sont présentes en Chine de leur propre initiative et/ou qui parlent
chinois. Une partie des employés de groupes internationaux se sont sentis « jetés à l’eau ».
Pour tous ceux qui ont déclaré que leur expérience était réussie, l’utilisation de quelques rudiments
de mandarin, le respect des bonnes manières et de l’étiquette chinoise sont indispensables. Il sera
donc impossible à un Français de s’adapter et de se faire respecter s’il insiste sur le maintien de ses
propres codes. Ces différences concernent aussi bien les gestes que le contenu des échanges.
@ Tous droits réservés - Par Pascale Reinhardt, 42 ans, est coach, chercheur et formatrice,
spécialiste du management interculturel, de la communication de conflits et de la négociation
(environnements chinois, européen, nord-américain). ([email protected])/ Pour Objectif Chine.
Extrait d’une étude universitaire en psychologie sociale portant sur le management des occidentaux
en Chine, réalisée d’après le témoignage de plus de 80 personnes
Présentation de l’auteur :
Pascale
Reinhardt
(Word, 28.5 ko
Droit et Economie
Dans la mesure où la majeure partie des publications juridiques sur la Chine relève du droit
économique, ce chapitre regroupe, de façon parfois arbitraire, les deux disciplines. La
production dans ces domaines est essentiellement tournée vers la publication d’articles et de
rapports, et le nombre limité de travaux monographiques
est peut-être encore plus évident qu’ailleurs.
L’économie La recomposition du paysage économique de la Chine après les réformes
introduites à la fin des années 1970, l’ouverture du pays à l’économie planétaire et la place
grandissante qu’elle occupe dans la concurrence mondiale ont créé un large besoin d’analyse
et d’explication. Cependant, hormis quelques titres de vulgarisation et donc forcément concis
(« Que sais-je ? » – épuisés –, La Découverte, Nathan), nous manquons en français d’études
d’ensemble et régulièrement mises à jour sur la situation macro-économique chinoise.
L’ouvrage le plus complet publié à ce jour est sans aucun doute celui de l’Ocde, La Chine

dans l’économie mondiale : les enjeux de politique économique intérieure. Il faut dire qu’il
existe naturellement une vaste littérature grise produite par les organismes officiels ou
professionnels français, etsurtout un vaste fonds, en anglais, auquel les personnes intéressées
ont l’habi-tude de se reporter (Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc.).
La raison de cette situation, outre la rapide obsolescence des écrits concernant la situation
chinoise, est, sans conteste, la faiblesse numérique de nos économistes spécialisés sur la
Chine.
La production éditoriale française
Elle est dominée par trois types d’écrits :
— des ouvrages de gestion rédigés par des praticiens, souvent non sinisants, concernant
l’approche du marché chinois (les investissements, l’implantation des entreprises en Chine,
l’art de la négociation, les difficultés du management interculturel…) ;
— des monographies savantes portant sur des questions de société et qui, pour la plupart, ont
été rangées, dans le présent recueil, sous la rubrique des sciences sociales et humaines (monde
du travail, main-d’oeuvre migrante, recompositions régionales, aménagement du territoire et
travaux d’infrastructure…) ;
— des études plus générales traitant de la transition vers l’économie de marché – englobant
parfois les autres pays socialistes – et s’attachant à ses conséquences, aux réformes des
entreprises, aux enjeux de l’entrée dans l’Omc, au choc de la crise asiatique, à la place de la
Chine sur l’échiquier mondial…).
Les€diteurs, généraux ou spécialisés, ne semblent pas encore porter leur attention sur ce
champ spécifique ; seule la maison L’Harmattan s’efforce de publier des€tudes sur l’Asie en
général et la Chine en particulier.Le droit En dehors d’ouvrages antérieurs à la Seconde
Guerre mondiale, les publications sur le droit chinois furent et sont dépendantes de l’évolution
du droit en Chine. Ce n’est que depuis 1979 que la Chine a adopté une voie légale et décidé
de se doter de lois et règlements. Depuis vingt-cinq ans, l’on observe une véritable révolution
juridique, dont l’arrivée à maturité prendra encore quelque temps. Les publications sur le droit
chinois sont par conséquent peu nombreuses, car rendues difficiles par une évolution très
rapide du contenu du droit, tant national que local, une absence de publication quotidienne
officielle des lois et réglementations et une relative confidentialité entourant la diffusion de
ces textes. Depuis peu, les autorités chinoises ont fait un effort de transparence avec le
développement de sites Internet sur le droit chinois et se sont engagées dans ce sens dans le
cadre de l’Omc.
L’état de l’édition française Elle est d’abord le reflet du petit nombre de chercheurs travaillant
sur le droit chinois. Il y a plus de publications assurées par des cabinets d’avocats à finalité
professionnelle que de publications scientifiques. Elle est ensuite tributaire d’un marché réduit
(l’intérêt pour les droits étrangers en France est limité et l’enseignement du droit chinois est
exceptionnel). Elle est enfin dépendante de la domination de l’anglais dans la pratique
internationale des affaires (des spécialistes français publient en anglais sur le droit chinois).
De plus, l’évolution très rapide du droit chinois amène les auteurs à privilégier la publication
d’articles par rapport à celle d’ouvrages.
Les publications professionnelles Les cabinets d’avocats français installés en Chine diffusent
des lettres d’information sur le droit chinois ; ils publient de nombreux articles d’actualité
juridique dans des revues professionnelles ; parfois ils contribuent à des publications
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%