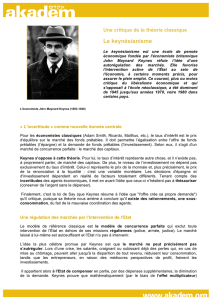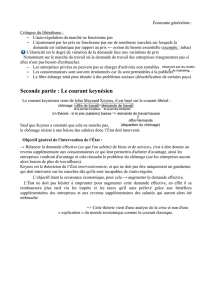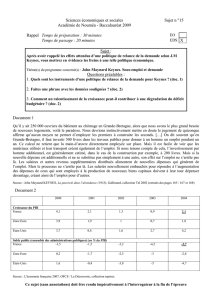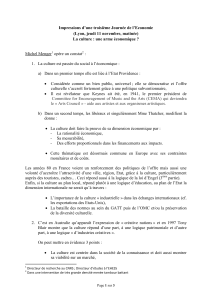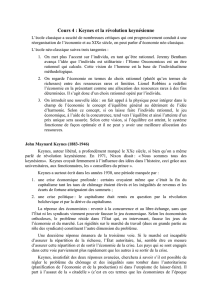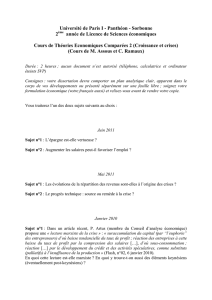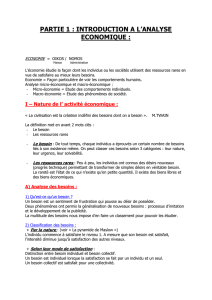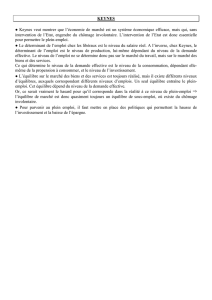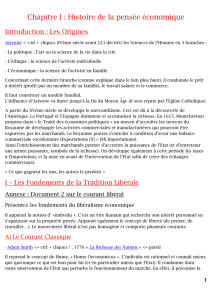Pourquoi lire Keynes aujourd`hui?

Gerard CLEMENT Page 1 du 11/01/2015 AU 18/01/2015 58268671716/04/2017
1
CENTRE RHONE –ALPES D’INGENERIE SOCIALE SOLIDAIRE & TERRITORIALE
REVUE DE PRESSE
DU 11 AU 18 JANVIER 2015
Hommages à Bernard Maris
Le suicide du libéralisme économique
Pourquoi lire Keynes aujourd'hui?
Enron : le mythe de la transparence
Nos sociétés sont dépressives
Articles de Bernard PARIS
Le terrorisme à l'âge du live tweet
La conquête des libertés en Occident
La laïcité, une singularité française ?
Qu'est-ce que le jihad ?

Gerard CLEMENT Page 2 du 11/01/2015 AU 18/01/2015 58268671716/04/2017
2
Hommages à Bernard Maris
Adieu à Bernard Maris, par Philippe Frémeaux (initialement publié sur AlterEcoPlus)
L’attentat contre Charlie Hebdo n’a pas seulement tué des personnes. Il s’est aussi attaqué à la liberté d’expression, à la
démocratie et à la cohésion de notre société. Il nous faut lutter contre le terrorisme avec détermination, mais sans perdre
de vue que ce serait donner raison à ceux qui le pratiquent que d’abandonner nos valeurs pour adopter la vision du
monde qui est la leur, un monde où l’intolérance est loi, un monde où l’identité se fonde sur la détestation de l’autre.
Parmi les victimes de cet attentat, Bernard Maris, qui signait ses chroniques hebdomadaires dans Charlie Hebdo sous le
pseudonyme d’« Oncle Bernard ». Universitaire de formation, Bernard Maris était présent dans de nombreux médias, et
notamment France Inter ou I-télé. Mais il a également longtemps été collaborateur de notre journal. Nous partagions en
effet bien des choses avec lui, à commencer par son regard critique sur le discours d’autorité tenus par les économistes
dominants, qui habillent leurs prescriptions d’un vernis scientifique contestable. Un regard qu’il avait brillamment
développé dans son livre Des économistes au-dessus de tout soupçon, paru en 1990.
Mais Bernard Maris n’était pas seulement un polémiste utilisant son immense talent pour ridiculiser la prétention et la
pédanterie des économistes dominants. C’était aussi un « intellectuel » dont la vision du monde se nourrissait d’une fine
connaissance des grands auteurs. Dans l’adieu au regretté Gilles Dostaler, lui aussi longtemps collaborateur d’Alternatives
Economiques, qu’il nous avait livré en mars 2011, il écrivait : « Comme tous les « frondeurs » de notre génération, Gilles
fut nourri de la Sainte Trinité, Nietzsche, Marx, Freud. Et très vite il fut ébloui par Keynes. (…) Keynes nous sauvait, Gilles
et moi, moi plus que lui, de la tristesse dans laquelle nous plongeait l'économie orthodoxe. »
De cette proximité intellectuelle était notamment né Capitalisme et pulsion de mort, en 2009, un livre stimulant qui
confrontait la pensée de Freud et Keynes, qui analysait avec finesse les ressorts de la quête démesurée de l’accumulation
d’argent qui régit notre société. Avec des références à Bataille, mais aussi aux défenseurs de la monnaie fondante, tel
Sylvio Gesell. Réfléchir à la place de la monnaie dans le capitalisme n’était donc pas seulement un enjeu en termes de
régulation macro-économique, mais allait bien au-delà, en conduisant à s’interroger sur le désir, et, plus au fond, aux
conditions d’une société pacifiée.
Bernard Maris était bien au fait de la complexité et de la violence du monde dont il vient d’être la victime. Il pouvait
parfois donner l’impression, ces dernières années, d’être devenu plus distancié. Auteur lui-même de plusieurs romans, il
s’investissait désormais autant dans la littérature que dans l’économie. Tant il est vrai que les meilleurs romans nous en
apprennent souvent plus sur la vie et la société que certains essais. Il venait de signer un « Houellebecq économiste »
stimulant au sens où les romans de cet auteur sont aussi un symptôme des désordres du monde actuel, et de la perte de
sens que l’on constate.
Eprouvé par la perte de sa femme, disparue depuis maintenant deux ans, il n’était pas pour autant tombé dans le
cynisme. Il continuait d’espérer que notre société puisse devenir plus douce à ses membres, donner plus de place au don
et au contre don.
Bernard, tu nous manques.
"Bernard Maris : souvenirs", par Christian Chavagneux (initialement publié sur AlterEcoPlus)
Nan mais t’as entendu ça Bernard ! Les voilà tous à parler de « l’économiste Bernard Maris ». Je t’entends d’ici : « Ah, les
cons ! » De ton premier à ton dernier livre, tu n’as jamais cessé de railler l’establishment des économistes patentés dont
les démonstrations, écrivais-tu, représentent « ce que les mots croisés sont à Proust » !
Formé à la micro à Toulouse !
Economiste, tu l’as été, ça c’est sûr. Docteur en économie, agrégé de l’université. Excusez du peu. Par une belle ironie qui
n’appartient qu’à toi, tu as fait tes études d’économie à Toulouse : chez des matheux spécialisés dans la petite
microéconomie théorique, toi le littéraire spécialiste des grandes questions macro ! T’en as bouffé des modèles ! Et même
passé cinq ans de ta vie à écrire une thèse sur une approche théorique de la répartition des revenus en période de
croissance équilibrée. Du sérieux.
Eh oui, à tous ceux qui prenaient Bernard pour un amuseur public, sachez qu’il a commencé par remplir sans problème
les canons de la discipline ; avant de prendre, heureusement pour nous, les chemins de l’indiscipline économique. Jean-
Jacques Laffont, le père spirituel de l’Ecole d’économie de Toulouse, t’appréciait beaucoup. C’est lui, on le sait peu, qui t’a
permis d’aller enseigner un an aux Etats-Unis, à l’université d’Iowa, d’où tu es revenu avec un accent toulousano-
américain absolument inimitable !
Une approche d’économie politique
« Si c’était à refaire, je ne le referais pas », disais-tu. Comme je te comprends.
Tu avais lu Marx, Keynes, Hayek et beaucoup d’autres : aujourd’hui majoritairement des noms sur de vieilles photos, je
ne suis pas sûr que notre soi-disant prix Nobel en ait même parcouru la moitié. Et je ne parle même pas de tes grandes
connaissances littéraires et philosophiques.
Tu dénonçais le goût immodéré de l’argent, cette course pour savoir qui serait le plus riche du cimetière
Tu défendais une approche d’économie politique, à vision large, qui s’interrogeait sur la nature du capitalisme, sa
dynamique et sa dimension sociale, écologique et politique. Tu t’intéressais aux dimensions psychologiques et
irrationnelles du comportement économique. Tu dénonçais la surconsommation et le goût immodéré de l’argent, cette
course pour savoir qui serait le plus riche du cimetière.
Un style
Tu savais écrire, en français, pas en équations. Et quelle plume ! Le sens de la formule : la fin du travail « s’est muée en
travail sans fin » ; les stock-options, une« simple avance sur pillage »… Et, bien sûr, le sens de l’humour. Les crises de
rire qu’on a pu prendre dans le studio d’On n’arrête pas l’éco quand on t’écoutait répéter tes portraits juste avant
l’émission. Et à l’écrit, je ne résiste pas à piocher deux trois choses parmi des centaines :
« Si l'on vendait Jacques Delors à sa valeur travail, on pourrait éponger les pertes sur Attali soldé à sa valeur
pensée. »
« Quand on a passé quelques heures sur le périphérique, on a plus vite fait le tour du progrès que de Paris ! »
Ou quand tu te demandais ce que c’est d’être socialiste aujourd’hui :« Désormais, les socialistes sont des
gestionnaires. Pourquoi pas ? Comptable est un métier comme un autre »…

Gerard CLEMENT Page 3 du 11/01/2015 AU 18/01/2015 58268671716/04/2017
3
Tu avais le goût et tu avais fait le choix de la pédagogie économique. S’adresser à tous pour donner envie de comprendre
et de s’impliquer dans le débat démocratique sur l’économie. En cela, tu ne pouvais qu’être proche d’Alternatives
Economiques. Tu as toujours été un fidèle compagnon de route.
Bref, on le comprend à cette longue liste, tu n’avais plus rien à voir avec ce qui fait l’économiste standard d’aujourd’hui.
Etre journaliste
« Si c’était à refaire, j’aurais commencé par le journalisme », as-tu dit. Héritage de ton père, un peu, qui dirigeait des
journaux pendant la résistance. « Journalisme », « résistance », deux mots qui vont si bien ensemble chez toi.
Permets-moi de finir sur une petite note personnelle. Quand Oncle Bernard m’a dédicacé son Journal d’un économiste en
crise, il a écrit : « Pour mon cher neveu Christian. » Je peux te dire que j’étais pas peu fier ce jour-là ! Je suis sûr qu’on
est plein à avoir reçu cette dédicace, parce que des neveux, heureusement, tu en as quelques-uns. C'est juste qu'il nous
faudra encore un paquet d'années pour arriver à ton niveau de culture économique et de pédagogie. Et pour le reste, la
voix, le style, l'humour, la poésie, etc., on sera obligé de faire autrement : tu as placé la barre trop haut.
Tes livres portaient une déception mais aussi un espoir
Enfin, alors que tu avais mon adresse mail et mon portable, quand tu voulais dire des choses importantes, tu continuais à
écrire des lettres, à l’ancienne. Dans la dernière que j’ai reçue de toi, tu me disais que tes livres portaient « une
déception mais aussi un espoir » : parce que « la vie est en nous, la vie est ailleurs », ailleurs que dans l'économie. Tu as
été un homme généreux. Et par les temps qui courent, la générosité, ça fait un bien fou.
Gilles Raveaud : Hommage à Bernard Maris
Bernard Maris a été assassiné le mercredi 7 janvier 2015 dans les locaux du magazine Charlie Hebdo, lors de la
conférence de rédaction à laquelle il participait.
Bernard Maris avait de multiples qualités, tant intellectuelles, professionnelles, artistiques, que personnelles. En
particulier, il était doté d’une gentillesse et d’une bienveillance rares.
En tant qu’économiste, il possédait avec brio ce qui est peut-être la qualité la plus importante : la capacité de surprendre,
de provoquer, mais aussi et surtout d’expliquer au plus grand nombre, de décortiquer, d’expliquer et… de faire rire.
Il était un passeur, un éveilleur de consciences, un « poil à gratter » qui déshabillait sans cesse les thuriféraires de la
pensée libérale pour montrer à quel point leur pensée allait à l’encontre du bonheur des hommes, du fonctionnement
harmonieux de la société, et de la préservation de notre environnement.
Sur le plan théorique, il était keynésien, au sens plein du terme. Pour Maris, Keynes c’était cet « économiste citoyen »,
celui qui recherche inlassablement la paix et la prospérité – car Maris n’oubliait jamais, sombre présage, qu’au bout de
l’horreur économique il y avait l’horreur tout court.
Pour Keynes, on le sait, « un économiste de qualité, ou simplement compétent, est un oiseau rare ». En effet, « il doit
être mathématicien, historien, homme d’Etat, philosophe, dans une certaine mesure. Il doit comprendre les symboles et
s’exprimer avec des mots. Il doit observer le particulier d’un point de vue général et atteindre le concret et l’abstrait du
même élan de pensée. Il doit étudier le présent à la lumière du passé et dans la perspective du futur. Rien de la nature et
des institutions de l’homme ne doit lui être étranger. Il doit être à la fois impliqué et désinteressé ; être aussi détaché et
incorruptible qu’un artiste et cependant avoir autant les pieds sur terre qu’un homme politique ».
Bernard Maris était un peu de tout cela. Lorsqu’on lui demandait ce que lui, économiste critique radical pouvait bien
enseigner, il répondait « l’histoire économique ». Aujourd’hui, l’histoire économique a à peu près disparu des cursus des
facultés d’économie – tout comme la lecture des textes de Keynes.
Bernard Maris était d’une grande érudition, qui ne se limitait pas aux sciences sociales. Le combat de l’AFEP est avant
tout celui de la culture économique, entendue comme connaissance des auteurs de sciences sociales, de l’histoire et des
sociétés contemporaines. Son combat est le nôtre.
Aujourd’hui, les facultés d’économie produisent des Jean Tirole, qui s’opposent au pluralisme.
Si l’AFEP ne gagne pas ses combats, elles ne produiront plus de Bernard Maris.
En attendant, que faire ? Lire, lire, et encore lire. Donner à lire aux étudiants l’Anti-manuel d’économie de Bernard Maris,
qui a connu un succès considérable dans la population mais qui est à peu près absents des cours de faculté.
Notre peine est infinie d’avoir perdu sous les balles une personne d’une telle intelligence, d’une telle humanité. Mais
l’AFEP est là pour essayer d’empêcher que sa lumière ne s’éteigne tout à fait.
Jean-Marie Harribey : "Atterré"
Le mot “atterré” a pris aujourd’hui un autre sens. Il ne désigne plus seulement une poignée d’économistes en opposition
avec leurs collègues qui continuent envers et contre toute pensée logique de faire prendre des vessies pour des lanternes
aux citoyens et à leurs étudiants. Bernard Maris faisait partie de ces économistes atterrés. Mais aujourd’hui le mot
“atterré” désigne l’effondrement qui nous atteint, nous sidère et nous submerge après son assassinat et celui de ses amis
de Charlie Hebdo.
Bernard Maris fut peut-être, à l’aube du capitalisme néolibéral qui vit la “science” économique basculer définitivement
dans l’apologie de la finance spéculative, l’un des premiers sinon le premier de notre génération à partir en bataille contre
cette pseudo-science. Il fit cela avec toute sa connaissance de l’intérieur de la discipline et avec un humour ravageur, à
l’image de son Charlie Hebdo, de notre Charlie Hebdo.
Car la bataille qu’il mena était double. D’abord contre ses pairs qui ne lui arrivaient pas à la cheville. Son livre Des
économistes au-dessus de tout soupçon ou la grande mascarade des prédictions (A. Michel, 1990) dénonçait déjà il y a
vingt-cinq ans, à une époque où les voix contraires étaient rares, les économistes “Diafoirus” et mettait en pièces les
prétendues “lois” économiques enseignées dans toutes les universités.
Et il mena aussi une bataille pour la démocratie en rendant accessible, par la voie de la dérision et du pastiche, la
dénonciation précise du discours envahissant la sphère cathodique. Il participa à sa manière à la critique de l’austérité
pour les pauvres et des largesses pour les riches, du capitalisme envahissant tout, du productivisme qui détruit humains
et planète, et son argumentation en faveur de la réduction du temps de travail ne se démentit jamais.
Atterrés que cette voix se soit tue, que cette voix ait été tuée, ulcérés devant de tant de violence et de haine envers
l’humanité humaine, nous pleurons de tristesse et de stupeur.

Gerard CLEMENT Page 4 du 11/01/2015 AU 18/01/2015 58268671716/04/2017
4
Je suis Charlie, nous sommes Charlie, telle est la réponse que spontanément la société oppose à cette violence et à cette
haine.
Bernard Maris était un “atterré” non violent. Nous sommes tous des atterrés non violents, mais déterminés.
Bernard Maris
Le suicide du libéralisme économique
Bernard MARIS, Professeur d'économie à l'université Paris VIII. Dernier ouvrage paru, en collaboration avec Philippe Labarde
Alternatives Economiques n∞ 211 - février 2003
Autopsie d'un anéantissement.
L'économie dite moderne s'est constituée autour du modèle de Walras et du concept de valeur utilité ou valeur subjective, en
opposition aux classiques - Ricardo, Mill, Malthus et Marx -, qui acceptaient le concept de valeur travail, valeur objective et
quantifiable (1). La valeur utilité n'est ni mesurable ni appréciable, sinon personnellement par les agents économiques. Cette
utilité est non comparable: si je gagne deux fois plus que mon voisin, je ne peux pas dire que je suis deux fois plus heureux que
lui, mais simplement que je suis au moins aussi heureux que lui.
L'économie moderne représente donc un monde où les individus sont l'explication ultime de tout phénomène social ou collectif.
Il n'existe pas de collectif en soi. Tout phénomène économique peut se ramener à l'interaction des calculs d'individus séparés,
autonomes, sans lien social: c'est l'hypothèse dite "d'individualisme méthodologique". Elle interdit de poser des phénomènes
globaux, sinon comme agrégation de phénomènes individuels.
Le libre jeu des égoïsmes
Pourquoi l'individualisme méthodologique a-t-il triomphé? Pourquoi le succès du modèle de Walras (1834-1910), cent ans
après La richesse des nations (2)? Parce qu'il donne un sens à la formidable intuition d'Adam Smith, la notion de marché
autorégulateur: le marché, la loi de l'offre et de la demande, laissée à son libre jeu, donne les solutions économiques les plus
efficaces possibles (3). Vous voulez que les hommes soient le plus heureux possible? Laissez-les échanger librement. Que les
provinces (sujets économiques) soient heureuses? Laissez faire, laissez passer. Que les nations (et les firmes) soient
heureuses, en paix et s'enrichissent? Favorisez le commerce.
Le modèle de Walras synthétise l'interdépendance des actions humaines (selon la fameuse phrase de Smith disant, en
substance, que ce n'est pas de la bienveillance du boulanger qu'on tire son bonheur, mais de son égoïsme, tandis qu'il tire son
bonheur du nôtre). Il postule ensuite (encore l'intuition de Smith) que ces actions humaines égoïstes et indépendantes peuvent,
laissées à elles-mêmes, par une sorte de ruse de la raison, produire une harmonie sociale. Walras, lui-même, ne démontrait pas
ce résultat. La démonstration en reviendra, en 1954, au prix Nobel Gérard Debreu et à d'autres (Arrow, Hahn). L'harmonie
sociale a pour nom "équilibre général". A peu près au même moment, Maurice Allais (il recevra le prix Nobel pour ça) démontre
la seconde intuition de Smith: un marché (le libre jeu des égoïsmes) est efficace dans l'affectation des biens.
Ricardo (sauf dans sa théorie du commerce international, qui est du pur Walras avant la lettre) et Marx sont morts. Même
l'oeuvre de Keynes, a priori étranger à la logique de l'équilibre général, ne brisera pas le consensus nouveau: en 1937, un an
après la parution de la Théorie générale, John R. Hicks, prix Nobel, rédigea Mr Keynes and the Classics: a Suggested
Interpretation, une récupération walrassienne de la théorie de Keynes, c'est-à-dire une explication de Keynes par le concept
d'équilibre (4). La messe est dite. L'économie "à la Walras" domine, s'enseigne partout avec d'épouvantables excroissances
comme les thèses de Gary Becker (prix Nobel) sur la famille, le crime et la drogue, ou de James Buchanan (prix Nobel) sur
l'Etat et la politique conçus à leur tour comme des marchés autorégulateurs.
"Le roi est nu"
Et pourtant! A peine l'économie à la Walras a-t-elle triomphé, que les économistes qui l'avaient portée au pinacle, ceux-là
mêmes qui l'avaient élaborée, s'appliquent à la détruire. Avec une minutie qui n'a d'égale que celle qu'ils avaient mise à la
construire. Ils laminent tous les heureux résultats du passé et n'ont de cesse de démontrer, dans un premier temps, que le
marché n'est pas efficace, ensuite qu'il n'est pas vrai qu'il conduise à l'équilibre ou à l'harmonie, puis que la loi de l'offre et de la
demande n'a pas de sens, qu'elle n'existe pas, et, enfin, qu'il n'est pas possible de fonder une politique économique sur le
concept libéral de marché. Je répète: il n'est pas possible (au moins pour un économiste digne de ce nom) de fonder une
politique économique sur le concept de marché. Ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est que ce sont Debreu, Allais,
Arrow et consorts (et non les attardés marxistes du café du commerce) qui s'acharnent sur la forteresse. Ils réussissent à la
transformer en sable avec une efficacité redoutable. L'un d'eux conclura: "Le roi est nu" (5). Walras, à son tour, est mort.
Commençons par la loi de l'offre et de la demande. Tout individu de "bon sens" songe, comme Walras, que si le prix d'une
chose augmente, on en veut moins, et inversement. Le problème, hélas, est l'interdépendance du désir de toutes les choses.
Autrement dit, un marché n'est jamais isolé: ma demande d'essence est liée à celle de tomates, de disques, de contrats
d'assurance, de voitures et à mon offre de travail; et il en est de même pour tout individu. Rien ne dit que le libre jeu isolé
(souligner trois fois) des offres et des demandes sur tous ces marchés conduit à un équilibre. Il peut conduire à une infinité
d'équilibres. Ou à aucun. Keynes avaient eu l'intuition magistrale qu'un marché boursier (avec tout ce que vous voulez de bonne
vieille loi de l'offre et de la demande, les actions, quand ça monte, j'achète, les obligations, quand ça baisse, je vends) était
dépourvu d'équilibre (6).
Debreu, Shonnenschein et d'autres, dans les années 70, ont démontré que les marchés ne conduisaient globalement à rien.
Pire. Ils ont prouvé en 1973, dans un théorème célèbre dit de Shonnenschein, qu'on ne pouvait déduire des comportements
normaux des demandeurs une loi "normale" de l'offre et de la demande et, horresco referens, qu'un système de prix, quel qu'il
soit, pouvait résulter de n'importe quel comportement loufoque ou aberrant de la part des offreurs et des demandeurs.
Autrement dit, la loi de l'offre et de la demande est informe. Exit la loi de l'offre et de la demande. Exit l'équilibre, l'unicité de
l'équilibre, la convergence vers l'équilibre. Exit l'harmonie par le marché. Conclusion: n'importe qui peut dire "c'est la loi de
l'offre et de la demande", sauf un économiste.
Le marché n'est pas efficace
L'efficacité du marché, maintenant. Nash a eu le prix Nobel pour avoir fourni, en 1950, comme matrice de raisonnement aux
économistes, la théorie des jeux. Le "jeu", c'est-à-dire des individus isolés décidant rationnellement d'une stratégie, constitue
bien le cadre général du modèle walrassien. Nash, après d'autres, a proposé un jeu fort simple comme image de la
concurrence, le "dilemme du prisonnier". Il est d'une portée philosophique considérable. L'équilibre (la solution de ce jeu) dit
que les acteurs en concurrence choisissent toujours la mauvaise solution. La coopération est meilleure. Savourons ce résultat:
la concurrence, le chacun pour soi, est inefficace. La solidarité serait plus efficace que la concurrence. Le collectif est plus
efficace que l'individualisme. La coopération est plus efficace que la non-coopération. Bref, on ne se lassera jamais de le
répéter, le marché n'est pas efficace. On devrait l'écrire en lettres d'or sur le frontispice du Parlement européen.
Venons-en aux relations de l'économie libérale et de la politique. John K. Arrow (encore un Nobel) a démontré, en 1951 (7), un
théorème dit d'"impossibilité". En substance, il dit qu'il n'est pas possible de construire un ordre social des choix économiques

Gerard CLEMENT Page 5 du 11/01/2015 AU 18/01/2015 58268671716/04/2017
5
au niveau d'une nation à partir des préférences exprimées par les agents individuels, sauf, évidemment si un dictateur impose
sa vision des choses. Cette impossibilité de passer de l'individuel au collectif a passionné les économistes, en particulier
Amartya Sen (Nobel aussi) qui a beaucoup glosé sur elle, pour confirmer qu'effectivement, c'est impossible: on ne peut utiliser
les demandes individuelles pour exprimer une demande collective. Conséquence: devant l'impossibilité de tirer une logique
économique collective à partir des choix individuels, c'est au politique de trancher. Sur toute question sociale, l'économique ne
permet rien d'inférer, il est à l'arrière-plan, et le politique au premier (8).
Quelques années plus tard, en 1956, fut découvert un théorème plus dévastateur encore, dit de Lipsey-Lancaster, lui aussi
d'une portée philosophique considérable. Imaginons qu'un marché parfait puisse exister (ce qui, vu d'aujourd'hui, après le
théorème de Shonnenshein, est une hypothèse vraiment héroïque) et qu'on veuille aller dans cette direction. On peut souhaiter,
petit à petit, libéraliser les marchés, celui du travail, celui des capitaux, puis privatiser, flexibiliser, supprimer les monopoles,
mettre des péages là où il n'y en avait pas, bref, faire un peu ce que fait l'Europe. Le bon sens voudrait que plus on approche de
la concurrence, plus le système est efficace. Si dans un pays il y a trois marchés, deux contrôlés par un monopole et le
troisième concurrentiel, l'évidence dit que ce pays est plus efficace que celui où il y a trois marchés et trois monopoles. Et que
le pays qui n'a qu'un monopole l'est encore plus.
Le théorème de Lipsey-Lancaster démontre que c'est faux: si l'on touche à un aspect anticoncurrentiel d'une économie, on se
retrouve dans une situation pire que celle du départ. Autrement dit, on ne peut pas aller pas à pas vers la concurrence. La
concurrence est un tout. Le marché est une totalité. Ou tout est marché ou ce n'est pas la peine d'avoir une politique des petits
pas, à l'européenne. C'est un résultat destructeur. Privatiser, par exemple, n'a aucune justification économique. Politique sans
doute, mais pas économique. Comme le théorème d'impossibilité d'Arrow, le théorème du second best de Lipsey-Lancaster
démontre le primat absolu du politique sur l'économique.
On peut ajouter, entre mille, un dernier résultat négatif à cette panoplie: le théorème de Grossman-Stiglitz (1980). Il dit, en
substance, qu'un mécanisme de marché ne peut jamais améliorer le fonctionnement du marché. Spontanément, le marché ne
crée jamais plus de marché (9). Autrement dit, le marché n'est jamais spontané, il est toujours une construction extra-
économique. Les lecteurs de Karl Polanyi n'avaient cependant pas attendu Grossman et Stiglitz pour s'en rendre compte.
Pas d'explication économique à l'économie
Et pourtant, il y a de l'équilibre. Et pourtant, il existe de l'harmonie sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a du lien autre
qu'économique, évidemment, car le lien économique, laissé à lui-même, est purement destructeur. Il y a du lien social, de
l'affection, de l'amitié, du lien féodal, de la soumission, de l'altruisme, de la coopération, du don, de la confiance, de la gratuité,
de la convention, de la coutume, de la loi, de la prédation. Il y a surtout énormément de gratuité pure dans les actions
humaines.
Les économistes contemporains ont ajouté à ces résultats deux avancées décisives supplémentaires: ils ne raisonnent plus en
avenir certain. Les catastrophiques résultats précédents sont évidemment amplifiés par l'introduction de l'incertain dans les
raisonnements, un peu comme si vous ajoutiez des hallucinogènes à l'alcool pour aggraver la perte des repères. Ensuite, ils ont
introduit des notions coopératives ou collectives fortes, comme les synergies, les rendements croissants, la croissance
endogène (par exemple, la qualité de l'enseignement qui nourrit la croissance, qui nourrit la qualité du travail, en boucle) ou
encore des représentations collectives comme les anticipations, rationnelles ou non.
Tous les économistes, libéraux ou non, sont donc conscients de l'état désastreux dans lequel se trouve le libéralisme théorique:
l'idée que la théorie économique walrassienne est "incapable de répondre à une question telle que "comment se forment
les prix?"" (10) fait désormais pratiquement consensus. Mesure-t-on l'importance de cet aveu? Il faut se frotter les yeux pour
croire une telle phrase! Le même auteur affirme également que "la théorie moderne et un "patchwork", sans doute haut en
couleur, mais constitué d'une juxtaposition de modèles particuliers, de modèles ad hoc, choisis pour la circonstance ou
l'illustration d'un problème spécifique" (ibid, p. 117). Il n'y a plus de modèle économique de la société. Plus d'explication
économique à l'économie.
Reste à comprendre pourquoi, malgré une telle lucidité, la prégnance du principe concurrentiel reste aussi forte. Autrement dit,
pourquoi, paradoxalement, la faillite du modèle théorique a propulsé au zénith l'idéologie économique libérale.
Grandeur et décadence du marché
1723 : Bernard de Mandeville. La fable des abeilles. Que les vices privés font le bonheur public.
1728 : Charles-Louis de Montesquieu. L'esprit des lois.Que les nations commerçantes ont les moeurs douces.
1776 : Adam SmithLa richesse : des nations.Que l'égoïsme de chacun fait la prospérité publique ; que la main invisible conduit
à l'harmonie sociale.
1803 : Jean-Baptiste Say. Traité d'économie politique.L'équilibre existe toujours. L'offre crée sa propre demande.
1817 : David Ricardo. Des principes de l'économie politique et de l'impôt. Le commerce international améliore l'utilisation des
facteurs de production et le bonheur des nations.
1874 : Léon Walras : Eléments d'économie politique pure. Le marché, la loi de l'offre et de la demande laissée à son libre jeu
permet d'atteindre un équilibre optimal.
1951 : Maurice Allais : Le marché est efficace : il alloue le mieux possible les biens et les services entre les individus.
1954 : Gérard Debreu. Oui, l'équilibre social de marché peut exister.
1936 : John Maynard Keynes. Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie.La loi de Say est fausse. Le
déséquilibre peut exister durablement. Le modèle du marché est la " foule ", anonyme, collective, irrationnelle.
1950 : John Nash. Le dilemme du prisonnier : le marché est inefficace.
1951 : Kenneth John Arrow. Il est impossible de définir une politique économique collective à partir des volontés libres des
individus.
1954 : Richard Lipsey et Kevin Lancaster.La politique économique fondée sur le concept de concurrence est un non-sens.
1973 : Gérard Debreu et Shonnenschein. L'équilibre est un cas rarissime, impossible à atteindre. La loi de l'offre et de la
demande n'existe pas.
1980 : Joseph Stiglitz. Spontanément, le marché ne crée jamais d'avantage de marché.
Bernard MARIS, Professeur d'économie à l'université Paris VIII. Dernier ouvrage paru, en collaboration avec Philippe Labarde
Alternatives Economiques n∞ 211 - février 2003
NOTES
(1) Il vaut d'être noté que Keynes accepte, dans la Théorie générale (1936), le concept de valeur travail: "Nos préférences
vont par conséquent à la doctrine préclassique que c'est le travail qui produit toute chose... avec l'aide du travail passé
incorporé dans les biens capitaux" (éd. Payot, 1969, p. 223, souligné par Keynes). C'est, stricto sensu, la théorie marxiste de
la valeur travail qui identifie le capital comme du travail accumulé.
(2) Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776), Eléments d'économie politique pure (1877).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%