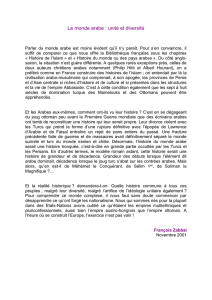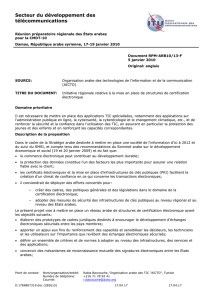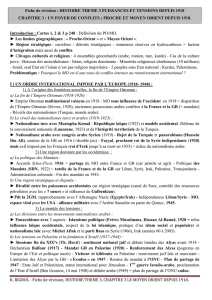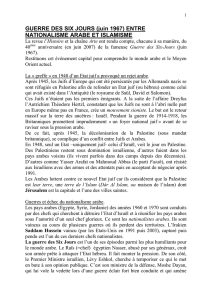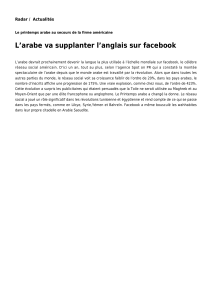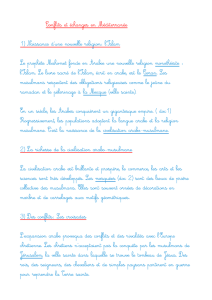La place de la Nakba dans la catastrophe générale du monde arabe

La place de la Nakba dans la catastrophe générale du monde arabe
Le 15 mai de chaque année, toutes ces 68 dernières années, les Palestiniens ont commémoré leur exil collectif de la Palestine. Le nettoyage ethnique de la Palestine pour faire place à une « patrie juive »s’est fait au prix d’une violence implacable et d’une souffrance perpétuelle. Les Palestiniens se réfèrent à cette tragédie comme à la « Nakba ,»ou « Catastrophe .»Cependant, la
«Nakba »n’est pas uniquement une expérience palestinienne... C’est également dans le monde arabe, une plaie qui ne cesse de saigner.La Nakba est nommément l’accord Sykes-Picot de 1916 qui a divisé une grande partie du monde arabe entre les puissances occidentales qui se faisaient
concurrence. Un an plus tard, la Palestine était retirée de la question arabe et «promise »au mouvement sioniste européen, provoquant ainsi l’un des conflits les plus longs de l’histoire moderne.Malgré toutes les tentatives de séparer le conflit actuel en Palestine de son
environnement arabe, les deux réalités ne peuvent être découplées puisque les deux remontent
aux mêmes racines historiques.Comment est-ce arrivé ?Lorsque le diplomate britannique Mark Sykes, a succombé à une pandémie de grippe espagnole à l’âge de 39 ans en 1919, un autre diplomate, Harold Nicolson, a décrit comme suit ce qu’avait été son influence sur la région du Moyen-Orient «:C’est grâce à son énergie et à sa persévérance sans limite ,à son enthousiasme et à sa foi, que le nationalisme arabe et le sionisme sont devenus deux des plus grands succès de
nos causes de guerre» .Rétrospectivement, nous savons que Nicolson a parlé trop vite. La nature du «nationalisme arabe »auquel il faisait référence en 1919 était fondamentalement différente de celle des mouvements nationalistes qu’ont connus plusieurs pays arabes dans les années 1950
et 60. Le cri de ralliement pour le nationalisme arabe dans ces années-là était la libération et la souveraineté face au colonialisme occidental et à ses alliés locaux.La contribution de Sykes à la montée du sionisme ne risquait pas de favoriser la moindre stabilité ...Depuis 1948, le sionisme et le nationalisme arabe ont été en conflit permanent, entraînant des guerres et des bains de sang
apparemment inépuisables.Cependant, la dernière contribution de Sykes à la région arabe a été son rôle majeur dans la signature il y a un siècle de l’accord Sykes-Picot ,également connu comme l’Accord d’Asie Mineure. Ce fameux traité entre la Grande-Bretagne et la France, qui a été négocié avec le consentement de la Russie, a façonné la géopolitique du Moyen-Orient pour
tout le siècle qui allait suivre.Au fil des années, les défis au statu quo imposé par cet accord Sykes-Picot, ont échoué à modifier fondamentalement les frontières arbitrairement dessinées qui divisaient les Arabes en «sphères d’influence » ,administrées et contrôlées par les puissances occidentales.Pourtant, avec l’apparition récente de «Daesh »et la mise en place à partir de 2014
de sa propre version de frontières tout aussi arbitraires, englobant de larges pans de la Syrie et de
l’Irak, le tout combiné aux actuelles discussions sur la division de la Syrie en une fédération, l’héritage de l’accord Sykes-Picot pourrait bien voler en éclat sous la pression de nouvelles et violentes circonstances.Pourquoi Sykes-Picot ?L’accord Sykes-Picot a été signé dans le contexte de la violence qui a ravagé une grande partie de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et du Moyen- Orient à l’époque.Tout a commencé après que la Première Guerre mondiale a éclaté en juillet 1914. L’Empire ottoman rejoignit bientôt la guerre aux côtés de l’Allemagne, en partie parce qu’il était conscient que les Alliés - principalement la Grande-Bretagne, la France et la Russie -
avaient l’ambition de contrôler tous les territoires ottomans dont les régions arabes de la Syrie,
la Mésopotamie, l’Arabie, l’Égypte et l’Afrique du Nord.En novembre 1915, la Grande- Bretagne et la France ont commencé sérieusement leurs négociations, dans le but de diviser l’héritage territorial de l’Empire ottoman après que la guerre se soit terminée en leur
faveur.Ainsi, une carte faite de lignes droites dessinées avec un crayon gras a largement
déterminé le sort des Arabes, en les divisant selon différentes hypothèses aléatoires de lignes

tribales et sectaires.Partage du butinLe négociateur pour la Grande-Bretagne était Mark Sykes, et le représentant de la France était François Georges-Picot. Ces deux diplomates décidèrent -
une fois les Ottomans vaincus - que la France recevrait les zones marquées de la lettre a et qui
comprenaient la région du sud-est de la Turquie, le nord de l’Irak, et l’essentiel de la Syrie et du Liban.Les territoires marqués d’un b étaient quant à eux sous contrôle britannique, ce qui incluait la Jordanie, le sud de l’Irak, Haïfa et Acre en Palestine, et la bande côtière entre la mer
Méditerranée et le Jourdain.La Russie de son côté ,devait prendre Istanbul, l’Arménie et le
détroit stratégique turc.La carte improvisée est faite non seulement de lignes mais aussi de
couleurs, avec un langage qui prouve que les deux pays considéraient la région arabe sur un plan
purement matériel, sans prêter la moindre attention aux répercussions possibles de ce
saucissonnage de civilisations entières.L’histoire d’une trahisonLa Première Guerre mondiale s’est conclue le 11 novembre 1918, après quoi la division de l’Empire ottoman a sérieusement commencé.Les mandats britannique et français ont été étendus sur des entités arabes divisés, alors que la Palestine - sur laquelle un État juif a été créé trois décennies plus tard .- était livrée au mouvement sioniste.L’accord, soigneusement conçu pour répondre aux intérêts coloniaux occidentaux, n’a produit que de la division, des crises et des guerres.Alors que le statu quo imposé a garanti l’hégémonie des pays occidentaux sur le Moyen-Orient, il n’a pas réussi à fournir un minimum de stabilité politique ou d’égalité économique.L’accord Sykes-Picot a été conçu en secret, pour une raison particulière : il était en désaccord complet avec les promesses
faites aux Arabes pendant la Grande Guerre. Les dirigeants arabes, sous le commandement de
Sharif Hussein, s’étaient vus promettre l’indépendance complète après la guerre en échange de
leur soutien aux Alliés contre les Ottomans.Il a fallu de nombreuses années et des rébellions
successives pour que les pays arabes accèdent à l’indépendance. Les conflits entre les Arabes et les puissances coloniales ont engendré le nationalisme arabe, né dans des environnements
extrêmement violents et hostiles, ou plus exactement après les avoir surmontés.Le nationalisme
arabe a peut-être réussi à maintenir un semblant d’identité arabe mais il n’a pas réussi à
développer une riposte solide et unifiée au colonialisme occidental.Lorsque la Palestine -
promise par la Grande-Bretagne comme foyer national pour les Juifs dès novembre 1917 - est
devenue Israël, accueillant principalement des colons européens, le sort de la région arabe à l’est de la Méditerranée a été scellé comme siège de conflits et d’antagonismes perpétuels.C’est en cela, en particulier, que le terrible héritage de l’accord Sykes-Picot se fait surtout sentir, dans
toute sa violence, son imprévoyance et son complet manque de scrupules politiques.Cent ans
après que deux diplomates britanniques et français aient divisé les peuples arabes en sphères d’influence, l’accord Sykes-Picot reste une réalité dominante du Moyen-Orient, bien que contestée.Cinq ans après que la Syrie ait sombré dans une violente guerre civile, la marque de l’accord Sykes-Picot se fait une fois de plus sentir alors que la France, la Grande-Bretagne, la
Russie - et maintenant les États-Unis - envisagent ce que le secrétaire d’État américain John Kerry, a récemment appelé le «plan B » ,qui consisterait à diviser la Syrie sur la base de lignes sectaires, probablement en conformité avec une nouvelle interprétation occidentale des « sphères d’influence .»La carte Sykes-Picot a pu être une vision brute élaborée à la hâte durant d’une guerre mondiale, mais, depuis lors, elle est devenue le principal cadre de référence que l’Occident utilise pour redessiner le monde arabe et pour «le contrôler comme ils le désirent et comme ils veulent le voir» .La «Nakba »palestinienne, par conséquent, doit être comprise
comme faisant partie intégrante des plus larges conceptions occidentales du Moyen-Orient,
datant d’un siècle, alors que les Arabes étaient (et restent) divisés et la Palestine était (et reste)

conquise .Source: Info-Palestine
14:52 2016-06-18
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=18&frid=18&seccatid=20&eid
=309836
1
/
3
100%