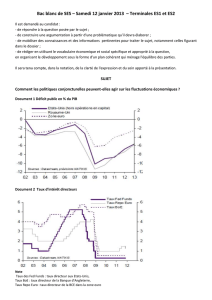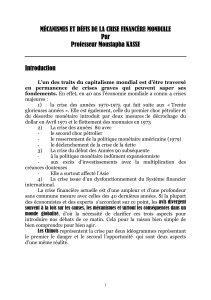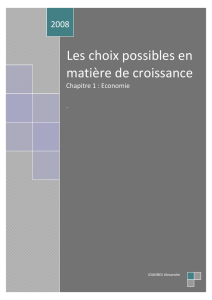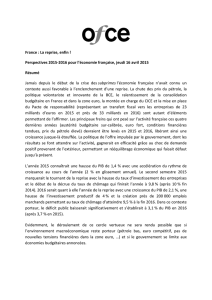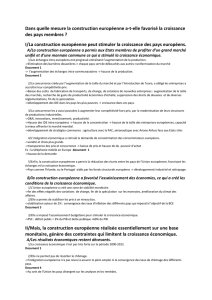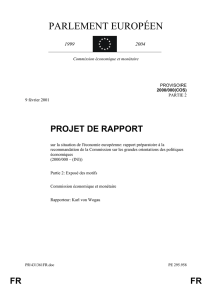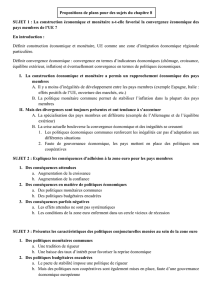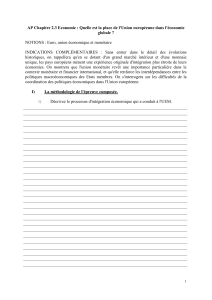La crise structurelle du capitalisme aujourd`hui

1
Kostas Vergopoulos
Université Paris VIII
LE NOUVEAU POUVOIR FINANCIER
Au cours de la dernière décennie, 2000-2010,
l’endettement total, tant public que privé, du groupe des
pays dits « développés » a en général augmenté de 3 ou 4
fois plus rapidement que leur PIB. Cette divergence se
manifeste en premier lieu aux Etats Unis et au Royaume
Uni, mais ces derniers sont suivis de près par les autres
pays membres de l’Union Européenne. Les économies-
modèles d’hier, « tigres et dragons », comme celles du
Royaume Uni, de l’Irlande, des Etats Unis, sont
aujourd’hui les plus lourdement endettées et même à un
tel point qu’elles apparaissent comme les victimes
privilégiées de la crise de l’endettement international qui
se manifeste à l’échelle de l’économie mondiale actuelle.
Une récente étude du FMI estime qu’en 2015 la dette
publique moyenne des pays des 20 plus grandes
économies du monde, celles du G20, passera à 115% du
PIB. De même, selon les projections du McKinsey Global
Institute, en 2050, la dette publique du Japon sera portée
à 600% du PIB, celle du Royaume Uni à 500% du PIB,
celle des Etats Unis à 450% du PIB, celle de la France à
400% du PIB, celle de l’Allemagne à 300% du PIB, celle
de l’Italie à 250% du PIB. Apparemment, nous sommes
en présence d’un gonflement, rapide, accéléré et sans
précédent, de la sphère financière par rapport à celle de
l’économie « réelle ». On peut interpréter cette
divergence soit comme un « retard » de la sphère
productive, ce qui se confirmerait par le fléchissement de
la productivité du travail dans les économies
occidentales, soit comme une « déconnection » et une
« virtualisation » de la sphère financière par rapport à la
sphère « réelle ». Dans le premier cas, on parlerait d’une
crise de l’économie « réelle », dans le second d’une crise
financière. Toutefois, les deux aspects de la crise actuelle
ne sont pas autonomes, mais interdépendants et il
resterait à définir leur relation organique profonde. Dans

2
les deux cas, il s’agirait, de toute façon, d’une crise de
surcapitalisation et naturellement de surproduction, qui
finit toujours par le ralentissement de la production et la
destruction d’une part importante du capital. La notion de
surcapitalisation peut s’appliquer aussi bien aux formes
productives du capital qu’à celles de la finance.
Cependant, nous n’avons pas à choisir entre l’une ou
l’autre des explications de la crise actuelle, étant donné
que les deux dimensions du capital se trouvent dans une
relation d’interdépendance organique forte, même si cette
relation s’avère in fine fortement antagonique. La
virtualisation de la sphère financière détermine
progressivement et de manière accélérée le resserrement
de plus en plus difficilement tenable par la sphère réelle
de l’économie. Déjà le nobéliste Américain Paul
Krugman avance la notion de « marasme généralisé »,
englobant aussi bien la sphère réelle que celle de la
finance. Le « marasme » de la sphère réelle implique les
réticences de la finance quant à s’engager dans la
dynamique éventuelle de la reprise, mais, inversement,
les réticences de la finance expliquent aussi le
« marasme » dans la sphère réelle. La transformation de
la sphère financière en pouvoir financier implique que la
finance, un élément de dépassement de la stagnation
longue menaçant le système capitaliste au cours des
années 1970 et 1980, ne constitue plus une solution, mais
fait partie intégrante et circonstance aggravante de ce
problème.
Une crise systémique
Si la crise actuelle du capitalisme n’est pas accidentelle ni
d’origine exogène, mais de nature endogène et
systémique, il faudra dépasser son interprétation
« dualiste », pour parvenir à une seule et unique
explication de l’ensemble de ses aspects, tant réels que
financiers. En fait, les origines de la crise actuelle
remontent aux décennies précédentes, celles des années

3
1980-1990 et 1990-2000, notamment aux dramatiques
mutations du capitalisme et aux importants changements
de politique économique des états, qui ont profondément
marqué cette période. La mutation financière du
capitalisme, la financiarisation, a permis d’une part
d’ouvrir un nouveau « créneau de secours » pour
l’accumulation du capital, repoussant ainsi la crise de
surcapitalisation vers l’avenir, mais d’autre part elle a
constitué un nouveau carcan à terme pour son propre
essor. Le sauveur de la crise devrait s’avérer par la suite
le catalyseur d’une crise plus profonde et plus redoutable.
Comme l’on sait, le principal produit du capitalisme est le
capital lui-même. Marx et Keynes ont bien montré que
sous le capitalisme, la production du capital se développe
infiniment plus rapidement que la production de toute
autre marchandise et que toute demande effective. Lénine
(1916) aussi avait évoqué ce phénomène sous la notion
de « disproportionnalité » dans le développement du
capitalisme. Disproportionalité, non seulement parmi les
secteurs de production, mais également entre la sphère
productive et celle de la finance. Conséquence
inéluctable de cette croissance rapide et démesurée du
capital est la baisse tendancielle du taux de rentabilité, ce
qui contraint le système à chercher et à inventer toujours
de nouvelles et additionnelles formes de valorisation. Au
cours des années 1970-1980, le marxiste Américain Paul
Sweezy relevait que l’ouverture de la sphère financière
serait une possibilité pour « soulager » le capital de la
baisse de rentabilité dans le domaine de l’économie
« réelle ». Ce « soulagement » par la finance avait bien
fait son apparition à la fin du 19e et au début du 20e
siècle, mais il s’était mal terminé, menaçant le
capitalisme d’avant la première guerre mondiale de
« parasitisme » et de « putréfaction », comme Rudolf
Hilferding (1910) et Boukharine (1915) l’ont bien relevé.
Il ne s’agissait pas seulement de la « fusion » entre le
capital bancaire et le capital industriel, comme cela fut
présenté par la suite, mais il s’agissait surtout de la
manifestation d’un antagonisme exacerbé et indépassable
entre la finance et l’économie réelle. Or aujourd’hui, ce
même phénomène est de retour. Plus les choses changent,

4
plus elles restent les mêmes. La finance « soulage » et par
la suite détruit le capitalisme.
De nos jours, le « soulagement par la finance » a bien
rempli son rôle pendant les deux dernières décennies du
20e siècle, mais depuis, il s’avère de plus en plus
menaçant pour la sphère productive, dans la mesure où
aujourd’hui il ordonne et impose partout dans le monde
la règle de la contraction et de la déflation, voire même
celle de la dépression la plus violente que le monde, dans
toute son histoire économique, a connue. Avec la priorité
accordée aujourd’hui à la lutte contre les déficits publics
et la généralisation des politiques d’austérité, les forces
internationales les plus conservatrices, au service toujours
du capital financier, risqueraient, une fois de plus, de
démolir toute forme d’économie productive, pour le
triomphe, une nouvelle fois, du parasitisme et de la
putréfaction. Ce processus contemporain entretient des
similitudes avec ceux manifestés il y a un siècle, tout en
gardant par ailleurs des caractéristiques propres, qui le
différencient et le spécifient par rapport à tout phénomène
comparable dans l’histoire.
Les « réformes » monétaristes
La « révolution » monétariste, à partir du début de la
décennie 1980, a largement contribué à la mutation
financière du capitalisme. Au début, elle fut présentée
comme une politique restrictive, cherchant le contrôle de
la masse monétaire, en vue de protéger les économies par
rapport au risque de l’inflation de la décennie des années
1970-1980. Or le resserrement de l’émission monétaire
officielle a ouvert le champ à l’entrée dans le jeu d’une
multitude de monnaies non-officielles, ainsi qu’à ce qui
fut appelé « monnaie d’endettement ». Des nouvelles

5
formes monétaires ou équivalentes ont vu le jour en
dépassant largement les cibles monétaires officielles.
D’abord, les secteurs privés de l’économie ont secrété de
nouvelles formes de liquidité, émises par les banques ou
même les entreprises et surtout ce gonflement de la
sphère monétaire et financière d’origine tout à fait privée
fut développé loin de tout contrôle officiel. Les politiques
monétaires restrictives des autorités publiques furent ainsi
surpassées par les politiques monétaires expansives des
secteurs privés. D’autre part, d’énormes quantités
monétaires furent déversées dans l’économie par la voie
de l’endettement auprès des pays excédentaires,
notamment asiatiques. Ces deux conditions ont
progressivement créé l’univers des innovations
financières qui a permis de légaliser les pratiques qui
restaient interdites depuis l’époque de Franklin Roosevelt
(1933). L’apothéose de ce processus fut atteint en 1999,
sous la présidence de Bill Clinton, par l’abolition dans un
climat de fanfare de la loi Glass-Steagall (1933), qui
séparait les activités des banques commerciales de celles
des banques d’investissement. A partir de cette date,
l’assaut fut donné vers l’achèvement de la mutation
financière de l’économie capitaliste. L’économiste
Américain Simon Johnson, au MIT et ancien responsable
des études du FMI, qualifie cette mutation de « coup
d’état financier » et dénonce la formation d’une
« nouvelle oligarchie financière ». C’est précisément de
cette période qu’émerge la notion d’ « économie
virtuelle », lancée pour la première fois par les conseillers
économiques du Président Clinton. Cette notion fut
connue surtout par son mépris des lois économiques et
par sa prétention de substituer le « virtuel » au principe
de la réalité. C’est à partir de cette date que se
développent les formes les plus fantaisistes, abstraites et
arbitraires de la monnaie et du crédit, sans le moindre
rapport avec l’économie réelle et en définitive dans une
relation antagonique avec elle. Les produits financiers
dérivés, selon Warren Buffet, ont constitué des
« nouvelles armes de destruction massive ». La titrisation
des dettes douteuses et sous-performantes, les swaps, les
ventes à découvert, les CDS nus, les hedge funds
imposant le principe de « casino » au centre de
l’économie. En deux mots, dans une époque qui se
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%