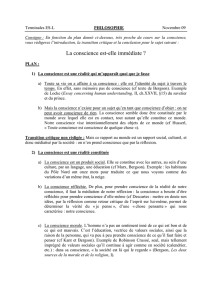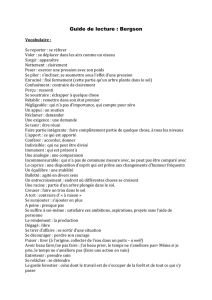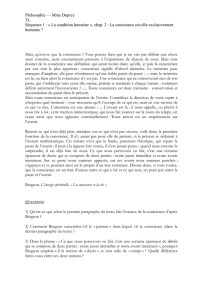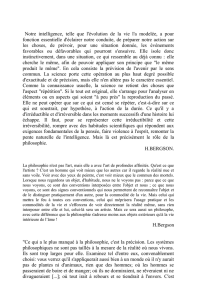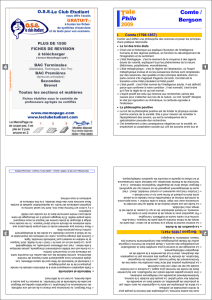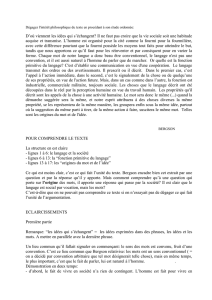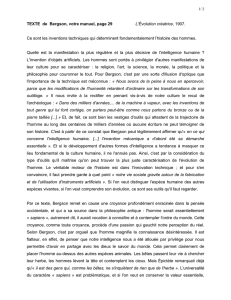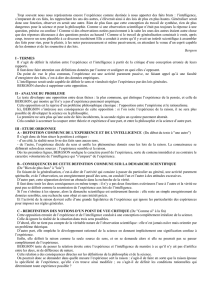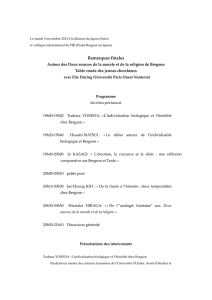DURING, Elie. Bergson et la métaphysique relativiste

Visualização do documento
DURING, Elie. Bergson et la métaphysique relativiste.doc
(116 KB) Baixar
Bergson et la métaphysique relativiste
25 12 2008 | Elie During
Version corrigée d’un article paru dans les Annales bergsoniennes, III, dossier "Bergson et
les sciences", Paris, PUF, collection Epiméthée, 2007
« En général, écrivait Bergson à Hendrik
Lorentz, j’ai été mal compris des physiciens, qui
d’ailleurs ne connaissent souvent mes vues que
par ouï-dire, par des résumés inexacts et même
complètement faux (1). »
Il faut reconnaître qu’il n’a pas été beaucoup mieux servi par les philosophes. Les plus
favorablement disposés à son égard se sont souvent accommodés d’un silence pudique ou
embarrassé qui masquait en général une réelle incompétence en matière de physique. Ce qui
revenait, en pratique, à s’en remettre à l’autorité des scientifiques pour ne retenir finalement de
Durée et simultanéité, l’objet du délit, que des mises au point éclairantes concernant quelques
concepts centraux du bergsonisme (2). L’enjeu réel de la confrontation tentée par le livre se
trouvait dès lors escamoté. Il était pourtant considérable, puisqu’il s’agissait d’établir que la
métaphysique de la durée est à même de produire une philosophie de la nature ou une cosmologie
compatible avec la théorie physique. Dans cette confrontation, la philosophie bergsonienne se
jouait tout entière, à ses risques et périls. C’est que le rapport entre philosophie et science, tel que
le conçoit Bergson, n’est pas un rapport d’extériorité, ou d’indifférence : il est de voisinage, parfois
d’empiétement, en tous cas de fécondation réciproque. Comme le dit Jean Gayon, s’il existe une
philosophie bergsonienne des sciences, elle est nécessairement « interventionniste » (3). C’est dire
que la philosophie bergsonienne ne peut sortir entièrement indemne de sa confrontation avec la
relativité. En retour, la conception que les physiciens se font de la portée philosophique de leur
propre théorie ne peut échapper au traitement que le philosophe leur fait subir, si du moins sa
critique ne manque pas complètement sa cible - ce qui reste à établir.
Précisons les choses. Si l’articulation de la philosophie et de la science que définit le bergsonisme
est une relation active, elle n’est pourtant ni de fondation (ou de surplomb), ni de rectification (ou
de critique interne) : philosophie et science travaillent pour ainsi dire « bord à bord », en
s’éprouvant mutuellement « tout le long de leur surface commune » (4). Dans la préface de Durée
et simultanéité, Bergson parle bien d’une « confrontation » ; mais il précise aussi que la
philosophie et les sciences sont faites pour « se compléter ». C’est le sens de cette relation de
complémentarité tendue qu’il convient d’éclaircir dans le cas précis de la théorie de la relativité,
avant de se prononcer trop vite pour un règlement à l’amiable, qu’il soit suggéré par les

philosophes ou par les physiciens. Les premiers voudraient battre en retraite tout en conservant
indemne le noyau « philosophique » des analyses bergsoniennes : la philosophie de Descartes est-
elle réfutée par sa théorie des tourbillons ou de la glande pinéale ? Quant aux physiciens, ils
réclameraient plutôt un partage clair des activités : en somme, ce serait « à chacun son temps », à
moins qu’on ne considère avec Einstein qu’il ne saurait y avoir, outre le temps psychologique et
le temps physique, un troisième temps qui serait « le temps du philosophe » (5). Mais l’idée même
que Bergson se fait de la philosophie ne peut se satisfaire d’aucun de ces régimes de coexistence
pacifique.
L’affaire se complique d’ailleurs du fait qu’il est difficile de dire où et en quoi exactement Bergson
se trompe, ni comment il peut persister dans son erreur en dépit des mises au point répétées que
lui ont adressées certains physiciens et qu’il a parfois eu soin de reproduire dans les appendices de
son livre. Dans une remarque maintes fois rapportée, Einstein parle des « bévues » ou des
« boulettes monstres » commises par le philosophe d’un point de vue strictement physique, mais
sans préciser davantage (6). Qu’en est-il au juste ? Bergson se trompe-t-il dans la restitution du
contexte historique de l’électromagnétisme ? Dans la dérivation des transformations de Lorentz ou
leur interprétation physique ? Dans la lecture qu’il donne des notions de système de référence ou
de simultanéité ? Dans sa présentation de la géométrie de Minkowski et de ses invariants ? Dans
la formulation du paradoxe de Langevin ou dans l’énoncé de ses conditions ? A-t-il restitué de
manière incorrecte, ou simplement faussé, le sens des exposés de Langevin, de Becquerel, de
Cunnigham, de Silberstein ou d’Eddington ? A-t-il mal compris les livres de Whitehead, ou les
études de C. D. Broad qu’il cite également dans ses notes ?
On invoque souvent, pour preuve de l’aveuglement de Bergson, son laborieux commentaire du
paradoxe du « voyage en boulet » (plus connu aujourd’hui comme le « paradoxe des jumeaux » de
Langevin), et le fait qu’il en refuse la conclusion pourtant inévitable d’un vieillissement inégal des
jumeaux. Encore faudrait-il prendre la mesure de la singularité de la méthode employée par le
philosophe, se familiariser avec les procédés que sa critique met en œuvre, le genre d’exercices ou
de « travaux pratiques » qu’elle suppose. Car il est clair que Bergson n’a pas voulu, avec Durée et
simultanéité, juger de la valeur scientifique de la théorie d’Einstein - d’ailleurs envisagée, pour
l’essentiel, dans sa formulation « restreinte ». A aucun moment le livre ne prétend rectifier certains
résultats relativistes sur le terrain même de la physique. Il est d’ailleurs difficile de croire que
Bergson ait pu être assez naïf ou prétentieux pour s’imaginer pouvoir pointer des erreurs
« matérielles » qui auraient échappé aux meilleurs physiciens de son temps. Aussi les effets
paradoxaux liés à la relativisation de la notion de simultanéité entre événements distants ne sont-
ils jamais directement en cause, pas plus que ne l’est la relativité de la simultanéité elle-même,
dans les conditions définies par le physicien (DS 54 / 108). C’est l’interprétation spontanément
réaliste de ces effets en termes de durées déphasées qui est problématique ; c’est sur elle que se
concentre l’essentiel de la critique bergsonienne. Ceux qui considèrent qu’une telle interprétation
fait partie intégrante de la théorie auront sans doute du mal à admettre ce point. C’est pourtant à
faire sentir le jeu entre la théorie et ses interprétations que s’emploie constamment Bergson (7).
On verra comment il convient d’aborder la « réfutation » du paradoxe des jumeaux, mais on ne
saurait trop marquer d’emblée le caractère de « second degré » de ce type d’analyses (8).
Cependant, Bergson n’entend pas proposer à son tour une interprétation « bergsonienne » de la
relativité qui l’accorderait à une philosophie préalable. Il travaille à partir de « l’hypothèse
d’Einstein prise à l’état pur » (DS 25-26 / 85), dans l’écart qu’elle marque par rapport aux
interprétations que la théorie charrie avec elle, et parfois malgré elle. Ces interprétations sont

soumises à une série d’opérations réglées. C’est pourquoi il invite son lecteur à le suivre pas à pas,
pour ainsi dire crayon en main, multipliant les angles d’attaque, reprenant les mêmes questions
sous différentes perspectives, selon un mouvement en spirale qui fait de ce livre un des plus denses
et peut-être les moins accueillants de toute son œuvre. Croit-on que Bergson se serait donné tant
de peine s’il attendait seulement de la théorie d’Einstein, rectifiée par ses soins, la simple
confirmation d’une métaphysique qu’il aurait développée par ailleurs ?
Les choses se sont passées différemment : contre toute attente, la théorie de la relativité venait
« compléter, et non pas seulement confirmer » (DS x / 60) la pensée de la durée, de sorte que
Bergson pouvait y chercher, jusque dans les paradoxes et les malentendus qu’elle suscitait, une
impulsion nouvelle pour prolonger et développer pour son compte des questions liées à la
spatialisation du temps, au rapport entre l’expérience de la durée et sa mesure, et plus
profondément à la coexistence et au mode de connexion des durées de l’univers sur quoi repose
en fin de compte la possibilité d’une unité non transcendantale de l’expérience. « Nous avons tenté
jadis un effort dans cette direction. La théorie de la Relativité nous a fourni l’occasion de le
reprendre et de le conduire un peu plus loin » (DS xi / 60). C’est que la théorie d’Einstein vaut
mieux que l’interprétation philosophique qui vient généralement l’habiller : elle constitue en elle-
même, à condition qu’on sache le voir, « un très grand progrès, non seulement du point de vue
physique, mais aussi du point de vue philosophique » (9) ; elle n’apporte « pas seulement une
nouvelle physique mais aussi certaines manières nouvelles de penser » (DS ix / 59). Et comme
souvent chez Bergson, la reconquête de l’intuition relativiste n’est pas séparable des gestes qui
viennent défaire les faux problèmes suscités par la pente métaphysicienne de l’intelligence
ordinaire. C’est tout l’enjeu critique du livre.
Il est heureux que des physiciens plus circonspects rouvrent aujourd’hui le dossier et reviennent
aux sources pour juger sur pièces (10). Mais s’il est salutaire de se demander sans préjugés jusqu’à
quel point les analyses de Durée et simultanéité peuvent s’accorder avec les vues d’un physicien
relativiste, il est tout aussi important de s’assurer de leur portée exacte en les évaluant en fonction
du projet et des problèmes qui furent ceux de Bergson. Si ce projet et ces problèmes sont de nature
philosophique, et même métaphysique, ils réclament donc une lecture particulière. En rappelant à
un de ses premiers critiques (André Metz) qu’« on peut être un physicien éminent et ne pas s’être
exercé au maniement des idées philosophiques » (11), Bergson ne cherchait pas à creuser un peu
plus profondément le fossé entre les « deux cultures » (les sciences et les humanités), il opposait
au contraire aux appels à l’autorité et aux revendications de compétence une formulation opératoire
du malentendu dont témoignait la réception de son livre : « la philosophie, comme le reste, a besoin
de s’apprendre » (12). Quel était le problème philosophique auquel la théorie de la relativité
permettait de donner sa formulation rigoureuse ? C’est ce qu’il faut s’employer à éclaircir. Mais
quelle que soit la manière dont on se figure la torsion que Bergson fait subir à la théorie d’Einstein,
on se gardera de lui faire deux faux procès.
1°) L’unité du temps réel
En premier lieu, on évitera de reprocher à Bergson de vouloir revenir, en deçà de la relativisation
einsteinienne des notions de temps et d’espace, à un temps absolu à la manière de Newton. Il n’a
jamais été question pour lui de restaurer, telle quelle, l’idée d’un présent instantané et universel,
distribué de manière univoque sur tous les points de l’espace. La notion même de durée, pensée
de manière intensive, interdit un retour pur et simple au temps mathématique et homogène, ce
temps spatialisé dont le présent universel constituerait le front immuable et changeant, déroulant
d’instant en instant, comme un ruban, le cortège des événements de l’univers. Plus précisément, la

notion de durée emporte deux conséquences. Tout d’abord, il ne saurait être question de faire du
temps un absolu, c’est-à-dire de le considérer indépendamment de l’écoulement ou du passage de
ce qui change, de manière nécessairement singulière, à travers des processus concrets : on ne
tiendrait plus alors qu’une « durée impersonnelle et homogène, la même pour tout et pour tous,
qui s’écoulerait, indifférente et vide, en dehors de ce qui dure » (MM 232 / 342). Ensuite, s’il se
prononce en effet pour « l’hypothèse d’un Temps matériel un et universel » (DS 44 / 100), Bergson
se soucie moins d’établir l’universalité ou l’unicité d’un temps global - dont les instants successifs
définiraient autant d’(hyper)-plans de simultanéité - que « l’unité du temps réel » (DS 76 / 127),
c’est-à-dire vécu par une conscience ou susceptible de l’être. C’est pour établir rigoureusement
cette unité qu’il doit en passer par le temps de l’univers matériel et sa formalisation physique.
L’unité du temps réel se manifeste déjà dans l’identité des durées internes des consciences
humaines, dont Bergson dit qu’elles marchent pour ainsi dire du même pas ; mais l’expérience de
durées diversement rythmées dans le monde vivant indique aussi qu’une telle unité est compatible
avec une pluralité de flux caractérisés par des rythmes divers, des degrés variables de tension et de
détente. L’unité du temps réel enveloppe donc une multiplicité de coexistence virtuelle (13) : c’est
une unité dynamique de type qualitatif ou intensif, plutôt qu’une unité substantielle abstraite -
qu’on la traduise en termes d’identité numérique ou d’égalité quantitative (intervalles de temps
égaux, rythmes isochrones). Elle doit être pensée en relation avec la durée du Tout de l’univers
dont participent l’ensemble des durées (durées multiples du monde vivant, durée unique du monde
matériel), ce Tout dont Bergson dit par ailleurs qu’il est de même nature que le moi. Et cependant,
cette unité ne peut être pleinement attestée qu’à travers la connexion des durées : il ne suffit pas
de poser l’unité des flux, il faut montrer comment ils s’unifient. L’approfondissement du moi par
lui-même ne peut en donner qu’un pressentiment. L’intuition formalisée - si l’on peut dire - d’une
telle connexion doit être ressaisie en extension dans la trame de l’espace ; elle trouve en définitive
son point d’appui dans l’unité de la durée de l’univers matériel, manifestée à travers les moyens
qu’on se donne de la mesurer.
C’est en ce point précis que la confrontation avec la théorie de la relativité devient inévitable. Mais
pour devancer quelques malentendus, il faut aussitôt insister sur le principe qui règle cette
confrontation. Il peut se formuler ainsi : le temps peut bien être unique sans que les conditions de
sa mesure cessent pour autant de lui conférer un caractère relatif. Telle est en effet la conclusion
la plus paradoxale et la plus méconnue de Durée et simultanéité : « [L]a conception habituelle du
Temps Réel subsiste tout simplement, avec, en plus, une construction de l’esprit destinée à figurer
que, si l’on applique les formules de Lorentz, l’expression mathématique des faits
électromagnétiques reste la même pour l’observateur censé immobile et pour l’observateur qui
s’attribue n’importe quel mouvement uniforme » (DS 167 / 204). On ne saurait mieux dire que ce
qui est refusé n’est pas tant la relativisation du temps-coordonnée opérée par la théorie de la
relativité, que la pluralisation ou la démultiplication des flux temporels qu’elle semble impliquer
lorsque nous confondons les durées coexistant virtuellement dans le Tout de l’univers avec une
pluralité actuelle de durées réellement (et numériquement) distinctes, dont témoignerait la disparité
quantitative des mesures relatives (14). En somme, la relativisation des temps associés au repérage
global de l’espace-temps effectué par les systèmes de coordonnées n’atteint pas le temps indexé
sur les processus concrets dont une conscience pourrait suivre le flux. Bergson n’en demande pas
davantage pour que l’univers ne se vaporise pas en une infinité de « mondes indépendants les uns
des autres » (DS 44 / 100). Est-ce déjà plus qu’on ne peut accorder ?
2°) Temps local et temps global

En deuxième lieu, et pour revenir à la distinction faite par Einstein entre le temps de la conscience
et le temps du physicien, Bergson n’a aucune intention de substituer à la construction physique du
temps une notion psychologique du temps vécu : il ne s’agit pas de choisir entre les deux, mais de
les articuler. Il n’ignore d’ailleurs nullement que la distinction capitale qu’il introduit pour sa part
entre temps « réels » (susceptibles de coïncider avec le flux d’une conscience située au voisinage
des processus correspondants) et temps « fictifs » (temps reconstruits, objets de mesures
indirectes) ne présente aucun intérêt pour le physicien aux yeux duquel toutes les grandeurs
mesurées sont également « observables », qu’il s’agisse du « temps propre » mesuré « sur place »
ou du « temps-coordonnée » indexant les moments d’un système distant. Il ne cesse de répéter au
contraire qu’une telle distinction n’a de sens que pour le philosophe, qui est d’ailleurs obligé de
l’introduire de force dans le plan de référence et de coordination du physicien en revenant aux
opérations qui guident ses constructions, en deçà du formalisme qui finit par placer tous les temps
« au même rang », « sur le même plan » (DS 207 / 236-237). Mais que le temps fictif soit
observable - quoique de manière indirecte, comme le fait remarquer Le Roy (15) - ne suffit pas à
en faire un temps réel, c’est-à-dire un temps susceptible d’être vécu par une conscience vivante.
Voilà ce qu’il faut reconnaître. Même le travail de coordination du physicien opérant se ramène
finalement, d’un côté à des constats de simultanéités locales (par là même absolues) entre signaux
et relevés d’horloges, de l’autre à des successions éprouvées à travers les phases d’un processus
lui-même ressaisi localement ou, ce qui revient au même, de proche en proche. L’expression des
durées en grandeurs invariantes ou « propres » (« temps propres ») donne déjà une idée de cette
approche locale sur le terrain des « observables » du physicien, même s’il s’agit encore, en
l’occurrence, d’une détermination globale du temps (16).
Pour Bergson, la racine du problème est dans l’idée même de simultanéité. C’est sur ce point que
divergent deux manières de formaliser la question de la coexistence des durées de l’univers ; mais
c’est sur ce point aussi qu’un travail de raccordement est possible, le long de la « surface
commune » à la science et à l’expérience. Il revient alors au philosophe de montrer qu’il existe
une forme de solidarité entre la simultanéité indirecte et artificielle définie entre événements
distants par des conventions sur les signaux optiques, et la simultanéité vécue dans la coïncidence
locale de deux flux (un processus mesuré et un processus mesurant) qui, en se déployant pour une
conscience, participent du même coup à sa durée interne. Seule cette solidarité, qui est en réalité
un rapport de présupposition (de la seconde par la première), justifie qu’on continue à parler de
« temps » à propos des grandeurs variablement « dilatées » que le (méta)physicien relativiste
attribue aux systèmes en mouvement : « car on ne peut concevoir un temps sans se le représenter
perçu et vécu » (DS 47 / 102). Autrement, nous n’aurions affaire qu’à une simple coordination des
phénomènes, selon une relation abstraite de succession. Bref, si c’est bien du temps que l’on
mesure, il faut s’assurer qu’on a encore une prise sur ce qui dure, sur le temps réel qui est d’abord
un temps local - non au sens où Lorentz ou Poincaré pouvaient l’entendre, mais par opposition au
temps global ou temps-coordonnée défini par le physicien relativiste lorsqu’il quadrille l’espace
de systèmes de coordonnées associés à des réseaux d’horloges synchronisées par des signaux
optiques (selon la procédure définie par Einstein dans son article de 1905).
On retrouve ainsi le premier problème, celui de l’unité du temps réel. Le chapitre V de Durée et
simultanéité est tout entier consacré au problème de l’unité pour ainsi dire « topologique » (en tous
cas, non métrique) de l’intervalle temporel. L’exercice intuitif mené sur les « figures de lumière »
y révèle cette unité sous les distorsions que font subir à une même durée figurée par des trajets de
lumière ses transpositions sous différentes perspectives, à mesure que l’on fait varier la vitesse du
système en mouvement. En somme, il s’agit de ressaisir concrètement, c’est-à-dire intensivement,
 6
6
 7
7
1
/
7
100%