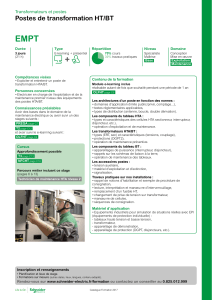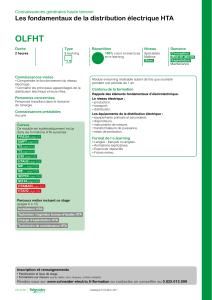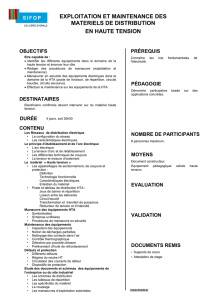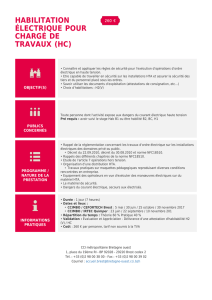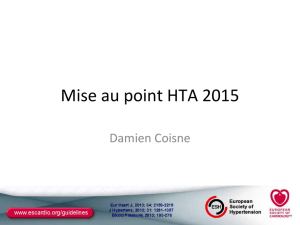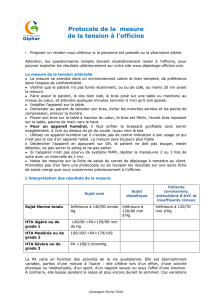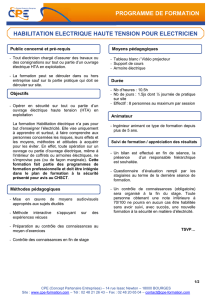stic_2011-Sapoval

ANNEXE 2
769785946
1
A renvoyer au DRCD, exclusivement par email à jean-charles.wintrebert@sls.aphp.fr, au plus
tard le 25 octobre à 12h.
Le document sera ensuite envoyé à la DGOS par le DRCD.
TECHNIQUES INNOVANTES COUTEUSES
Hors champ cancérologie
FICHE DE PROPOSITION
D’UNE INNOVATION PAR L’ETABLISSEMENT
Nom de l’établissement : Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Rang de proposition donné par l’établissement à l’innovation :
Ce rang sera déterminé par le jury interne à l’AP-HP qui se réunira le 27 ou le 28 octobre.
Intitulé de l’innovation proposée :
Dénervation sympathique rénale par ablation intra-artérielle avec courant de radiofréquence
dans le traitement de l’hypertension artérielle résistante.
Caractère de l’innovation :
Thérapeutique Diagnostique □ Organisationnelle □ Autre □
Spécialités ou disciplines concernées par l’innovation (3 au maximum pour la même innovation) :
1. Radiologie Interventionnelle
2. Cardiologie et maladies vasculaires
3. Néphrologie
Si dispositif médical innovant, date du marquage CE : 28 Février 2008 auprès de la British
Standards Institution. Valable jusqu’au 27 Février 2013
Références d’un PHRC terminé s’il y a lieu (année, titre, coordination, co-investigateurs, résultats) :
Non applicable
Citer les 3 principaux articles de la littérature internationale répertoriés dans Medline validant
cliniquement l’innovation et attestant son importance clinique (auteurs, titre, revue, année,
tome, pages) :
1. Krum H, Schlaich M, Whithbourn R, Sobotka PA. et al. Catheter-based renal sympathetic
denervation for resistant hypertension: a multicenter safety and proof-of-principle cohort study.
Lancet 2009;373:1275-1281
2. Schlaich MP, Sobotka PA, Krum H, Whitbourn R, Walton A, Esler MD. Renal denervation as a
therapeutic approach for hypertension. Novel application of and Old Concept. Hypertension 2009:
54: 1-7
3. DiBona GF, Esler M. Translational medicine: the antihypertensive effect of renal denervation.
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2010 Feb; 298(2):R245-53. Epub 2009 Dec 2.

ANNEXE 2
769785946
2
Affection concernée et présentation de la proposition d'innovation :
1. Affection concernée :
Patients ayant une hypertension artérielle (HTA) résistante à une trithérapie antihypertensive
incluant un diurétique selon les critères définis par la HAS (pression artérielle, PA, > 140 ou 90
mmHg chez l’hypertendu tout venant ou > 130 ou 80 mmHg chez le l’hypertendu diabétique ou ayant
une néphropathie protéinurique)
2. Présentation de la proposition d’innovation :
La dénervation sympathique rénale par ablation intra-artérielle (ou dénervation rénale, DR), consiste
à interrompre par radiofréquence l’innervation sympathique afférente et efférente dans l’adventice
des artères rénales. Le courant de radiofréquence est délivré dans les deux artères rénales par une
électrode de dispersion de courant de radiofréquence située à l’extrémité d’un cathéter spécifique à
usage unique introduit par voie trans-fémorale (Symplicity® Catheter System, Ardian, USA) connecté
à un générateur de courant de radiofréquence. L’intervention, réalisée sous sédation-analgésie en
salle d’angiographie, dure environ 30 à 45 minutes.
Cette technique s’appuie sur un pré-requis ancien. Dans de nombreux modèles animaux, la DR
bilatérale prévient le développement ou atténue l’importance de l’HTA. Les premiers essais
chirurgicaux de DR dans les années 1960 à 1970 (intervention de Smithwick), réservés à des
patients ayant une HTA très sévère, ont montré l’efficacité de l’approche en permettant une
réduction tensionnelle importante, mais l’intervention chirurgicale était lourde et se compliquait
fréquemment d’une hypotension orthostatique sévère et mal tolérée, d’impuissance etc.
La mise au point de cathéters permettant d’appliquer un courant de faible intensité au contact de la
paroi artérielle rénale par voie endovasculaire pour détruire les filets nerveux sympathique présents
dans l’adventice artérielle, a relancé la DR dans le traitement des formes sévères d’HTA. Une étude
préliminaire de faisabilité, non contrôlée (Krumm et al) a été menée sur 45 patients hypertendus,
résistants (PA = 177/101 mm Hg) malgré trois antihypertenseurs dont un diurétique. La DR par
ablation endovasculaire a entraîné une baisse importante de la PA systolique/diastolique
respectivement à 1, 3, 6, 9 et 12 mois de : -14/-10 mm Hg, -21/-10 mm Hg, -22/-11 mm Hg, -24/-11
mm Hg et -27/-17 mm Hg avec un traitement de même intensité. Les complications directes liées à
la procédure ont été rares : une dissection de l’artère rénale liée à la mise en place du cathéter,
traitée avec succès par stent, et un faux anévrysme au point de ponction, traité médicalement avec
succès. Aucun des 18 patients ayant un contrôle angiographique à 1 mois n’avait d’anomalie de
l’artère rénale ou du rein d’aval. Le suivi morphologique, disponible en IRM chez 14 patients à 6
mois, n’a pas montré d’anomalie de la paroi artérielle rénale tronculaire. Il n’y a pas eu d’altération
de la fonction rénale après la procédure.
L’efficacité et la sécurité de la DR utilisant le Symplicity® Catheter System est en cours
d’évaluation dans un essai randomisé contrôlé HTN2 auquel le groupe de l’Hôpital Européen
Georges Pompidou a participé (analyse en cours).
Nombre de malades pour la France entière susceptibles de bénéficier de l’innovation en une
année (population cible) :
En appliquant les taux de prévalence observés dans les deux études ENNS (2006-2007) et MONA
LISA aux derniers chiffres de population publiés par l’INSEE pour 2009, on estime la prévalence de
l’HTA à 12 millions de personnes entre 34 et 74 ans et 13 millions entre 18 et 74 ans, soit 31 % de la
population adulte française. L’incidence annuelle de l’HTA en médecine de ville issue de l’enquête
sur le panel THALES, réalisée auprès de 1300 médecins de ville et extrapolée sur la base de 56000
médecins généralistes est de 1,7 million en 2006 contre 1,9 million en 2004 et 2005 (CSD-Th@les
2007).
La proportion de patients pour lesquels l’HTA n’est pas normalisée (<140mmHg et une <90mmHg)
parmi les hypertendus traités (18-74 ans) est de 49% dans l’étude ENNS (femmes : 58%, hommes :
42%) et de 24% pour les hommes et 39% pour les femmes dans l’étude MONA LISA (35 -74 ans).
Cette proportion ne tient pas compte du nombre de traitements antihypertenseurs pris et de leur
nature. Le données de la CNAMTS (2006) montrent qu’environ 26% des hypertendus sont traités par
plus de trois antihypertenseurs en France.
La prévalence de « l’HTA résistante » selon le critère ci-dessus est moins bien connue. Elle est
estimée à 5% dans la population générale et serait comprise entre 15 et 25 % dans les services

ANNEXE 2
769785946
3
spécialisés, tel que celui de l’hôpital Européen Georges Pompidou (25%). Cette proportion doit être
corrigée en tenant compte des contraintes anatomiques (longueur et diamètre des artères rénales)
liées à la technique de DR qui ne permettent pas d’appliquer la méthode chez environ 10% des
patients.
On peut donc estimer qu’environ 3 % de la population adulte est susceptible de bénéficier de ce
nouveau traitement en France, soit entre 300 000 et 500 000 patients.
En l’absence de l’innovation, technique, traitement ou méthode de référence, actuellement
utilisés dans la même indication ?
L’ensemble des recommandations internationales a défini « l’hypertension résistante » comme
l’impossibilité d’atteindre l’objectif tensionnel de 140/90 mmHg chez un patient traité par une
association de trois médicaments antihypertenseurs dont un diurétique. Après avoir éliminé une
erreur de mesure tensionnelle, des facteurs iatrogènes (alcool, médicaments hypertenseurs) et
environnementaux (apports sodés excessifs, obésité), une HTA secondaire et une mauvaise
observance au traitement, la prise en charge thérapeutique ultérieure n’est pas standardisée
actuellement. Les recommandations de la HAS et des sociétés savantes Internationales préconisent
la prise en charge par un centre spécialisé, un renforcement de l’intensité des traitements
(notamment diurétiques mais sans autre précision d’utilisation, l’ajout d’un antialdostérone,
d’antihypertenseurs centraux…) l’utilisation des combinaisons d’antihypertenseurs en un seul
comprimé et un suivi renforcé en particulier par l’automesure tensionnelle.
Bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé pour le patient du fait de la mise
en œuvre de l’innovation, en particulier par rapport à la technique, traitement ou méthode de
référence :
Il s’agit de patients en situation d’échec thérapeutique, pour lesquels la seule alternative à ce jour est
l’ajout de multiples classes d’antihypertenseurs suivi de la titration des doses, cette escalade étant
adaptée à la réponse tensionnelle et à la tolérance clinico-biologique des traitements. Les résultats
de cette approche thérapeutique restent incertains en termes de succès tensionnel. L’ajout successif
de médicaments antihypertenseurs et la titration de dose exposent à une augmentation du risque
d’effets secondaires et de l’inobservance au traitement. L’HTA résistante s’accompagne d’un risque
majeur d’atteinte des organes cibles et de morbi-mortalité cardiovasculaire. En effet, la probabilité
d’événement cardiovasculaire majeur est directement corrélée au niveau de la PA sous traitement. Il
est donc impératif de tenter d’améliorer le contrôle tensionnel car le bénéfice de l’abaissement
tensionnel pour le patient hypertendu est amplement démontré : Le traitement médicamenteux de
l'HTA permet de diminuer le risque d'accident cardiovasculaire comme le montre la récente méta-
analyse de 147 essais contrôlés. Cette étude montre qu’une réduction de pression artérielle (PA)
systolo/diastolique de 10/5 mmHg sous traitement diminue le risque d’évènements coronaires de 22
% (IC95% :17-27) et cérébraux (AVC) de 41 % (IC95% :33-48). La méta-analyse des BP-Trialist a
montré qu’une réduction tensionnelle systolique/diastolique supplémentaire de 4/3 mmHg par
rapport à un contrôle tensionnel classique réduisait le risque relatif d’événements CV de 15 %. La
réduction tensionnelle doit être obtenue assez rapidement. En effet, dans l’essai VALUE, comparant
le valsartan à l’amlodipine chez 15 245 patients de plus de 50 ans et à haut risque cardiovasculaire,
la différence moyenne de PA systolique de 3,8 mmHg observée dans les trois premiers mois entre
les deux traitements est associée à une diminution significative du risque relatif d'AVC et
d'événements cardiaques pendant cette période
Les résultats préliminaires de la DR (Krumm et al.) suggèrent que les patients ayant une HTA
résistante puissent bénéficier grandement de cette technique. L’amplitude exacte de ce bénéfice et
sa fréquence ne sont pas encore précisément connus. Les résultats de l’essai contrôlé randomisé en
cours comparant la DR au traitement médicamenteux usuel (HTN 2) permettront de préciser ces
points. Ils sont attendus fin novembre 2010.
Estimation du coût (annuel) de l’innovation pour un patient :
Le geste de DR n’aura lieu qu’une seule fois cours d’une hospitalisation de 48 h dont les coûts
s’approchent de ceux habituellement pratiqués au cours d’une angioplastie artérielle rénale avec ou
sans endoprothèse. Il faut y ajouter les coûts i) d’une consultation pré-procédurale et d’un acte per-
procédure d’anesthésiologie, et ii) du dispositif avec son amortissement.

ANNEXE 2
769785946
4
Les coûts estimés par patient sont les suivants :
Hospitalisation de 48 h : pour les GHM concernés facturation entre 2000 et 3000 €
Parmi les coûts imputés sur ces GHM :
- Angioplastie rénale EDAF007 + YYYY240 soit 730 €,
- Dans le même GHM, le dispositif (cathéter et son générateur) coûte 4000 €
Total estimé par patient: environ 9000 €
Autres précisions sur la proposition :
La DR par voie endovasculaire a aujourd’hui une place réduite dans la prise en charge des patients
hypertendus. L’objectif de notre étude est d’évaluer sa place dans l’arsenal thérapeutique chez des
patients ayant une HTA résistante avant de proposer cette intervention à un grand nombre de
patients. Le plan expérimental sera choisi en fonction des résultats de l’essai contrôlé randomisé
HTN2 mené par la société ARDIAN dont les résultats seront présentés fin novembre au congrès de
l’American Heart Association. Elle doit aussi tenir compte de l’expérience parisienne préliminaire :
sur 25 patients éligibles pour l’essai, 13 ont refusé de participer et 2 ont retiré leur consentement
après inclusion.
Plusieurs alternatives sont possibles à ce stade :
- un essai randomisé de supériorité, comparant la DR immédiate à la DR différée après 6 mois
- une étude de cohorte restreinte avec un groupe contrôle contemporain
- un essai pragmatique de type « contrôlé » niché dans la cohorte (cohort multiple randomised
controlled trial)
Le choix reposera aussi sur l’intérêt d’évaluer les résultats de la DR en termes médical et
économique dans un contexte clinique quotidien, ce qui présente l’intérêt d ‘une « applicabilité » tant
clinique qu’économique plus directe qu’une étude randomisée contrôlée. Elle fournira aux autorités
de santé des éléments quantitatifs nécessaires à la décision de diffusion et de remboursement de la
technique.
Quel que soit le plan expérimental retenu, l’étude répondra à des critères de validité internes de
qualité listés ci-après.
Les patients éligibles auront les critères d’inclusion et de non-inclusion suivants:
Critères d’inclusion
- Patients des 2 sexes âgés de 18 à 75 ans
- ayant une HTA résistante documentée par une mesure ambulatoire de PA (MAPA) diurne > 135 ou
85 mmHg après une période filtre sous trithérapie par hydrochlorothiazide 25 mg/j + amlodipine 10
mg/j (ou diltiazem 300 mg/j ou verapamil 240 mg/j) + un antagoniste du système rénine angiotensine
dont on puisse quantifier l'observance (ramipril 10 mg/j, irbesartan 300 mg/j ou aliskiren 300 mg/j)
- une HTA dont le caractère « essentiel » a été documenté lors d’un bilan datant de <2 ans
- dont l’imagerie montre la faisabilité de la DR (artère rénale unique ou dominante de chaque côté,
dont le tronc mesure >2 cm de long et plus de 4 mm de diamètre)
- ayant un débit de filtration glomérulaire ≥ 40 ml/min estimé par la formule du MDRD
- Consentement éclairé signé
Critères de non-inclusion
- diabète de type I
- insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire < 40 ml/min
- Sténose artérielle rénale présente ou préalablement dilatée
- athérome aortique sévère, thrombose aortique basse, problème d’accès vasculaire ilio-fémoral
- accident cardio- ou cérébrovasculaire aigu datant de moins de 3 mois.
- obésité (BMI > 35 kg/m2) avec impossibilité de mesure de la PA
La distribution entre groupe DR et groupe témoin sera fonction du plan expérimental sélectionné et
reposera sur le choix éclairé du patient après information écrite et orale sur les alternatives (DR ou
médicaments seuls)
Suivi Clinique et Biologique

ANNEXE 2
769785946
5
Le suivi vise le meilleur soin courant. Il utilisera un algorithme de traitement défini au cours d’une
étude précédente (PHARES) réalisée par le centre d’HTA de l’HEGP. En complément de la
trithérapie décrite ci-dessus, l’algorithme conduit à ajouter successivement un antialdostérone
(spironolactone 25 mg/j), le furosémide (20 puis 40 mg/j), l’amiloride 5 mg/j avec comme objectif
tensionnel une PA de consultation < 140 et 90 mmHg. Il utilisera aussi une téléréunion mensuelle
présentant de façon standardisée et anonyme les données du patient (PA, traitement, biologie
simple, tolérance, événements etc.) sur un document pré-formaté. Un contrôle de MAPA sera obtenu
à 6 mois et un contrôle de MAPA et d'imagerie rénale à 12 mois. . Les patients dénervés sont revus
à 2 ans pour contrôler leur imagerie rénale.
Critères d’évaluation:
- PA en MAPA à 6 mois évaluée à l’insu de la procédure
- Délai pour obtention du contrôle tensionnel en PA clinique confirmé par la MAPA (PA diurne < 135
et 85 mmHg)
- Nombre, nature et dose des antihypertenseurs utilisés
- Préférence des patients
- Qualité de vie (SF36) et EuroQol5D (mobility, self care, usual activities, pain/dysconfort,
anxiety/depression)
- Evolution de la fonction rénale (créatinine et protéinurie)
- Morbidité de la DR évaluée selon l’échelle en 5 grades de Clavien-Dindo
- Observance du traitement médical par une méthode objective (dérivés urinaires ou plasmatiques)
- Évènements cardio- et cérébrovasculaires et rénaux
- Analyse économique
Nombre de patients à inclure
Au jour de la rédaction de cette lettre d’intention les résultats de l’étude randomisée HTN 2 qui a
inclus 120 patients ne sont pas connus. On se fixe a priori comme limite supérieure de patients à
inclure le nombre de 120 patients. Ce chiffre sera ajusté en fonction du résultat de l’essai HTN2 et
du plan expérimental choisi.
En cas d’essai randomisé, le risque alpha sera fixé à 5% et le risque béta à 20% pour le calcul du
nombre de sujets nécessaires. La randomisation sera réalisée par permutation de blocs aléatoires et
stratifiée par centre et de type 1 :1.
Faisabilité du projet
Le centre de l’HEGP (Prof. PF Plouin) coordonne le réseau National des Centres d’Excellence en
HTA accrédités par la Société Européenne d’HTA (n= 12) qui ont tous donné leur accord de
participation. A chaque médecin spécialiste en HTA est associé un radiologue interventionnel ayant
une expérience acquise dans le domaine de l’angioplastie artérielle rénale (30 angioplasties au
cours de la carrière). Pour tenir compte de la courbe d’apprentissage de la technique, les
radiologues de chaque centre auront une session de formation. Celle-ci pourra consister :
- à assister à 2 cas à l’HEGP et à un atelier de formation théorique de 2 h
- un tutorat par le Pr Sapoval/ le Dr Pagny (HEGP) qui se déplaceront dans chaque centre pour le
premier cas.
Par ailleurs, il est prévu que l’organisation logistique de l’étude soit coordonnée par le réseau
national des CIC cardiovasculaires (R2C2, Pr F Zannad, Nacy), dont le CIC de l’HEGP fait parie.
Enfin, la Société Française de Radiologie et d’HTA ont classé ce projet comme le projet prioritaire
(STIC).
Analyse Statistiques (Pr Gilles Chatellier, URC HEGP)
Elle sera fonction du plan expérimental.
- Etude de cohorte : elle utilisera la régression logistique pour ajuster sur les variables pronostiques,
ou des scores de propensité
- Essai randomisé : il s’agira de l’analyse d’un essai de supériorité. Les variables d’intérêt seront
analysées avec ajustement sur les valeurs de base.
Volet économique : (Pr Isabelle Durand-Zaleski)
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%
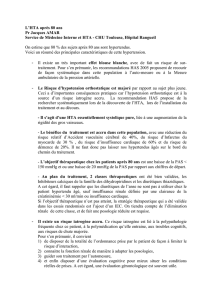
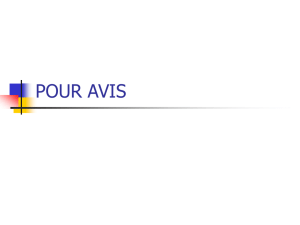

![EXII Exploitation d’une installation industrielle Installations haute tension [nouvelle version]](http://s1.studylibfr.com/store/data/008500893_1-ce1bcbfa853c7dcb5fe9f0d1673b72f8-300x300.png)