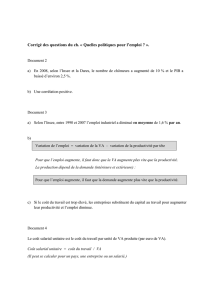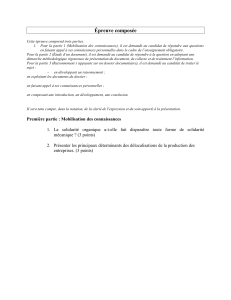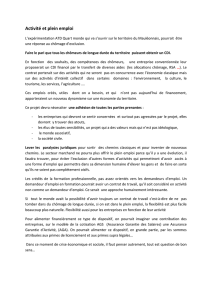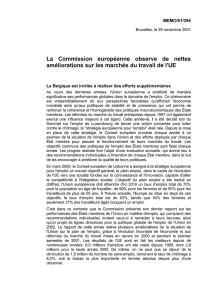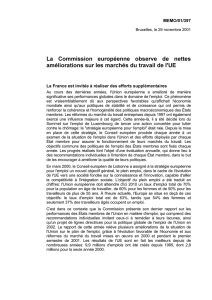Introduction générale :

Section 2 - Les politiques de l’emploi dans les pays européens
Il s'agit tout d'abord d'étudier les explications du chômage actuel. Les rigidités
productives et celles du marché du travail permettent de dégager un faisceau de causes
explicatives de l'accroissement du niveau actuel du chômage, en particulier dans les sociétés
européennes. Il faut insister également sur les explications plus globales du sous-emploi actuel
mettant l'accent sur la transition de paradigme techno - économique. La multiplicité des causes
du chômage va justifier une approche multidimensionnelle des politiques de l'emploi.
A - Les facteurs du chômage en Europe
Le chômage reste encore aujourd'hui un mal affectant principalement les pays
européens par rapport aux Etats-Unis ou aux pays d’Asie. Les facteurs explicatifs de ces
différences sont multiples : progression peu dynamique du PIB, coût du travail élevé pour les
travailleurs non qualifiés, rigidités qui affectent le fonctionnement du marché du travail. A la fin
de la décennie 2000, la situation de l’emploi en Europe évoluait favorablement mais la crise
économique qui a débuté en 2008 a enrayé ce processus positif. Les explications avancées pour
rendre compte du sous-emploi sont multiples ainsi que les solutions envisagées pour y pallier. De
façon synthétique, les causes peuvent être cherchées, d'une part, dans les rigidités du mode de
production dominant actuel (ou mode de production fordiste) et, d'autre part, dans l'implantation
en cours et insuffisante d'un nouveau paradigme techno- économique, assis sur les nouvelles
technologies de l'information et des communications.
1 - Les caractéristiques d’un contexte économique peu favorable
Le chômage européen se caractérise par trois éléments majeurs : un niveau élevé,
l’importance du chômage de longue durée (avec un risque associé de perte d’employabilité), un
chômage des jeunes significatif. En France, le chômage est plus spécifique : un chômage de
longue durée (aujourd’hui un peu moins important que dans le reste de Europe), un chômage des
jeunes en revanche plus élevé (accès plus difficile au premier emploi), un chômage des
travailleurs non qualifiés qui est revenu récemment dans la moyenne européenne et un chômage
des seniors (personnes âgées de plus de 55 ans) faible. Au total, il apparaît que c’est autant par

- 2 -
son taux de chômage élevé que par son faible taux d’activité
1
que la France se caractérise par
rapport à ses principaux partenaires européens. Le taux d’emploi (ou proportion des personnes
disposant d’un emploi parmi celles en âge de travailler) qui reflète la capacité de l’économie à
utiliser son facteur travail était en 2008 de 63,2% en France contre 65,5% en Allemagne, 71,7%
au Royaume-Uni et 63,5% en Espagne. La dégradation de la situation de l'emploi en Europe a
coïncidé avec un ralentissement de la croissance et un dérèglement des mécanismes de
stabilisation du travail, processus qui démarre après le premier choc pétrolier de 1973.
L'insuffisance de la coordination entre les politiques conjoncturelles et l'absence de réaction face
aux dysfonctionnements du marché du travail peuvent être également mises en avant.
a - Le contenu de la croissance en emplois
Si le niveau de la croissance est essentiel pour expliquer les variations du taux
de chômage, le contenu de la croissance en emploi remplit un rôle important pour expliquer
celles-ci. Le lien entre croissance et création d'emploi dépend à terme de l'augmentation de la
productivité apparente du travail qui est égale au rapport entre le PIB et les effectifs salariés. A
niveau de croissance égal, l'augmentation des postes de travail offerts est d'autant plus forte que
la productivité du travail progresse faiblement et que son évolution ne permet pas de répondre à
l'augmentation de la production. A moyen terme, la hausse de la productivité du travail est à peu
près stable, même si dans la courte période, elle varie de façon cyclique en fonction de la
conjoncture (cycle de la productivité). Elle croît en période de reprise (les firmes hésitant à
embaucher) et elle diminue en période de ralentissement (les firmes ne procédant pas
immédiatement à des licenciements). L'impact d'une hausse de la croissance sur l'emploi est
ainsi, au bout de quelques mois, intégrale et proportionnelle, dès lors qu'elle est supérieure à
l'augmentation moyenne de la productivité du travail :
PIB = productivité du travail + emploi
En France, comme dans la plupart des pays européens, le niveau élevé de la productivité
du travail a longtemps atténué l'effet de la croissance sur l'emploi. Ainsi, de 1974 à 1989, la
croissance n'a été créatrice d'emploi qu'au-delà d'un seuil de 2,3% par an contre 0,5% aux Etats-
Unis. Cette productivité relativement élevée s'expliquait par :
1
Selon l’INSEE, le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population
totale correspondante.

- 3 -
- une importante substitution du capital au travail, ce qui entraînait une augmentation
naturelle de la productivité du travail (Y/L) et a contrario, une baisse de la productivité du capital
(Y/K) ;
- un phénomène de rattrapage technologique des pays européens par rapport aux Etats-
Unis, qui s'est achevé au début des années 80 ;
- des difficultés d'embauche pour les travailleurs non qualifiés, engendrant une exclusion
massive de cette population du marché du travail.
Toutefois, depuis 1990, on constate une tendance à la baisse de la croissance annuelle de
la productivité du travail en France, à l'origine de créations d'emplois plus nombreuses. Il
convient de noter que cette baisse de la productivité du travail ne veut pas dire que l’économie
française est moins productive et moins compétitive. Le surcroît d’emploi permet en effet
d’accroître l’utilisation du capital et sa productivité : la productivité totale des facteurs est
préservée. La baisse de la croissance de la productivité s'expliquerait par :
- le développement du temps partiel qui concentre désormais plus de 15% des actifs en
France (proportion plus élevée aux Etats-Unis : 18% ; Royaume-Uni : 24% ; Pays-Bas : 35 %).
- l'allégement des charges sur les bas salaires qui a permis le développement des emplois
dans les services et l'embauche de travailleurs peu qualifiés. La majeure partie des créations
d'emplois a concerné depuis 1993 le tertiaire marchand (en particulier les services aux
particuliers) et dans une moindre mesure le tertiaire non marchand (emplois publics, par
exemple). Simultanément, les effectifs de l'industrie et du BTP (surtout du BTP) diminuaient
légèrement.
A la fin des années 90, la reprise de la croissance économique à un niveau élevé a permis
d’amplifier le retour à de fortes créations d’emplois. L’emploi total a ainsi progressé de 700 000
unités au cours des années 1999 et 2000. On peut noter que la création de 200 000 emplois
s’explique par le dispositif d’emplois aidés du secteur non marchand (emplois jeunes, emplois à
domicile, etc) et 500 000 postes de travail ont été créés dans le secteur marchand. Sur ces
500 000 emplois salariés, l’impact des allègements de charge est estimé à 80 000 unités, celui de
la réduction du temps de travail à 40 000 unités, le reste (plus de la moitié des créations) étant
imputable à la croissance économique.
En résumé, si une croissance forte de la productivité du travail a des effets négatifs sur
l'emploi à court terme, en revanche à long terme, cette réalité est plus nuancée. En effet, les gains
de productivité sont redistribués par les firmes, notamment sous la forme de baisse des prix ou de
hausse des salaires, ce qui conduit à une augmentation de la demande et des salaires réels. La
production est alors appelée à se développer. A long terme, l'impact des gains de productivité sur

- 4 -
l'emploi est donc plutôt positif. On peut ajouter que l’accroissement de la productivité augmente
le niveau de croissance économique potentielle et exerce grâce à l’innovation à laquelle elle est
liée un effet bénéfique sur la compétitivité de l’économie nationale. A long terme, l’impact des
gains de productivité sur l’emploi est donc bénéfique car il influence la croissance économique
(l’emploi n’est plus la variable d’ajustement). C’est ce que montre l’étude du chômage
européen : de 1980 à 1997, la montée du chômage a coïncidé avec un ralentissement de la
productivité du travail et non pas avec une augmentation de celle-ci, tandis que le retour à un
rythme important de productivité et d’innovation, à partir de 1997, s’est accompagné d’une
baisse du chômage. Par ailleurs, la concomitance aux Etats-Unis, depuis 1990, de gains de
productivité élevés et d’une baisse forte du chômage montre le lien qui unit progrès technique,
productivité, croissance et emploi.
b - La progression de la population active
Une partie de la hausse du chômage en France est imputable à la progression
régulière de la population active depuis plus de 30 ans, qui n'a pu être absorbée par le marché du
travail du fait de l'insuffisante création d'emplois. Toutefois, on ne peut ramener la hausse du
chômage à ce phénomènes démographique : en effet, la population active a crû en France de
0,8% par an en moyenne entre 1985 et 2005, c'est-à-dire moins rapidement que dans les autres
pays de l'OCDE (1 %) alors que le taux de chômage y est moins élevé, et moins rapidement
qu'aux Etats-Unis (1,5%) où le chômage y est plus faible. Dans l’avenir, la population active
pourrait s’inscrire en stabilité, ce qui faciliterait la baisse du chômage : là où il fallait créer plus
de 200 000 emplois pour réduire le chômage au début des années 2000, il en faut moins de
100 000 aujourd’hui.
2 - L'existence de rigidités importantes du marché du travail
Des rigidités d'ordre structurel affectent le fonctionnement du marché de travail au
sens large et contribue à expliquer la montée du chômage en Europe.
a - L'apparition d'un chômage structurel important et inégal dans les pays européens
La théorie économique distingue à l'intérieur des taux de chômage trois
composantes dont chacune exige des politiques économiques adaptées :

- 5 -
- une composante conjoncturelle explicative du chômage keynésien
traditionnel dans un contexte économique d'insuffisance de la demande de biens et d'offre
rentable excédentaire ;
- une composante structurelle (on parle de taux de chômage naturel ou
taux de chômage d'équilibre) liée au niveau des coûts salariaux, à la flexibilité du marché du
travail ainsi qu'à l'adéquation des qualifications à l'emploi. C'est le chômage classique : l'offre de
biens est insuffisamment rentable en raison de salaires trop élevés. Chômage keynésien et
chômage classique peuvent coexister dans une même économie, ce qui va nécessiter une
politique économique s'attachant à augmenter la demande (relance budgétaire) tout en améliorant
la flexibilité des salaires réels.
- une composante frictionnelle liée à la recherche d'emploi et aux délais
d'adaptation du marché du travail
La notion de taux de chômage naturel a été mise en évidence par M. Friedman en 1968. Il
est dit d'équilibre parce qu'il correspond à une augmentation des salaires compatible avec une
inflation constante, c'est-à-dire à une situation équilibrée du marché du travail (NAIRU ou Non
Accelerating Inflation Rate of Unemployment). En deçà de ce taux de chômage, les salaires
croissent plus vite que la productivité du travail, ce qui engendre une hausse des prix. Au-delà de
ce taux de chômage, la pression sur les salaires diminue et l'inflation diminue. On peut ajouter
que le taux de chômage naturel dépend de plusieurs facteurs qui renvoient aux caractéristiques
structurelles de l'économie :
- la croissance de la productivité du travail : une baisse de celle-ci doit entraîner une
augmentation moins rapide des salaires réels ; si celle-ci ne se produit pas spontanément, une
hausse du chômage interviendra pour ramener l'élévation des salaires réels dans des limites
raisonnables ;
- la prise en compte dans les négociations salariales de la productivité ;
- la hausse du prix des importations ;
- tous les facteurs contribuant à accroître momentanément le coût du travail (salaire
minimun, cotisations sociales ou impôts) engendrent des tensions inflationnistes et nécessitent
une augmentation du chômage d'équilibre pour arrêter ce surcroît d'inflation.
Dans les faits, le taux de chômage d'équilibre a augmenté dans la CEE de 3,5% avant
1973 à 6,5% en 1990, notamment sous l'effet du freinage des gains de productivité et de la
hausse des prix du pétrole. En 2005, il s'est établi à 6% à cause de la sensibilité croissante des
salaires réels aux évolutions de la productivité. En France, selon la Communauté européenne, ce
taux d'équilibre est relativement plus élevé (7 à 8 % en 2005), ce qui explique en grande partie la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%