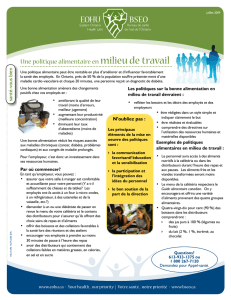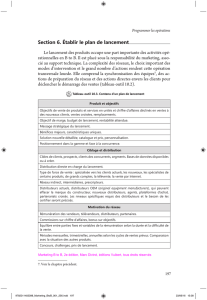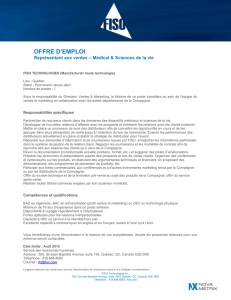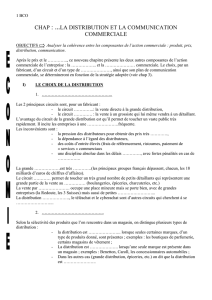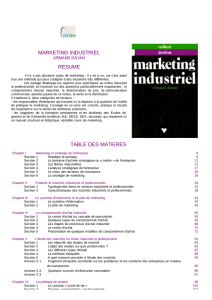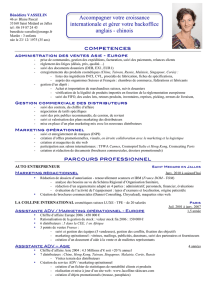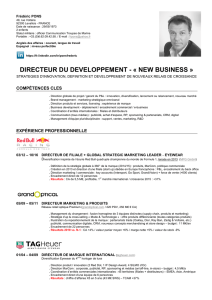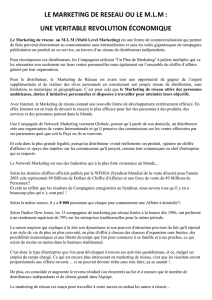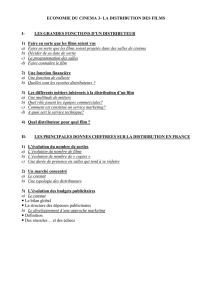Nous allons essayer, tout au long de ce mémoire de comprendre la

Mémoire de maîtrise IUP MARKETING & VENTE 1997-1998
La coopération entre fournisseurs et distributeurs de la grande distribution…
1
INTRODUCTION.
Lors d’un stage au sein de la société CHOCOLAT POULAIN en 1995, en tant que
responsable de secteur, j’ai été très surprise des relations que j’ai pu avoir avec les
distributeurs.
De même, lors d’animation en grandes surfaces, j’ai remarqué toujours que les chefs de rayon
et les fournisseurs entretenaient des rapports difficiles.
Cependant, si les industriels veulent vendre leurs produits, ils doivent le faire en passant par
les distributeurs.
De même, si les distributeurs veulent accroître la fréquentation de leur magasin, ils doivent
proposer suffisamment de produits aux consommateurs.
Fournisseurs et distributeurs sont donc obliger de travailler ensemble, alors pourquoi
n’essayeraient-ils pas d’entretenir des rapports moins conflictuels ? Surtout qu’ils ont tout de
même un objectif commun, qui est la satisfaction du consommateur.
Cette idée paraît très naïve, surtout que ces différentes expériences ne sont certainement pas
représentatives de la vie quotidienne des distributeurs et des fournisseurs.
Cependant, elles m’ont permise de me poser des questions et de m’intéresser de beaucoup
plus près à ce problème.
C’est ainsi que cette étude a vu le jour, car j’ai eu envie d’explorer les rapports actuels entre
les fournisseurs et les distributeurs au travers d’un thème : la coopération.

Mémoire de maîtrise IUP MARKETING & VENTE 1997-1998
La coopération entre fournisseurs et distributeurs de la grande distribution…
2
Je vous invite donc à me suivre dans ma réflexion au travers de ce mémoire qui se
compose de deux grandes partie :
Un cadre théorique qui a pour objet de nous décrire la chaîne distributive
ainsi que les conditions théoriques d’apparition, d’installation et de stabilisation de la
coopération entre les acteurs.
Pour ce faire, nous nous sommes basés sur la théorie du comportement coopératif de Robert
AXELROD.
Une étude exploratoire à travers une analyse de contenu du discours de
distributeurs et de fournisseurs sur leur perception de la coopération.

Mémoire de maîtrise IUP MARKETING & VENTE 1997-1998
La coopération entre fournisseurs et distributeurs de la grande distribution…
3
I) La théorie du comportement coopératif selon Robert AXELROD.
Robert AXELROD nous démontre tout au long de ce livre que la coopération est un
jeu à somme non nulle, c’est à dire que le résultat de la coopération est supérieur aux
bénéfices de l’un ou de l’autre s’il ne coopérait pas.
Robert AXELROD a basé l’ensemble de sa démonstration à partir du dilemme du prisonnier,
de la théorie des jeux et de témoignages d’expériences vécues lors de la première guerre
mondiale.
C’est ainsi qu’il nous démontre la robustesse d’une stratégie DONNANT, DONNANT et les
conditions favorables à l'apparition de la coopération, sa stabilisation et son entretien.
Ainsi, dans un premier temps, nous allons rappeler les différents apports des théories
(dilemme du prisonnier, théorie des jeux) et des témoignages. Ensuite, nous citerons les
conditions théoriques nécessaires pour que la coopération naisse pour enfin essayer de les
appliquer aux relations entre les fournisseurs et les distributeurs de la filière distributive.

Mémoire de maîtrise IUP MARKETING & VENTE 1997-1998
La coopération entre fournisseurs et distributeurs de la grande distribution…
4
I.I) Les apports théoriques.
1) Le dilemme du prisonnier.
a) Explication du dilemme du prisonnier:
Deux joueurs sont en présence. Chacun a deux options : soit coopérer, soit faire
cavalier seul. Chacun doit choisir sans connaître la décision de l’autre. Quoi que fasse l’autre,
il est plus intéressant de faire cavalier seul que de coopérer. Le dilemme consiste en ceci que,
si les deux joueurs font cavaliers seuls, ils s’en tirent moins bien que s’ils avaient coopéré. Ce
jeu simple est le fondement de l’analyse développée par AXELROD.
b) Les limites des théories effectuées sur le dilemme du
prisonnier:
La meilleure tactique dépend en partie de ce que l’autre joueur risque de faire.
L’efficacité d’une stratégie dépend donc non seulement de ses propres caractéristiques, mais
aussi de la nature des stratégies avec lesquelles elle doit interagir.
Les travaux effectués sur le dilemme du prisonnier ne révèle pas grand chose sur la manière
de bien jouer car ils se fondent presque exclusivement sur l’analyse des choix effectués par
des joueurs abordant le jeu pour la première fois.
Une nouvelle approche est donc nécessaire si l’on désire en savoir plus sur le meilleur choix à
faire dans un dilemme du prisonnier itératif.
Cette nouvelle approche va être appréhender à partir des tournois informatiques.
2) Le succès de DONNANT,DONNANT dans les tournois informatiques.
Dans ce type de tournoi, chaque participant rédige un programme qui est l’incarnation
d’une règle permettant de choisir entre la coopération ou la non-coopération à chaque coup.
Le programme connaît l’histoire du jeu jusqu’au coup en cours et peut s’en servir pour
prendre sa décision.

Mémoire de maîtrise IUP MARKETING & VENTE 1997-1998
La coopération entre fournisseurs et distributeurs de la grande distribution…
5
a) Les résultats de la première manche.
C’est «DONNANT, DONNANT», proposé par le professeur Anatol RAPOPORT de
l’université de Toronto, qui remporta le tournoi. Aucun des programmes plus complexes
soumis ne fut capable de faire aussi bien que la version simple de «DONNANT,
DONNANT»
«DONNANT, DONNANT» commence par coopérer, puis fait ce que l’autre joueur a fait au
coup précédent.
Ses propriétés qui le distinguent des autres programmes :
Ce n’est jamais le premier à faire cavalier seul, il est bienveillant.
Son indulgence contribue à restaurer la coopération mutuelle.
En effet, dès qu’un joueur faisait défection, «DONNANT, DONNANT» se montre sévère
pour un coup, mais ensuite pardonne totalement cette défection. Après une punition, il passe
l’éponge.
Il minimise également la défection isolée afin de ne pas déclencher une longue série de
représailles et de contre représailles, car les deux parties pourraient en pâtir.
b) Les résultats de la seconde manche:
Lors de cette deuxième manche, les joueurs connaissaient non seulement les résultats
du premier tournoi, mais aussi les concepts utilisés pour analyser la réussite et les pièges
stratégiques qui avaient été découverts.
«DONNANT, DONNANT» était le programme le plus simple de la première manche et il
l’avait remportée. Ce fût le plus simple de la seconde manche, et il la remporta également.
Tous les participants savaient que «DONNANT, DONNANT» avait gagné la première
manche, mais personne ne fut capable de concevoir un programme plus performant.
Alors qu’une règle explicite autorisait chacun à soumettre le programme de son choix, même
un programme dû à quelqu’un d’autre, seule une personne proposa «DONNANT,
DONNANT» : Anatol RAPOPORT, son auteur.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
1
/
105
100%