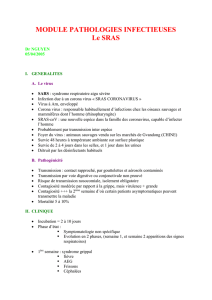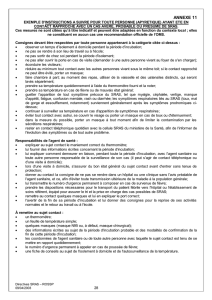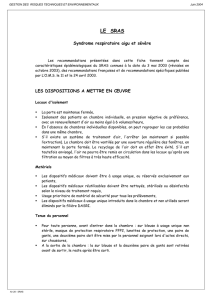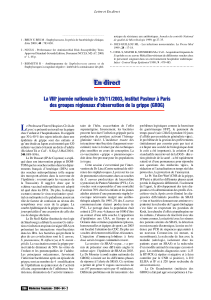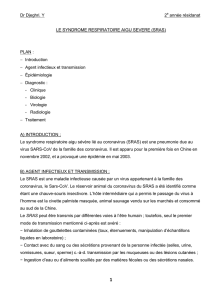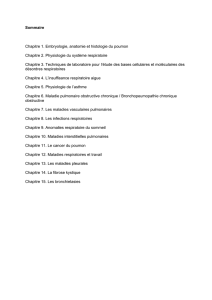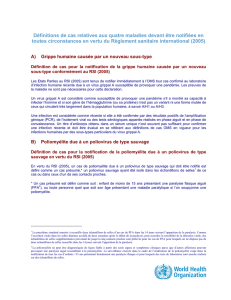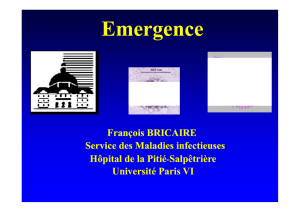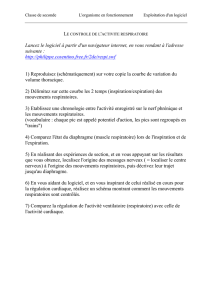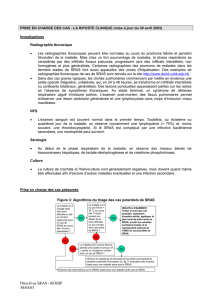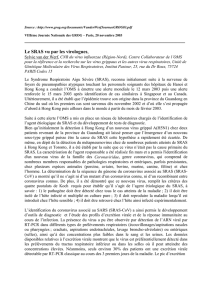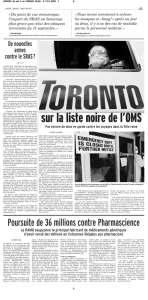Word doc

Directives SRAS - ROSSP
06/05/03
DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA MALADIE (mise à jour du 6 mai 2003)
Historique
Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), pneumonie atypique causée par un coronavirus, a été
diagnostiqué pour la première fois le 26 février 2003 à Hanoi (Vietnam), mais c'est en novembre 2002 que
l'épidémie s'est déclarée, dans la province de Guangdong (Chine).
Du 16 novembre 2002 au 5 mai 2003, 27 pays ont déclaré un total cumulé de 6 583 cas probables (dont
461 mortels) à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'OMS coordonne l'effort international
d'investigation de cette flambée épidémique et travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires
des pays touchés afin de les aider à enrayer l'épidémie et de leur apporter au besoin un soutien clinique et
logistique.
Des foyers de transmission locale ont été principalement observés dans les régions suivantes : provinces de
Beijing, Guangdong et du Shanxi et Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Taiwan, Hanoi
(Vietnam) Singapour et Toronto (Canada). De nombreux autres pays ont signalé des cas importés
seulement, ou une transmission locale très limitée.
Les chercheurs conviennent désormais que le principal agent pathogène est un nouveau coronavirus, le
"virus du SRAS". Les principaux symptômes et signes de la maladie sont : poussée fébrile (température
supérieure à 38 °C, soit 100,4 °F), toux, dyspnée ou gêne respiratoire. Environ 10 pour cent des patients
présentant les symptômes du SRAS développent une pneumonie grave; certains nécessitent une assistance
respiratoire.
La majorité des cas signalés en date du 5 mai concernent des sujets ayant eu des contacts très rapprochés
avec d'autres cas. Les agents de santé sont donc particulièrement exposés au risque d'infection.
Description de la maladie
Les premières manifestations consistent dans une poussée fébrile pendant un ou deux jours, suivie d'une
toux sèche ou d'une dyspnée pendant deux à trois jours. Une pneumonie atypique se développe, dans la
majorité des cas, le quatrième ou cinquième jour. Tout d'abord unilatérale, la pneumonie devient souvent
bilatérale et évolue progressivement vers un "voile blanc" sur les radiographies thoraciques.
La maladie suit alors l'un des deux cours suivants :
A. le malade voit son état s'améliorer (dans 80 à 90% des cas) et guérit en quatre à sept jours;
B. l'état du malade s'aggrave sensiblement à partir du sixième ou septième jour, et le patient présente
des signes de détresse respiratoire (dans 10 à 20% des cas).
Cinquante pour cent des cas du type B nécessitent une assistance respiratoire. Le taux de mortalité de ce
sous-groupe est élevé. Au début de la flambée épidémique, près de 50 pour cent des malades du type B
sont décédés, soit un taux de létalité de 5 à 10 pour cent. Les facteurs de risque d'échec ne sont pas
élucidés, hormis la gravité de la maladie et la nécessité d'une ventilation assistée. Jusqu'à présent, le SRAS
a surtout affecté les adultes de 20 à 70 ans. Peu d'enfants ont été touchés.
Outre la fièvre et la gêne respiratoires, d'autres symptômes peuvent être associés au SRAS : céphalée,
courbatures, perte d'appétit, malaise, confusion, rash et diarrhée.
Certains modes de transmission restent encore à déterminer. Le SRAS semble se propager le plus souvent
par contact rapproché en face-à-face, sous l'effet d'une exposition à des gouttelettes respiratoires
contagieuses et par contact direct avec des liquides organiques infectés. Un isolement respiratoire, et des
soins infirmiers rigoureux en isolement au niveau respiratoire et muqueux sont préconisés. Les malades
doivent être traités selon les indications cliniques (voir précisions ci-dessous).
Épidémiologie
Agent pathogène et dose infectieuse

Directives SRAS - ROSSP
06/05/03
2
Les chercheurs ont progressivement circonscrit leurs investigations sur l'agent étiologique aux familles des
paramyxovirus et des coronavirus, et conviennent désormais que le principal agent pathogène est un
nouveau coronavirus, le "virus du SRAS". La dose infectieuse n'est pas connue.
Source
À ce jour, au vu des connaissances, la source d'infection est une autre personne atteinte du SRAS.
Occurrence
Jusqu'à présent, tous les cas signalés en dehors des régions affectées ont concerné des personnes qui, au
cours des quatorze jours précédents, avaient traversé une région touchée ou été en contact rapproché avec
un sujet atteint.
Mode de transmission
Le germe se transmet principalement de personne à personne par les gouttelettes respiratoires expulsées
pendant un accès de toux ou d'éternuement, et une transmission par contact direct avec des liquides
biologiques, y compris avec des objets ou surfaces contaminés est possible. La transmission aérienne
semble peu fréquente, voire inexistante . La transmission par des facteurs environnementaux est probable
dans certaines conditions. L'élimination du virus du SRAS dans les selles, les sécrétions respiratoires et
l'urine est désormais bien établie. À la fin du mois de mars, à Hong Kong, un important agrégat de plus de
320 cas simultanés s'est subitement déclaré parmi les habitants d'un complexe immobilier. Cette flambée a
conduit à supposer que l'environnement était une source d'infection possible. D'après des investigations
ultérieures, il se pourrait que la contamination par le système d'égouts ait joué un rôle. Près de 66 pour cent
de ces malades souffraient de diarrhée, contre 2 à 7 pour cent des cas d'autres foyers épidémiques. À
l'exception de cet agrégat et d'un épisode précédent, dans lequel les cas concernaient les clients d'un hôtel,
résidant tous au même étage, le SRAS se propagerait, dans la majorité des cas, de personne à personne,
par exposition rapprochée à des gouttelettes respiratoires infectées.
Période de transmissibilité
Elle est inconnue, mais la maladie est particulièrement contagieuse après l'apparition des symptômes
respiratoires. Un risque moindre de transmission existe probablement au cours de la phase prodromique
(voir figure 1).
Période d'incubation
La période d'incubation est estimée à deux à sept jours, exceptionnellement dix jours, au maximum de 13
jours, le plus souvent trois à cinq jours.
Catégories vulnérables de la population
Les agents de santé, les proches et les amis de personnes atteintes du SRAS risquent fortement de
contracter la maladie.
Des cas secondaires sont signalés chez des personnes ayant voyagé dans le même avion qu'un cas de
SRAS.
À ce stade, on ne dispose pas d'informations suffisantes sur les personnes risquant de tomber gravement
malades et de décéder. Les effets les plus graves peuvent être attendus chez des sujets présentant une
maladie respiratoire et cardiaque sous-jacente—asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique, ou
cardiopathie.
Risque en Océanie
Le principal risque encouru en Océanie est celui de l'importation du virus par des sujets en provenance de
zones affectées, avec transmission ultérieure locale à d'autres personnes, notamment à des agents de
santé, par contact rapproché.
1
/
2
100%