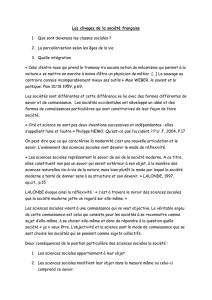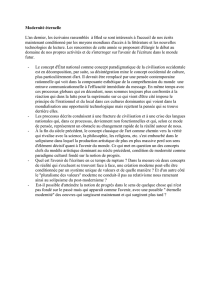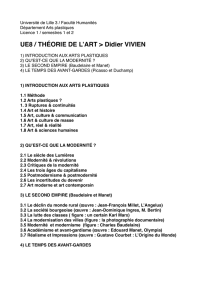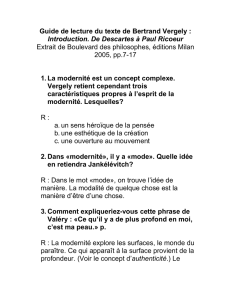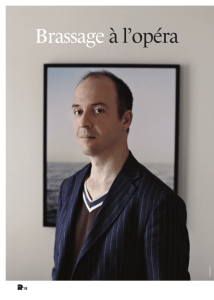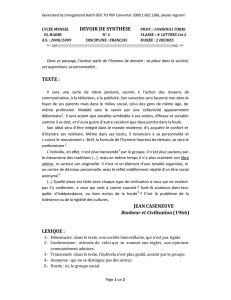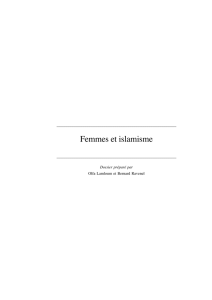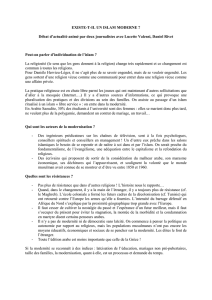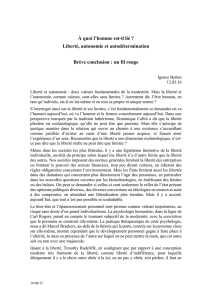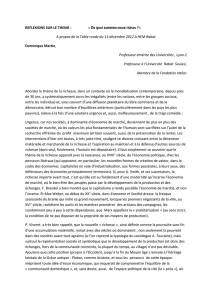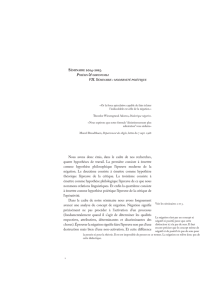Les nouvelles dynamiques sociales

Sociologie des nouvelles dynamiques sociales
Monsieur M. Nachi
année académique 2002-2003
Ulrich BECK et Anthony GIDDENS :
LE CONFLIT DES MODERNITES
Travail réalisé par
Stéphanie CRICKBOOM
Yaëlle KOOS
Delphine LECOMTE
Anne PALENTE
Valérie PEIFFER
Bénédicte SCHOONBROODT
Deuxième licence en Sociologie

2
Sommaire
1. Introduction
2. La modernité réflexive
A. Critiques adressées à la Sociologie de la Modernité
- Selon Ulrich Beck
- Selon Anthony Giddens
B. La réflexivité
- Comment définir la réflexivité
- La Sociologie réflexive selon Pierre Bourdieu
C. Dans quelle société vivons-nous ?
3. Le risque
A. Sommes-nous dans une société de risque ?
B. Les contours de la société du risque
4. L’individualisation
A. Définition
B. Nos sociétés et leur destin collectif
5. Le rapport au politique et à la science
A. Le retour des individus au niveau infra-politique
B. La légitimité scientifique
6. Distance critique et réflexions soulevées

3
1. Introduction
Ces dernières années, la question du risque a été souvent soulevée dans les sciences sociales,
aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis : « Nous sommes dans l’ère du risque ».
La société doit être envisagée comme une « nouvelle société » dans une idée de rupture (et
non continuation) dans le sens où nous vivons dans une production industrielle sans société
industrielle. C’est ce qu’affirment deux sociologues européens qui ont nourri le débat
intellectuel en France et en Grande-Bretagne, Ulrich Beck et Anthony Giddens.
En effet, nous assistons à une dissolution des concepts de base et des fondements de la
société industrielle. Il existe une dissolution des grands principes qui animaient la société
industrielle, comme la famille ou la classe sociale, qui pourrait faire en sorte que l’industrie
devienne elle-même une tradition. L’individualisation, vécue de manière collective, fait que
les décisions prises aujourd’hui doivent être négociées à la base, et non plus être imposées par
un « modèle dominant dépassé » qui ne correspond plus à ce qui est de manière empirique.
C’est pourquoi Beck et Giddens envisagent la modernité réflexive. Puisque nous ne pouvons
et ne voulons pas faire marche arrière sur le chemin de la modernité, nous assistons à un
nouveau visage donné à la société, où les individus, acteurs de leur destin, pourraient faire
leur retour au niveau infra-politique.
Cette « renivellement » de la société par le bas est possible, et certainement sur le point de
prendre forme, alors qu’il se manifeste, actuellement, par l’auto-dénégation citoyenne, qui
aveugle sur ses possibilités.

4
2. La modernité réflexive
Avant d’entrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse ici, c’est-à-dire une réflexion sur le
concept de modernité, nous allons observer de manière générale les ouvrages d’Ulrich Beck et
d’Anthony Giddens traitant de ce terme de « Modernité réflexive », en rupture avec la
manière dont la Modernité avait été pensée jusque maintenant en Sociologie.
Ces deux auteurs ont le mérite de dire non à la vision unitaire de la « Modernité » pour en
envisager « l’éclatement ». C’est alors qu’il n’est plus question d’UNE modernité, puisqu’elle
est envisagée comme étant multidimensionnelle.
A. Critiques adressées à la Sociologie de la Modernité
- Selon Ulrich Beck
Professeur de Sociologie à l'Université de Munich, il a écrit « La société du risque », paru en
1986 en Allemagne, et quatorze ans plus tard en France. Cet ouvrage, publié alors que le
nuage de Tchernobyl survolait l'Europe, a connu un grand retentissement. Il s’agit, en
quelques mots, d’une analyse minutieuse et critique de la modernisation des sociétés
contemporaines.
C’est principalement une tentative pour penser une transformation sociale, et nous allons,
avec cet auteur, tenter d’observer ce passage qu’il annonce : De la « modernité industrielle »
vers la « modernité réflexive ».
Pour Beck, la Sociologie occidentale de la modernité est dépassée depuis un bon moment :
elle est en quelque sorte « périmée », car elle n’offre pas d’alternative et propose l’analyse de
la modernité comme si elle était unidimensionnelle.
Il utilise la notion de « société de risque » pour désigner une phase de l’évolution de la société
moderne. Il développe l’idée générale du passage d’une « société industrielle » à une « société
du risque » et insiste d’emblée sur la différence entre :
La Modernité Unidimensionnelle :
Jusqu’à présent, c’est de cette manière que la modernisation fut pensée en termes
sociologiques. Il s’agit de rationaliser la tradition. Dans cette optique, il n’existe qu’une
alternative dans la manière d’envisager la société par la Sociologie, ce qui fait qu’elle est
infalsifiable et donc non scientifique.
La Modernité réflexive :
Il s’agit de rationaliser le processus de rationalisation. Beck va donc s’attaquer au processus,
au « comment ? ».
En effet, jusqu’à présent, la Sociologie a toujours pensé la modernité comme étant différente
des valeurs anciennes, des traditions, des religions, etc.. Et si la société industrielle devenait

5
elle-même une tradition, si ses propres principes, ses concepts de base, son fondement étaient
en voie de dissolution ?
La rationalisation de la rationalisation signifie qu’il va nous amener à réfléchir sur les propres
fondements de nos sociétés pour en venir au constat que la modernité d’aujourd’hui se
déroule dans un contexte de production industrielle sans les fondements de la société
industrielle. Ces fondements comme les classes sociales ou la famille sont des concepts qui
n’ont plus de réalité empirique et qui sont en train de se dissoudre.
La théorie de Beck est ainsi fondée sur une rupture au sein de la modernité, il refuse
l’approche post-moderniste. Pour lui, nous sommes dans une modernité nouvelle, voire autre,
mais toujours dans la modernité de laquelle nous ne sortons pas.
Les sociétés modernes avancées se situeraient actuellement entre deux phases de l’évolution
de la société moderne : venant de la modernité industrielle nous nous dirigeons vers une
modernité réflexive.
L’ouvrage d’Ulrich Beck, La société du risque: sur la voie d'une autre modernité, analyse
donc le post-modernisme comme une modernité réflexive qui devient elle-même l’origine de
ses propres risques et détruit les cadres sociaux de la modernisation.
Nous ne pouvons parler de modernité sans y associer le travail d’Anthony Giddens, l’alter-
ego britannique de Beck. Les thèses des deux auteurs sont en effet très proches.
- Selon Anthony Giddens
Quant à Giddens, il accuse également les analyses sociologiques de la modernité pensées
jusqu’ici, dans la même optique de simplifications. Elles ont réduit cette modernité à UNE
tendance, à un processus unique.
Il cite notamment le capitalisme chez Marx, l’industrialisme chez Durkheim, ou encore la
rationalisation selon Weber. Il s'affiche résolument contre l'idée de post-modernité.
Contrairement à ces derniers, il va « éclater » la notion de modernité en dégageant quatre
logiques institutionnelles, qui pour lui, sont partiellement autonomes. Il s’agit du capitalisme,
de l’industrialisme, de la surveillance et du militarisme. Chacune de ces logiques serait
vecteur de profils de risque.
Pour Giddens, nous ne sommes pas entrés dans cette ère nouvelle de « post-modernisme »,
mais plutôt dans une phase qu’il qualifie de « modernité avancée ». En effet, suite à la
Révolution française dans l'ordre politique et à la Révolution industrielle dans l'ordre
économique, nous sommes confrontés aux conséquences des transformations sociales qui ont
lieu, et se déploient dans toute leur amplitude.
Le diagnostic de Giddens, qui ébauche une critique de la notion de post-modernité, émet l'idée
qu’aucun savoir n'est jamais fermement établi et qu’il est nécessaire de mettre un terme au
« fameux » mythe du progrès.
Giddens d’une part, développe une théorie dite « de la structuration » où à la manière de
Parsons, (qui fait référence aux fonctions ramenées à un Tout englobant, comme la société), il
tente de rendre compte de la constitution mutuelle de l’action et de la structure sociale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%