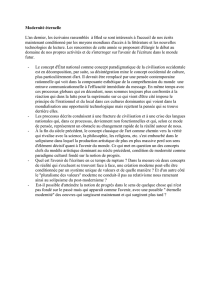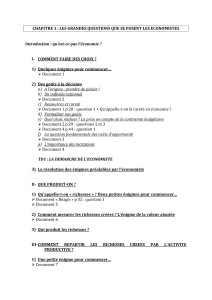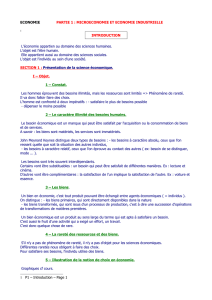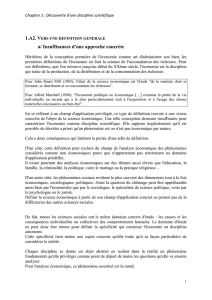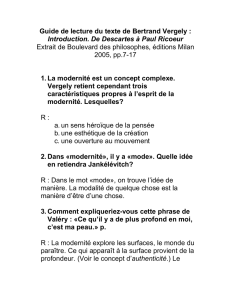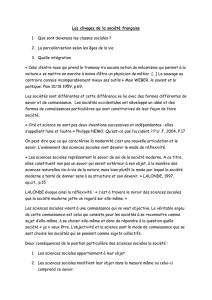REFLEXIONS SUR LE THEME : « De quoi sommes

REFLEXIONS SUR LE THEME : « De quoi sommes-nous riches ?»
A propos de la Table ronde du 13 décembre 2012 à HEM Rabat
Dominique Martin,
Professeur émérite des Universités , Lyon 2
Professeur à l’Université Rabat Souissi,
Membre de la Fondation Helios
Aborder le thème de la richesse, dans un contexte où la mondialisation contemporaine, depuis près
de 30 ans, a systématiquement accru les inégalités (entre les nations, entre les groupes sociaux,
entre les individus) et, sous couvert d’une diffusion planétaire du libre commerce et de la
démocratie, détruit bon nombre d’équilibres antérieurs (particulièrement dans les pays les plus
pauvres), relève à la fois d’une salutaire urgence et, aussi, malheureusement , de la tragi-comédie ;
Urgence, car nos sociétés, à dominante d’économie de marché, deviennent de plus en plus des
sociétés de marché, où les valeurs les plus fondamentales de l’humain sont sacrifiées sur l’autel de la
recherche effrénée du profit maximum (et bien souvent, aussi, de la préservation de la rente). Les
interventions d’hier ont toutes, à très juste titre, souligné ce divorce croissant entre la dimension
matérielle et marchande de la richesse et l’aspiration au maintien et à la défense d’autres sources de
richesse (dont seul, finalement, l’humain est dépositaire). Il faut simplement se souvenir que le
thème de la richesse apparaît avec la naissance, au XVIII° siècle, de l’économie politique, chez les
penseurs libéraux (qui opposent, en particulier, les nouvelles formes de création de valeur, dans le
cadre des économies capitalistes en voie d’industrialisation, aux formes passéistes, à leurs yeux, des
défenseurs des économies principalement terriennes). Si, pour A. Smith, et ses successeurs, la
richesse importe avant tout, c’est qu’elle est au fondement d’une modernité qu’incarne l’économie
de marché, où le bien être des peuples passe par le développement de la production et des
échanges. F. Braudel a bien montré que le capitalisme a rendu possible l’économie de marché, et non
l’inverse. Et Max Weber, au début du XX° siècle, dans Economie et Société dresse la fresque
saisissante du branle qui initie ce grand mouvement, lorsque les premiers négociants de la ville, au
XVI° siècle, rachètent les outils et les matières premières des artisans des campagnes, les
condamnant peu à peu à cette dépendance, que Marx appellera la « prolétarisation » (au sens strict,
la condition de ne pas disposer de la propriété de ses moyens de production).
P. Viveret a très bien rappelé, que la nouvelle « richesse », ainsi définie comme la poursuite sans fin
d’une accumulation matérielle, rompt avec des siècles où dominaient , non seulement la pauvreté
dans des sociétés avant tout agraires (si l’on reprend la typologie du sociologue A. Touraine), mais
surtout la représentation sociale et symbolique que le développement de la production (et donc des
échanges, hors de la communauté restreinte, la plupart du temps, au village) n’est pas désirable.
Ajoutons que cette position (propre à l’Occident, jusqu’à la fin du Moyen âge ) renvoie à l’héritage
lointain de la Grèce antique : Platon, comme Aristote, et tous les penseurs de cette époque
méprisent toute idée d’essor économique, qui risquerait de compromettre l’équilibre de la
« communauté domestique », et, sans doute, aussi, de l’espace politique de la cité (la « polis »), où

l’essentiel est l’échange des mots, de la parole démocratique ; de ce que A. Arendt appelle
« l’action », par opposition au labeur jugé «servil » (le « travail ») ou même « l’œuvre » (dont la
production qualifiée de l’artisan est le symbole). On retrouvera cette inspiration chez certains des
contempteurs de la frénésie marchande, tel le grand A. Gorz, qui propose – face à l’emprise
croissante du marché et de la finance dans la modernité – ni plus ni moins qu’un retour aux valeurs
de la frugalité, de la réduction des productions et des consommations somptuaires, et plus
largement une alternative en termes de rupture par rapport au modèle économique dominant,
marqué par l’hétéronomie.
Puisque la sociologie est ici convoquée, pour compléter les approches philosophiques et éthiques qui
ont été abondamment développées par les autres intervenants de la table ronde, mentionnons que
le divorce entre le tsunami marchand (qui commence à déferler sur les rivages de l’Europe, avec la
Révolution industrielle), et la lente érosion des valeurs qui mettent au premier pal l’humain a aussi
quelque chose de tragicomique : là où la Modernité devait libérer l’homme du joug des diverses
oppressions, liées aux anciens régimes, elle a par une sorte de « ruse de la raison », comme aurait dit
Hegel, engendré un asservissement peut-être plus terrible encore. A l’époque du Moyen âge, malgré
l’infranchissable distance des statuts sociaux, les Seigneurs et les « mécréants » pouvaient partager
un certain nombre de valeurs d’entraide, de respect, de confiance dans les solidarités de base de
sociétés avant tout communautaires ; le sentiment, aussi, que la dureté de la condition humaine était
frappée au sceau d’un égal destin : jamais le pouvoir ni l’argent n’aboliraient la mort (même si le
pouvoir politique a largement utilisé la crainte de l’au-delà pour asseoir, par Eglise interposée, la
pérennité de sa domination sur les plus faibles et les « mal nés »). Avec l’avènement du règne de la
production illimitée et –mondialisation contemporaine oblige dans les années 80- de la croyance
démesurée dans la vertu salvatrice de la richesse matérielle, les frontières de la mort elle-même
semblent reculer (comme le dit très bien, à la suite d’Ariès, l’un des intervenants) : comme si
l’abolition présumée de l’espace et l’entrée dans une temporalité réduite à l’instantanéité
(l’idéologie des « traders » et des partisans du « village global ») avait raison, dans sa démiurgie
prométhéenne, des limites de l’humaine condition.
Pauvreté de cette richesse, tragicomique –si elle n’était pas malheureusement souvent tragique,
pour tous ceux qui en subissent la face « sombre » (pensons ainsi aux pays de l’Afrique sub
saharienne). Comme le disait déjà, dans les années 40, les penseurs de l’Ecole de Francfort (Adorno,
Lukacs, Horkheimer), la modernité a été détournée par le capitalisme triomphant du potentiel de
rationalité qu’elle contenait, à l’origine, pour entrer dans l’ère de la rationalisation purement
matérielle (au mépris de ce que M. W » et de la « choséification » : comme le citait P. Viveret, la cité
ne se pense plus qu’à l’aune de la « res », non plus la « res – publica », mais la société réduite au
monde des affaires, où les citoyens perdent leur âme (ce qui nous ramènerait à cette épouvantble
prédiction de M. Weber lui-même, méditant sur le nouveau règne de sociétés à la fois
bureaucratisées et dominées par le seul goût du lucre , où il voit le triste avènement des « jouisseurs
sans être et des sybarites sans cœur » ; en bref, cette « cage d’acier », qui pourrait bien être dans
laquelle nous nous débattons, aujourd’hui, plus que jamais).
Un dernier commentaire : de même qu’il n’est raisonnable de soutenir que la mondialisation n’ait
pas aussi des effets positifs (à condition d’établir un bilan rigoureux de ses « créations » et de ses
« destructions », pour reprendre l’expression du grand économiste J. Schumpeter, dans les années
50) ; de même, aussi, qu’il serait insensé de se réfugier dans l’angélisme, en stigmatisant toute

forme de développement de la production et des échanges (comme si les hommes ne vivaient qu’au
ciel des valeurs immatérielles), il faut garder à l’esprit, face à la grande « dérégulation planétaire » à
laquelle l’idolâtrie contemporaine de la richesse nous a conduits, que d’autres valeurs et d’autres
formes de valorisation de richesses sont possibles et souhaitables. Les intervenants en ont
mentionné un certain nombre : la richesse des femmes, qui doivent faire face au poids de siècles
de domination masculine ; et concrètement, aussi, plus sournoisement, non seulement aux préjugés
tenaces sur leur « manque d’aptitude » à prendre leurs responsabilités ; mais qui, aussi –comme on
l’a redit- entretiennent parfois une complicité , nolens volens, au plan des mentalités, avec les
couches les plus réactionnaires de leurs homologues masculins. La richesse d’autres formes de
développement –que le Brésil, et d’autres pays en pointe dans ce domaine, illustrent aujourd’hui-,
qui s’appuient sur les concepts d’économie solidaire (comme économie « hybride », au sens où
l’entend par exemple Jean-Louis Laville, au CNAM, dans la lignée des travaux de K. Polanyi), même si
cette forme d’économie ne peut pas – à moins d’une révolution planétaire- devenir dominante et
supplanter l’économie capitaliste de marché. La richesse des éco-systèmes naturels, qui conduit,
depuis près de vingt ans, à repenser le rapport entre nature et culture, mis à mal par l’idéologie
industrialiste qui a régné en maître dans l’ancienne Union soviétique, et qui sévit encore,
particulièrement dans les grands pas émergents (là encore, l e culte effréné de la production de
richesses à tout prix a conduit à saccager les espaces naturels et à compromettre les équilibres
fondamentaux de notre planète). En ce sens, la première de nos richesses, c’est –comme on l’
souligné- cette planète, peut- être Deus sive natura, comme disait Spinoza, il y plusieurs siècles.
La richesse première, la matrice de toutes les autres, c’est donc, on le voit bien, la puissance
intérieure de la vie humaine. Ici, ce que nous avons entendu en termes philosophiques et moraux
appellerait bien des commentaires, qui excèdent les limites de notre propos. On peut à loisir
convoquer, dans un pluralisme éclectique, Camus, Jonas, et plus près de nous Foucault. Je ferai
référence à deux autres penseurs, peut-être plus proches l’un de l’autre qu’on ne peut l’imaginer :
Sartre et Levinas. Le premier vient rappeler que la réalité humaine se caractérise existentiellement
par la rareté et le manque, et que la liberté humaine s’enracine précisément dans cette capacité qu’à
l’homme – à la différence des animaux- de se produire comme projet, dans la dynamique de son
propre manque (« l’homme est l’étant par lequel le néant vient au monde ») ; en ce sens, l’homme
ne pourra jamais abolir la rareté, non pas parce qu’elle est liée à l’état de l’économie, mais parce que
la rareté est le prix à payer d’un monde fini, contingent, seul espace où ma liberté peut se mouvoir).
Sartre nous rappelle aussi –contre tous les chantres du bonheur par la consommation – que l’homme
est un être de désir, et que le désir est incommensurable avec le besoin. En ce sens, aucune richesse
matérielle ne satisfera jamais le désir humain. Le deuxième penseur qu’est Lévinas partage avec
Sartre – qui fut aussi, on l’a oublié, un apôtre de l’amour, comme ce qui peut relier in fine les
hommes, au-delà du combat entre leurs libertés– l’idée
1
/
3
100%