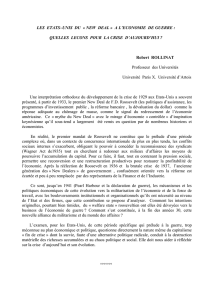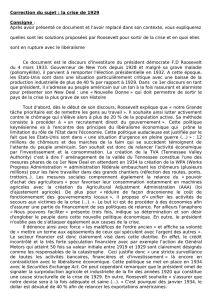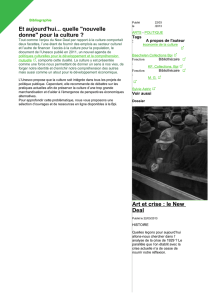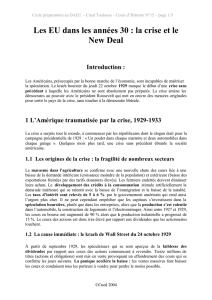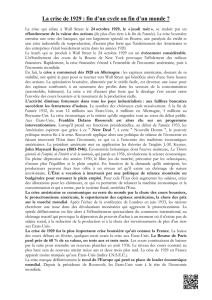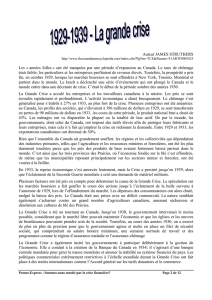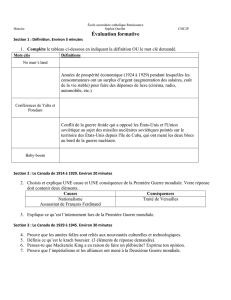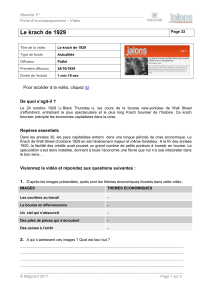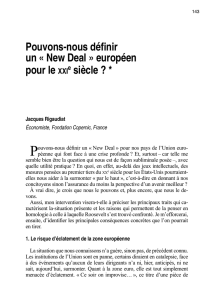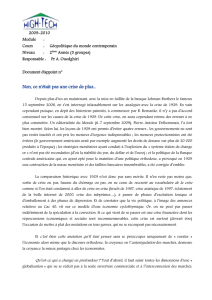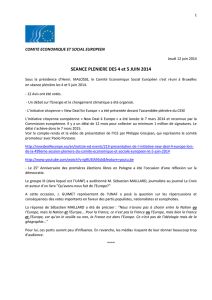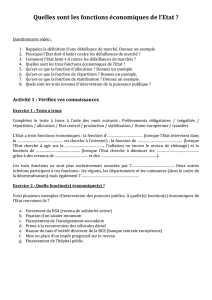31 Ce qui a changé, c`est le niveau d`intervention acceptable et les

1
1
LE NEW DEAL :
UN BILAN CONTRADICTOIRE ENTRE VISION ET IMPROVISATION
Pierre ARNAUD
Maître de Conférences à l’Université de Paris X
Dresser un bilan de l’action économique de Franklin Delano Roosevelt est une tâche
malaisée. Si au plan politique, et dans la conscience populaire, sa figure demeure largement
héroïque, les analyses économiques de sa présidence sont très contradictoires : sauveur de la
Grande Crise pour les uns, interventionniste imbu de son autorité pour les autres, coupable
d’avoir retardé la sortie de la crise et entraîné les Etats-Unis sur une pente fatale d’étatisme.
Une raison de cette polarisation est sans aucun doute l’instrumentalisation du bilan
rooseveltien, aussi bien par les tenants du néolibéralisme que par les défenseurs du
keynésianisme. Toutefois, si l’action du gouvernement dans les années 1930 se plie si
facilement à des démonstrations radicalement opposées, c’est qu’elle est peu lisible.
L’observateur objectif est frappé par le côté hétéroclite et confus du New Deal, qui ne semble
obéir à aucun esprit de système. Pour comprendre cet apparent désordre tout en évitant les
déductions partisanes, il faut d’abord retourner au point de départ de la Crise, afin d’en saisir
la nature systémique et incompréhensible pour les contemporains. Les contradictions et
insuffisances du New Deal apparaissent alors comme inévitables : FDR a du trouver des
réponses à une situation sans équivalent dans un contexte de vide conceptuel, car la science
économique de l’époque ne proposait ni analyse pour comprendre l’enchaînement des
événements, ni solutions pour guider l’action du gouvernement.
1. 1929 : une rupture systémique
1.1 Une crise surprise
A première vue, le krach de 1929 prend les Etats-Unis par surprise. La foule qui se
rassemble devant Wall Street, le jeudi 24 octobre, semble frappée de stupeur. Les témoins
relatent la rumeur sourde qui en émane, comme la plainte d’un peuple brutalement écrasé.
C’est un événement traumatique ; pourtant, le pire est à venir. Ce revirement boursier va se
propager aux autres secteurs de l’économie et provoquer une catastrophe selon un scénario
qui n’est nullement inéluctable. D’autres crises financières n’ont pas engendré de telles
conséquences. En réalité, il y a des signes avant-coureurs, et les avertissements s’élèvent
d’horizons divers. Dès 1928, des banquiers et des courtiers encouragent leurs clients à couvrir

2
2
leurs marges et réaliser au moins une partie de leurs gains, car la flambée de la bourse leur
parait malsaine. Ils sont écoutés par certains épargnants, qui voient alors le Dow Jones entrer
dans la phase la plus spectaculaire de son ascension, sans qu’ils en profitent. Ceci
décrédibilise les cassandres jusqu’aux journées fatales d’octobre.
La Federal Reserve lance à son tour l’alerte en relevant son taux de 3,5 à 4,5% afin de
ralentir la spéculation boursière fondée sur le crédit. Pour finir, en février 1929, elle publie un
communiqué dans lequel elle déclare ne plus vouloir consentir d’emprunts aux banques qui se
serviraient de ces fonds pour, à leur tour, financer les achats en bourse de leurs clients
1
. Le
risque est donc clairement perçu et le débat entre optimistes et pessimistes existe. Cependant,
l’opinion positive l’emporte de manière écrasante : effet de la dynamique grégaire inhérente à
toute bulle spéculative
2
, aggravée par les abus multiples qui entraînent nombre d’épargnants
dans un jeu qu’ils ne comprennent pas. Toutefois, la puissance du phénomène à la fin des
années 1920 se nourrit d’une décennie exceptionnelle, qui donne aux observateurs
contemporains le sentiment qu’un monde nouveau est en train de naître, et dans lequel les
repères et règles connus perdent leur pertinence.
Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l’économie américaine a connu une
période de croissance exceptionnelle. Mesuré en dollars de 2005, le PIB passe de moins de
700 milliards en 1920 à plus de 950 milliards en 1929. De 1921 à 1929, la production
industrielle augmente de 26%. Mais au-delà de cette exceptionnelle prospérité, ce sont tous
les aspects de la vie qui ont été bouleversés depuis le début du siècle. La population a doublé
depuis 1890, pour un tiers sous l’effet d’une immigration qui amène vers les côtes
américaines des populations aux d’origines beaucoup plus diverse que par le passé : près de 6
millions de catholiques italiens, hongrois ou polonais ; un demi-million de Grecs orthodoxes ;
plus de deux millions de Juifs russes, ukrainiens et lithuaniens ; des Slovaques, des
Biélorusses, des Roumains, des Croates, des Serbes, des Bulgares, etc. Les villes américaines
deviennent des lieux de métissage multiculturels et polyglottes. A New York, un citoyen sur
six seulement est protestant.
1
Cette mesure aurait pu être efficace, comme en témoigne le brusque retournement du marché qui fait suite à
cette annonce. Toutefois, elle est anéantie par l’initiative d’un groupe de banques de Wall Street, qui crée un
pool destiné à prêter l’argent que la Federal Reserve refuse désormais. Pourtant, le crédit est bien un moteur
de la bulle financière : entre le début des années 1920 et 1928, les encours de crédits consentis par les
courtiers sont multipliés par 6, le plus gros de la hausse étant concentré à partir de 1927.
2
Sur les dynamiques, entres autres mimétiques, des marchés financiers, voir Galbraith, Brève histoire de
l’euphorie financière, in Economie hétérodoxe 2007 p. 545-618, et également, dans une perspective plus
théorique, Orléan, L’Empire de la valeur, 2011, chapitres VI et VII, p. 231-312.

3
3
Parmi les changements déterminants, le rapport commandité par le gouvernement
Hoover, intitulé Recent Social Trends, cite également la Prohibition, les campagnes pour le
contrôle des naissances, le vote des femmes et une approche plus ouverte des questions
sexuelles. Le rapport mentionne par ailleurs des mutations économiques qui vont avoir un
effet déterminant sur les événements des années 1930. Il s’agit de l’avènement de nouvelles
technologies — énergie électrique, l’automobile, la radio, le cinéma — qui vont ouvrir de
vastes nouveaux marchés, auxquelles s’ajoute le développement de l’aviation.
Ces progrès engendrent une profonde mutation de la production, en même temps qu’ils
en sont une conséquence. La révolution productiviste des méthodes tayloristes trouve son
aboutissement dans les nouvelles technologies du début du XXe siècle. Cette combinaison
rend possible un bouleversement socio-économique décisif, l’émergence de la production et
de la consommation de masse, avec ses corollaires : l’émergence de la publicité, du marketing
et du financement par le crédit.
Les États-Unis entrent dans le consumérisme une génération avant l’Europe. En 1929,
on compte une automobile pour cinq Américains, contre une pour quarante-trois Britanniques
et une pour trois cent trente-cinq Italiens. L’électroménager envahit les foyers, largement
financé par l’emprunt. Dès 1924, les trois-quarts des achats d’automobiles sont payés à
tempérament. En 1925, le crédit à la consommation finance 70% de l’ameublement, 75% des
postes de radio, 80% des phonographes, 80% des appareils ménagers, et 90% des pianos
3
.
En moins d’une génération, c’est toute l’expérience de vie du citoyen qui se trouve
bouleversée, aussi bien du point de vue matériel que social. L’esprit d’optimisme se nourrit de
ces bouleversements et de l’explosion de l’aisance matérielle pour une partie importante de la
population. L’optimisme est le carburant des bulles spéculatives. A la fin des années 1920, la
société américaine regorge de cette ressource peu coûteuse. Les cassandres se voient opposés
l’argument — employé également dans les années 1990 — que l’économie est entrée dans
une phase nouvelle, si bien que les repères anciens n’ont plus raison d’être. La hausse du
marché ne fait que refléter le potentiel de prospérité inhérent au nouveau paradigme. Celui-ci
repose sur la libération et la satisfaction du désir illimité des hommes. Telle était la conclusion
du Comité sur les changements économiques récents, mis en place par Hoover : « L’enquête
démontre de façon sûre ce que l’on avait longtemps tenu pour vrai en théorie, à savoir que les
désirs sont insatiables ; qu’un désir satisfait ouvre la voie à un autre. Pour conclure, nous
3
Gary Cross, An All Consuming Century, Why Commercialism Won in America, New York: Columbia
University Press, 2000, p. 27.

4
4
dirons qu’au plan économique un champs sans limite s’offre à nous ; de nouveaux besoins
ouvriront sans cesse la voie à d’autres plus nouveaux encore, dès que les premiers seront
satisfaits. […] La publicité et autres moyens promotionnels […] ont attelé la production à une
puissance motrice quantifiable. […] Il semble que nous pouvons continuer à augmenter
l’activité. […] Notre situation est heureuse, notre élan extraordinaire ».
4
Cette prospective radieuse est rédigée en 1929, quelques mois avant le krach. Elle
reflète l’état de confiance générale qui se propage au marché financier et lui procure son
ultime élan et le pouvoir d’attraction qui en découle, en une forme de prophétie auto-
réalisatrice. Plus les gains des uns attirent de nouveaux boursicoteurs, plus le marché monte,
engendrant de nouvelles vocations qui entretiennent la fièvre. Tout se passe comme si la
bourse réalisait les promesses d’une économie au ressort inépuisable. Le public parie sans
aucun discernement sur des entreprises simplement parce qu’elles appartiennent à des secteurs
novateurs. C’est ainsi que la société Seaboard Air Line voit ses actions s’envoler, les
acheteurs croyant, sur la foi du nom, qu’il s’agit d’une compagnie aérienne, alors que ses
activités sont on ne peut plus terrestres : le transport ferroviaire en Floride.
Le retournement d’octobre 1929 survient dans ce contexte. Si les deux journées noires
(mardi et jeudi) restent gravées dans les annales, l’effondrement va durer un mois. Quand la
baisse marque enfin une pause à la mi-novembre, l’indice Dow Jones a perdu la moitié de sa
valeur de septembre 1929. Dans les mois qui suivent, la production industrielle commence à
décliner. D’un indice 100 points en 1929, elle s’effondrera jusqu’à 55 points en 1932, avant
de commencer à remonter lentement. Le PNB en dollars constants passe de 104,4 milliards en
1929 à 74,2 milliards en 1933. En prenant en compte la déflation des prix, la baisse est encore
plus impressionnante : de 104,6 à 56,1 milliards. La contraction, sans équivalent et survenant
après une longue période de croissance florissante, va produire une catastrophe économique et
sociale qui traumatise les Américains et laisse leurs leaders politiques dans l’impuissance et le
désarroi.
1.2 Contagion : dans quel sens ?
La question peut surprendre. Après tout, la Grande Crise s’inscrit bien dans le sillage du
Krach. Cependant, les indices d’un retournement apparaissent avant octobre 1929. L’indice de
la production industrielle de la Réserve Fédérale atteint son maximum en juin 1929 (126),
4
Jeremy Rifkin, La Fin du travail, Paris : La Découverte / Poche, 2006, p. 46-47.

5
5
avant de commencer à descendre (117 en octobre). La production d’acier se replie également
dès juin
5
.
Les déséquilibres se sont accumulés au cours des années 1920, sous la surface
chatoyante de la prospérité. Le secteur agricole subit une baisse des prix dès le début de la
décennie. D’autre part, le consumérisme doit beaucoup au crédit : les salaires demeurent
comparativement bas. Henry Ford accorde une forte augmentation à ses employées dans ces
années-là, mais ce n’est pas, contrairement à la légende, pour leur permettre d’acheter les
automobiles qui sortent de ses chaînes. Il s’agit en fait de combattre la redoutable rotation de
personnel : pour maintenir l’effectif nécessaire de 14 000 hommes, l’entreprise doit en
embaucher 53 000 par an. Les nouvelles méthodes de production ont fortement augmenté le
rendement, mais le travail est pénible et les ouvriers fuient.
La productivité augmente de 43% environ entre 1919 et 1929, mais les prix et les
salaires demeurent relativement stables
6
. Les bénéfices augmentent, encourageant un fort
niveau d’investissement. La production de biens d’équipement progresse à un rythme annuel
de 6,4%, celle des biens de consommation non durables de 2,8% seulement. Pour les biens de
consommation durable, la progression moyenne est de 5,9%
7
. Selon James Livingston, il y a
même contraction de l’investissement net dans les années qui précèdent la crise
8
.
L’augmentation de la productivité sur fond de salaires (donc de demande) stables, décourage
un surcroît d’investissement dans l’outil industriel. Que faire alors des profits additionnels ?
Ceux-ci vont naturellement s’investir en bourse, alimentant alors la hausse des titres et la
spéculation. John Kenneth Galbraith insiste sur la fragilité d’un système qui repose
essentiellement sur la consommation de biens d’équipement et les achats superfétatoires des
classes aisées. Des nouvelles même modérément mauvaises peuvent suffire à provoquer une
baisse de cette demande spécifique, entraînant alors une spirale descendante. Pour Livingston,
la responsabilité des inégalités de revenus jouent un rôle important dans la survenue de la
crise, en raison de son effet inhibiteur sur la demande finale, principal moteur de la croissance
dans un système de consommation de masse. C’est ce phénomène selon lui, allié au
5
La Crise économique de 1929 : anatomie d’une catastrophe financière, Paris : Editions Payot & Rivages,
2008, p. 145.
6
Ibid., p. 247.
7
Ibid., p. 248.
8
James Livingston, « Their Great Depression and Ours, » Challenge, Volume 52, Number 3 / May - June 2009,
Newark: Rutgers University, p. 34-51.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%