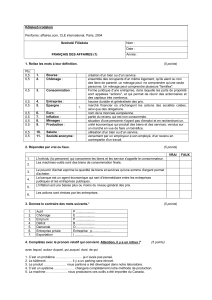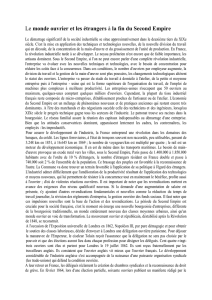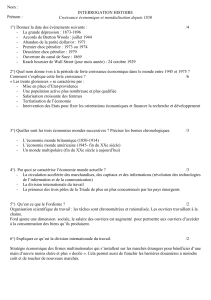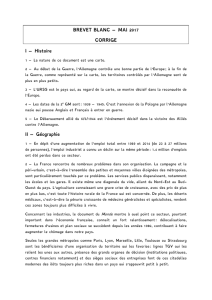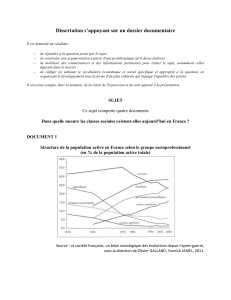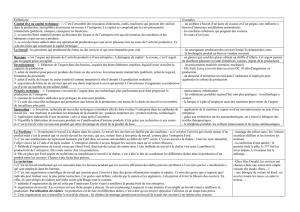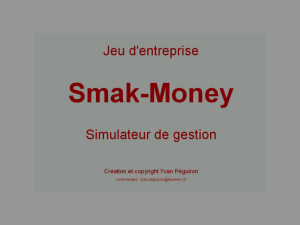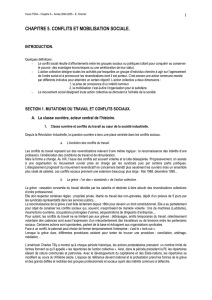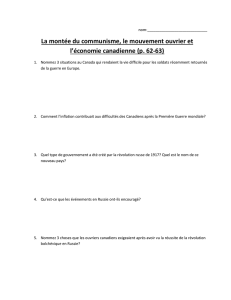1. 1851-1870 : Avant la Commune 2. 1871 : La Commune 3. 1871

1
1. 1851-1870 : Avant la Commune
2. 1871 : La Commune
3. 1871-1885 : Après la Commune. La république et ses tentatives d’intégration de la classe
ouvrière
4. 1872-1889 : La classe ouvrière et la construction de ses organisations indépendantes
Introduction
Toutes les décennies qui suivirent la Commune furent profondément marquées par l’événement
considérable que fut la prise de Paris par les ouvriers révolutionnaires. Mais plus encore, une
grande partie des idées et des organisations ouvrières qui sont les nôtres ainsi que les institutions
républicaines telles que nous les connaissons encore aujourd’hui furent une conséquence de la
Commune et de l’incroyable énergie que le mouvement ouvrier continua à développer à sa suite.
Il n’y eut pas non plus d’événement qui ne fut autant sali, déformé et qu’on tenta de faire
disparaître autant de l’histoire de France que de son poids sur l’évolution du pays.
C’est ce qu’on voudrait essayer de rappeler et refaire vivre aujourd’hui.
1851-1870 Avant la Commune
De la crise de 1860 à celles de 1866-67 et 1869-70
Le 2 décembre 1851, le neveu de Napoléon Ier, alors président de la république, organise un coup
d’état et prend le pouvoir comme empereur sous le titre de Napoléon III. L’empire sera donc le
régime du gouvernement français pendant 20 ans de 1851 à 1871.
Dans les premières années ce régime bénéficie du soutien de la bourgeoisie et de l’Eglise et
réprime fermement le mouvement ouvrier que le massacre de juin 1848 avait déjà fortement
saigné.
Mais en 1860, au détour d’une ouverture commerciale des frontières françaises à la concurrence
anglaise, la bourgeoisie française dont les revenus sont menacés se détourne de l’empire en
même temps que Napoléon III se brouille avec le pape.
Dès lors dans cette période où les entreprises industrielles modernes se sont fortement
développées - Paris est la grande ville à la concentration ouvrière la plus forte d’Europe, 400 000
ouvriers et artisans y habitent alors - l’empereur va tenter d’obtenir le soutien de l’aristocratie
ouvrière en faisant quelques concessions au mouvement ouvrier. Il autorise le droit d’association
aux ouvriers – et à partir de là, le droit de grève - qui leur était interdit depuis 1791. Il invite les
associations ouvrières à être représentées à l’exposition universelle de 1862 en Angleterre.
Les ouvriers se saisiront de ces occasions. A la suite des contacts pris avec le mouvement ouvrier
anglais, ils fonderont en 1864, la 1ère Internationale (AIT), première organisation ouvrière
internationale dont le but est « l’Emancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes » et
qui va œuvrer à casser les frontières corporatives ou nationales qui divisaient les ouvriers jusque là
tout en soutenant l’explosion de grèves qui vont naître à partir de 1866.
Une violente crise frappe en effet cette année-là la France et amène de nombreux licenciements,
fermetures d’entreprises ou baisses des salaires. De là une véritable épidémie de grèves qui
s’empare du pays. Ce sont, dans un premier temps, des grèves économiques contre les
licenciements ou pour des hausses de salaires puis des grèves de plus en plus politiques, pour
l’abolition du salariat ou la proclamation de la République. Ainsi par exemple 40 000 ouvriers de
Mulhouse se sont mis en grève, victorieuse, en juillet 1870 pour une baisse des horaires et une
hausse des salaires. A cette époque où on travaille encore souvent 13 à 14 heures par jour, ils
obtiennent la journée de 10 heures, payée 11.

2
Les luttes ouvrières des années 1860 et 1870
Il y a grève et grève. Toutes n’ont pas le même sens, ne représentent pas le même danger pour
l’ordre établi, n’ont pas la même capacité d’élever la conscience, la cohésion et la force des
ouvriers. Dans les années 1860, avant la Commune, et plus on s’approchait de la guerre, plus les
grèves, par delà leurs revendications immédiates posaient le problème du régime politique, la
chute de l’Empire et la création de la république. Pour empêcher la guerre qui venait, il fallait
renverser l’Empire par la révolution. Il fallait finir la révolution de 1789. Du côté ouvrier, on voyait la
république sociale, mais pas vraiment encore le socialisme.
Après la Commune et l’établissement de la république, les deux classes modernes , bourgeoisie et
prolétariat se font face, débarrassées de toutes les scories du féodalisme, (à part encore l’église) et
l’enjeu devient alors pouvoir bourgeois ou ouvrier, capitalisme ou socialisme.
Sens politique des grèves des années 1860 : guerre ou révolution, République ou Empire
Avec la crise économique mondiale de 1866-1867, la lutte de classes s’approfondit. En octobre
1867, au milieu des fastes de l’Exposition universelle, le Crédit Mobilier suspendit ses paiements,
créant la panique à la Bourse de Paris, ruinant des milliers de petits et moyens actionnaires. Par
ailleurs des milliers de petites et moyennes entreprises firent faillite, les plus importantes
licencièrent et baissèrent les salaires. D’innombrables corps de métier, des mineurs aux tisserands,
des teinturiers aux employés de commerce, entrèrent en grève dans différentes régions
industrielles. On parle d’ « une vague de grèves sans précédent ». Ces grèves n’allaient pas
cesser jusqu’à la déclaration de guerre en juillet 1870.
« Des grèves, toujours des grèves, et encore des grèves... une épidémie de grèves, de troubles
sévit sur la France et paralyse la production » constate avec dépit le proudhonien Fribourg. En mai,
juin, juillet 1870 malgré la répression bonapartiste, dont on a vu qu’elle est dirigée à ce moment par
le cabinet Ollivier et ses ministres libéraux, la vague de grève ne fit que s’accentuer. Mais le
mouvement de grèves a changé de nature entre celles de 1866, 1867, 1868 et celles de 1869-1870
et s’est encore politisé.
C’est qu’entre temps ont eu lieu les élections de 1869. Gambetta s’est fait connaître en novembre
1868 comme défenseur dans le procès contre Délescluze suite à la manifestation du 2 novembre
1868, devant la tombe du député Baudin tué le 3 décembre 1851 sur les barricades du faubourg
Saint-Antoine. Les lois libérales de l’Empire étaient promulguées. Une floraison de journaux
républicains virent le jour. Du 1er janvier au 5 avril 1869, on estime à 46 le nombre de nouveaux
journaux républicains parus. Mais en même temps, les socialistes organisent une vague de
meetings : de juillet 1868 à mars 1869 eurent lieu de 300 à 400 réunions publiques, où furent
prononcés de 2 à 3 000 discours. Certaines de ces réunions rassemblent 2 à 3 000 participants de
milieu populaire. Le ton y est de plus en plus socialiste. G. de Molinari, rédacteur du grand journal
libéral Orléaniste Le Journal des Débats, propriété de Léon Say, futur ministre des finances de la
République, constatait dans les colonnes de son journal avec irritation et inquiétude que « le
socialisme avait reparu, plus bruyant et plus confiant que jamais dans sa vitalité et sa force. »
« Députés conservateurs et députés de l’opposition, bourgeois royalistes, libéraux et républicains,
tous s’accordèrent à dépeindre les réunions publiques comme d’affreux repaires, dans lesquels les
honnêtes gens qui s’y aventuraient couraient chaque soir le risque d’être égorgés, et à représenter
ceux qui y prenaient la parole comme des bandits prêchant le massacre et le vol. »
Au cours de la session parlementaire du 1er février 1869, les députés libéraux, Garnier-Pagès,
Pelletan soutenus par les députés républicains exigèrent du gouvernement bonapartiste une
répression plus vigoureuse contre les orateurs de ces meetings et une application plus stricte à leur
égard de la loi de juin 1868 sur les réunions électorales. Le gouvernement leur promit de

3
s’exécuter. Les poursuites et les arrestations contre les orateurs de ces réunions populaires se
firent de plus en plus nombreuses. Selon le témoignage de B. Malon, au début 1869 déjà 60 de ces
orateurs avaient été condamnés à des peines de prison allant de 15 jours à 8 mois. Le
gouvernement bonapartiste tira de plus une brochure à plus de 100 000 exemplaires pour répondre
à cette campagne de meetings où il accusait les orateurs socialistes de préconiser le régicide, le
pillage et autres forfaits. Les élections de 1869 ont donné un nouvel essor au mouvement ouvrier.
Les grèves se multiplient.
Les dirigeants républicains et députés de gauche ne participent pas à ces manifestations et grèves
de 1869-1870. On connaît d’ailleurs la réponse de Jules Favre à la délégation d’ouvriers venus lui
demander s’ils pouvaient espérer être guidés dans leur lutte par l’opposition parlementaire : « C’est
vous, messieurs les ouvriers, qui seuls avez fait l’Empire, à vous de le renverser seuls » (référence
à la passivité ouvrière lors du coup d'Etat de Napoléon en 1851).
Les ouvriers qui avaient manifesté aux obsèques politiques de Victor Noir en janvier 1870 étaient
licenciés en masse. A ce moment, les 10 000 ouvriers du Creusot entament une grève politique
que 3 000 soldats brisèrent sous la conduite d’un général, malgré les nombreuses fraternisations
entre ouvriers et soldats. De nombreux ouvriers furent condamnés à des peines de trois mois à
deux ans de prison. Le 7 février, nouvelle manifestation politique ouvrière, contre l’arrestation de
Rochefort pour l’article qu’il avait consacré à l’assassinat de Victor Noir par un membre de la
famille Bonaparte. Sous la conduite de Millière et Flourens, des barricades sont érigées,
l’entreprise de fabrique d’armes Lefaucheux est dévalisée. Nombre d’ouvriers de Belleville font
grève le 8 février et construisent d’autres barricades. 94 ouvriers sont arrêtés et condamnés pour
participation à l’émeute. Les dirigeants socialistes du journal La Marseillaise sont arrêtés :
Flourens, Grousset, Fonvielle, etc. Une délégation ouvrière se rendit auprès des députés de
gauche le 8 février pour qu’ils démissionnent en signe de protestation. Ils sont éconduits. Une
seconde grève éclata au Creusot le 21 mars qui durera jusqu’au 15 avril. L’armée est à nouveau
envoyée sur les lieux. Des condamnations jusqu’à deux ans de prison sont prononcées pour grève
politique, des soldats qui ont sympathisé avec les grévistes sont à nouveau punis. Les grèves se
multiplient souvent avec l’expression d’un solidarité ouvrière du pays tout entier sinon parfois d’une
solidarité internationale. En mai 1870, Napoléon organise son plébiscite où il dit clairement :
« Donnez-moi une nouvelle preuve de votre attachement. En apportant au scrutin un vote affirmatif,
vous conjurerez les menaces de la révolution, vous assoirez sur une base solide l’ordre et la
liberté et vous rendrez plus facile, dans l’avenir, la transmission de la couronne à mon fils. »
On ne peut être plus clair : « si vous voulez conjurer les menaces de révolution »... et Napoléon ne
fait pas allusion aux républicains qui eux s’empressent dans cette campagne de se désolidariser
des socialistes car ils craignaient en s’associant à eux de donner un caractère révolutionnaire à la
campagne d’opposition contre le plébiscite.
Ce fut la première occasion pour l’Internationale de mener une grande campagne politique en
expliquant le sens du plébiscite et en affirmant son programme, notamment que les mines, les
canaux, les chemins de fer, les banques, moyens d’exploitation entre les mains de « la féodalité du
capital » deviennent des services publics au service des citoyens. On comprend bien pourquoi les
républicains et libéraux, rois des chemins de fer et des mines, ne tenaient pas à se mêler à la
campagne des socialistes. Les républicains comme Favre, Simon, Picard, comprennent en ces
années, qu’il n’était pas possible de conquérir la République sans l’appui des masses profondes du
peuple, ils avaient peur de l’action populaire et préféraient pour cette raison se contenter d’une
monarchie constitutionnelle qu’ils se proposaient d’instaurer par la voie parlementaire. Toute leur
politique ultérieure, du 4 septembre 1870 au massacre de la Commune est déjà là. Pourtant c’est
aussi dans ces années que d’autres républicains, des jeunes, rompirent avec le combat républicain
pour rejoindre le combat socialiste. Ce fut le cas de Ch. Longuet et P. Lafargue pour les plus

4
connus. En 1866, ce dernier écrivait :
« Le temps nous a dessillé les yeux. Aujourd’hui nous comprenons qu’ils [les républicains] sont les
souteneurs de l’Empire, sa soupape de sûreté... Alors nous avons brusquement rompu avec eux.
Leurs salons ouverts pour nous à deux battants ont été désertés. On se caserna au Quartier Latin
[Lafargue est alors étudiant] et on ne fréquenta que des ouvriers. »
Marx, Engels soulignent le mouvement en marche en France mais l’immaturité ou l’absence de
cadres socialistes.
La vague de grèves met à l’ordre du jour : guerre ou révolution, république ou empire, bref une
révolution politique bourgeoise faite par des ouvriers.
Sens politique des grèves des années 1860
Avec la crise économique mondiale de 1866-1867, avant la Commune, nous avons vu que la lutte
de classes s’approfondit.
Des milliers de petites et moyennes entreprises firent faillite, les plus importantes licencièrent et
baissèrent les salaires. D’innombrables corps de métier, des mineurs aux tisserands, des
teinturiers aux employés de commerce, entrèrent en grève dans différentes régions industrielles.
On parle d’ « une vague de grèves sans précédent ». Ces grèves n’allaient pas cesser jusqu’à la
déclaration de guerre en juillet 1870.
Mais au fil du temps et avec l’amplification du mouvement, la nature des grèves a changé. Elles se
politisent.
Car dans le même temps, une floraison de journaux républicains avait vu le jour et les socialistes
avaient organisé de juillet 1868 à mars 1869 de 300 à 400 réunions publiques, avec parfois jusqu’à
2 à 3 000 participants.
Les poursuites et les arrestations contre les orateurs de ces réunions populaires se firent de plus
en plus nombreuses. Les élections de 1869 donnent un nouvel essor au mouvement ouvrier. Puis
en janvier 1870 ont lieu des manifestations massives de protestation contre l’assassinat par
Napoléon III (vérifier) d’un journaliste républicain, Victor Noir.
Les ouvriers qui avaient manifesté à ces obsèques politiques sont licenciés en masse. A ce
moment, les 10 000 ouvriers du Creusot entament une grève politique que 3 000 soldats brisèrent
malgré les nombreuses fraternisations entre ouvriers et soldats. Le 7 février, nouvelle manifestation
politique ouvrière, contre l’arrestation d’un dirigeant républicain d’extrême gauche. Des barricades
sont érigées, une entreprise de fabrique d’armes est dévalisée. Les arrestations d’ouvriers et de
socialistes se multiplient. Une seconde grève éclata au Creusot le 21 mars 1870 qui durera
jusqu’au 15 avril. L’armée est à nouveau envoyée sur les lieux. Des condamnations jusqu’à deux
ans de prison sont prononcées pour grève politique, des soldats qui ont sympathisé avec les
grévistes sont à nouveau punis. Les grèves se multiplient dans un climat de solidarité du pays tout
entier sinon parfois même d’une solidarité internationale.
Face à cette politisation des mouvements de grève, en mai 1870, Napoléon organise un plébiscite
pour détourner les menaces de révolution puis entre dans la guerre avec la Prusse.
Sur ce fond de grèves, ce fut la première occasion pour l’Internationale, l’AIT, de mener une grande
campagne politique en expliquant le sens du plébiscite et en affirmant son programme, notamment
que les mines, les canaux, les chemins de fer, les banques, moyens d’exploitation entre les mains
de « la féodalité du capital » deviennent des services publics au service des citoyens. C’est dans
ces années qu’une génération de jeunes républicains rompirent avec le combat républicain pour
rejoindre le combat ouvrier et socialiste.
Marx, Engels avaient souligné ce mouvement en France mais aussi l’immaturité ou l’absence des
cadres socialistes. Les républicains et l’idée républicaine dominent encore.

5
C’est ainsi que la Commune fut dans la continuation de cette vague de grève, une révolution
ouvrière mais sans véritable direction ouvrière, une révolution ouvrière dont le résultat immédiat fut
l’établissement de la République bourgeoise.
Dans le même temps que la grande bourgeoisie réprime violemment les grèves – il y a de très
nombreux morts et des milliers d’arrestations et de condamnations à la prison, - elle abandonne
Napoléon dont la politique commerciale ne lui convient pas mais qui semble aussi incapable
d’enrayer la montée des luttes ouvrières. La bourgeoisie napoléonienne rejoint et finance alors le
camp républicain. C’est ainsi que les Peugeot devinrent républicains par intérêt à ce moment
comme la plupart des grands patrons mulhousiens, les Scheurer-Kestner par exemple.
Sous la pression conjuguée républicaine bourgeoise et ouvrière, la fin de l’Empire devient plus
libérale, admet des républicains au sein du gouvernement et accorde la liberté de la presse. C’est
alors une explosion de journaux républicains ou socialistes et de manifestations politiques. Début
1870 lors de l’enterrement d’un journaliste républicain, Victor Noir, assassiné par un membre de la
famille de Napoléon, 500 000 manifestants réclament la démission de l’empereur et la république.
La guerre de 1870, la chute de l’Empire et la république
Napoléon et la bourgeoisie républicaine, devant la révolution qui gronde choisissent l’aventure
militaire pour détourner les mécontentements et entrent en guerre contre la Prusse début Août
1870. Une énorme manifestation populaire dit son hostilité à la guerre. Et immédiatement l’Etat-
major français, corrompu et incapable, plus prompt à réprimer les ouvriers en lutte qu’à risquer sa
vie sur le front, accumule défaites sur défaites. Le gouvernement cache la vérité mais les rumeurs
filtrent et la population réclame des informations véridiques. Des manifestations frisant
l’insurrection ont lieu. La Bourse est envahie aux cris de « A bas la Bourse. A bas les voleurs ».
Des collusions ont lieu entre la police et les manifestants un peu partout dans Paris. Le peuple
réclame des armes. On sent que la révolution est dans l’air. A Marseille, les Internationalistes de
l’AIT et les républicains s’emparent de l’hôtel de Ville et proclament la Commune Révolutionnaire.
Des troupes se mutinent. Il y a des explosions sociales à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Limoges
Les républicains inquiets de la révolution sociale qui gronde, changent alors leur fusil d’épaule et
cherchent l’alliance avec les monarchistes et les bonapartistes contre la rue. On ramène 40 000
soldats du front à Paris pour surveiller la ville rebelle. Mais le 2 septembre 1870, l’armée française,
empereur en tête, capitule. Le 4 septembre les ouvriers Lyonnais proclament la Commune. Ils
licencient immédiatement la police et l’administration de l’Empire. Ils rayent les subventions aux
institutions religieuses, ils instaurent un impôt sur le capital et la propriété immobilière et annulent
toutes les poursuites pour délits politiques ou grèves. Le 4 septembre également, 500 000
parisiens se massent devant le Parlement, l’envahissent et les militants révolutionnaires socialistes
blanquistes proclament la déchéance de l’Empire et la république sociale. Les républicains de leur
côté avec Jules Ferry, Gambetta proclament aussi leur république. Pendant quelques moments, il
va y avoir deux gouvernements républicains, l’un socialiste et l’autre bourgeois. Finalement, usant
de belles paroles, de leur notoriété et profitant de l’absence des leaders socialistes et de la
dispersion des militants ouvriers par la guerre, les républicains bourgeois vont réussir à tromper la
foule ouvrière et l’emporter.
Les républicains au pouvoir ils mettent tout de suite en place d’anciens monarchistes et
bonapartistes aux ministères et postes clefs et commencent la répression contre le mouvement
ouvrier. En même temps il ne cherche pas vraiment à s’opposer à l’avancée des troupes
prussiennes et cherche à renvoyer chez eux les soldats que la contagion révolutionnaire a touché.
Leur seule inquiétude c’est la révolution ouvrière.
Le 18 septembre les troupes prussiennes sont sous les murs de Paris. Le gouvernement
républicain veut capituler mais les ouvriers parisiens craignant que la capitulation devant
l’empereur prussien n’entraîne la chute de la république veulent continuer la lutte. Partout en
France des hommes se lèvent tout à la fois contre la Prusse mais aussi pour la république sociale.
Et partout en France, les dirigeants militaires et politiques tentent de saboter ce mouvement. Les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%