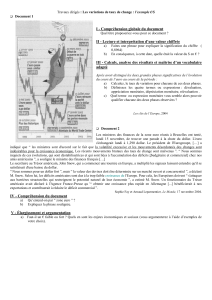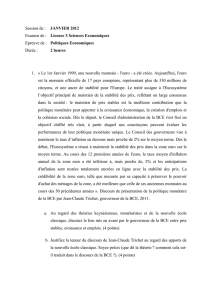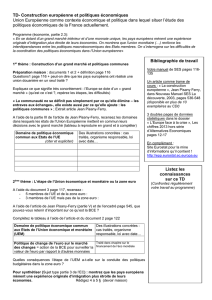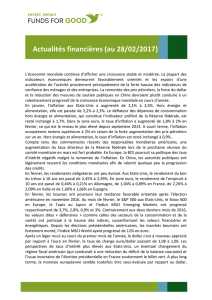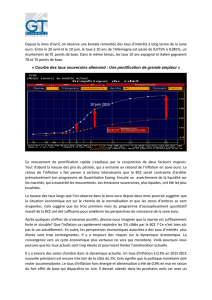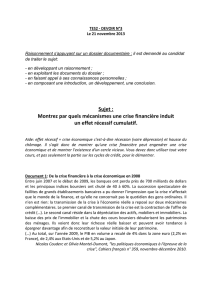TD 4- LA POLITIQUE MONETAIRE EUROPEENNE

T.D. 4- LA POLITIQUE MONETAIRE EUROPEENNE : Objectifs et limites
1- La BCE : la mise en œuvre de sa mission
a) La doctrine de la BCE (doc vidéo)
Questions :
1) Quel est l’objectif prioritaire de la BCE ? Par quel moyen principal assure-t-elle cette mission ?
2) Si l’objectif prioritaire de la BCE est atteint, déterminez-en les avantages pour l’économie en
complétant le schéma ci-dessous avec les propositions suivantes :
hausse des débouchés ; hausse des exportations et baisse des importations ; hausse de l’emploi ;
désinflation.
b) La mécanique monétaire en action
Document 1
La gestion monétaire n'agit sur l'inflation que par la médiation de ses effets sur l'économie réelle. Une
modification du taux d'intérêt affecte le taux de change - c'est-à-dire la compétitivité de l'économie -, les
conditions de crédit, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les entreprises et les ménages peuvent financer
leurs investissements. Il en résulte une évolution de la demande réelle qui modifie les perspectives d'emploi.
Source : Jean-Paul Fitoussi, La Règle et le Choix, Seuil. Coll. La république des idées, 2002.
Questions :
3) Le taux de change et ses conséquences :
Dates
Taux de change
Décembre 1998
1 euro = 1,17 dollar
26 octobre 2000
1 euro = 0,82 dollar
Juillet 2002
1 euro = 1 dollar
7 novembre 2007
1 euro = 1,47 dollar
Considérons les relations commerciales entre les pays de la zone euro et les États-Unis.
Retenons, pour simplifier l’analyse, les trois hypothèses suivantes :
1- Les pays de la zone euro fabriquent et vendent aux États-Unis un produit facturé 100 euros.
2- Les États-Unis fabriquent et vendent aux pays de la zone euro un produit facturé 100 dollars.
3- Les coûts de transport sont nuls.
a) Comment l’euro évolue-t-il par rapport au dollar entre décembre 1998 et le 26 octobre 2000 ? entre le
26 octobre 2000 et juillet 2002 ?
b) Calculez le prix du produit exporté par la zone euro vers les États-Unis, pour les états-uniens (donc en
$), en décembre 1998, le 26 octobre 2000, en juillet 2002 et le 7 novembre 2007. Comment les
exportations du produit vers les États-Unis peuvent-elles évoluer entre décembre 1998 et le 26 octobre
2000 ? entre le 26 octobre 2000 et juillet 2002 ? entre juillet 2002 et le 7 novembre 2007 ? Pourquoi ?
Accroissement
de la
compétitivité-
prix des
produits
européens
Équilibre balance
courante
Croissance
économique

c) Calculez le prix du produit exporté par les États-Unis vers la zone euro, pour les européens (donc en
euros), en décembre 1998, le 26 octobre 2000, en juillet 2002 et le 7 novembre 2007. Comment les
importations de la zone euro en provenance des États-Unis peuvent-elles évoluer entre décembre 1998 et
le 26 octobre 2000 ? entre le 26 octobre 2000 et juillet 2002 ? entre juillet 2002 et le 7 novembre
2007 ? Pourquoi ?
d) Quand la B.C.E. décide d’augmenter son taux directeur, toutes choses étant égales par ailleurs, le taux
de change de l’euro en dollar augmente-t-il ou diminue-t-il ? Expliquez.
4) La hausse du taux d’intérêt et la demande :
a) Quel est l’effet d’une hausse du taux d’intérêt sur la demande dans les pays de la zone euro ?
b) Comment cette hausse affecte-t-elle la demande dans les pays de la zone euro ?
c) Quelles sont les conséquences de l’évolution de la demande dans les pays de la zone euro sur la
production et l’emploi ?
5) Complétez le tableau suivant récapitulant une politique monétaire restrictive menée par la BCE. :
Caractéristique de la
politique monétaire
Objectifs
Moyens
Limites
6) Synthèse des effets d’une politique monétaire restrictive menée par la BCE :
Complétez le schéma suivant par les expressions : freine la demande - ↑ taux de change de l’€/$ - ↓ quantités
X – Désinflation - ↑ débouchés - ↑ quantités M - ↓ demande de crédits des ANF – Accroissement de la
compétitivité-prix des produits européens - ↑ prix X – écart réduit entre O et D - ↑ emploi - ↓ prix M
– équilibre de la balance courante ? – Croissance économique -

Schéma
2 – L’objectif de « la stabilité des prix » : mais quels prix ?
Document 2
Et quelles hausses de prix faut-il surveiller ? Traditionnellement, les banques centrales mettent l’accent sur les prix à la
consommation. Cependant, certains chercheurs, comme Michel Aglietta insistent sur la nécessité pour les banques
centrales de prendre en compte le prix des actifs (les actions, les logements…). En effet, les bulles spéculatives (*) sur
les marchés d’actifs sont aujourd’hui la forme essentielle de l’inflation dans les pays développés. […]
Une autre forme d’inflation s’est développée depuis une vingtaine d’années, qui est la hausse brutale et apparemment
traditionnelle du prix des actifs financiers ou des actifs immobiliers : bulle japonaise entre 1985 et 1990, bulle asiatique
entre 1990 et 1997, bulle Internet de 1995 à 2001, bulle immobilière de 1998 à 2006. Ces mouvements se terminent
presque toujours par des crises aux conséquences parfois très graves. Ainsi, la bulle japonaise, qui a touché tout ce qui
pouvait servir de réserve de valeur, de la Bourse au marché de l’art, en passant par l’immobilier et les terrains de golf, a
été suivie de quinze ans de stagnation, la croissance passant de 3,8 % à 1,4 % par an. Or, une politique d’argent facile
de la part de la banque centrale peut grandement contribuer à l’apparition de bulles spéculatives, en donnant aux
emprunteurs les munitions qui leur permettent d’acheter à crédit des actifs financiers ou immobiliers dans l’espoir d’une
plus-value à la revente.
* phase de forte hausse des prix d’une catégorie d’actifs sur un marché (financier, immobilier, de l’art…). Généralement
liée à un excès de liquidités et à des comportements spéculatifs (des agents achètent un actif uniquement pour le
revendre avec profit), une bulle n’est pas soutenable et finit par se dégongler ou crever brutalement.
Source : Arnaud Parienty, à quoi servent les banques centrales ?, Alternatives économiques, n°263, novembre 2007.
Document 3
La première critique porte sur le rôle du prix des actifs. Elle consiste à dire que l'excès de création monétaire ou de
distribution de crédit peut, pendant une longue période, conduire à des hausses des prix des actifs (immobilier, actions)
et non des prix des biens et services. Cela vient de ce que les prix des actifs sont devenus beaucoup plus flexibles que
les prix des biens, que l'offre d'actifs est devenue beaucoup plus rigide que l'offre de biens et services.
Si une hausse du crédit distribué accroît la demande de biens (électronique...), cette demande supplémentaire peut être
satisfaite par les importations et n'engendre pas de hausse des prix. Si une hausse du crédit stimule le demande d'actifs
(maisons, actions...) la quantité disponible des actifs étant ce qu'elle est, leurs prix montent.
Depuis 1998, on a vu dans la zone euro et au Royaume-Uni une forte progression de l'endettement, d'où,
alternativement, des hausses de prix de l'immobilier et des cours boursiers, mais pas d'inflation : aujourd'hui, après neuf
ans de hausse de l'endettement, l'inflation (hors énergie) est voisine de 1,5 % dans la zone euro et au Royaume-Uni.
Source : Patrick Artus, Quand l’inflation ne menace pas, Le Monde, 18 novembre 2006.
↑ taux d’intérêt

Questions :
7) Complétez le schéma suivant sur les risques inflationnistes d’une baisse des taux d’intérêt avec les
propositions ci-dessous :
hausse de la demande de biens et services – baisse du coût du crédit – hausse de la demande de crédits
des ménages et des entreprises – excès de la demande sur le marché des biens et services.
8) Pourquoi, selon Patrick Artus, si les taux d’intérêt diminuent dans la zone euro, cela « n’engendre pas
de hausse des prix » ?
9) D’après Michel Aglietta (doc 2) et Patrick Artus (doc 3), quels prix devrait surveiller la B.C.E. ?
Pourquoi ?
3 – L’intervention sur le marché monétaire de la B.C.E. en août 2007
Doc vidéo
Questions :
10) Quelles sont les fonctions de la Banque de France ?
11) Quelle était la situation sur le marché monétaire début août 2007 selon Christian Noyer ?
12) Comment la B.C.E. est-elle intervenue sur le marché monétaire en août 2007 ?
13) Pour quelle(s) raison(s) la B.C.E. a-t-elle procédé à cette intervention selon Jean-Claude Trichet ?
Document 4
Les banques centrales ont pourvu le marché en liquidités à bas coût et sauvé de la faillite des
établissements bancaires, comme les banques allemandes IKB et Sachsen LB, pour éviter un risque
systémique, c’est-à-dire l’extension de la crise de proche en proche à l’ensemble du système financier par le
jeu des créances et des dettes. De telles initiatives se justifient afin d’éviter des conséquences très
dommageables pour l’économie réelle. Mais sur le fond, elles ne sont guère satisfaisantes.
Elles consistent en effet à faire prendre en charge par la collectivité les risques inconsidérés pris par les
établissements financiers. Ce qui les encourage à penser que les autorités finiront toujours par leur sauver la
mise. Ouvrant ainsi la route à une prochaine crise qui a de fortes chances d’être encore plus grave que la
crise de cet été. C’est ce que les économistes appellent la question de l’aléa moral. Une telle situation paraît
d’autant plus injuste que, pendant ce temps, les ménages victimes des prêts subprime continuent, eux, de
perdre leur logement et leur épargne…
Source : Sandra Moatti, Faut-il renflouer les spéculateurs ?, Alternatives économiques, n°261, septembre 2007.
Questions :
14) Pourquoi les interventions des banques centrales sur les marchés monétaires en août 2007 étaient-
elles nécessaires ?
15) Expliquez la phrase en caractère gras.
Baisse des taux d’intérêt
Inflation

1- La BCE : la mise en œuvre de sa mission
a) La doctrine de la BCE
Doc Vidéo 1’08 : de « La BCE est basée à Francfort… à … ce qui se décide à Francfort, c’est le
pouvoir d’achat et la croissance de l’Europe ». De 56’05 à 57’13
1) Quel est l’objectif prioritaire de la BCE ? Par quel moyen principal assure-t-elle cette
mission ?
Objectif prioritaire de la BCE= stabilité des prix ou désinflation, objectif chiffré = 2 % ; Moyen principal =
Variation du niveau des taux d’intérêt directeurs sur le marché monétaire.
2) Si l’objectif prioritaire de la BCE est atteint, déterminez-en les avantages pour l’économie en
complétant le schéma ci-dessous avec les propositions suivantes :
hausse des débouchés ; hausse des exportations et baisse des importations ; hausse de l’emploi ;
désinflation.
Désinflation = ralentissement de l’inflation.
Avantages pour l’économie :
Document 1
3) Le taux de change et ses conséquences :
a) Comment l’euro évolue-t-il par rapport au dollar entre décembre 1998 et le 26 octobre 2000 ?
entre le 26 octobre 2000 et juillet 2002 ?
entre décembre 1998 et le 26 octobre 2000, baisse de la valeur de l’euro par rapport au dollar.
entre le 26 octobre 2000 et juillet 2002, hausse de la valeur de l’euro par rapport au dollar.
b) Calculez le prix du produit exporté par la zone euro vers les États-Unis, pour les états-uniens
(donc en $), en décembre 1998, le 26 octobre 2000, en juillet 2002 et le 7 novembre 2007.
Comment les exportations du produit vers les États-Unis peuvent-elles évoluer entre décembre
1998 et le 26 octobre 2000 ? entre le 26 octobre 2000 et juillet 2002 ? entre juillet 2002 et le 7
novembre 2007 ? Pourquoi ?
Prix du produit exporté par la zone euro vers les États-Unis :
en décembre 1998 117 $
le 26 octobre 2000 82 $
juillet 2002 100 $
le 7 novembre 2007 147 $
Entre décembre 1998 et le 26 octobre 2000, le prix du produit baissant en dollar, les exportations du
produit vers les États-Unis devraient augmenter en volume.
Entre le 26 octobre 2000 et le 7 novembre 2007, le prix du produit augmentant en dollar, les exportations
du produit vers les États-Unis devraient baisser en volume.
Désinflation
Accroissement
de la
compétitivité-
prix des
produits
européens
Hausse des X
et baisse des
M
Equilibre balance
courante
Croissance
économique
Hausse de
l’emploi
Hausse des
débouchés
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%