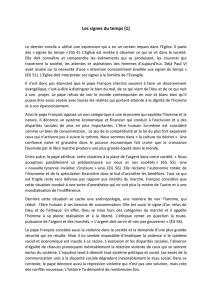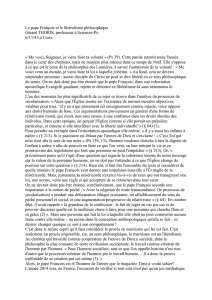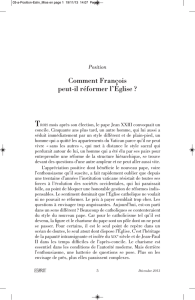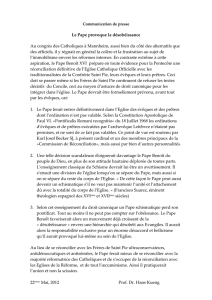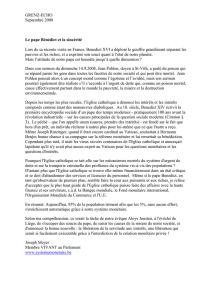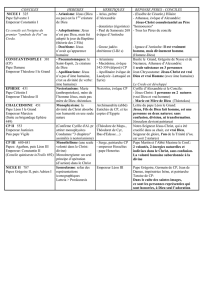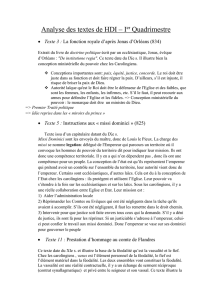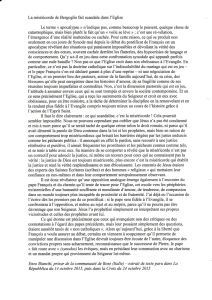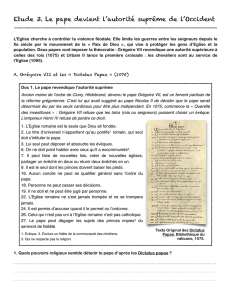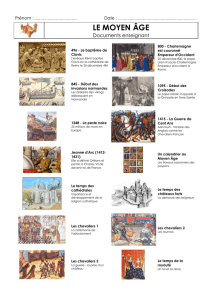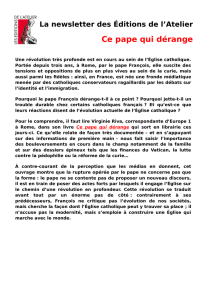1.1.1

1
Université Robert Schuman
Institut d’Etudes Politiques
1ère année
***
Anne-Sophie Chauvet
Institutions et vie politique française et étrangère
1ère partie : Théorie générale de l’Etat
Titre 1 : La notion d’Etat
Chapitre 1 : Définition de l’Etat
Ce type d'organisation politique est apparu en Europe (essentiellement France, Angleterre et
Allemagne) au 13ème siècle puis s'est étendu dans le reste du monde. Au 18ème siècle
l'extension s'est fait aux anciennes colonies anglaises puis une autre extension s'est fait au
moment de la décolonisation à proprement parler. En 1945 l'ONU regroupe en théorie tous les
Etats. Suite à la décolonisation le nombre d'Etats va être multiplié par 4 en 50 ans. Ce
quadrillage étatique du monde détermine la politique intérieur et extérieur des Etats. Mais
comment l'Etat est-il apparu ?
I. Genèse de L'Etat moderne
D'après Norbert Elias, l'Etat est né de la monopolisation du pouvoir par les monarques. Ils ont
affirmé leur domination sur les seigneurs féodaux, leur indépendance vis à vis de l'Empereur
et du Pape. En même temps est née la notion de souveraineté.
Il en a découlé la suprématie d'une certaine puissance et la souveraineté de cette puissance.
Cette puissance prévaut, elle ne dépend de rien ni personne en interne et est au moins égale
aux autres puissances en externe.
La souveraineté s'exerce sur un territoire délimité : on parle de puissance territoriale. L'Etat se
définie par l'existence de frontières et une organisation juridique qui ne dépend pas de celle
des autres Etats.
A. La territorialisation de la puissance publique (De l'Empire a L'Etat)
L'Etat existe sur une certaine surface à l'intérieur des frontières. Au départ la domination était
universelle (Dominium mundi ).
1. Le Dominium Mundi des organisations impériales
Ex : la Chine (l'Empire du milieu), dont les limites territoriales n'étaient pas définies, était
décrite comme le pays "sous le Ciel dominé par le Fils du Ciel". Pour les Chinois il n'y avait
qu'une civilisation, un maître du monde, au loin ce n'était plus des humains, mais des barbares
indignes d'intérêt.
En grec « oikou mene » défini l'espace civilisé dirigé par le Cosmos au-delà duquel il n'y a
que des barbares et un monde dépourvu de sens.

2
On voit que chaque Etat se définit comme le centre du monde, sans frontières. Au départ le
terme frontière était perçu d'une façon négative comme séparant de "l'autre" puis a pris une
connotation positive car devenu le signe reconnaissance de l'autre.
Cette forme d’organisation a imprégné l’idéologie impériale, telle qu’elle réapparaît sous
Charlemagne (an 800). L’empereur va avoir un certain nombre de prétentions à maîtriser
l’ensemble du monde civilisé. Cette formulation apparaît très clairement lors de la diète de
Roncaglia en 1158, où le roi Frédéric 1er, Barberousse se fait appeler « loi vivante » ("Toi la
loi vivante tu peux donner, dissoudre, créer les lois, les ducs naissent et disparaissent et les
rois gouvernent sous ta juridiction") : tout ce qu'il dit a valeur de loi. Un certain nombre de
légistes réagissent à ces prétentions.
2. La réaction des légistes royaux aux prétentions impériales à partir des 12ème-
13ème siècles
L'entourage de Louis IX réagit, refusant la dépendance du roi de France envers l'Empereur du
Saint Empire Romain Germanique. Jean de Blanot, légiste et publiciste du roi, déclare ainsi
que" Le roi de France est Empereur en son royaume". Aussi le roi de France est-il dès lors
perçu comme loi vivante au même titre que l'Empereur (expression constante de la monarchie
jusqu’en 1789), marquant le début de la monarchie absolue. Mais il ne prétend pas au pouvoir
universel, il gouverne à l’intérieur d’un cadre territorial.
En France au même moment, la titulature du roi change, jusque Philippe Auguste, le roi était
"rex francorum" (roi des francs), là il devient "rex franciae" (roi de France). Le territoire est
maintenant défini, et non plus une population. Cette prétention qui commence au 13ème siècle
va être un motif constant de discordes entre la France et l’Allemagne au long des 13ème et
14ème siècles. Les empereurs successifs maintiennent cette fiction juridique de suprématie
impériale. Une des dernières réfutations des prétentions allemandes se trouve dans le Traité
des Seigneuries de Le Bret. Il y souligne la souveraineté du roi et sa non dépendance envers
l'Empereur.
En 1648 le Traité de Westphalie met fin à la guerre de 30 ans (guerre civile européenne) et
aux prétentions impériales à la suprématie universelle. Désormais les relations entre Etats sont
régit par le principe de l'équilibre des puissances, facteur de paix et de prospérité.
B. La sécularisation de la puissance publique (de l'Eglise à l'Etat)
La séparation du domaine politique et religieux n'est que progressive. Si la laïcité de l'Etat est
aujourd'hui une valeur fondamentale de la société moderne, le principe de cette distinction
n'est apparu qu'au 13ème siècle. Avant cela l'Etat faisait partie du domaine théologico-
politique.
1. L'indifférenciation du spirituel et du temporel dans les sociétés traditionnelles
(holistes)
Dans l'Egypte ancienne et en Mésopotamie le pouvoir politique et religieux sont confondus.
De même en Chine, où l’empereur était l’intercesseur entre le monde des dieux et celui des
hommes. Il interprète la volonté divine en lisant les signes du Ciel et les retranscrit sur terre.
En Europe règne la théocratie pontificale jusqu'au 14ème siècle. Le pape considéré comme le
vicaire du Christ sur terre. Il interprète ainsi sa volonté, exprimée dans les évangiles.
L'organisation de la vie terrestre se fait donc à partir des Ecritures. Cette forme très
particulière d’organisation du pouvoir apparaît sous Léon IX et s’affirme avec son successeur,

3
Grégoire VII (Réforme grégorienne). Le pape se voit alors doté de trois pouvoirs
fondamentaux :
-Il reconnaît au concile le droit voter pour lui, supprimant le pouvoir de l’empereur dans ce
domaine.
-Le pape nomme les évêques seul, et non plus sur proposition de l’empereur du Saint Empire
Romain Germanique, ce qui va provoquer la querelle des investitures en Allemagne au 11ème
siècle.
-Le pape est infaillible dans l'interprétation qu'il donne des écritures. Aussi peut-il déposer un
roi « hérétique » ou l'excommunier.
Le pape est détenteur de 2 glaives :
-Le glaive spirituel
-Le glaive temporel dont il a délégué l’exercice au roi, mais qu’il peut reprendre à tout
moment.
Il est celui qui exerce un pouvoir suréminent au titre de la vérité révélée.
2. Les grandes étapes de la sécularisation du pouvoir en France
Face à cette confusion du pouvoir religieux et politique se produit une réaction de rejet. Les
rois de France commencent par contrôler la vérité religieuse, il s’agit du gallicanisme. Se
développe ensuite le pluralisme (Edit de Nantes de 1598). On a enfin observé un phénomène
de sécularisation (ensemble des attitudes qui tentent de dissocier le domaine religieux du
domaine politique) qui a abouti à la mise en place de la laïcité.
a. La solution gallicane
L'opposition entre le pape et le roi né au sujet de l'impôt. L'affrontement débute avec Boniface
VIII et Philippe Le Bel (1296-1304). Il se développe une activité juridique et théologique
intense pour justifier de leur droit à lever l'impôt de part et d'autre : en effet, le roi, pour
financer sa campagne en Flandres prétend imposer l’Eglise de France, qui ne paye d’impôts
qu’à Rome. En France va naître une véritable conception du statut politique de l’Eglise.
Dans l’entourage du Pape, Gilles de Rome (grand canoniste), s'attache à justifier la théocratie
pontificale par l'Evangile selon St Matthieu : "Non est enim potestas ni si a Deo" (il n'est de
pouvoir qui n'émane de Dieu). Il soutient par-là la théorie des pouvoirs exceptionnels : « de
même que Dieu peut faire des miracles, de même le Pape peut intervenir de manière
exceptionnelle dans le cours des affaires temporelles. »
En France, Jean de Paris (légiste) veut justifier la pleine autonomie du pouvoir temporel. Il dit
que la politique est une science autonome qui ne dépend pas exclusivement de la révélation
chrétienne mais aussi de la nature de l'Homme. Il se réfère à Aristote ("l'Homme est un animal
politique"), qui est un auteur non chrétien, ce qui prouve que l’autorité ne peut se prévaloir
d’une révélation divine. Sa rationalité lui donne raison : la science politique n’est pas une
science théologique mais une science autonome.
A partir du tout début du 14ème siècle apparaît l’idée d’une autonomie du pouvoir temporel qui
va s’affirmer dans le cadre des positions de l’Eglise anglicane. Au sein de l'Eglise dirigée par
le pape, il existe des Eglises nationales subordonnées au pape pour les questions religieuses
mais subordonnées au roi pour les questions d'administration (pour la chose temporelle). Ce
gallicanisme va trouver son expression dans la « pragmatique sanction » de Bourges en 1438,
acte de Charles VII qui décide de manière unilatérale que dorénavant les évêques de France
seront choisis par le monarque avant d’être investis par le Pape.
b. L'organisation du pluralisme

4
Progressivement va se mettre en place une politique qui reconnaît la coexistence pacifique de
plusieurs religions sur un même territoire.
L'Edit de Nantes de 1598 donne un statut à la religion protestante. Mais surtout le pouvoir
politique ne peut plus être déduit du pouvoir religieux puisqu'on accepte le pluralisme. Enfin
le pluralisme religieux suppose une liberté de conscience.
Le Concordat de 1801 entre Napoléon 1er et le Pape consacre la coexistence pacifique des
quatre religions reconnues, redonne un certain statut officiel à l’Eglise catholique et reconnaît
les ministres du culte comme fonctionnaires (statut toujours en vigueur en Alsace-Moselle où
la loi de séparation religieuse de 1905 ne s’applique pas). Le pluralisme religieux constitue un
pas vers la sécularisation.
c. La mise en place de la laïcité
La loi de 1905, en mettant fin au Concordat, déclare que la religion est de l'ordre du privé.
L’organisation du culte, la rémunération des ministres du culte et l’entretien des bâtiments
cultuels sont à la charge des pratiquants.
En 1946, l'article premier de la constitution dit que "la France est une république laïque". On
distingue le domaine religieux purement privé du domaine politique public.
C. La monopolisation de la puissance publique
Aux 12ème-13ème siècles, le roi va réagir à la structure féodale du royaume de France : à partir
de Philippe Auguste, et surtout sous Louis IX, il y a une forte réaction aux prétentions
seigneuriales. C’est l’image du roi justicier, qui correspond à l’affirmation progressive d’une
compétence juridictionnelle supérieure aux autres : « le roi est souverain par-dessus tous »
d’après Philippe de Beaumanoir.
1. La souveraineté comme suprématie
Au 13ème siècle la France est une fédération de seigneurs plus ou moins vassalisés envers le
roi. Ils prétendent juger, faire la guerre, et battre la monnaie. Les rois réagissent durement et
entendent exercer une compétence juridique exclusive. La souveraineté provient de la
suprématie du roi, le pouvoir des seigneurs découle de lui.
A la fin du 16ème siècle, le roi fait la loi et n'est plus seulement celui qui rend la justice
(théorisé par Jean Baudin dans son Traité de droit public en 1576).
Tout au long du 19ème siècle, le roi revendique le pouvoir d'homologation, affirmation selon
laquelle la coutume existe mais ne fait office de loi (caractère obligatoire) que si le roi le veut.
La loi est un acte unilatéral mais tandis que la coutume n'est qu'une pratique. Le fondement de
la force obligatoire de la coutume a changé : il est à chercher dans l’absence de volonté
contraire du roi (« la souveraineté c’est de pouvoir faire la loi et de la casser » Bodin).
2. La souveraineté comme indépendance
Le roi monopolise l’intégrité de la puissance publique mais il est indépendant à l’égard de tout
autre pouvoir extérieur : l’ordre international est composé d’Etats définis comme
rigoureusement égaux. Progressivement, les légistes vont opérer une construction juridique
qui va consister à transférer la titularité du monarque à l’Etat. Loyseau définit ainsi le roi
comme « le principal officier de la couronne ».
II. La définition de l'Etat comme personne morale

5
A. La construction juridique de la notion de personnalité morale de l'Etat
Les individus sont régulièrement renouvelés d'où le problème de savoir comment on peut
avoir une certaine unité de l'Etat.
1. Personne physique et personne juridique
Une personne physique est un individu avec un patrimoine, des droits et des intérêts.
Une personne juridique a un statut juridique, des droits propres, un patrimoine et peut être
représentée en justice. Elle existe indépendamment des gens qui la compose, la continuité est
possible. Elle se définit par l’addition de deux éléments : intérêt pour un groupe et la
protection juridique.
2. Les archétypes de la personnalité de l'Etat
a. Les deux corps du roi
Cette hypothèse vient du Moyen Age en Angleterre. On fait la distinction entre la personne
physique du roi et son corps symbolique, son royaume. En réalité cette théorie est calquée sur
l'idée des deux corps du Christ (Jésus et l’Eglise, le corps spirituel). De plus, le roi étant de
droit divin, il est dans l’ordre du possible qu’il ait un corps spirituel. Ceci constitue une
volonté d’unifier l’Etat.
b. La notion de couronne chez Loyseau
Cette théorie est apparue après la mort d'Henri IV, au 17ème siècle. Deux expressions dénotent
la volonté de continuité politique dans le royaume : "Le Roi est mort. Vive le Roi !" et " Le
Roi ne meurt jamais". Ceci dénote l'immédiateté de la succession et le dédoublement du Roi.
Loyseau va essayer de systématiser cette théorie de la couronne, cette dernière étant le
véritable souverain : « Le véritable souverain c'est la couronne et le monarque en est le
principal officier ». La Couronne subsiste toujours tandis que les rois se succèdent.
c. La théorie de la personnalité de l'Etat dans la pensée de Gerber
Gerber juriste allemand de la fin du 19ème siècle, formule cette théorie dans le cadre d’une
Allemagne monarchique. Il dit que l'Etat est une personne juridique souveraine afin
d’empêcher la bourgeoisie de participer au pouvoir. C'est la première fois qu'on emploi le mot
personne pour parler de l'Etat. Cette théorie de la personnalité de l’Etat va ensuite être
appliquée à la nation.
B. L'Etat, personnification juridique du peuple ou de la nation
1. La notion juridique de peuple
Un Etat est composé d’une population assujettie aux lois du pays. Le peuple politique est une
communauté, un ensemble, une universalité de citoyens mais on différencie peuple de
population car le peuple politique se définit par une condition de nationalité. Pour exercer ses
droits, il faut remplir un certain nombre de conditions : jouir de ses droits civiques et avoir
 6
6
 7
7
1
/
7
100%