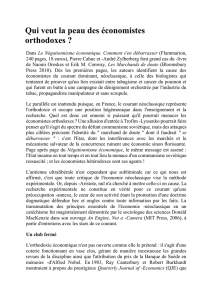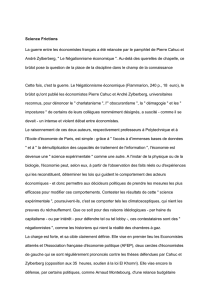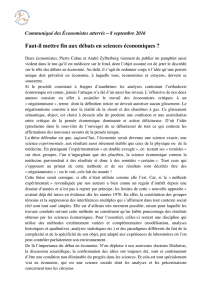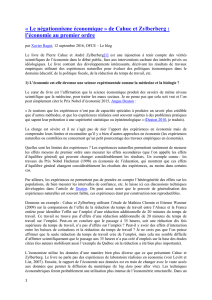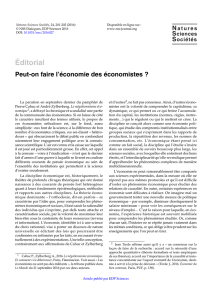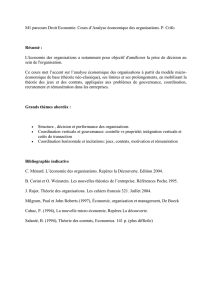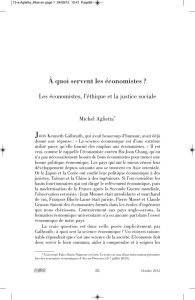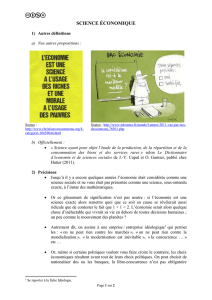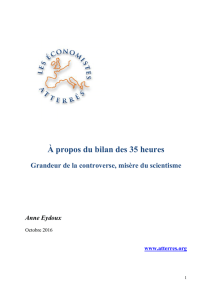debat_negationnisme_economique_3

DEBAT AUTOUR DU « NEGATIONNISME ECONOMIQUE »
3ème partie
Et qui sont les cobayes des économistes ?
«Chercheure au CNRS ? La classe ! En économie ? Tu sers à quoi ? A rien apparemment, vu la crise et le chômage.»
Contrôle du self. Je souris. Si vous saviez… entre nous, on est encore plus féroces. En témoigne le dernier livre de Pierre
Cahuc et André Zylberberg le Négationnisme économique (Flammarion), sorti début septembre, dans lequel les
auteurs fustigent tour à tour les dangereux gauchistes et les suppôts du capitalisme vendus au patronat. Selon eux, ces
deux catégories de traîtres nient les résultats établis de l’analyse économique pour servir des intérêts privés ou
idéologiques.
Alors, certes, les médias sont peuplés d’imposteurs et cela représente un vrai danger pour la démocratie. Mais peut-on
pour autant suivre les auteurs quand ils affirment que les économistes sérieux produisent des vérités scientifiques ?
Que le salut est dans l’expérimentation ? Autrement dit, l’analyse économique devrait, selon eux, s’inspirer de la
recherche en médecine ou en biologie pour mettre au point non pas des traitements mais des politiques publiques qui
marchent.
Franchement, je rêve de tester mes hypothèses comme le font mes copains biologistes. Mais pour avoir passé des
heures autour d’une bonne bouteille à comparer nos disciplines, à discuter méthodes de travail, organisation en labo,
délai de publication, concurrence scientifique… je peux témoigner (à jeun) que nos démarches sont bien différentes. Je
vois trois grandes différences.
Premièrement, les recherches en biologie se font beaucoup plus par processus cumulatif. Un exemple récent est la
découverte du CRISPR (1), cet outil de génie génétique permettant de modifier plus facilement et plus précisément
l’information génétique d’une cellule, ce qui devrait permettre d’éliminer certaines maladies. Ce genre de découverte
révolutionnaire est possible parce qu’une armée de chercheurs s’est mobilisée autour d’une question consensuelle. Ils
ont progressé en reproduisant les expériences des laboratoires concurrents pour montrer que leur propre technique
améliorait tel ou tel paramètre. En comparaison, l’objet de recherche économique, le champ social, est divers et
contextuel ; en ce moment, les macro-économistes italiens sont obnubilés par le chômage et les allemands par les taux
d’intérêts planchers de la BCE. Il est donc difficile de s’accorder sur une grande question à résoudre. Avec une
multitude de questions et autant de données pour les traiter, l’émulation et la concurrence entre laboratoires sont des
moteurs secondaires dans la recherche en économie.
Deuxièmement, mes copains biologistes se heurtent beaucoup moins que moi à des problèmes d’accès aux données.
Le plus souvent, ils les collectent eux-mêmes sur des cobayes. Leur contrainte est donc d’ordre éthique. En économie,
notre contrainte est la disponibilité et la confidentialité ! La plupart des données sont collectées indirectement par des
instituts de statistiques, des banques centrales, des gouvernements, etc. Les questions empiriques sont donc
déterminées par l’existence des données. Par exemple, on vient seulement d’avoir accès à quelques données sur les
activités des banques européennes dans les paradis fiscaux. Il y a donc des questions plus difficiles à traiter que
d’autres… et ce pour des raisons politiques !
Enfin, troisième différence, la principale application de la recherche en biologie est le développement de traitements
médicaux. En économie, c’est la politique publique. Or, la coexistence de groupes sociaux aux intérêts non alignés
entraîne que la mesure publique adoptée dépendra au moins autant de l’équilibre des pouvoirs que de sa capacité
objective (et scientifiquement démontrée) à régler un problème. Là où un seul lobby, le pharmaceutique, interfère
avec le développement thérapeutique, dans un pays, c’est une myriade de groupes sociaux qui défendent leurs
intérêts. En réalité, la grande hypocrisie à prétendre que l’analyse économique peut se faire en laboratoire avec des
pures expérimentations consiste à ignorer que les décisions politiques sont le fruit d’une synthèse d’intérêts
contradictoires.
A ce propos, j’adore la description qu’un ami m’avait faite quand il occupait un poste en cabinet à Bercy. «Le ministre
prend ses décisions en quelques minutes. Pour chaque question, il est bombardé d’avis émanant de l’industrie, de
représentants syndicaux, du patronat, de son parti, etc. Mon job consistait simplement à démonter avec quelques
arguments économiques les doléances les plus fallacieuses» (en vrai il n’a pas utilisé cet adjectif-là…).
(1) Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats ou «courtes répétitions palindromiques groupées et
régulièrement espacées».
Anne-Laure Delatte, Chargée de recherches au CNRS, laboratoire EconomiX, OFCE, professeure invitée à Princeton.
Libération — 19 septembre 2016

“La science économique en crise doit imiter la médecine.” Réflexions sur Romer, Cahuc
et Zylberberg
La semaine dernière, Pierre Cahuc et André Zylberberg ont jeté un pavé dans la mare (certains diraient dans la gueule)
des économistes français en publiant un pamphlet dans lequel ils accusent une bonne partie de leurs collègues de
négationnisme scientifique. Cette semaine, Paul Romer, nouvellement nommé économiste en chef de la Banque
Mondiale, fait de même avec les macroéconomistes américains. Certes, ces deux J’accuse diffèrent substantiellement
en terme d’objectif, d’auditoire, de cible et de fondements épistémologiques. Mais leurs similitudes sont tout aussi
frappantes, en particulier leur volonté de défendre la crédibilité de leur discipline dans un contexte de scepticisme
grandissant, et ce en faisant références aux pratiques de la médicine. Et ces similitudes en disent peut-être aussi long
sur les transformations internes à la discipline que sur ses relations aux politiques et au grand public.
Cahuc, Zylberberg, et l’économie expérimentale face au négationnisme
L’objectif affiché des deux économistes est de corriger la manière dont les médias et le grand public consomment
l’économie. Ils s’émeuvent que des charlatans, dont les travaux ne reposent pas sur des bases épistémologiques
solides, reçoivent une trop grand attention médiatique, et leur pamphlet est d’abord une tentative pour expliquer aux
journalistes quels sont les économistes dont ils devraient relayer les idées. A ces derniers, Cahuc et Zylberberg
proposent donc dès l’introduction un critère de sélection intellectuel :
Depuis 3 décennies […] l’économie est devenue une science expérimentaledans le sens plein du terme. […]
A l’instar de la recherche médicale, l’économie s’attache à bâtir des protocoles
expérimentaux permettant de connaître les causes des phénomènes observés […] Pour savoir si la
dérégulation financière favorise la croissance, si le coût du travail a un effet sur l’emploi, si l’immigration
crée du chômage, si les dépenses publiques relancent l’activité ou si la hausse des impôts la déprime ; et
plus généralement pour toute question où l’on recherche un lien de cause à effet, l’analyse économique
compare des groupes tests au sein desquels ces mesures ont été mises en œuvres, avec des groupes de
contrôle où elles n’ont pas été mises en œuvre.
Cette description de la « bonne science » est complétée, dans l’ultime chapitre, par un critère institutionnel :
En science, c’est le consensus de la communauté des chercheurs, lorsqu’il existe, qui constitue la
meilleure approximation de la « vérité.» Ce consensus repose sur des articles publiés dans des revues
scientifiques [après] une procédure de « critique par les pairs » […] Plus une revue se trouve en haut des
classements, plus la sélection des articles y est sévère, plus crédibilité de ce qui est publié est élevée.
La série de chapitres qui constitue le cœur de l’ouvrage vulgarise donc une série d’article publiés dans les “meilleures
revues,” dont l’objectif est de comprendre les conséquences des
réformes scolaires, de la taxation, de la durée du temps de travail
ou de la régulation financière. Mais l’ouvrage aborde, en pratique,
peu de travaux qui collent le plus à la méthode décrite ci-dessus,
celle des expérimentations par assignation aléatoire. L’un des
exemples développés est le programme américain Moving to
Opportunity dont les résultats montrent que relocaliser des
adolescents de milieux défavorisés dans des environnements plus
aisés ne favorise pas leur réussite scolaire. En fait, Cahuc et
Zylberberg détaillent surtout les résultats d’expériences naturelles,
où l’on utilise des évènements créant accidentellement des
groupes de test et de contrôle. L’exemple canonique est l’étude
dans laquelle Card et Kruegercomparent l’emploi dans les fast-
foods de Pennsylvanie et du New Jersey pour savoir si
l’augmentation du salaire minimum (qui a lieu dans l’un des deux
états seulement) affecte le taux d’emploi. Mais ils utilisent
également les résultats de travaux comme ceux deThomas Piketty,
qui cherche à reconstruire des faits stylisés dans une tradition
d’histoire économique, pour discuter d’une augmentation des
taux marginaux d’imposition. A chaque étude citée correspond
une prise de position : les auteurs émettent ainsi des doutes sur
l’efficacité des règlementations financières type taxe Tobin, du
CICE, ou des 35 heures. Se positionnant de manière répétée
comme des économistes “de gauche,” ils affirment que parce que

les résultats de l’économie mainstream ne conduit pas toujours à soutenir des politiques libérales, celle-ci est donc
bien objective.
Cahuc et Zylberberg font le choix de ne jamais aborder les débats autour de certaines expérimentations quand ceux-ci
existent (par exemple sur l’interprétation des résultats d’une expérimentation sur le pre-K schooling, l’équivalent de la
toute petite section, dans le Tennessee). Ils n’abordent aucune des nombreuses critiques faites aux expériences
aléatoires, en particulier les problèmes de validité interne (que mesure-t-on exactement, quels peuvent être les biais ?)
et externe (ces résultats sont-ils généralisables ?). Aucune méthode alternative n’est évoquée, que ce soit les
expériences de laboratoire, en plein boom, l’analyse des faits stylisés, pourtant présente dans le volume, l’économétrie
structurelle, la microéconometrie sur données de panel, ou l’intégration balbutiante destechniques de machine
learning (traitement algorithmique a-théorique d’énormes bases de données) aux pratiques des économètres. Ils
choisissent également d’ignorer que les stratégies de publication des scientifiques et le classement de leurs revues
puissent être eux-mêmes analysés comme des phénomènes sociaux répondant à des contraintes institutionnelles et
des stratégies de pouvoir. Ils ne mentionnent pas l’existence possible de biais dans l’évaluation par les pairs supposée
garante de la scientificité des travaux. Et c’est une stratégie de vulgarisation étrange. Il n’est en effet pas nécessaire
d’avoir lu Angus Deaton pour se demander si les résultats d’une expérimentation menée il y a 15 ans dans un Etat
américain sont transférables au système scolaire ou fiscal français. Et les journalistes français, et le public, ont bien
conscience de l’augmentation considérable du nombre de scandales et de rétractations, en premier lieu dans la
biologie et la médecine.
Le cadre ainsi planté par Cahuc et Zylberberg les amène à considérer que
tous ceux qui ne fondent pas leurs préconisations de politique économique
sur des expérimentations pratiquent, en connaissance de cause, un
négationnisme visant à enfumer le public et les décideurs pour leur profit,
leur prestige ou leur pouvoir. Ces négationnistes qui accaparent la scène
publique comprennent, à leurs yeux, aussi bien des PDG comme Jean-Louis
Beffa que la quasi-totalité des économistes hétérodoxes français, au premier
rang desquels leséconomistes atterrés ou ceux d’Alternative Economique. Les
méthodes d’analyse de ces économistes de l’analyse Keynésienne à celle des
institutions et des modes de régulation économiques, ne sont pas réellement
expliquée dans l’ouvrage. Mais puisqu’elle ne peuvent pas permettre une
identification robuste des causes des phénomènes économiques, elles
mettent, aux yeux des auteurs, leurs défenseurs sur le même plan que ces
intellectuels ayant défendu la charge de Lyssenko contre la génétique ou que
ces scientifiques ayant produit des études brouillant les liens entre tabagisme
et cancer pour le compte de l’industrie du tabac.
Car c’est essentiellement sur les travaux de l’historien Robert Proctor, auteurs
de deux ouvrages décrivant les pratiques du tabac, que les deux économistes
s’appuient. Dans Cancer Wars, puis Golden Holocaust, ce dernier a analysé en
détail le processus par lequel certaines entreprises et lobbies “fabriquent de
l’ignorance” pour leur profit personnel. Le nom qu’il a donné à l’analyse de ce
phénomène “l’agnotologie,” désigne un domaine de recherche désormais très
fécond. Mais contrairement à la majorité des ces études, Cahuc et Zylberberg
n’expliquent pas vraiment quel profit les hétérodoxes tirent de leur
négationnisme. Ils empruntent également à Proctor sa justification de
l’analogie avec l’holocauste. De la même façon que l’historien justifie son choix
par le nombre de décès causés par les agissement de l’industrie du tabac (“a
calamity of epic proportions with too many willing to turn a blind eye, too
many willing to let the horror unfold without intervention”) les économistes
affirment ainsi “qu’à l’échelle de la planète, des politiques fondées sur des
idées fausses se traduisent par des millions de chômeurs, autant de morts et
l’appauvrissement de centaines de millions de personnes. ” Naomi Oreske et
Erik Conway, auteurs d’une célèbre étude des lobbies climatosceptiques parue
en 2010, avaient par comparaison choisi le titre Merchants of Doubt. Le choix
de ce titre, et de l’analogie qu’il porte, autant que les prémisses
épistémologiques des auteurs, a attiré les foudres de nombreux économistes
hétérodoxes parmi lesquels l’un des chefs de l’école régulationiste, André Orléan. Ces mêmes travers ont été soulignés
par un commentaire plus académique de Xavier Ragot, directeur de l’OFCE et macroéconomiste tout ce qu’il y a de
plus “orthodoxe.” Olivier Bouba-Olga explique de son côté que la parfaite neutralité du chercheur, défendue par les
auteurs, est une illusion.

Romer, les modèles DSGE et la pseudoscience
Si Cahuc et Zylberberg ciblent les économistes hétérodoxes, Romer attaque au contraire le cœur de la macroéconomie
orthodoxe, les modèles DSGE. Son auditoire est également différent, puisqu’il s’agit de convaincre les économistes
d’enterrer définitivement ces modèles. L’article est le dernier d’une série d’attaques publiées ces derniers mois, dans
lesquels il expliquait que le problème de la modélisation macroéconomique dominante n’est pas l’utilisation des
mathématiques en soi, mais la mathiness, une complexification factice des modèles visant à en obscurcir la lecture,
afin que le lecteur ne puisse en identifier les présupposés idéologiques ajoutés sous le manteau.
Pour identifier les causes des cycles économiques (les mouvements des prix et les variations de l’emploi), les
économistes comme Lucas, Kydland et Prescott ont construit des modèles post-real aux hypothèses de plus en plus
fantaisistes, explique Romer. Les cycles ne sont pas expliqués par les comportements intrinsèques des agents
économiques mais par des chocs de productivité aux sources ésotériques :
-un type général de phlogiston qui augmente la quantité de biens de consommation produits au moyen
d’inputs donnés.
-un type de phlogiston investment-specific qui augmente la quantité de biens d’équipement produits par
des inputs donnés
-un troll qui change les salaires payés à tous les travailleurs de manière aléatoire
-un gremlin qui change le prix des outputs de manière aléatoire
-l’Ether, qui augmente la tendance des investisseurs à prendre des risques
-une source de chaleur qui pousse les individus à vouloir moins de loisirs
Romer accuse ces macroéconomistes de vouloir rendre plus difficile encore l’identification des causes par l’ajout de ces
variables exotiques. Car plus le nombre de variables d’un système d’équations multiples est important, plus le nombre
de paramètres à estimer est important, et plus l’économiste doit imposer des restrictions a priori sur les
caractéristiques de son modèle (les termes d’erreurs ou les élasticités, par exemple) pour que celui soir identifié.
Ajouter des anticipations rationnelles au modèle augmente encore le nombre de restrictions à apporter. Et, si le
modèle est assez complexe, ces restrictions a priori peuvent être formulées à l’insu de tous de manière à orienter les
résultats en fonction de son idéologie :
With enough math, an author can be confident that most readers will never figure ou here a FWUTV [a
priori belief] is burried. A discussant or referee canot say that an identification assumption is not credible
if they cannot figure out what it is and are too embarassed to ask.
D’après Romer, la calibration, puis l’utilisation de l’approche bayésienne, rendent encore plus aisé l’insertion de
restrictions a priori intraçables dans les modèles macroéconomiques. Une meilleure solution au problème de
l’identification, précise-t-il, serait d’utiliser plus d’expériences naturelles, comme l’ont fait Friedman et Schwartz, puis
Romer et Romer, avec les grandes crises financières et de la déflation Volcker pour comprendre l’impact de la création
monétaire sur l’économie. Romer considère au total le passage du programme
Friedmanien au programme Lucasien comme une
véritable “régression,” qui a transformé la macroéconomie
en une “pseudoscience,” un terme jusqu’à présent plutôt
utiliser pour discuter de l’astrologie. Là ou Cahuc et
Zylberberg se réfèrent à la littérature sur l’agnotologie,
Romer emprunte au philosophe Mario Bunge. Celui-ci
propose d’étudier un ensemble de caractéristiques clé
pour chaque champ cognitif (sa communauté, son
epistémologie sous-jacente, son mode de formalisation,
ses méthodes etc) afin de séparer les research fields dont
la science fondamentale et appliquée, desbelief fields,
dont les religions, idéologies et pseudosciences. Le titre
choisi par Romer pour son essai, The Trouble with
Macroeconomics est d’ailleurs un clin d’œil à l’ouvrage dans lequel Lee Smolin accuse les théoriciens des cordes de
mettre en danger la science physique par leurs élucubrations pseudoscientifiques.

Sauver la science économique ? Structures sociales et analogie médicales
Les trois auteurs cherchent donc essentiellement à préserver leur discipline de la crise de crédibilité qu’elle connaît
actuellement. Mais si les deux points d’ancrage offerts sont
identiques – assainir les structures sociales internes de la discipline
et ses fondements méthodologiques –, cette convergence cache
en fait des visions très éloignées des problèmes à corriger.
Dans les deux cas, le ton est dur, les accusés explicitement pointés
du doigt. Romer est très explicite sur l’aspect social de la crise que
connaît la macroéconomie aujourd’hui. Il emprunte à Smolin l’idée
que la pseudoscience se développe au sein d’une communauté
scientifique monolithique, et que les croyances non étayées par les
faits se diffusent ensuite par loyauté envers les leaders de ces
approches. Cahuc et Zylberberg n’en disent pas long sur la cuisine
interne de la profession, mais le dernier chapitre fournit néanmoins une des clés pour comprendre l’ouvrage. Fin 2014,
le ministère de la recherche avait failli accéder à la requête des économistes de l’AFEP, qui demandaient la création
d’une nouvelle section CNU pour abriter les économistes hétérodoxes (un précédent avait été la création d’une section
de mathématiques appliquées aux côtés de la section de mathématique historique). La création d’une nouvelle section
fut évitée de justesse parl’intervention de Jean Tirole, et les auteurs reprennent à leur compte son idée que les
pluralistes chercheraient à se soustraire à l’évaluation par les pairs (mais c’est justement pour se soustraire ou
jugement de ces pairs-ci qu’Orléan demande le divorce). Les enjeux de ces débats portent donc autant sur les
méthodes employées que sur les processus de validations des travaux économiques, y compris leur dimension sociale.
La qualité de ces débats bénéficierait de références plus systématiques aux riches analyses des structures sociales de la
discipline publiées par des sociologues comme Marion Fourcade, Daniel Breslau, et, pour le cas français, Fréderic
Lebaron, Olivier Godechot, ou Thomas Angeletti.
Un autre point commun entre les deux textes est la référence aux sciences médicales comme modèle de pratique
scientifique. Les 3 auteurs font référence à l’expérimentation de terrain (naturelle ou contrôlée) comme la méthode la
plus à même de résoudre le problème de l’identification. Mais là ou Cahuc et Zylberberg filent sans réserve la
métaphore médicale, Romer utilise celle-ci pour présenter un tout autre argument. Les premiers se placent dans une
mouvance, en pleine explosion, qui consiste à faire des essais cliniques le nouveau gold standard de la méthode
économique. La validité épistémologique de cette analogie a d’ailleurs été contestée, par exemple parNancy
Cartwright et plus récemment par Judith Favereau (voir aussi ce texte). Mais alors que Cahuc et Zylberberg voient dans
les essais cliniques une méthode pure, ou l’identification de la causalité est débarrassée des scories propres à l’histoire
économique ou aux modèles structurels, Romer utilise au contraire l’analogie médicale comme un appel à mieux
accepter les impuretés de la méthode économique. Il concluait ainsi une version préliminaire de son article par :
Peut-être que cette fois, les macroéconomistes devraient-ils admettre que le naufrage est si grand qu’ils
devraient abandonner leur quête du modèle d’équations simultané ultime. Il serait peut-être plus sage
d’adopter les méthodes désordonnées que les chercheurs en médecine ont utilisés pour faire les
découvertes qui permirent, une fois mises en oeuvre, d’améliorer effectivement la santé.
Ailleurs, Romer explique avoir appris de l’observation des pratiques de son épouse, une chirurgienne ayant travaillé
dans la recherche sur le cancer, que les médecins savent arbitrer entre l’attente d’un traitement dont les effets causaux
seraient nettement identifiés, et les coûts de cette attente en terme de santé. Les économistes feraient bien de s’en
inspirer, et cesser de placer leurs espoirs dans d’hypothétiques (et couteuses) expériences aléatoires, qui tiennent plus
du botox que de la chirurgie. Il faut parfois accepter de mettre en œuvre des politiques économiques aux effets plus
incertains, dont les retombées possibles en terme de bien-être sont très importantes, conclut-il.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%