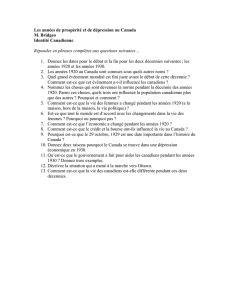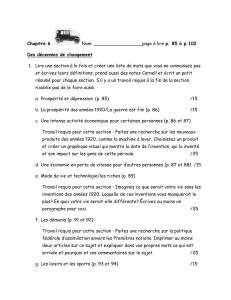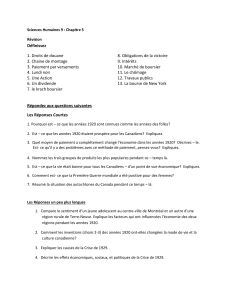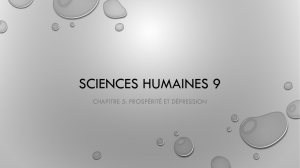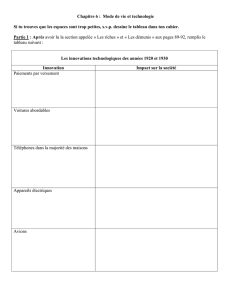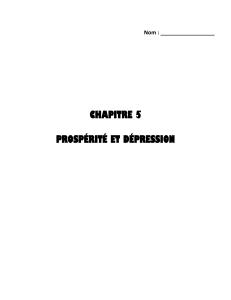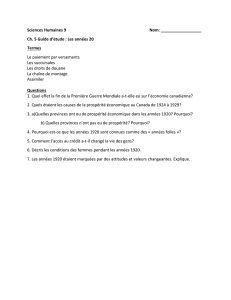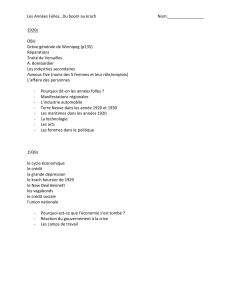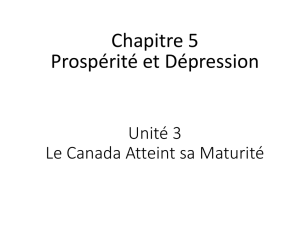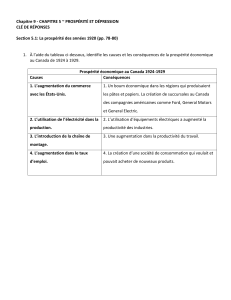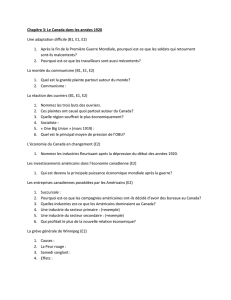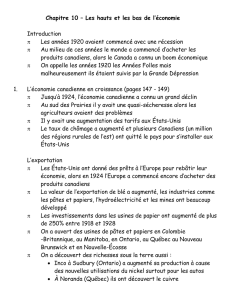Prospérité et dépression

Une petite fille touche le casque
d'un soldat de
la
paix
à
Visoko en
Bosnie-Herzégovine, en 199A. Au
cours du 20e siècle, le Canada, pays
agricole, plus préoccupé par ce qui
arrivait
à
l'intérieur de
ses
frontières,
s'est transformé en pays industria-
lisé plus ouvert au monde.
Prospérité et
dépression
Dans ce chapitre et dans toute l'unité 3, vous devrez évaluer le rôle
d'évènements historiques dans l'identité canadienne. Vous étudierez,
dans ce chapitre, les évènements de deux décennies très différentes:
celles des années 1920 et 1930. Les années 1920 ont été des années
de croissance et de prospérité. Les nouvelles technologies ont fait
partie de la vie quotidienne de nombreux Canadiens. Certains évène-
ments des années 1920 ont provoqué une crise économique qui a
durement touché les Canadiens pendant les années 1930, connues
aussi sous le nom de Grande Crise. En étudiant les évènements de
ces deux décennies, tentez de comprendre comment la prospérité des
années 1920 et les luttes économiques des années 1930 ont contribué
à façonner l'identité actuelle du Canada.
Figure
6.1
En
1930, plus d'un million d'automobiles ont
ère.-
immatriculées au Canada. Comment l'accroissement de
la
mobilité
a-t-il changé
la
vie des gens dans les années 1920?
Figure 6.2
Au cours des années 1930,
les
gens enlevaient
souvent
le
moteur de leur voiture et y attelaient des chevaux
ou des bœufs. On appelait
ces
voitures des «bogheis
à
Bennett»
d'après le patronyme du premier ministre,
R
.B.
Bennett.
85

La
prospérité des années
1920
La guerre est
finie
La Première Guerre mondiale a apporté de nombreux
changements dans la société canadienne. À la fin de
cette guerre, en 1918, les Canadiens espéraient que la
vie reviendrait rapidement à la normale. L'adaptation
à la paix
n'a
toutefois pas toujours été facile. Par ex-
emple, l'économie de guerre a dû se transformer en
économie de paix. Pendant la guerre, l'Europe avait
un énorme besoin de produits canadiens qui incluaient
de la nourriture et des produits manufacturés, surtout
des armes et des munitions. Cette demande a chuté
avec la fin de la guerre et a ainsi créé une récession
temporaire au Canada. Cette récession s'est surtout
ressentie dans les Maritimes et les Prairies où les
ventes de poisson et de blé ont baissé.
Les biens et services étaient rares au Canada pen-
dant la guerre, car les industries produisaient des biens
essentiellement militaires. Cela a entraîné une hausse
des prix des biens de consommation courante. De re-
tour au pays, les soldats ont été surpris de constater que
bien des produits coûtaient deux fois plus cher qu'avant
la guerre. Les travailleurs se sont vite aperçus qu'ils
ne pouvaient plus acheter le nécessaire parce que les
salaires n'avaient pas augmenté au même rythme que
les prix. Les ventes 'ont donc baissé, ce qui a nui à
l'économie. Le chômage s'est accru et plusieurs
ex-combattants n'ont pas trouvé de travail.
parce que le blé était de nouveau en grande demande.
Les activités minières se sont accrues, surtout en
Colombie-Britannique, grâce à la demande du Canada
et d'antres pays en minerais divers (fer, nickel, zinc,
cuivre et autres métaux). Le commerce avec les États-
Unis a augmenté dans les années 1920, poussé par la
demande en pâtes et papiers, ce qui a produit un boom
économique dans les régions productrices de pâtes et
papiers. Les compagnies américaines comme Ford,
General Motors et General Electric ont construit
des succursales au Canada afin d'éviter les droits
de
douane
ou les taxes sur les produits importés au
Canada. Les villes du Canada central ont bénéficié de
l'augmentation du secteur de la fabrication au cours
des années 1920. La valeur des produits manufacturés
à Montréal a connu une hausse de 700
%
pendant
cette décennie.
Les nouvelles technologies ont stimulé la croissance
économique. Dans les années 1920, l'électricité s'était
répandue, même si elle n'était pas encore accessible
aux nombreux Canadiens qui vivaient à l'extérieur des
zones urbaines. L'utilisation d'équipements électriques
et à essence a fait augmenter la productivité au travail.
1100
1000
900
I!!
800
..!!:!
ë5
700
"O
(1J
600
"O
Ill
500
c:
.52
400
~
300
200
100
0
1901 1911
1921
240
220
200
180
Ill
•..
ra
160
0
140
"O
(1J
120
"O
VI
c:
100
.52
~
80
60
40
20
0
1901
1911
1921
1.
Faites une recherche sur les nouveaux produits
des années 1920, comme
la
machine à laver.
Choisissez un produit et faites un organigramme
pour montrer l'impact de
ce
produit sur d'autres
secteurs de l'économie. Montrez, par exemple, les
emplois créés grâce à
la
fabrication de ce produit.
Vous pouvez utiliser un logiciel de diagramme en
toile d'araignée pour réaliser cette activité.
1.
Comment vous seriez-vous senti
si
vous aviez
combattu lors de
la
Première Guerre mondiale
et que vous n'aviez pas trouvé de travail de retour
au Canada? Exprimez vos sentiments dans une
lettre à un journal.
Produits spécialisés
•
Produits agricoles
Produits d'élevage
Figure 6.3
Production
agricole
au
Canada.
Quelle
région
a
été
la
plus
touchée par
la
récession
qui
a
suivi
la
Première
Guerre
mondiale?
•
Autre
Métaux précieux
•
Métaux communs
•
Charbon
Une économie en perte de vitesse
pour d'autres
personnes
Le boom économique des années 1920
n'a
pas atteint
les Maritimes où l'économie ralentissait ou déclinait.
L'économie de Terre-Neuve-et-Labrador (qui était alors
le Dominion de Terre-Neuve)
n'a
pas connu ce boom
économique à cause de certaines raisons.
La construction navale avait été le principal moteur
de l'économie de la région pendant de nombreuses
années. Cette industrie avait déjà commencé à perdre de
l'importance avant même la Première Guerre mondiale.
Malheureusement, aucune autre industrie importante
ne l'avait remplacée. De plus, les ports de St. John's
et d'Halifax ne pouvaient pas se moderniser assez
rapidement et entrer en concurrence avec le port de
Montréal, qui avait reçu des subventions fédérales
pour son expansion.
Après la Première Guerre mondiale, de nouvelles
politiques fédérales ont également nui à l'économie de
la région. Le gouvernement avait haussé les tarifs de fret
ferroviaire. Les industries des Maritimes et de Terre-
Neuve étaient situées trop loin de leurs marchés des
autres provinces du Canada et des États-Unis, contraire-
ment aux industries de l'Ontario et du Québec. Pour
couvrir les tarifs de fret de plus en plus importants, les
industries ont dû augmenter leurs prix. Leurs produits
sont devenus moins attirants et les industries ont perdu
des clients. Entre 1920 et 1926, la région a perdu 42
%
de ses emplois dans le secteur manufacturier. Bien des
gens ont quitté la région pour trouver du travail en
Ontario, au Québec ou aux États-Unis.
Une intense
activité
économique
pour
certaines personnes
En 1923, le Canada central, la Colombie-Britannique
et les Prairies ont commencé à sortir de la récession
pour entrer dans une période de croissance. La produc-
tion
agricol7gmenté,
surtout
dam
les Prairies
Figure 6.4
Production
minière au
Canada.
Comment
la
prospérité
grandissante
du
pays
a-t-elle
influencé
la
vie
des
citoyens
canadiens?
1
/1.
-
1
.1
1
i
1
11
••
1
86
Faire le
point
1.
Quel effet
a
eu l'augmentation des échanges com-
merciaux avec les États-Unis au cours des années
1929 sur l'identité canadienne?
2. Comment l'accessibilité à l'électricité a-t-elle touché
le secteur de
la
production?
3. Comment
la
chaîne de montage et
la
production en
série ont-elles augmenté les profits d'une entreprise?
L'introduction de la chaîne de montage a aug-
menté la productivité au travail ainsi que les bénéfices
des industries. De nouvelles inventions pour la maison
comme la cuisinière électrique, qui est une invention
canadienne, ont contribué au développement de l'in-
dustrie de la transformation et du commerce de détail
au Canada central. L'emploi s'est accru avec le temps
et plus de travailleurs ont pu s'offrir les nouveaux pro-
duits. Une société de consommation, prête à acheter
les tout derniers appareils, faisait son apparition.
87

Colombie- Saskat- Nouveau- Nouvelle-
Britannique Alberta chewan Manitoba Ontario Québec Brunswick Écosse
1.-P.-É.
1921 0,5 0,
1
0,05 0,3 2.8 1,8 0,03 0,03 0,001
1931 1,2 0,2 0,
1
1,
1
4,9 8,
1
0,4 0,3 0,004
Approfondir ses connaissances
1.
Le
débat sur
la
puissance politique et sur l'économie
de
la
région de l'Atlantique continue d'exister.
Certaines personnes prétendent que cette région est
trop dépendante du gouvernement fédéral, tandis que
d'autres pensent qu'elle est désavantagée par le
sys-
tème fédéral. Faites une recherche sur les différents
points de vue. Rédigez un texte d'opinion afin d'ex-
primer votre point de vue sur cette question.
2.
Faites
plus de recherche pour identifier
les
mesures
prises en faveur de
la
coopération entre les provinces
de
la
région de l'Atlantique.
Est-ce
que
la
création
d'une province de l'Atlantique unie est une bonne
idée? Justifiez votre point de vue.
l.
Dressez, sur une carte du Canada, une liste des
activités économiques et de leurs influences pendant
les années 1920 pour les régions suivantes:
Figure 6.5 Production d'énergie électrique par province (en milliards de kWh), en
1921
et 1931. Que signifie kWh? Utilisez un atlas pour
comparer ces chiffres avec ceux de
la
production d'électricité aujourd'hui. (Il y avait neuf provinces canadiennes dans les années 1920.)
L'hydroélectricité s'est développée moins rapidement
dans les Maritimes que dans le reste du Canada, faute
d'argent. La première grande centrale hydroélectrique
des Maritimes, située à Grand Falls au Nouveau-
Brunswick, ne s'est ouverte qu'en 1931. Le manque
d'énergie électrique empêchait les industries de profiter
des nouvelles technologies. Par conséquent, les indus-
tries du
secteur
secondaire, comme celle des pâtes
et papiers, ont mis plus de temps à se développer.
L'exploitation des ressources naturelles
-
les indus-
tries du secteur primaire, comme la pêche, l'agriculture,
les mines et la
forêt-
a été la principale source d'em-
plois dans les Maritimes pendant les années 1920.
Les États-Unis ont augmenté leurs tarifs d'importation
de poisson et de produits agricoles, ce qui a créé un
problème important à ces industries. Comme leurs
produits étaient soudainement devenus plus chers,
les pomiculteurs de la Nouvelle-Écosse, les produc-
teurs de pommes de terre du Nouveau-Brunswick et
de l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que les pêcheurs des
Maritimes et du Dominion de Terre-Neuve ont perdu
des clients. L'industrie houillère de la Nouvelle-Écosse
a connu, elle aussi, des hauts et des bas pendant ces
années-là. Le marché du charbon a chuté lorsque les
industries manufacturières de l'Ontario et du Québec
ont commencé à utiliser le pétrole et l'électricité.
Les difficultés des années 1920 ont conduit de nom-
breux habitants des Maritimes à défendre l'idée d'une
union de leurs provinces. Ils pensaient qu'une union
des provinces les rendrait plus fortes et plus aptes à
résoudre les problèmes de la région. Ils pourraient éga-
lement avoir plus d'impact sur les décisions du gouver-
nement fédéral. Ce mouvement a fait reconnaître les
Maritimes comme une région et a abouti à la rédaction
d'un rapport recommandant une baisse des tarifs de fret
pour les Maritimes.
88
Mode de vie et technologie
Figure 6.6 Quels ont été les effets de l'exode de
la
main-d'œuvre
sur l'économie des Maritimes? Quels revenus ont été perdus à cause
de l'envoi des matières premières aux États-Unis?
Les années 1920 sont connues comme des
«
années
folles», parce que c'était une décennie de liberté
sociale où
il
faisait bon vivre. Les nouvelles techno-
logies et les inventions avaient rendu la vie plus facile
et plus agréable à de nombreux Canadiens. La produc-
tion en série rendait les nouveaux produits facilement
disponibles pour ceux qui pouvaient se les offrir.
Faire le point
Les
riches
La prospérité économique a apporté des changements
importants. Comme les salaires augmentaient, les
travailleurs avaient plus d'argent pour acheterles
nouveaux produits fabriqués en série. Le système de
paiement
par
versements, qui permettait aux consom-
mateurs« d'acheter maintenant et de payer plus tard»,
a été implanté pour ceux qui n'avaient pas d'argent ou
la patience d'attendre. Pour la première fois, bien des
personnes ont commencé à acheter à crédit. Des agri-
culteurs, par exemple, voulaient de nouvelles machines
agricoles, mais ne pouvaient pas toujours les payer
comptant. Alors les marchands accordaient un crédit.
Les gens s'endettaient et pensaient qu'il
n'y
aurait pas
de problème:
1. Comment les facteurs suivants ont-ils nui
à
l'économie
des Maritimes au cours des années 1920?
•
les taux élevés de fret ferroviaire et
la
distance qui
les sépare du Québec et de !'Ontario;
•
le manque de capitaux
à
investir dans
les ressources
;
•
le lent développement de l'énergie
hydroélectrique;
•
les tarifs douaniers.
2. Comment le manque d'industries du secteur
secondaire a-t-il limité le développement de
l'industrie forestière?
l.
Pourquoi les habitants des Maritimes croyaient-ils
que l'union de leurs provinces attirerait l'attention
du gouvernement fédéral?
la
Colombie-Britannique, les Prairies, le Canada cen-
tral et
la
région de l'Atlantique. Vous pouvez utiliser un
système d'information géographique (logiciel
SIG)
et
un logiciel de présentation pour réaliser cette activité.
4.
Le
Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest
sont devenus plus accessibles lorsque
les
pilotes de
brousse ont commencé
à
aller dans le Nord au cours
des années 1920. Faites une recherche pour découvrir
quel
a
été l'impact économique et social de
ces
expé-
ditions sur les Premières nations et
les
Inuits. Dressez
une liste des activités économiques de cette région et
de leurs influences. Ajoutez-la sur votre carte.
5. Terre-Neuve était un dominion indépendant dans
les
années 1920. Lisez des récits sur la vie de
ses
habi-
tants dans ces années-là. Quelle province avait l'éco-
nomie
la
plus ressemblante?
La voiture venait en tête de liste des objets à acheter.
Il devenait possible de posséder une voiture pour« un
dollar versé et un dollar par semaine». En 1923, une
nouvelle Ford coûtait 440$ (soit
5
211
$
aujourd'hui).
On pouvait ajouter des options comme un pneu de
secours, un compteur de vitesse ou des phares en payant
un peu plus cher. Beaucoup de gens ne pouvaient se per-
mettre de débourser autant d'argent en une seule fois,
alors on leur accordait un prêt. La voiture a rendu les
voyages plus faciles
:
les citadins ont commencé à aller
à la campagne et les habitants de la campagne pouvaient
aller faire leurs achats en ville.
Le téléphone est également devenu à la mode à cette
époque-là.
Il
permettait la communication entre et avec
les habitants des régions isolées ou d'autres régions et
ce, même
si
les appels interurbains étaient souvent diffi-
ciles à faire et coûtaient cher. En 1920, une famille sur
quatre avait le téléphone, mais en 1929, trois familles
sur quatre en possédaient un dans plusieurs régions
du Canada.
Les nouveaux appareils électriques étaient égale-
ment très demandés. Bien des travailleurs canadiens
pouvaient s'offrir ces nouveaux produits grâce aux
paiements mensuels et aux ventes à terme. Des tech-
niques publicitaires persuasives encourageaient les
consommateurs à acheter.
89

Figure 6.7
Cette photo d'une
rue animée avec
ses
voitures
et ses tramways
a
été prise
à
Toronto en 1929. Quelle sorte
de changement
la
production
en série de voitures a-t-elle ap-
portée dans une ville déjà pleine
d'activité? Quels changements
les voitures ont-elles apportés
dans le Canada rural?
Labors
Figure
6.8
Ces
produits sont devenus populaires chez ceux qui avaient l'électricité
et qui pouvaient
se
les
offrir ou les acheter grâce au paiement par versements. Quand
l'électricité a-t-elle été accessible aux foyers de votre localité?
Faire le
point
1. Comment l'accès au crédit a-t-il changé
la
vie
des gens?
2.
Observez
les
nouveaux appareils de
la
figure 6.8.
Comment chacun a-t-il modifié le travail à
la
maison?
90
01•&47,
Thl8
Uprl11ht T8ble
ToHter
la lieavtly nlckel-Plated
wtlh
beavy oast. base; bas
a
guarante<'Ù
element t.bat
Will
toast the
breed
eventv: complete wltb
auscn-
~~:.~~~~-~~-1~:
3.75
1. Imaginez
ce
que serait votre vie sans les inventions
des années 1920. Laquelle de
ces
inventions vous
manquerait le plus?
En
quoi votre vie serait-elle
différente?
2.
Dans quelle mesure les biens matériels sont-ils
devenus une partie de l'identité canadienne?
Donnez des exemples pour appuyer votre réponse.
Les démunis
Les Canadiens n'ont pas tous profité de la prospérité
des années 1920. Les nouveaux produits et les nou-
velles technologies n'étaient que des rêves pour cer-
taines personnes.
Les travailleurs
à
faible salaire, par exemple, n'ont
pas bénéficié du boom des années 1920. Dans les
régions rurales du Canada, les familles pauvres échan-
geaient avec les commerçants ce qu'ils cultivaient
contre des produits de première nécessité. Dans les
villes, des familles de petits salariés luttaient pour sur-
vivre, elles n'avaient pas toujours l'électricité ni les
moyens d'acheter les nouveaux biens offerts sur le
marché. Bien des Canadiens d'origine africaine et
de descendance asiatique faisaient partie de ces petits
salariés. L'insousciance des années 1920 n'avait pas
atteint les petits salariés.
Les conditions des femmes pendant cette décennie
étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Lors de
la Première Guerre mondiale, les hommes sont partis
au combat et les femmes ont fait des progrès dans le
monde du travail. La plupart ont cependant perdu leur
emploi au retour des soldats.
La plupart des filles quittaient l'école vers la
ge
année. Elles devaient devenir des épouses et des
mères et abandonner le marché du travail une fois
mariées. Les femmes qui avaient un certain niveau
d'instruction pouvaient être institutrices, infirmières,
aides-comptables ou secrétaires. Celles qui n'avaient
pas de qualifications trouvaient du travail comme
femmes de ménage et commis dans des bureaux, des
magasins ou des usines.
Quelques femmes fréquentaient l'université. En
1920, 16,3
%
des étudiants de premier cycle étaient
des femmes; en 1930, ce chiffre est passé à 23,5 %.
Les diplômées universitaires avaient plus de possibi-
lités d'emploi, mais elles étaient généralement beau-
coup moins payées que les hommes occupant les
mêmes postes.
Les conditions des enfants s'étaient améliorées
grâce aux lois sur le travail des enfants, mais un bon
nombre de jeunes gens travaillaient toujours dans des
entreprises familiales ou quittaient l'école pour aller
travailler. En 1929, les lois sur le travail des enfants ont
interdit le travail en usine ou dans les mines aux jeunes
de moins de 14 ans, et ce dans la plupart des provinces.
l
I
1'
1.
1
1
1
l
l
I
''
'l
I
t
!
1
1.
1
1
!I
1
1,
1
11
;
Figure 6.9
Les
femmes ont trouvé des emplois de téléphonistes grâce
à
la
popularité grandissante du téléphone. Comparez les conditions
de travail des années 1920 avec celles d'aujourd'hui.
9l

Les Premières nations du Canada
n'ont
pas profité
de la croissance économique des années 1920. Com-
me vous
l'avez
appris dans le chapitre 3, plusieurs
Premières nations avaient été déplacées dans des
régions où le sol était pauvre et les ressources écono-
miques faibles. La vie dans ces communautés était
parfois très difficile.
Le gouvernement espérait assimiler les Premières
nations à la culture dominante. Sa politique était fondée
sur la croyance ethnocentrique que les Premières
nations bénéficieraient des prétendus avantages de
la culture dominante
s'ils
abandonnaient leurs valeurs,
leurs croyances et leur culture.
Les Premières nations avaient plus de contacts
avec la culture dominante parce que l'avion rendait plus
facile l'accès aux communautés éloignées. En 1920,
le gouvernement a rendu l'école obligatoire pour tous
les enfants des Premières nations âgés de
7
à
15
ans.
Le gouvernement pensait que
l'école
était le meilleur
moyen d'atteindre son objectif d'assimilation.
Au début de 1800, il y avait des écoles dans les
réserves. Dans les années 1870, le gouvernement a
commencé
à
construire des pensionnats. On pensait
alors que ces pensionnats, qui éloignaient les enfants
de l'influence des parents, étaient la meilleure façon
d'assimiler
les enfants des Premières nations. Les
années 1920 ont vu le nombre de pensionnats aug-
menter. Des milliers d'enfants déracinés n'avaient plus
le droit de parler leur langue maternelle, de porter leurs
vêtements traditionnels ou de participer à leurs fêtes
culturelles.
Les Premières nations qui se sont assimilées ont
souvent trouvé que les avantages de l'assimilation
n'étaient
pas aussi grands que ce que le gouvernement
avait bien voulu leur faire croire. Elles
n'étaient
pas
facilement acceptées par les autres membres de la
société canadienne.
Les politiques gouvernementales sur l'instruction
étaient contestées. Fred Loft (appelé Onondeyoh ou
«
montagne magnifique»), un ancien combattant
mohawk de la Première Guerre mondiale, a fondé,
en décembre 1918, la League
ofJndians
of Canada.
Fred Loft voulait hausser le niveau de scolarisation
offert aux membres des Premières nations. Il a encou-
ragé toutes les bandes du Canada à faire partie de la
ligue et
à
assister aux réunions annuelles. Le ministère
des Affaires indiennes
s'est
farouchement opposé à
cette ligue, sous prétexte que Loft cherchait
à
nuire
92
Figure 6.10 Quenich (à gauche) est le père des enfants que l'on
voit ici dans leurs uniformes de pensionnaires.
Ce
genre de photo
du début du
xxe
siècle était utilisé pour promouvoir les pensionnats.
Quels messages cette photo pouvait-elle envoyer
à
la
fois aux
membres des Premières nations et aux autres Canadiens?
à
l'autorité
du gouvernement. En 1927, le gouverne-
ment a adopté la Loi sur les Indiens qui interdisait
aux Premières nations de s'organiser politiquement et
d'engager
des avocats pour les représenter dans toute
revendication contre le gouvernement. Ces restrictions
sont restées en vigueur
jusqu'en
1951.
Faire le
point
1. l'étiquette
d'«
années folles» attribuée aux années
1920 ne reflète pas véritablement
la
perception
qu'avaient certains Canadiens de cette décennie.
Quelle étiquette les Canadiens qui souffraient de
pauvreté ou de discrimination auraient-ils pu attri-
buer à cette décennie? Discutez avec vos camarades
de
la
justesse de
ces
étiquettes.
1.
Les
Premières nations ont conservé leur culture
malgré
la
politique fédérale d'assimilation et
la
discrimination de
la
société canadienne envers eux.
Qu'est-ce que cela révèle sur leur sentiment d'iden-
tité? Justifiez votre réponse.
Les
loisirs
L'invention de la radio et celle du cinéma ont enrichi
les loisirs des années 1920. Les premières radios fonc-
tionnaient mal, mais étaient très demandées. Il fallait
utiliser un casque d'écoute et se concentrer pour
entendre quelque chose. Vers 1925, Ted Rogers, un
ingénieur canadien, a inventé la radio électrique pour
remplacer la radio à piles et à cristaux. La radio était
un moyen de procurer une plus grande variété d'infor-
mations et de divertissements à un plus vaste public.
La radio, par exemple, a popularisé le jazz, un style
créé par des musiciens afro-américains.
Les films muets étaient un divertissement populaire.
Mary Pickford, née à Toronto, est devenue une vedette
Figure 6.11
Les
Edmonton Grads ont
permis de faire reconnaitre
le basket-ball féminin.
Les
Grads ont remporté
le championnat du monde
en basket-ball féminin
17
années de suite.
...
-
de cinéma populaire et elle
a
été surnommée
«
l'ange
del'
Amérique». Elle a commencé sa carrière dans les
films muets et
l'a
poursuivie dans les
«
films parlants»
comme on appelait les premiers films avec du son dans
les années 1930. Mary Pickford et d'autres acteurs de
l'époque ont créé
l'United
Artists, une société cinéma-
tographique prospère.
Les sports
Les années 1920 sont reconnues comme
l'âge d'or
du sport au Canada. Plus de Canadiens ont commencé
à assister à des matchs de baseball, de football et de
boxe parce
qu'ils
travaillaient moins longtemps et
avaient plus
d'argent
à dépenser. Les matchs de hockey
étaient diffusés à la radio. La voix de Poster Hewitt
criant
«
Il lance et compte
!
»
était entendue partout
dans le pays. La course à pied, l'aviron, la natation et
les courses cyclistes étaient également très populaires.
Les femmes ont commencé à
jouer
un rôle actif
dans les sports organisés. Pour la première fois, des
femmes ont pu participer à des compétitions en athlé-
tisme aux Jeux olympiques de 1920. L'équipe féminine
canadienne de relais a remporté la médaille
d'or
du
relais 400 mètres. Le basket-ball féminin a été reconnu
ED\\O\ TO\
C'O\I
\\f:"CIAL
G~DU-\TES
BASKETBALL
CLUB
T
WOAL.05
t;HAMPtONS
J
1111
!1:1
1
',
'
93
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%