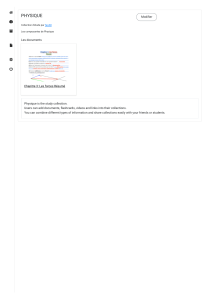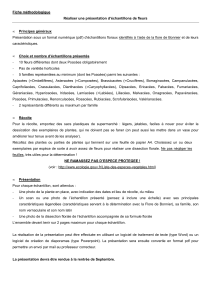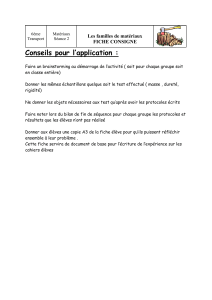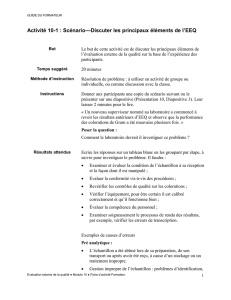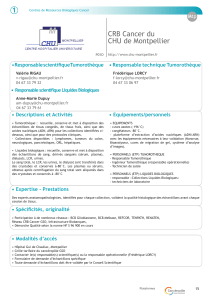« Échantillon », mot-clef et concept central pour les collections de

10
LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA
11
MUSÉOLOGIE SCIENTIFIQUE
Pierre Brunel, professeur honoraire au Département de sciences
biologiques de l’Université de Montréal, est biologiste et océano-
graphe. Il est président de l’Institut québécois de la biodiversité.
Dans un numéro récent de la SPNHC Newsletter,
diffusé par la « Society for the Preservation of Natural His-
tory Collections », John E. Simmons (2004), gestionnaire des
collections du Musée d’histoire naturelle de l’Université du
Kansas, s’interroge pertinemment sur la désignation la plus
appropriée de toutes les « composantes » (i.
e. les objets) des
collections de sciences naturelles. Après avoir passé en revue
les équivalents anglais des mots « artéfact », « item », « objet »,
« spécimen » et « chose », il conclut que le mot « élément »
serait le plus convenable, parce qu’il est le plus général. L’
Ox-
ford English Dictionary
est la seule source lexicographique
ford English Dictionary est la seule source lexicographique ford English Dictionary
citée par l’auteur. Dans les paragraphes qui suivent, j’entends
montrer, en recourant à un autre dictionnaire, que le mot
« échantillon » est plus approprié, car le mot « élément » dési-
gne un concept beaucoup trop englobant qui inclut toute
abstraction faisant partie d’un ensemble ou d’une « chose »
plus grande, qui peut être tout aussi abstraite.
Les écologistes, les taxinomistes et les autres natura-
listes savent bien que l’étude de la nature s’est énormément
transformée depuis les époques de Linné et de Darwin, aux
XVIII
e
et XIX
e
siècles. Le développement de l’écologie, de
l’éthologie et de la génétique au XX
e
l’éthologie et de la génétique au XXe
l’éthologie et de la génétique au XX
siècle a notamment eu
pour effet de réduire les préoccupations des naturalistes pour
la taxinomie, la oristique et la faunistique, essentiellement
descriptives, et de déplacer leurs intérêts vers les associations
végétales et animales (i.
e. les communautés, ou biocénoses),
vers les écosystèmes et les mécanismes qui les structurent,
et en n vers l’évolution, qui explique les lointaines origi-
nes des groupes d’espèces. Bref, l’intérêt pour les espèces
individuelles, leur identi cation et leur classi cation s’est
progressivement déplacé vers les groupements d’espèces,
les facteurs physico-chimiques de leur environnement, et les
facteurs historiques de leur phylogénie.
En raison de ressources nettement insuf santes, les
musées d’histoire naturelle ont eu beaucoup de dif cultés
à adapter leurs collections de recherche à cette évolution.
Encore aujourd’hui, la plupart des musées conservent leurs
collections avec un souci prioritaire pour les espèces et les
spécimens qui en sont les plus représentatifs, plutôt que
pour les ensembles d’espèces. Cette tendance est encore plus
marquée chez les collectionneurs privés, notamment chez les
entomologistes autodidactes, particulièrement nombreux
au Québec. Car les deux fonctions taxinomiques et écolo-
giques conservent toujours toute leur importance pour une
étude sérieuse de la biodiversité (Brunel, 2004), ce qui signi e
que par leur nature même de service à toutes les recherches,
« Échantillon », mot-clef et concept central pour
les collections de sciences naturelles
Pierre Brunel
les collections de sciences naturelles sont appelées à toujours
se développer. Les besoins en espace et en personnel pour les
rendre accessibles devraient donc augmenter avec le temps
et les progrès scienti ques. Or le contraire semble plutôt se
produire.
Les développements technologiques survenus
pour raf ner les recherches écologiques ont multiplié les
méthodes de prélèvement des végétaux, des animaux et des
microbes dans la nature. Bien sûr, dans les habitats terres-
tres visibles et facilement accessibles comme les prairies, les
forêts, ou même les déserts et les marécages, on peut encore
prélever à la main une plante ou un insecte, tuer ou piéger
un oiseau, un mammifère ou un autre vertébré d’assez
grande taille, tout comme Linné et les anciens naturalistes
le faisaient. On prélève alors généralement un ou quelques
individus à la fois, de façon assez aléatoire et sélective, selon
ses intérêts, traditionnellement plutôt taxinomiques. Et les
modes de prélèvement étaient et peuvent encore demeurer
très rudimentaires, sans que les organismes ainsi mis en col-
lection perdent de leur intérêt.
Les méthodes de prélèvement inventées pour les
recherches écologiques, de plus en plus quantitatives,
ont toutefois permis de prélever d’un coup des groupes
d’animaux ou de végétaux comprenant des nombres con-
sidérables d’individus. Ces méthodes avaient d’ailleurs été
inventées depuis longtemps pour les milieux aquatiques,
notamment les fonds marins exploités par les pêcheurs :
l’utilisation du chalut, ce let en forme de poche que traîne
le navire et qui racle le fond en ramassant tous les gros ani-
maux qui s’y trouvent, remonte au Moyen Âge, et celle de
la drague n’est probablement pas beaucoup plus récente. Le
let à plancton, inventé par Hensen à la n du XIX
e
siècle,
permet encore aujourd’hui de prélever une communauté
planctonique entière : comme pour les chaluts, la dimension
des mailles détermine quelle fraction de cette communauté
multidimensionnelle sera prélevée.
Les «
éléments
» d’une collection muséologique sont
donc des objets très concrets. Leur interprétation ou leur
explication peut devenir abstraite, mais les abstractions ne
sont pas véritablement des «
composantes
» d’une collection.
Selon moi, désigner un animal ou une plante comme étant
un «
objet
» (désignation «
raisonnable
» selon Simmons) ne
le ravale pas au rang inférieur des objets non biologiques tels

10 11
LE NATURALISTE CANADIEN, VOL. 129 N
o
1
HIVER 2005
MUSÉOLOGIE SCIENTIFIQUE
Le tri d’un des échantillons écologiques de fond marin (en arrière-
plan) extrait les animaux des sédiments, sépare laborieusement
l’échantillon en sous-échantillons taxinomiques rassemblés dans
des plats de verre, puis dans des oles étiquetées qui seront
classées dans une collection de recherche.
JEAN-LUC VERVILLE
que les roches, comme Simmons semble le penser lorsqu’il
invoque «
un certain poids historique
» pour rejeter le terme
«
objet
». En outre, après avoir cité le sens inapproprié du mot
anglais «
object
», soit «
objection
» ou «
obstacle
», l’auteur
cite la dé nition appropriée de ce mot
: «
quelque chose qui
peut être vu, touché, ou autrement senti
. Cela décrit assez
bien le contenu de la plupart des collections, tant d’histoire
naturelle que d’artéfacts humains. Mais des sonogrammes de
chants d’oiseaux, des odeurs orales en oles ou sur d’autres
supports physiques, ainsi que d’autres composantes descrip-
tives de collections qui ne sont pas des objets physiques sem-
blables aux spécimens traditionnels, sont des composantes
fort valides des collections de sciences naturelles. Que le mot
«
objet
» soit adéquat ou non, par conséquent, il vaut la peine
d’examiner un autre mot et un autre concept.
D’une certaine manière, on peut considérer tous
les musées comme des institutions scienti ques dédiées à
l’étude et à l’interprétation, tant pour le grand public que
pour les usagers spécialisés, des collections d’objets qui sont
leur principale caractéristique. Puisque la première étape de
toute étude scienti que consiste à observer la réalité objec-
tive avec nos cinq sens, les musées rassemblent, pour tous les
chercheurs intéressés et pour tous les visiteurs de leurs expo-
sitions, des « concentrés de réalité ». Ces concentrés nommés
« collections » épargnent beaucoup de voyages coûteux à
leurs usagers qui, pour la plupart, comprendraient mieux la
réalité en l’observant directement mais ne peuvent absorber
de tels frais de voyage dans des lieux très éloignés ou trop dan-
gereux. Et les voyages dans les temps passés sont impossibles,
sauf par les collections, les livres, les lms et autres moyens
indirects semblables. En outre, voyager intelligemment dans
l’espace ou dans le temps requiert habituellement de bons
guides ou experts, peu souvent disponibles sans frais. Les
musées procurent généralement ces savoirs. Toutefois, les
musées ne diffèrent pas des autres institutions scienti ques
en ce que les « meilleurs concentrés de réalité » qu’ils peu-
vent offrir sont lourdement tributaires de leurs ressources.
Les objets contenus dans leurs collections sont donc ce que
tous les scienti ques modernes nomment
«
échantillons
»
de cette réalité, c’est-à-dire des sous-ensembles de l’énorme
quantité d’objets naturels produits par l’évolution organique
ainsi que par les facteurs écologiques plus récents, mais éga-
lement des sous-ensembles du plus petit nombre d’artéfacts
produits par les humains.
Quelle est cette réalité que les objets muséaux visent
à représenter
? Si l’on se limite d’abord aux traditionnels
musées d’histoire naturelle, leur tâche classique
–
jusqu’aux
– jusqu’aux –
quelques décennies récentes
–
consistait à montrer la réalité
– consistait à montrer la réalité –
des
espèces
. Les échantillons de cette réalité que leurs res-
sources limitées leur permettaient d’exposer ou de mettre à la
disposition des chercheurs, on les nommait
spécimens
. Dans
le dictionnaire
Robert
(1993), ce mot (qui remonte à 1662),
Robert (1993), ce mot (qui remonte à 1662), Robert
dans son premier sens, se dé nit comme suit : « Individu qui
donne une idée de l’espèce à laquelle il appartient ; unité ou
partie d’un ensemble qui donne une idée du tout ». Simmons
(2004) n’aime pas ce mot à cause de ses « connotations aris-
totéliciennes ou typologiques », et parce qu’il « dénote une
partie représentative d’un tout ». Cette objection signifie
simplement que le spécimen n’est pas un bon échantillon
parce qu’il peut mal représenter l’espèce réelle. Mais les
mots-clef ici sont « individu » et « représentatif ». Je note que
la dé nition française n’emploie pas le mot « représentatif »,
mais réfère plutôt à « l’idée » (de la réalité de l’espèce) trans-
mise par « l’individu », et que ce dernier mot n’apparaît pas
dans le choix d’une dé nition par Simmons. Tout scienti-
que admettra qu’un spécimen choisi comme « type » par
les anciens naturalistes était souvent peu représentatif de
son espèce. Mais il pouvait l’être. Et qu’il soit représentatif
ou pas, il donnait une « idée » du groupe d’individus affublé
d’un nom scienti que d’espèce. Le mot « spécimen » est donc
parfaitement valide pour désigner un échantillon consistant
en un seul individu. On peut également le considérer comme
un
« échantillon taxinomique »,
car sa fonction taxinomique
est nettement supérieure à sa fonction écologique (cf. Brunel,
2004).
Le mot « échantillon », apparemment plus ancien en
français (il remonterait à 1260.) que le « sample » anglais,
est dé ni comme suit dans le Robert (1993), dans son sens
le plus approprié ici : « Petite quantité d’une marchandise
qu’on montre pour donner une idée de l’ensemble. » Une
petite quantité peut être aussi petite qu’un seul individu – un
spécimen - ou elle peut contenir plusieurs unités, mais dans
les deux cas l’intention est encore de « donner une idée » de la
réalité du tout. Que l’objet soit représentatif ou pas importe
peu : il est toujours un échantillon, bon ou mauvais. On a
progressivement étendu aux recherches scienti ques ce sens
commercial du mot « échantillon ». Et les scienti ques, dans
les musées ou ailleurs, conviendront aisément qu’aucun

12
LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA
13
MUSÉOLOGIE SCIENTIFIQUE
JEAN-LUC VERVILLE
Cette branche de pin gris est un sous-échantillon d’arbre
individuel, c’est-à-dire un spécimen dont les « cocottes »
témoignent de la saison de reproduction de l’espèce dans
les Laurentides il y a 52 ans. Le réchauffement climatique
en cours y change-t-il quelque chose ?
échantillon, aussi grand soit-il, ne sera jamais parfaitement
représentatif du tout, c’est-à-dire de la réalité. Mais il en
transmet toujours « une idée » : c’est tout ce qu’il peut faire
dans notre monde imparfait.
Les études modernes en sciences naturelles ont
déplacé l’accent, auparavant centré sur les réalités taxino-
miques, vers les réalités écologiques. Les échantillons sont
devenus plus gros et plus raffinés (i.
e. plus quantitatifs),
en particulier dans les milieux aquatiques, d’où l’on peut
extraire des échantillons de communautés biotiques entiè-
res à l’aide de lets à plancton, dragues, bennes, chaluts, etc.
On prélève même le substrat physique – sable, vase – des
communautés benthiques qui y vivent. Dans les milieux
terrestres, on peut capturer des quantités considérables
d’insectes dans les pièges lumineux, et les pédologues peu-
vent prélever des échantillons quantitatifs de sols analogues
aux échantillons de faune benthique aquatique. À cause de la
nature laborieuse et coûteuse du travail de tamisage, de tri, de
décompte, d’isolement et d’étiquetage des nombres énormes
d’individus rapportés dans de tels échantillons, on les fait
attendre longtemps avant de les traiter. On peut et on doit
les entreposer en collection. Pour réduire les coûts et cibler
les problèmes urgents, toutefois, on extrait généralement les
spécimens des espèces choisies pour leur valeur marchande,
en laissant le reste à de futurs chercheurs animés d’objectifs à
plus long terme. De tels
échantillons écologiques
contiennent
en général des spécimens de plusieurs taxons différents de
haut niveau (embranchements, classes, ordres). Les musées
n’en ont pas conservé beaucoup dans le passé, faute d’espace
et de personnel. Au cours des récentes décennies, ce type de
« données brutes » a plutôt été produit par les laboratoires
gouvernementaux pourvus de mandats en ressources natu-
relles ou en environnement. Les professeurs d’universités
aux ressources encore plus limitées, qui en produisent aussi
beaucoup avec leurs étudiants, tendent plutôt à les jeter.
À notre époque de troubles environnementaux
croissants, les échantillons écologiques acquerront assuré-
ment une plus-value scienti que bien plus grande que dans
le passé. Les mouvements écologistes militants poseront
bientôt des questions embarrassantes aux gouvernements
qui sont les pourvoyeurs responsables du nancement des
musées et des universités, sans parler de leurs propres labora-
toires, qui sont eux-mêmes sous- nancés pour la recherche
fondamentale d’avenir. En effet, le domaine légal aura de
plus en plus l’obligation de préserver les habitats naturels en
danger, et pas seulement les espèces. Et la réalité des habitats,
auparavant naturels et maintenant perturbés, doit être docu-
mentée avec des échantillons écologiques, pas seulement par
les échantillons taxinomiques ou biogéographiques, qui ont
pour fonction de documenter la réalité des espèces et de leur
répartition spatiale à grande échelle (Brunel, 2004).
Pour désigner des échantillons écologiques, les
expressions « lot » ou « faunal group » sont aussi utilisées,
par exemple au Musée canadien de la nature. Dans deux de
ses signi cations appropriées, le mot « lot » est dé ni par le
Robert
(1993) soit comme « partie d’un tout partagé entre
Robert (1993) soit comme « partie d’un tout partagé entre Robert
plusieurs personnes », soit comme « ensemble de marchan-
dises ou de produits vendus ou donnés ensemble ». Il peut
s’appliquer à un échantillon contenant plusieurs ou un très
grand nombre d’individus ou de spécimens, mais il inclut
un concept de quantité. Il ne peut donc pas désigner un seul
individu. Outre que « faunal group » ne saurait désigner
un échantillon de plancton végétal, il en découle que deux
mots, « spécimen » et « lot », seraient nécessaires pour dési-
gner n’importe quel type d’échantillon. Et deux spécimens
forment-ils un lot
?...
Les échantillons prélevés dans la nature constituent
les nœuds communs autour desquels les collections de
recherche en sciences naturelles devraient être organisées et
informatisées dans l’avenir, par les musées et les laboratoires
gouvernementaux pourvus de mandats pour suivre et pro-
téger soit les espèces (e.
g. légalement protégées en raison de
leur statut précaire), soit l’environnement (e.
g. les habitats),
soit les ressources naturelles (e.
g. celles des forêts, de l’agri-
culture, des pêches). Idéalement,
un numéro d’échantillon
exclusif et informatisé devrait apparaître sur chacune des
étiquettes accompagnant les spécimens ou les groupes de
spécimens, c’est-à-dire tous les « échantillons ». Au moment
de concevoir leurs banques relationnelles de données, les
conservateurs ou les gestionnaires de collections devraient
informatiser leurs données autour de ces numéros d’échan-

12
13
LE NATURALISTE CANADIEN, VOL. 129 N
o
1
HIVER 2005
MUSÉOLOGIE SCIENTIFIQUE
tillons plutôt qu’autour des noms d’espèces : deux « tableaux
de données » fondamentaux devraient être greffés à chaque
numéro d’échantillon, l’un nommé
données stables
, l’autre,
données évolutives
, comme point de départ de la hiérarchie
des tableaux informatiques.
Les
données stables
comprennent tous les renseigne-
ments rassemblés au moment du prélèvement de l’échan-
tillon dans la nature. Les exemples suivants de « descripteurs »
(terminologie moderne…) désignent des données stables :
nom et coordonnées géographiques du lieu du prélèvement
(i.
e. d’échantillonnage), date et heure du prélèvement, nom
de l’appareil de prélèvement (avec son caractère quantitatif
ou qualitatif, son ouverture de mailles, etc.), altitude, profon-
deur, température et autres variables écologiques observées
ou mesurées simultanément, etc. Toutes ces données sont
dites stables : en effet, à moins d’erreurs de transcription, de
données égarées puis retrouvées, ou d’entités géographiques
rebaptisées, elles ne changeront jamais parce qu’elles pro-
viennent du passé. Dans le passé lointain, les naturalistes les
notaient dans des calepins de terrain, des livres de bord et
autres cahiers manuscrits, que tous les musées responsables
conservent soigneusement dans leurs archives parce que de
là provient la valeur scienti que de leurs collections (Beidel-
man, 2004). On le notera ici, informatiser les données stables,
relativement peu nombreuses, représente une tâche beau-
coup moins monumentale que de saisir dans des tableaux
informatiques les données évolutives décrites ci-dessous.
Les
données évolutives
émanent de tous les « trai-
tements » administrés à l’échantillon qu’on rapporte au
laboratoire ou qu’on entrepose en collection, après son
prélèvement en nature. Les exemples suivants sont des don-
nées évolutives : nombre et volume des aliquotes, nombre et
nom de chacun des taxons de haut niveau (embranchement,
classe, ordre, etc.) qu’on reconnaît assez aisément et rapide-
ment, qu’on trie et isole de l’échantillon (chacun constituant
un « sous-échantillon taxinomique »), nombre d’individus
dans chaque sous-échantillon, noms scienti ques de toutes
les espèces dans chacun de ces sous-échantillons, leurs sexes,
stades de maturité, tailles, pièces morphologiques détachées
(e.
g. pièces buccales disséquées et montées sur lames, os, etc.)
et, dorénavant, pièces moléculaires comme l’ADN (autant
de sous-échantillons plus fins…), etc. De telles données
évolutives seront toujours susceptibles de changer à mesure
que progresseront les connaissances, et que l’échantillon et
ses sous-échantillons seront soumis à l’examen taxinomique
ou écologique par le futur personnel technique ou scienti-
que. Ces personnes seront toujours sujettes aux erreurs :
changements de noms, mauvaises identi cations, décomp-
tes erronés, etc. Bien sûr, la manière moderne d’enregistrer,
d’effacer et de modi er ce type de données évolutives passe
par l’ordinateur.
C’est ici que tous les gestionnaires et conservateurs de
collections font face à leur plus gigantesque tâche : les relevés
écologiques modernes, en particulier dans les milieux aqua-
tiques, prélèvent de gros et nombreux échantillons qui con-
tiennent des douzaines ou souvent des centaines d’espèces et
des milliers d’individus à la fois des habitats planctoniques
et benthiques. Puisqu’on ne peut conserver tout ce matériel
répétitif, se pose le problème croissant de la conservation
de « spécimens-témoins » (Wheeler
et al
., 2003), mieux
nommés « échantillons-témoins », lorsque le manque de
ressources empêche le laborieux et coûteux travail de trier,
identi er et dénombrer tout ce matériel dès après son arri-
vée au laboratoire. Par conséquent, pour que les collections
servent mieux la recherche et la société (Suarez et Tsutsui,
2004) dans un proche avenir, compte tenu de l’aggravation
des problèmes environnementaux, de
l’espace et du personnel
additionnels sont indispensables
dans les musées de sciences
naturelles et dans les laboratoires gouvernementaux et uni-
versitaires pourvus d’un mandat de recherche fondamentale
en biodiversité. Et ce mandat doit viser à la fois la biodiversité
écologique et la biodiversité taxinomique.
A n de mettre à la disposition de tous les chercheurs
et de tous les écologistes militants l’immense réservoir de
données encore cachées dans les millions d’échantillons con-
tenus dans les collections de recherche, l’outil informatique
est devenu indispensable (Edwards, 2004).
C’est en centrant sa Banque de données sur la bio-
diversité du Québec (BADIQ) autour de la notion d’échan-
tillon, comme je le préconise ici, que Francœur (1993, 2001)
avait déjà conçu la gestion de son système informatique avant
la plupart des chercheurs dans ce domaine.
Références
BEIDELMAN
, R., 2004. More than specimens in natural history museums.
BioScience, 54(7): 612. American Institute of Biological Sciences (AIBS),
Washington, DC.
BRUNEL
, P., 2004. Les collections de sciences naturelles
: principaux types selon
leurs fonctions prédominantes. Le Naturaliste canadien, 128(2)
: 9-14.
EDWARDS
, J.L., 2004. Research and societal benefits of the Global Biodiver-
sity Information Facility. BioScience, 54(6): 485-486. AIBS, Washington,
DC.
FRANCŒUR
, A., 1993. Gestion et validation des données d’échantillonnage
à l’aide de la BADIQ. Dans
: Inventaire et cartographie des Invertébrés
comme contribution à la gestion des milieux naturels français
: Actes du
séminaire tenu au Mans, 6-7 nov. 1992. Secrétariat de la Faune et de
la Flore, Collection Patrimoines naturels, Série Patrimoine écologique,
13
: 18-27. Muséum national d’histoire naturelle, Paris
FRANCŒUR
, A., 2001. Une problématique concernant la nature, l’exploita-
tion et la conservation des données d’échantillonnage sur les animaux
invertébrés. Cahiers de l’APPI, 6
: 2-10. Association pour la promotion
de la protection des invertébrés (APPI), Paris.
ROBERT
, 1993. Le nouveau petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique
de la langue française. 2492 pp. Dictionnaires Le Robert, Paris.
SIMMONS
, J.E., 2004. What should we call the components of museum
collections
?
SPNHC Newsletter, 18(1): 9-10. Society for the Preservation of Natural History
Collections (SPNHC), Washington, DC et Lawrence, KS.
SUAREZ
, A.V. and N.D. Tsutsui, 2004. The value of museum collections for research
and society. BioScience, 54(1): 66-74. AIBS, Washington, DC.
WHEELER
, T.A.
et al.
, 2004. The role of voucher specimens in validat-
ing faunistic and ecological research. Biological Survey of Canada
(Terrestrial arthropods), Document Ser., 9: 11 pages en ligne. http:
//www.biology.ualberta.ca/bsc/briefs/brvouchers.htm
1
/
4
100%