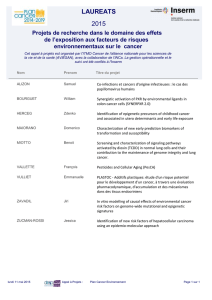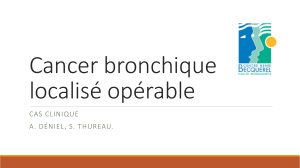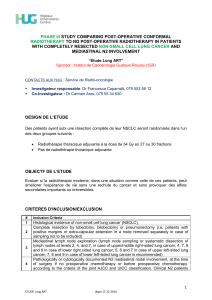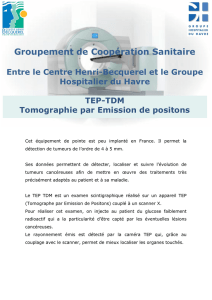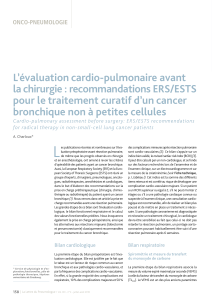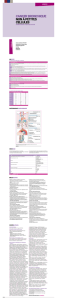Le bilan préopératoire du cancer bronchique

635
Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 635-50
Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 635-50 © 2005 SPLF, tous droits réservés
Doi : 10.1019/200530066
Série « Considérations chirurgicales pour le pneumologue »
Coordonnée par V. Ninane et G. Decker
Le bilan préopératoire du cancer bronchique
Le point de vue du chirurgien
G. Decker1, 2, P. De Leyn2
Résumé
Introduction Le pronostic global du cancer bronchique non-à-
petites-cellules (CBNPC) reste mauvais à cause d’une découverte
souvent tardive et de la comorbidité associée pouvant empêcher
un traitement optimal du cancer. La résection chirurgicale reste le
meilleur traitement curatif des stades limités.
État des connaissances Le bilan préopératoire doit déterminer
si l’extension tumorale permet une résection complète et si l’état
physiologique du patient lui permet de supporter l’intervention
curative requise. Le but ultime étant d’améliorer le pronostic à
5 ans, en cas d’inopérabilité initiale, le bilan doit déterminer si un
traitement oncologique préopératoire peut rendre une tumeur
avancée opérable (p.ex. stade IIIA) ou si une préparation ciblée
peut amener le patient à pouvoir supporter une intervention initia-
lement jugée trop risquée.
La rapide évolution des moyens techniques disponibles pour le
bilan requiert une mise en question continue des « guides de
bonne pratique ». L’imagerie par tomographie à émission de posi-
trons a considérablement augmenté la précision du bilan radiolo-
gique classique. Néanmoins le bilan par imagerie seule reste
imprécis au point de toujours nécessiter des examens invasifs
pour prouver histologiquement le stade clinique du CBNPC. Les
techniques de stadification invasive du médiastin évoluent rapide-
ment et gagnent en précision tout en diminuant d’invasivité. La
médiastinoscopie agrémentée de technologies vidéo modernes,
les ponctions endoscopiques guidées par échographie et la tho-
racoscopie sont des techniques invasives plus complémentaires
que concurrentielles.
Le bilan fonctionnel doit estimer le risque opératoire de la résec-
tion pulmonaire envisagée, identifier des actions ciblées pouvant
diminuer ce risque ou en l’absence de telles actions orienter vers
des techniques chirurgicales moins invasives mais moins bien
validées, voire vers des thérapies palliatives. Quand le risque opé-
ratoire ne peut être diminué, son estimation précise permet au
moins au patient de décider si son risque lui semble acceptable
par rapport à ses chances de guérison.
Perspectives et conclusions Le bilan préopératoire du futur devra
mieux reconnaître les atteintes micro-métastatiques du CBNPC afin
d’améliorer le choix des thérapies inductives et adjuvantes. L’usage
croissant de chimiothérapies d’induction avant résection chirurgi-
cale ne fait qu’augmenter l’importance d’un bilan détaillé pour la
sélection des patients comme pour l’évaluation des résultats.
Mots-clés : Cancer bronchique • Stadification • Bilan • Chirurgie.
Réception version princeps à la Revue : 25.01.2005.
Retour aux auteurs pour révision : 25.02.2005.
Réception 1ère version revisée : 11.04.2005.
Acceptation définitive : 18.04.2005.
1Département de Chirurgie Thoracique, Groupe Thorax, Centre
Hospitalier Luxembourg, Luxembourg.
2Department de Chirurgie Thoracique, Hôpitaux universitaire de
Leuven, Leuven, Belgique.
Correspondance : G. Decker
Groupe Thorax - Chirurgie thoracique, Centre Hospitalier
Luxembourg, 4, rue E. Barblé, L-1210 Luxembourg.
decker.georges@chl.lu

G. Decker, P. De Leyn
Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 635-50
636
Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 635-50
Summary
Introduction The overall prognosis of non-small cell carcinoma
of the bronchus (NSCLC) remains poor on account of frequently
late diagnosis and associated co-morbidity preventing the opti-
mal treatment of the tumour. Surgical resection remains the best
curative treatment for limited stage disease.
State of the art The pre-operative assessment should deter-
mine whether the extent of the tumour permits complete resec-
tion and whether the physiological state of the patient would
tolerate the curative resection required. The ultimate goal is to
improve 5-year survival. In the case of initial inoperability the
assessment should determine whether pre-operative oncologi-
cal treatment might make an advanced tumour operable
(e.g. stage IIIA), or whether targeted medical treatment might
improve the patient sufficiently to tolerate an intervention ini-
tially judged too risky.
The rapid development of the technical modalities available for
the assessment requires a continuous review of the current
practice guidelines. Positron emission tomography has consi-
derably augmented the accuracy of classical radiological
assessment. Nevertheless staging by imaging alone remains
imprecise to the extent that invasive examinations are still nec-
essary to provide histological proof of the clinical stage of
NSCLC. The techniques for assessing mediastinal invasion are
developing rapidly and becoming more accurate and less inva-
sive. Mediastinoscopy enhanced by modern video technology,
ultrasound guided endoscopic biopsies and thoracoscopy are
complimentary rather than competing techniques.
The functional assessment should estimate the operative risk of
the proposed pulmonary resection, identify the targeted actions
aimed at reducing this risk or, in the absence of such actions,
suggest less invasive but less well validated surgical techniques
or even palliative treatments. When the operative risk cannot be
reduced its precise estimation at least allows the patient to
decide whether the risk seems acceptable in relation to the
chances of a cure.
Viewpoint and conclusions In the future the pre-operative
assessment of NSCLC should improve the detection of micro-
metastases in order to optimise the choice of induction and adju-
vent therapies. The increasing use of induction chemotherapy
before surgical resection can only increase the importance of a
detailed assessment for the selection of patients and the evalua-
tion of results.
Key-words: Cancer bronchique • Stadification • Bilan • Chirurgie.
The pre-operative assessment of bronchial
carcinoma. The surgeon’s viewpoint
G. Decker, P. De Leyn
Introduction
Moins d’un patient sur trois présente un cancer bronchi-
que non-à-petites cellules (CBNPC) complètement
« réséquable ». Le bilan est fondamental car il détermine à la
fois le degré d’extension de la tumeur qui permet d’identifier
ce sous-groupe de même que l’aptitude physiologique du
patient à subir l’intervention chirurgicale. Malgré des progrès
constants, l’imprécision du bilan moderne d’extension
demeure toutefois telle que la chirurgie ne guérit qu’un
patient opéré sur deux. Au total, 13 à 15 % seulement des
patients atteints d’un cancer bronchique sont en vie au terme
de 5 ans [1-3].
Il n’y a pas de bilan de référence et ceci est notamment
illustré par le grand nombre de guidelines ou « guides de
bonne pratique » en matière de bilan préopératoire du
CBNPC, jusqu’à 51 recensés dans une récente revue de la lit-
térature [4]. Leur nombre et les divergences entre ces « guides
de bonne pratique » témoignent de la complexité d’un sujet
en évolution permanente. Au terme d’une analyse critique
utilisant des critères objectifs et validés, Harpole et coll. [4]
concluaient que la plupart sont d’un niveau scientifique faible
et sont souvent basés sur des pratiques corporatistes ou habi-
tudes des sociétés scientifiques. Seuls 19 (37 %) de ces
« guides de bonne pratique » semblaient recommandables [4].
En outre, ces recommandations sont difficilement généralisa-
bles en raison des disparités de pratiques médicales et des dif-
férences dans les conditions socio-économiques et
géographiques qui régulent l’accès aux examens médicaux.
Dans cet article, notre ambition comme chirurgiens tho-
raciques est simplement de discuter les aspects du bilan préo-
pératoire qui pourraient augmenter les chances de succès
d’une intervention chirurgicale à visée curative du CBNPC.
Principes généraux du bilan préopératoire
Le bilan oncologique doit évaluer la réséquabilité, c’est-
à-dire exclure toute chirurgie dépassée par le stade tumoral,
tout en évitant une surévaluation qui priverait le patient de
son unique espoir de guérison. Malgré des progrès constants
(imagerie, tomographie par émission de positrons (TEP-scan),
endoscopie diagnostique et interventionnelle…), les modalités
diagnostiques restent assez imprécises et doivent souvent être
complétées par des techniques invasives de staging.
Le bilan fonctionnel doit estimer l’opérabilité, c’est-à-
dire la faisabilité et le risque opératoire liés à la résection envi-
sagée. Les risques étant rarement réversibles et la comorbidité
cardio-respiratoire étant souvent importante, le bilan fonc-
tionnel servira également à informer le patient de son risque
pour qu’il puisse lui-même participer à la décision opératoire
de la façon la plus « éclairée » possible.
Ces deux bilans se déroulent souvent parallèlement
mais sont également liés : une certitude d’inopérabilité ou
d’irréséquabilité pourra conduire à annuler des examens

Le bilan préopératoire du cancer bronchique
© 2005 SPLF, tous droits réservés 637
complémentaires. Une programmation logique des examens,
selon une séquence ou un algorithme précis est certainement
souhaitable mais perturbée par les contraintes économiques,
organisationnelles et d’accessibilité. Il serait par exemple logi-
que, chez le patient asymptomatique sur le plan neurologi-
que de ne réaliser la TDM cérébrale qu’au terme du bilan,
lorsque d’autres sites métastatiques plus fréquents ont été
exclus. Effectivement, seuls 3 % de ces patients ont une
TDM cérébrale positive. Certains suggèrent dès lors de ne
réaliser une TDM cérébrale qu’en préopératoire immédiat et
de préférence la nuit (appareil inutilisé) [5] mais sur le plan
logistique, cette séquence est souvent impossible. L’abord
séquentiel qui tient compte des résultats avant de poursuivre
la séquence est également peu pratique avec des délais qui
peuvent devenir inacceptables d’un point de vue psychologi-
que et oncologique.
La preuve histologique de malignité
d’une tumeur pulmonaire
Le plus souvent, la voie d’abord diagnostique histologi-
que est endobronchique : biopsies directes d’une tumeur cen-
trale ou, dans le cadre de tumeurs périphériques,
prélèvements endoscopiques guidés sous contrôle radiologi-
que. Pour les tumeurs avancées, la preuve de malignité peut
être obtenue au niveau de ganglions distants (par exemple
supra-claviculaires) ou de métastases (ponction-biopsie hépa-
tique, ponction médullaire, biopsie de métastase sous-
cutanée, biopsie osseuse…) confirmant en même temps l’ino-
pérabilité. Parfois c’est au niveau d’un site d’atteinte ganglion-
naire médiastinal N2 voire N3 que la malignité est prouvée
avec, ici également, des implications en terme de staging et de
traitement. En dehors de la médiastinoscopie classique, des
techniques alternatives moins invasives, associées à un rende-
ment et un coût intéressant, ont été développées (ponction
ganglionnaire transbronchique guidée ou non par voie écho-
graphique, ponction ganglionnaire par écho-endoscopie
trans-oesophagienne, ponction trans-thoracique guidée par
tomodensitométrie) et leur choix respectif fait intervenir la
localisation des ganglions et surtout, l’accessibilité à la techni-
que et l’expertise locale [6]. Parfois, en particulier pour des
tumeurs périphériques, aucune preuve histologique n’est
obtenue. Si le risque opératoire est acceptable et la probabilité
de malignité très élevée, aucune preuve histologique n’est
requise avant l’opération [6, 7] qui débute par une résection
atypique (« résection en coin »), idéalement par voie thoracos-
copique associée à un examen histologique extemporané,
avant de procéder à une résection anatomique plus complexe.
Dans ce scénario, une biopsie trans-thoracique sous tomo-
densitométrie est peu utile car, en surplus des risques faibles
mais réels (pneumothorax, hémorragie, ensemencement pleu-
ral…), l’existence de faux résultats négatifs n’empêche pas le
geste chirurgical subséquent. La bonne indication d’une
ponction-biopsie trans-thoracique est donc le patient ayant
un risque clinique (théorique) modéré de malignité et chez
qui une ponction négative aboutira à une attitude expectative,
voire le patient inopérable ou celui refusant formellement un
geste chirurgical et chez qui la preuve histologique de mali-
gnité permettra d’initier un traitement systémique ou une
radiothérapie [6].
Le bilan d’extension de la tumeur
Le bilan d’extension tumorale aboutit à la stadification
clinique de la tumeur qui s’appuie sur le système TNM
promu par Mountain et Dresler [8]. Les ganglions médiasti-
naux y sont classés en s’appuyant sur la cartographie ganglion-
naire adoptée par l’Union Internationale Contre le Cancer et
l’American Joint Committe on Cancer, basée sur les travaux de
Naruke et coll. [9]. Actuellement la version 2002 du système
TNM-UICC est utilisée et se base sur le pronostic des diffé-
rents stades cliniques [10]. Du point de vue chirurgical, le
souci est de séparer le groupe de patients pouvant profiter
d’un traitement chirurgical à visée curative (stades IA à IIB),
de ceux (IIIB et IV) pour qui une intervention n’apporte pas
de chance de guérison. Entre ces deux extrêmes, le stade IIIA
(atteinte ganglionnaire médiastinale ipsilatérale) regroupe des
patients généralement considérés comme initialement inopé-
rables mais pour lesquels une résection complète précédée
d’une chimiothérapie d’induction (ou « néo-adjuvante »)
semble offrir les meilleures chances de guérison, du moins en
cas de réponse favorable à la chimiothérapie [11-13]. Dans
cette stratégie thérapeutique, dominante actuellement, il est
d’abord indispensable d’établir de façon fiable (et donc par
prélèvements histologiques) l’existence d’une telle atteinte
ganglionnaire médiastinale. Ceci ne serait pas le cas si le
meilleur traitement du stade IIIA était la chirurgie primaire.
Dans cette dernière hypothèse, la question se ramènerait à
déterminer la possibilité de réséquer complètement la tumeur
et ses voies de drainage (résection dite R0) et à exclure une
atteinte des ganglions contralatéraux par rapport à la tumeur
(stade IIIB). En conséquence et tant qu’il n’y aura pas de stan-
dard universellement valable pour l’indication chirurgicale, il
ne peut pas y avoir de bilan standard qui serait recommanda-
ble et applicable partout. C’est dans cet esprit que devra être
lu tout ce qui va suivre.
Le bilan d’extension comprend une anamnèse appro-
fondie et un examen clinique complet suivi d’une série
d’examens complémentaires biologiques, endoscopiques,
radiologiques et scintigraphiques qui seront discutés successi-
vement. Certains examens complémentaires sont réalisés sys-
tématiquement, d’autres sont réalisés pour répondre à des
questions précises. La chirurgie représentant virtuellement le
seul traitement curatif, aucun malade ne devrait être récusé
d’une résection chirurgicale sans preuve histologique de
malignité des adénopathies médiastinales ou de la métastase
à distance qui contre-indiquerait une résection de la tumeur
primitive.

G. Decker, P. De Leyn
Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 635-50
638
L’anamnèse et l’examen clinique
Chez plus de 90 % des patients, des symptômes mènent
au diagnostic [3]. Ils sont malheureusement tardifs, à un stade
où la tumeur souvent n’est plus réséquable. Ainsi chez deux
tiers des patients les symptômes sont ceux de la maladie
métastatique [3]. Le pronostic à 5 ans serait par conséquent
meilleur pour les patients asymptomatiques [3, 7].
L’examen clinique du chirurgien thoracique se focalisera
surtout sur les signes qui peuvent influencer le geste et/ou le
risque chirurgical voire suggérer l’irrésécabilité :
– les signes d’un syndrome cave supérieur ou d’une tampon-
nade péricardique évoquent un stade cT4, généralement non
résécable ;
– la raucité de voix fait suspecter un envahissement du nerf ré-
current laryngé. À gauche, ceci peut être la conséquence d’un
envahissement du nerf vague (nerf X crânien) par la tumeur
(cT4), d’un envahissement de l’anse du nerf récurrent au ni-
veau de la fenêtre aorto-pulmonaire (d’origine ganglionnaire
ou plus rarement par la tumeur), ou de l’envahissement récur-
rentiel dans son trajet ascendant par des ganglions métastati-
ques (cN2 si tumeur ipsilatérale). À droite, le nerf récurrent
peut être envahi par une tumeur de l’apex pulmonaire à déve-
loppement antérieur (cT4). Quand il s’agit d’un envahisse-
ment tumoral direct, ces tumeurs restent souvent réséquables,
au prix d’un risque majoré suite aux risques postopératoires de
fausses déglutitions et à une toux moins efficace ;
– le syndrome de Claude-Bernard-Horner est souvent révéla-
teur d’une tumeur de l’apex pulmonaire envahissant le gan-
glion stellaire ipsilatéral ;
– une dyspnée récente peut révéler une paralysie phrénique
(cT3) ou une tumeur obstruant une bronche lobaire (cT2) ou
souche (cT3 ou 4 selon l’extension proximale) ;
– la douleur thoracique pariétale localisée fera suspecter un en-
vahissement pariétal (cT3) qui, localisé au niveau de l’apex
thoracique, pourra s’accompagner de douleurs radiculaires
(fréquemment dans le territoire C8 ou D1) ou d’une atrophie
musculaire (tumeur de Pancoast) signant un stade cT4 ;
– la dysphagie pourra être provoquée par un envahissement
œsophagien direct (cT4) d’une tumeur lobaire inférieure ou
par des adénopathies médiastinales (cN2) ;
– des signes ou symptômes neurologiques d’apparition récente
suggèrent la présence de métastases cérébrales. Le cancer bron-
chique est la première cause de cancer métastatique se révélant
par une métastase cérébrale symptomatique (70 % des cas)
[14]. L’existence de ces signes ou symptômes impose un bilan
radiologique du système nerveux central (SNC) [15] ;
– la découverte d’adénopathies supra-claviculaires (cN3) ou de
métastases sous-cutanées ou musculaires (cM) et leur confir-
mation histologique écartent définitivement le patient d’une
exérèse chirurgicale ;
– des douleurs osseuses focales et récentes indiquent une haute
probabilité de métastases osseuse et représentent une indica-
tion formelle de scintigraphie osseuse (et/ou PET-scan) [15] ;
– l’atteinte métastatique abdominale (foie, surrénales…) n’est
que peu accessible à l’évaluation clinique ;
– les syndromes paranéoplasiques intéressent moins le chirur-
gien dans le sens qu’ils ne contre-indiquent pas une chirurgie
à visée curative. La correction des troubles métaboliques asso-
ciés est importante pour diminuer les complications postopé-
ratoires.
Le bilan d’extension loco-régional
La radiographie de thorax conventionnelle est souvent le
point de départ d’un bilan oncologique mais son pouvoir de
stadification est limité. Le meilleur rendement de la tomo-
densitométrie thoracique (TDM) en fait une partie indispen-
sable du bilan, comme l’endoscopie ; elle permet également
de planifier l’étendue de la résection parenchymateuse [7, 16,
17] et l’ajout de quelques coupes au niveau de l’abdomen
supérieur permet également d’exclure la plupart des métasta-
ses hépatiques ou surrénaliennes. L’IRM est considéré comme
n’apportant aucune précision supplémentaire [16, 17]. Elle
reste utile pour étudier des plans de clivage éventuels entre des
tumeurs de l’apex pulmonaire (Pancoast) et les vaisseaux,
structures nerveuses et osseuses.
Le recours systématique à la TDM est relativement
récent : selon une enquête réalisée en 1990 auprès des chirur-
giens thoraciques anglo-saxons, 44 % d’entre eux (totalisant
43 % de toutes les résections pulmonaires en Grande-Breta-
gne) opéraient sans TDM thoracique préopératoire [18], ce
qui explique les taux inacceptables de thoracotomie explora-
trice de l’époque. Lors de l’intervention, 45 % d’entre eux ne
biopsiaient jamais les ganglions médiastinaux d’apparence
grossièrement normale de sorte que le stade réel de la maladie
restait inconnu même après l’opération [19], rendant les ana-
lyses comparatives entre différentes stratégies chirurgicales ou
thérapies adjuvantes difficiles [18]. L’attitude variable face à
l’exploration médiastinale s’explique néanmoins par la con-
duite chirurgicale toujours très divergente face à la découverte
d’une atteinte ganglionnaire médiastinale (N2). Beaucoup de
chirurgiens continuent en effet à proposer une résection chi-
rurgicale aux patients ayant une atteinte N2 manifeste en justi-
fiant cette attitude par des séries historiques, biaisées,
rapportant des taux de survie à 5 ans élevés de l’ordre de 20 à
30 % [9, 19, 20]. La révision de ces séries, tenant compte de
tous les patients initialement opérés, montre des taux réels de
survie à 5 ans lorsque l’atteinte N2 est démontrée en préopéra-
toire de seulement 5 à 9 % [20, 21].
À l’inverse, la recherche agressive de l’atteinte ganglion-
naire médiastinale avec preuve histologique systématique par
médiastinoscopie permet de sélectionner un groupe homo-
gène de patients avec atteinte N2 (excluant donc ceux avec un
envahissement ganglionnaire controlatéral), candidats à
l’administration préopératoire de chimiothérapie, attitude
thérapeutique plus communément adoptée actuellement avec
des résultats prometteurs [13]. En cas de TDM et médiasti-
noscopie systématique négatives, 9 à 20 % des patients ont
néanmoins une atteinte N2 « inattendue » lors de la thoraco-
tomie [22-24]. Ce sous-groupe IIIa a toutefois un pronostic
plus favorable (dépassant les 20 % à 5 ans) justifiant la résec-

Le bilan préopératoire du cancer bronchique
© 2005 SPLF, tous droits réservés 639
tion avec curage médiastinal formel. Un autre sous-groupe
candidat à la chirurgie est l’atteinte des seuls ganglions de la
fenêtre aorto-pulmonaire ou para-aortiques, avec une survie à
5 ans qui peut atteindre 28 % [25] ou même 42 % [26].
C’est donc dans le contexte de leurs implications thérapeuti-
ques que les performances des techniques de stadification
invasives comme non-invasives doivent être analysées.
Évaluation non-invasive
de l’atteinte ganglionnaire médiastinale
La TDM se base sur le critère de taille ganglionnaire, le
plus souvent sur une plus petite dimension ganglionnaire
dépassant les 10 mm pour suggérer une atteinte ganglion-
naire [27]. Toutefois, dans une série de 2 891 ganglions pro-
venant de 265 résections pulmonaires pour CBNPC, 75 %
des 541 ganglions d’un diamètre de 10 et 14 mm et 40 %
des ganglions de plus de 15 mm étaient libres d’atteinte
tumorale [28]. À l’inverse, comme suggéré préalablement par
des groupes pratiquant des médiastinoscopies systématiques
[23, 29], 44 % des ganglions positifs avaient un petit diamè-
tre inférieur à 10 mm et 18 % de tous les patients avec une
atteinte ganglionnaire N2 n’avaient aucun ganglion de plus
de 10 mm [28]. La fréquence de l’atteinte N2 faussement
négative en TDM était corrélée au facteur d’extension tumo-
rale T (fréquence croissante de T1 à T2, T3 et T4) [23].
L’atteinte ganglionnaire est donc mal corrélée à la taille gan-
glionnaire (tableau I). Les mauvaises performances de la
TDM pour stadifier le médiastin sont lourdes de conséquen-
ces. Ainsi, Fernandoet coll. [24] ont rapporté chez des
patients opérés alors qu’ils étaient radiologiquement N0, une
sous-évaluation du stade chez 435 des patients (19 % N1 et
24 % N2). À l’inverse, les groupes qui favorisent la résection
chirurgicale en présence d’une atteinte N2 rapportent que
38 % de patients cliniquement N2 sont en fait N0 ou N1
alors que 6 % étaient sous-évalués car N3 [30]. La TDM ne
doit donc pas servir de seul outil de stadification ganglion-
naire médiastinale, pas plus que l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) dont les performances sont beaucoup
moins bien étudiées (sensibilité 64-71 %, spécificité 48-91 %)
mais ne semblent pas meilleures pour des raisons similaires
[16, 27, 31].
Le rôle important de la tomographie à émission de posi-
trons (TEP) dans le bilan ganglionnaire médiastinal sera
abordé dans un chapitre à part mais il convient de souligner
que, dans la plupart des pays, la disponibilité de la TEP est
limitée ou inexistante.
Évaluation invasive
de l’atteinte ganglionnaire médiastinale
Plusieurs approches peuvent apporter les informations
histologiques requises pour une stadification clinique adé-
quate (cTNM). Parmi les techniques non chirurgicales,
l’endoscopie bronchique permet des ponctions non-guidées
(ponction transcarénaire) ou guidée par échographie
(« EBUS ») ou TDM. La ponction ganglionnaire trans-thora-
cique guidée par TDM peut également analyser des ganglions
suspects dans certaines localisations médiastinales. De même
la ponction trans-oesophagienne guidée par écho-endoscopie
peut étudier sélectivement des ganglions des régions sous-
carénaire (niveau 7), aorto-pulmonaire (niveau 5), para-oeso-
phagienne (niveau 8) ainsi que des ligaments pulmonaires
(niveau 9) (fig. 1). Les trois derniers relais sont généralement
inaccessibles à la médiastinoscopie classique, tout comme la
partie postérieure des ganglions sous-carénaires qui pour cer-
tains est responsable de la moitié des faux négatifs de la
médiastinoscopie classique [22]. Les ponctions écho-guidées
ont servi essentiellement à confirmer une atteinte ganglion-
naire suggérée par TDM avec des résultats encourageants
[32, 33] et le besoin de recourir à une médiastinoscopie peut,
pour certains, être diminué de moitié [31]. Leur performance
pour évaluer des ganglions non-suspects en imagerie reste à
établir. La ponction écho-guidée trans-oesophagienne permet
également de ponctionner la glande surrénalienne gauche en
cas de suspicion métastatique à ce niveau. Chacune de ces
techniques, réalisables en ambulatoire sans anesthésie géné-
rale, a ses propres indications et limites [31]. À l’exception des
Tableau I.
Comparaison des performances diagnostiques des techniques explorant l’atteinte ganglionnaire médiastinale. Modifié d’après Toloza et coll.
[27, 37].
N patients Sensibilité Spécificité VPP VPN Prévalence
atteinte N2
TDM 3,438 0,57 0,82 0,56 0,83 0,28
TEP 1,045 0,84 0,89 0,79 0,93 0,32
Ponction transbronchique 910 0,76 0,96 1,00 0,71 0,70
Ponction transthoracique 215 0,91 1,00 1,00 0,78 0,83
Echo-endoscopie sans ponction 163 0,78 0,71 0,75 0,79 0,50
Ponction écho-endoscopique 215 0,88 0,91 0,98 0,77 0,69
Médiastinoscopie cervicale classique 5,687 0,81 1,00 1,00 0,91 0,37
Médiastinoscopie classique et « extended » 206 0,73 1,00 1,00 0,85 0,39
Médiastinoscopie cervicale et médiastinotomie antérieure 71 0,87 1,00 1,00 0,90 0,42
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%