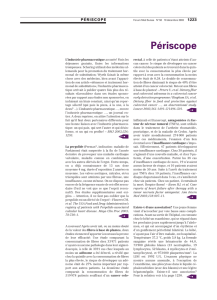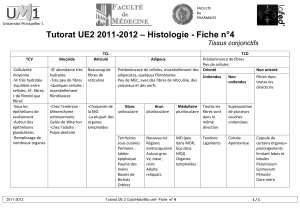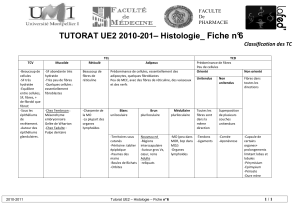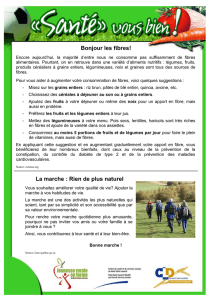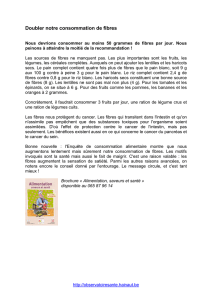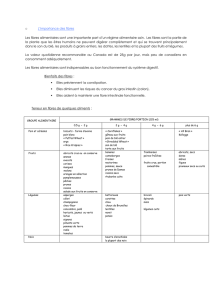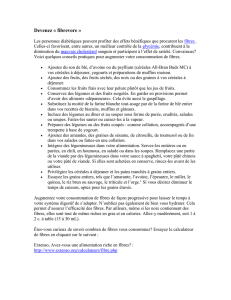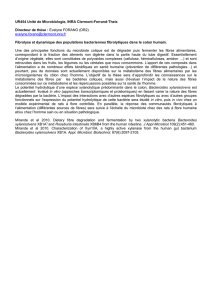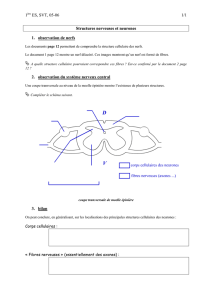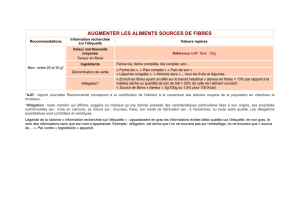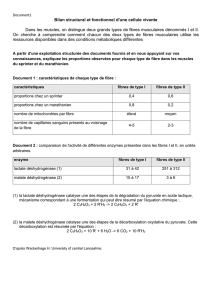Fibres alimentaires et cancer colorectal

Fibres alimentaires et cancer colorectal
Etudes expérimentales, épidémiologie, mécanismes
Pierre ASTORG (1, 2), Marie-Christine BOUTRON-RUAULT (1)
pour le Groupe « Fibres et cancer colorectal » du réseau NACRe : Claude ANDRIEUX (2), Pierre ASTORG (1),
François BLACHIER (3), Hervé BLOTTIÈRE (4), Claire BONITHON-KOPP (5), Marie-Christine BOUTRON-RUAULT (1),
Pierrette CASSAND (6), Catherine CHAUMONTET (3), Christine CHERBUT (4), Françoise CLAVEL-CHAPELON (7),
Denis CORPET (8), Pierre-Henri DUÉE (3), Mariette GERBER (9), Khaled MEFLAH (10), Jean MÉNANTEAU (10),
Marie-Hélène SIESS (11)
(1) UMR Epidémiologie Nutritionnelle INSERM U557/INRA/CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris ;
(2) Unité Ecologie et Physiologie du Système Digestif, INRA, Jouy-en-Josas ;
(3) Unité Nutrition et Sécurité Alimentaire, INRA, Jouy-en-Josas ; (4) Unité Fonctions Digestives et Nutrition Humaines, INRA, Nantes ;
(5) INSERM CRI 9505, Registre Bourguignon des Tumeurs, Dijon ; (6) Laboratoire de Nutrition et de Signalisation Cellulaire, Université de Bordeaux I ;
(7) INSERM Z521, Laboratoire d’Epidémiologie des Cancers, Institut Gustave Roussy, Villejuif ; (8) Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse ;
(9) Centre Régional de Lutte contre le Cancer, INSERM, Montpellier ; (10) INSERM U419, Nantes ;
(11) UMR Toxicologie Alimentaire INRA/ENSBANA/Université de Bourgogne, Dijon.
TABLE DES MATIE
`RES
INTRODUCTION
FIBRES ALIMENTAIRES : DÉFINITION, SOURCES,
CONSOMMATION
•Définition
•Sources, consommation
RECHERCHES SUR MODÈLES ANIMAUX
•Modèles animaux utilisés
•Effets comparés de différents types de fibres sur la cancéro-
genèse colique chez le rongeur (modèles chimiques)
•Effets des fibres sur les différentes phases de la cancéroge-
nèse (modèles chimiques)
•Effet des fibres sur la cancérogenèse intestinale dans les
modèles génétiques
•Conclusion
ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
•Etudes écologiques
•Etudes cas-témoins
•Etudes de cohortes
•Etudes d’intervention
•Conclusion
MÉCANISMES D’ACTION DES FIBRES SUR LA
CANCÉROGENÈSE COLORECTALE
•Effet des fibres sur la masse fécale
•Adsorption des cancérogènes par les fibres
•Effets des fibres sur le pH du contenu colique et sur les acti-
vités enzymatiques bactériennes
•Effets des fibres sur la composition de la flore
•Effets des fibres sur la prolifération cellulaire
•Rôle du butyrate
•Rôle des constituants végétaux autres que les fibres
•Effets des fibres sur l’équilibre énergétique et la résistance à
l’insuline
•Conclusion
CONCLUSION GÉNÉRALE
CONTENTS
Dietary fibers and colorectal cancer. Experimental studies,
epidemiology, mechanisms
INTRODUCTION
DIETARY FIBERS: DEFINITION, SOURCES AND INTAKE
•Definition
•Sources, intake
ANIMAL STUDIES
•Animal models used
•Effects of different fiber types on colon carcinogenesis in
rodents (chemical models)
•Effects of fibers on different phases of colon carcinogenesis
(chemical models)
•Effects of fibers on intestinal carcinogenesis in genetic mod-
els
•Conclusion
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES
•Ecological studies
•Case-control studies
•Cohort studies
•Intervention studies
•Conclusion
MECHANISMS OF ACTION OF FIBERS ON COLORECTAL
CARCINOGENESIS
•Effect of fibers on fecal mass
•Carcinogens adsorption by fibers
•Effets of fibers on colonic pH and on bacterial enzyme
activities
•Effects of fibers on the composition of colonic flora
•Effects of fibers on colonic cell proliferation
•Role of butyrate
•Role of phytochemicals other than fibers
•Effects of fibers on energetic balance and insulin resistance
•Conclusion
GENERAL CONCLUSION
L’incidence du cancer colorectal (CCR) varie dans un
rapport de1à20selon les régions du monde. Dans
les pays développés : Europe, Australie, Amérique
du nord, c’est l’un des cancers les plus communs dans les deux
sexes. En France, le CCR représente 33 000 nouveaux cas par
an, et constitue la deuxième cause de mortalité par cancer, après
le cancer du poumon. Il est rare, en revanche, en Afrique, en
Amérique latine et en Asie, les taux d’incidence les plus faibles
étant observés en Afrique occidentale et orientale et en Inde [1].
Les études sur les populations migrantes, dont l’incidence de CCR
rejoint assez rapidement celle du pays d’accueil, et des augmen-
tations rapides, récentes, de l’incidence dans des régions comme
le Japon ou les zones urbaines de la Chine montrent que ces
différences entre pays sont dues pour une large part aux facteurs
Tirés à part : P. ASTORG, UMR U557 INSERM/INRA/CNAM, Institut
Scientifique et Technique de l’Alimentation, Conservatoire National des
Arts et Métiers, 5, rue du Vertbois 75003 Paris.
E-mail : [email protected]
NACRe : Réseau National Alimentation Cancer Recherche ; (Responsa-
ble Paule Martel), LNSA, INRA, Centre de Recherches de Jouy, 78352
Jouy-en-Josas Cedex.
© Masson, Paris, 2002. Gastroenterol Clin Biol 2002;26:893-912
893
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/07/2015 par CHU de Nantes . (517211)

environnementaux, et notamment alimentaires, bien davantage
qu’aux facteurs génétiques [2, 3]. Parmi les facteurs alimentaires
qui pourraient favoriser la cancérogenèse colorectale, on peut
citer l’apport calorique total, la consommation de graisses
animales et saturées, d’alcool ainsi que peut-être celle de viande
rouge et de charcuterie [2-5]. Parmi les facteurs présumés
protecteurs, on trouve les légumes, les fruits, les fibres alimen-
taires, le calcium, l’acide folique [2-5]. Une étude récente d’après
une cohorte américaine a estiméque 40 à55 % des CCR
pourraient être évités par des changements dans six facteurs de
risque, dont trois concernent l’alimentation [6]. L’hypothèse d’un
effet protecteur des fibres alimentaires vis-à-vis du CCR a été
émise dès 1971 par Burkitt [7], àla suite de l’observation de sa
très faible incidence dans des populations africaines dont
l’alimentation est particulièrement riche en fibres. Elle a fait
l’objet depuis de très nombreuses recherches, tant expérimenta-
les qu’épidémiologiques. Cependant, la nature de la relation
entre la consommation de fibres et le CCR est loin d’être
clairement établie [8]. Récemment, la publication de résultats
concluant àl’absence d’effet protecteur des fibres ou des aliments
riches en fibres sur le CCR dans des études de cohortes [9, 10],
ou sur la récidive des adénomes dans des études d’intervention
[11-13], a déclenchéune controverse sur la réalitéde l’effet
protecteur des fibres sur la cancérogenèse colorectale [14]. Cette
revue fait le point des travaux expérimentaux et épidémiologi-
ques sur les effets des fibres sur le CCR et sur les mécanismes en
jeu, et s’efforce de tirer des conclusions sur l’intérêt des fibres et
des aliments riches en fibres dans la prévention du CCR.
Fibres alimentaires : définition, sources,
consommation
Définition
On désigne par «fibres alimentaires »un ensemble de
substances complexes qui échappent àl’action des enzymes du
tube digestif et parviennent dans le côlon. Il n’y a pas de
définition des fibres internationalement reconnue [15], mais la
plupart des auteurs incluent l’ensemble des glucides non digesti-
bles (amidons résistants, polysaccharides non amylacéset
oligosaccharides non digestibles) et les lignines (tableau I). Parmi
les amidons résistants, le type 3 est d’une importance particulière,
car il peut se former après cuisson àl’eau et refroidissement à
partir de la plupart des aliments amylacés [16]. On peut
distinguer les fibres alimentaires présentes naturellement dans les
aliments et les fibres ajoutées au cours de la fabrication de
certains aliments [15], notamment pour leur pouvoir gélifiant.
Les fibres alimentaires sont habituellement classées en fibres
solubles (une partie des hémicelluloses, pectines, gommes,
mucilages, produits algaux, oligosaccharides), formant avec
l’eau des solutions visqueuses ou des gels, et fibres insolubles (la
plupart des hémicelluloses, la cellulose, la lignine). La principale
propriétébiologique des fibres alimentaires est leur fermentesci-
bilitépar les bactéries du côlon, qui produisent de l’acide
lactique, des acides gras àchaîne courte (AGCC) (acétate,
Tableau I. − Fibres alimentaires.
Dietary fibers.
Classe Origine Fibre Caractéristiques
Amidons résistants Végétale (cellule) Amidon résistant de type 1 (AR1) α-glucane, physiquement inaccessible ; peu fermentescible
Amidon résistant de type 2 (AR2) α-glucane, granules natifs résistants àl’α-amylase ; soluble (gel),
fermentescible
Amidon résistant de type 3 (AR3) α-glucane, rétrogradéaprès traitement thermique ; soluble (gel)
fermentescible
Synthèse Amidon résistant de type 4 (AR4) α-glucane, chimiquement modifié ; soluble (gel) fermentescible
Polysaccharides
non amylacésVégétale (parois) Cellulose (1-4) -glucane ; polymère linéaire de glucose de haut poids moléculaire,
insoluble, peu fermentescible
-glucanes Polymères linéaires de glucose de faible poids moléculaire, solubles,
fermentescibles
Hémicelluloses Divers hétéropolymères ramifiés dont des xyloglucanes (fruits et légumes),
des arabinoxylanes (céréales) ; en partie solubles (gels) et fermentescibles
Pectines Hétéropolymères complexes ramifiés, contenant de l’acide galacturonique,
du rhamnose, de l’arabinose, du galactose ; solubles (gels), très
fermentescibles.
Végétale (cellule) Gommes (guar, caroube, etc.) Hétéropolymères complexes : arabinogalactanes, galactomannanes ;
solubles (gels), fermentescibles
Mucilages (ispaghule, psyllium) Hétéropolymères complexes ; solubles (gels), fermentescibles
Inuline Polymère de fructose ; soluble (gel), très fermentescible
Algale (parois) Carraghénanes, alginates, agar Solubles (gels), fermentescibles
Animale (carapace des crustacés) Chitine, chitosan Structure voisine de la cellulose ; insolubles ou peu solubles, non ou peu
fermentescibles
Fongique, bactérienne -glucanes, galactomannanes, xanthanes ; solubles (gels), fermentescibles
Synthèse Polydextrose Polymère de glucose ramifié ; soluble (gels), fermentescible
Oligosaccharides
indigestibles Hydrolyse ou biosynthèse Fructooligosaccharide,
galactooligosaccharide
maltodextrines
Oligopolymères de fructose, de galactose, de glucose ou d’autres oses ;
solubles, très fermentescibles
Autres polymères Végétale (parois) Lignines Polymèresenréseau d’acides phénoliques ; insolubles, hydrophobes, non
fermentescibles
Subérine, cutine Polyesters d’acides gras et de polyphénols, liésàun réseau de type
lignine ; insolubles, hydrophobes, non fermentescibles
P. Astorg et al.
894
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/07/2015 par CHU de Nantes . (517211)

propionate, butyrate), de l’hydrogène, du dioxyde de carbone et
de la biomasse. L’absorption des AGCC permet de récupérer une
partie de l’énergie des glucides qui ont échappéàla digestion
dans l’intestin grêle. Les fibres insolubles sont peu fermentées
(cellulose) ou ne sont pas du tout fermentées (lignine), alors que
les amidons résistants et les fibres solubles sont très fermentesci-
bles.
Sources, consommation
Les fibres alimentaires, hors l’amidon résistant, sont principa-
lement apportées par les céréales complètes et les produits qui en
dérivent, les fruits, les légumes, les graines, les fruits secs et les
légumes secs. La consommation moyenne de fibres (non compris
l’amidon résistant) est estiméeà11 à13,5 g/jour aux Etats-Unis
[17], 15 à22 g/jour en France (dont 50 % proviennent des
aliments céréaliers, 32 % des légumes, 16 % des fruits, et 3 % des
légumes secs) [18]. Ces quantités sont inférieures àla quantité
recommandée (environ 30 g/jour). La consommation d’amidon
résistant dans un régime occidental a étéestiméeà3-5 g/jour
[19]. Sur la base des méthodes de dosage existantes, la quantité
totale de glucides atteignant le côlon serait donc de l’ordre de 15
à25 g/jour [18]. Cependant, cette quantiténe représente que le
tiers de celle que requièrent les synthèses bactériennes dans le
côlon [20]. Apparemment, les méthodes physico-chimiques
disponibles sous-estiment fortement les fibres et en particulier
l’amidon résistant. Celui-ci pourrait représenter en réalité10 %
ou plus de l’amidon ingéré[20, 21], soit une quantitéégale aux
autres types de fibres, voire davantage. Ces incertitudes sur les
teneurs des aliments en fibres et en amidon résistant sont un point
faible des études basées sur les tables de composition actuelles.
Dans l’avenir, compte tenu des propriétéstrès diverses des
différents types de fibres, le développement des études épidémio-
logiques nécessitera des tables plus détaillées et plus fiables que
les tables actuelles, qui ne mentionnent souvent que les fibres
totales. Des tables plus détaillées —par exemple distinguant les
fibres solubles et insolubles —sont en cours de réalisation, en
France en particulier. En attendant, beaucoup d’études épidé-
miologiques récentes se réfèrent souvent aux aliments ou groupes
d’aliments riches en fibres plutôtqu’aux fibres elles-mêmes.
Recherches sur modèles animaux
Modèles animaux utilisés
Le modèle expérimental le plus utiliséest un modèle de
cancérogenèse chimique chez le rat utilisant comme agent
initiateur des cancérogènes indirects comme la diméthylhydra-
zine (DMH) ou l’azoxyméthane (AOM), administrés par voie
sous-cutanée. Ces cancérogènes sont activés au niveau du foie et
gagnent l’intestin par le sang ou par la bile sous forme de
conjuguésàl’acide glucuronique. Ils engendrent àcourt terme
(dès deux semaines) des foyers de cryptes aberrantes, considérés
comme de bons marqueurs prénéoplasiques, et àplus long terme
(6 mois), des tumeurs qui partagent avec les tumeurs humaines de
nombreuses similarités histologiques et biologiques, y compris
dans les altérations génétiques. La séquence adénome-cancer
n’est pas toujours observée dans ce modèle. Ce type de modèle,
de loin le plus utiliséàce jour, permet d’évaluer l’effet du produit
alimentaire testé, mais aussi celui de la période d’administration
de ce produit : pendant toute la duréedel’expérience, ou
pendant la période de pré-initiation/initiation (avant et pendant
l’administration du cancérogène, qui peut durer de 1 à20
semaines), ou pendant la période de promotion/progression
(aprèslapériode d’administration du cancérigène) [22]. Récem-
ment, des modèles génétiques de cancérogenèse intestinale ont
étédéveloppés. Des souches de souris (Min, Apc1638,
Apcdelta716) portant un allèle mutant du gène de la polypose
adénomateuse humaine (Apc) développent spontanément et
rapidement des tumeurs (carcinomes) de l’intestin grêle et du
côlon (surtout de l’intestin grêle), en l’absence de tout traitement
par un cancérigène [23, 24].
Effets comparés des différents types de fibres
sur la cancérogenèse colique chez le rongeur
(modèles chimiques)
Deux types de fibres alimentaires ont étéétudiés. Il s’agit
d’une part des produits riches en fibres comme le son de céréales
(blé, mais aussi avoine, orge, seigle, maïs, riz, soja) ou d’autres
sources comme la fibre de betterave, de carotte, de luzerne, de
café, etc., d’autre part des fibres plus ou moins purifiées. Les
teneurs en fibres des régimes expérimentaux varient de 2 à25 %
(en France, les fibres représentent 15-25 g/jour, soit environ 2 à
5 % de la matière sèche du régime, voir paragraphe «sources,
consommation »). Les travaux expérimentaux réalisés sur les
modèles chimiques sont résumés dans le tableau II.
Un grand nombre de travaux ont étéconsacrés au son de
blé: chez le rat, administrépendant toute la duréedel’expé-
rience, il diminue le plus souvent l’incidence et/ou la multiplicité
des tumeurs coliques [25-37] ou des foyers de cryptes aberrantes
[33, 35, 41-43]. Il arrive cependant qu’il soit sans effet, ou même
qu’il augmente l’incidence ou le nombre des tumeurs induites par
la DMH chez le rat [40] ou la souris [45]. Les sons d’autres
céréales montrent des effets divers, mais globalement beaucoup
moins convaincants que ceux du son de blé. Le son de maïs, très
insoluble et peu fermentescible, augmente la cancérogenèse
chimique chez le rat ou la souris [39, 45, 52]. Le son d’avoine,
riche en fibres solubles et fermentescibles, n’a pas d’effet ou a des
effets promoteurs [26, 34, 54]. Parmi les fibres insolubles, la
cellulose a un effet protecteur dans une majoritéd’études chez le
rat [27, 47, 61-68], mais parfois elle n’a aucun effet, voire un
effet promoteur [54, 69,70]. D’autres fibres insolubles ont des
effets protecteurs [43, 52, 60].
Les fibres solubles et très fermentescibles (gomme guar,
pectine de pomme ou de citrus, psyllium, fibre de luzerne, son
d’avoine ou de soja, amidons résistants, carraghénanes) ont des
effets très variables sur la cancérogenèse colique chimio-induite
chez le rat : administrées pendant toute la durée du processus,
soit elles n’ont pas d’effet [30, 39, 62, 85, 86, 90], soit elles
diminuent la formation de tumeurs ou de foyers de cryptes
aberrantes [30-32, 37, 44, 59, 64, 71, 73-75, 79, 88, 89], soit,
au contraire, elles l’augmentent [26, 30, 34, 38, 54, 81, 82, 87].
Les différentes fibres solubles (y compris les amidons résistants) ne
se distinguent pas clairement les unes des autres par leurs effets,
àdeux exceptions près : les oligosaccharides et l’inuline, qui ont
régulièrement montrédes effets protecteurs [44, 91-97] et jamais
ABRÉVIATIONS :
AGCC : acides gras àchaîne courte
AOM : azoxyméthane
CC : cancer du côlon
CR : cancer du rectum
CCR : cancer colorectal
COX-2 : cyclooxygénase-2
DMAB : 3, 2’-diméthyl-4-aminobiphényle
DMH : 1, 2-diméthylhydrazine
FCA : foyers de cryptes aberrantes
FOS : fructooligosaccharide
IGF-1 : insulin-like growth factor 1
IQ : 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline
MNU : N-méthyl-N-nitrosourée
7OH-IQ : 7-hydroxy-2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline
OR : odds-ratio
PAF : polypose adénomateuse familiale
RR : risque relatif
Fibres et cancer colorectal
895
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/07/2015 par CHU de Nantes . (517211)

Tableau II.−Effets des fibres sur la cancérogenèse colique chimioinduite chez le rongeur.
Effects of fibers on chemically induced colon carcinogenesis in rodents.
Type de fibre Fibre, dose (% du régime) Espèce Cancérogène Période d’adm
on
des fibres Critères
observésEffet Références
Son de bléSon de blé4-30 % Rat DMH ou AOM I + P Tumeurs ↓25-36
ou DMAB 37
Son de blé15-40 % Rat DMH ou MNU I + P Tumeurs –30, 38, 39, 45
Son de blé20 % Rat DMH I + P Tumeurs ↑40
Son de blé4-20 % Rat AOM ou IQ I + P FCA ↓33, 35, 41- 43
Son de blédésamidonné8 % Rat AOM I + P FCA –44
Son de blé20 % Souris DMH I + P Tumeurs ↑45
Son de blémicrofibre 20 % Souris AOM I + P Tumeurs ↓46
Son de blé20-30 % Rat AOM I Tumeurs ↓47
Son de blé20 % Rat DMH I Tumeurs ↑40
Son de blé20 % Rat DMH P Tumeurs –40
Son de blé10-20 % Rat DMH P Tumeurs ↓39, 48, 49
Son de blé20 % Rat DMH P FCA ↓50
Son d’autres céréales Son de maïs enrichi en hémicellulose 4,5 % Rat DMH I + P Tumeurs –51
Son de maïs 15-20 % Rat DMH I + P Tumeurs ↑39, 52
Son de maïs 20 % Souris DMH I + P Tumeurs ↑45
Son de seigle 30 % Rat AOM I + P Tumeurs ↓53
Son d’orge 5 % Rat DMH I + P Tumeurs –ou ↓27, 28
Son d’orge 5 % Rat DMH P Tumeurs ↑28
Son d’avoine 6-10 % Rat DMH I + P Tumeurs ↑26, 34, 54
Son de riz ou de soja 20 % Rat DMH I + P Tumeurs –39
Son de soja 20 % Souris DMH I + P Tumeurs ↑45
Autres sources de
fibres Fibre de carotte 20 % Rat DMH I + P Tumeurs –38
Luzerne 20 ou 30 % Rat AOM I Tumeurs ↓47
Luzerne 15 % Rat MNU I + P Tumeurs ↑30
AOM I + P –
Fibre de betterave 20 % Rat DMH I + P Tumeurs –55, 56
ou I –
ou P –
Fibre de betterave 20 % Rat DMH I + P FCA ↓56-58
ou I ↓
ou P ↓
Psyllium 5-15 % Rat DMH ou AOM I + P Tumeurs ↓32, 64, 71
Psyllium 20 % Souris DMH I + P Tumeurs ↑ou –85
Fibre de café10 % Rat AOM I + P FCA ↓59
Pulpe d’orange 15 % Rat DMH I + P Tumeurs ↓60
Fibres insolubles
purifiées Cellulose 4,5-30 % Rat DMH ou AOM I + P Tumeurs ↓27, 47, 61-68
Cellulose 10-25 % Rat DMH I + P Tumeurs –54, 69-70
Cellulose 4,5-15 % Rat DMH P Tumeurs –ou ↓62, 71
Lignine autohydrolysée 7,5 % Rat DMAB I + P Tumeurs ↓52
Lignine 5 ou 10 % Rat DMH P Tumeurs –72
Parois subérisées (liège, p. de terre) 5 % Rat IQ I + P FCA ↓43
Fibres solubles
purifiées Pectine de pomme ou de citrus 10-20 % Rat DMH ou AOM ou
DMAB I + P Tumeurs ↓30, 31, 37,
73-75
Pectine 10 % Rat AOM I + P FCA ↓59
Pectine 15 % Rat DMH ou MNU I + P Tumeurs –30, 62
Pectine de citrus 6,5-10 % Rat DMH I + P Tumeurs ↑38, 54
Pectine peu ou trèsméthoxylée 5 % Rat DMH I Tumeurs ↑76
Pectine 10 % Rat DMH P Tumeurs ↓77, 78
Guar 15 % Rat DMH I + P Tumeurs ↓79
Guar 10 % Rat DMH I + P Tumeurs ↑26, 54
Guar 10 % Rat DMH P Tumeurs ↓77
Agar Souris DMH I + P Tumeurs ↑80
Carraghénane 6-15 % Rat DMH ou AOM ou
MNU I + P Tumeurs ↑81, 82
Carraghénane 2,5 % dans l’eau Rat AOM P FCA –ou ↑83, 84
Amidons résistants Amidon résistant de type 2 (maïs) 3 ou 10 % Rat DMH I + P Tumeurs –86
Amidon résistant de type 2 (pomme de terre)
15 % Rat DMH I + P Tumeurs
FCA ↑
↑87
Amidon résistant de type 3 (maïs) 20 % Rat AOM I + P FCA ↓44
Amidon résistant de type 2 (pomme de terre
ou maïs) Rat AOM ou DMH P FCA ↓88, 89
Amidon résistant de type 3 (maïs) 25 % Rat DMH I FCA –90
Oligosaccharides Fructooligosaccharide (FOS) 10 % Rat AOM I + P FCA ↓44, 91, 92
Inuline 10 % Rat AOM I + P FCA ↓91, 92
Galactooligosacharide (GOS) 5-27 % Rat AOM I + P Tumeurs ou FCA ↓93, 94
FOS 2 % Rat AOM P FCA –95, 96
FOS2%+bifidobactéries Rat DMH P FCA ↓95, 96
Inuline 5 % ou Rat DMH P FCA ↓97
inuline5%+bifidobactéries Rat DMH P FCA ↓97
DMH : 1,2-diméthylhydrazine ; AOM : azoxyméthane ; MNU : N-méthyl-N-nitrosourée ; DMAB : 3,2’-dimethyl-4-aminobiphenyl ; IQ : 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline ;
I : pendant ou avant et pendant l’administration du cancérigène ; P : aprèsl’administration du cancérigène ; I + P : pendant et après ou avant, pendant et aprèsl’administration
du cancérigène ; FCA : foyers de cryptes aberrantes ; —: pas d’effet des fibres ; ↓:lesfibres diminuent l’incidence et/ou le nombre et/ou la taille des tumeurs ou des FCA ; ↑:
les fibres augmentent l’incidence et/ou le nombre et/ou la taille des tumeurs ou des FCA.
P. Astorg et al.
896
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/07/2015 par CHU de Nantes . (517211)

d’effet aggravants, et les carraghénanes, qui, àl’inverse, ont
régulièrement montrédes effets promoteurs [81-84] et jamais
d’effets protecteurs. Dans les quelques travaux réalisés avec le
modèle chimique chez la souris, les fibres, solubles ou insolubles,
ont la plupart du temps un effet aggravant [45, 80, 85].
Effets des fibres sur les différentes phases
de la cancérogenèse (modèles chimiques)
Chez le rat, un régime à20 % de son de blé, donné
uniquement pendant la période d’administration de la DMH,
augmente parfois fortement le nombre de tumeurs du côlon par
rapport àun régime sans fibres (3 à4 fois plus de tumeurs) [40].
En revanche le son de bléadministréaprèslafindel’exposition à
la DMH exerce le plus souvent un effet protecteur [39, 48-50].
Certaines fibres solubles et très fermentescibles (gomme guar,
pectine, amidon résistant) qui ont des effets promoteurs ou
variables lorsqu’on les administre pendant la phase d’initiation
ou pendant tout le processus, ont un effet protecteur lorsqu’on les
administre uniquement en phase de post-initiation [77, 78, 88,
89]. Ces travaux montrent la possibilitéd’effets différents, voire
opposés, des fibres selon la phase de la cancérogenèse au cours
de laquelle on les administre dans les modèles chimiques. Il
peuvent expliquer en partie les résultats contradictoires obtenus
chez le rat lorsqu’on administre les fibres pendant toute la durée
du processus.
Effets des fibres sur la cancérogenèse intestinale
dans les modèles génétiques
Les quelques travaux réalisés dans les modèles génétiques
montrent des effets très variables des fibres. Les fructooligosac-
charides (FOS) diminuent l’incidence et le nombre des tumeurs du
côlon, alors que le son de bléet l’amidon résistant n’ont pas
d’effet, et qu’aucune de ces fibres ne modifie le nombre des
tumeurs du grêle [23]. Le son de seigle diminue l’incidence des
tumeurs du côlon ; le son de bléest sans effet, et le son d’avoine
et l’inuline ont tendance àaugmenter le nombre de tumeurs de
l’intestin grêle [98]. Deux autres travaux montrent des effets
aggravants des fibres dans ce modèle : l’amidon résistant de type
2 (pomme de terre + maïs) augmente le nombre de tumeurs de
l’intestin grêle, dans une souche ne présentant pas de tumeurs du
côlon [24] ; un régime riche en son de blé(10 %) et surtout un
aliment d’élevage riche en fibres (de céréales et de luzerne)
(18 %) augmentent l’incidence et le nombre des tumeurs du
côlon, alors que la gomme guar et la cellulose n’ont pas d’effet
sur les tumeurs du côlon, mais diminuent le nombre de tumeurs de
l’intestin grêle [99]. Il n’est pas possible de tirer une conclusion de
ces quelques résultats disparates : ici encore, selon les cas, les
fibres peuvent diminuer ou augmenter la cancérogénèse dans ce
modèle.
Conclusion
En conclusion, les résultats des nombreuses expérimentations
utilisant les modèles chimiques chez le rongeur frappent d’abord
par leur manque de cohérence : une même fibre peut avoir un
effet protecteur ou aggravant ou n’avoir pas d’effet [100]. Dans
ces modèles, la nature du cancérogène, la duréeetlapériode
d’exposition (initiation ou post-initiation) sont susceptibles de
rendre compte en partie de cette variabilité. Quelques tendances
peuvent cependant être discernées. Le son de bléest la source de
fibres qui a le plus régulièrement des effets protecteurs, mais il
peut être sans effet, et même avoir des effets aggravants, lorsqu’il
est administréuniquement pendant la période d’administration
du cancérigène. Les fibres insolubles et non fermentescibles :
cellulose, lignine, subérine ont un effet protecteur ou sont parfois
sans effet ; curieusement, le son de maïs, bien que très insoluble,
augmente la cancérogénèse colique. Les fibres solubles et
rapidement fermentescibles (y compris les amidons résistants) ont
des effets trèsaléatoires, souvent aggravants ; cependant,
comme le son de blé, elles ont presque toujours des effets
protecteurs lorsqu’on les administre uniquement en phase de
post-initiation [100], àl’exception des carraghénanes. Les
travaux réalisés avec les modèles génétiques ne clarifient pas
pour l’instant la question, sinon qu’il montrent la possibilité
d’effets aggravants des fibres même en l’absence d’interaction
avec un cancérogène. Au total, la diversitédes effets constatés
empêche de conclure àun effet protecteur des fibres dans leur
ensemble sur la cancérogenèse colique chimio-induite ou spon-
tanée chez le rongeur. Parmi les fibres testées, seuls les
oligosaccharides (y compris l’inuline) montrent régulièrement des
effets protecteurs (et jamais d’effets promoteurs), peut-être en
raison de leur effet prébiotique (voir plus loin). Les effets
aggravants souvent observés, notamment, mais pas uniquement,
avec les fibres fermentescibles, posent le problème de la
possibilitéde tels effets chez l’homme : tant que les mécanimes et
les conditions d’apparition de ces effets n’auront pas étéclarifiés,
il conviendra de rester très prudent dans la recommandation ou
la prescription de suppléments de fibres.
Etudes épidémiologiques
Depuis l’hypothèse initiale de Burkitt [7], différents types
d’études ont étéréalisés pour tester l’association entre les fibres
alimentaires et le CCR. La portée des résultats obtenus doit être
confrontée aux limites des protocoles utilisés. Ainsi, les études
écologiques examinent la relation entre la consommation d’un
facteur alimentaire —ici, les fibres —et la prévalence ou
l’incidence du CCR ou la mortalitépar CCR dans des populations
différentes, ou àdifférentes périodes pour une même population.
Toutefois, les faibles possibilitésd’ajustement sur les nombreux
facteurs de confusion en limitent l’interprétation. Les études
cas-témoin n’ont pas ces inconvénients, car elles peuvent éliminer
ou contrôler les facteurs de confusion connus ou potentiels. Leurs
plus sérieuses limitations sont d’une part le choix des témoins,
d’autre part la détermination rétrospective du régime alimen-
taire, sujette àerreurs qui peuvent différer selon que les sujets sont
des cas ou des témoins. Les études de cohortes, dans lesquelles
l’enregistrement des données alimentaires précède la survenue
de la maladie, évitent ces sources de biais. Cependant, la relative
imprécision des données alimentaires obtenues par autoques-
tionnaires a tendance àréduire la puissance de ces études. Les
recherches épidémiologiques sur les fibres et le CCR ont fait
l’objet de revues [8, 20, 101-103], dont deux récentes [8, 103].
Etudes écologiques
Parmi les études publiées (une trentaine), la plupart ont mis en
évidence une association inverse entre la consommation de fibres
ou d’aliments riches en fibres et le CCR [8, 101]. Quelques études
récentes méritent un intérêt particulier. Une comparaison interna-
tionale incluant des pays d’Amérique, d’Europe et d’Asie a fait
apparaître une corrélation inverse entre la consommation d’ali-
ments amylacésetl’incidence du CCR, qui pourrait peut-être
suggérer un effet protecteur de l’amidon résistant [104]. Toute-
fois, ce résultat n’a pas étéconfirmédans une étude portant sur
65 districts chinois, oùau contraire la consommation de riz et de
produits amylacés raffinésétait associéeàun risque plus élevéde
cancer du côlon [105]. Caygill et al. [106] ont recherchéles
relations entre la mortalitépar CCR et la consommation d’ali-
ments sources de fibres dans 28 pays, soit àla même période que
Fibres et cancer colorectal
897
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/07/2015 par CHU de Nantes . (517211)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%